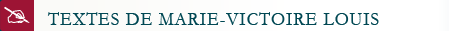Femmes
Extrait de l’Abécédaire féministe
À la recherche du patriarcat…
L’abécédaire féministe, profondément revu, comporte dorénavant 29.821 items et 24 rubriques : I. Culture (1244) ; II. Droit (473) ; III. Êtres humains (1.623) ; IV. Corps (776) ; V. Enfants (404) ; VI. Femmes (3.781) ; VII. Hommes (2.203) ; VIII. Relations entre êtres humains (1.101) ; IX. Famille (757) ; X. Féminismes (519) ; XI. Justice (1.137) ; XII. Langage (1.316) ; XIII. Patriarcat (945) ; XIV Penser (2041) ; XV. Politique (3.147) ; XVI. Pornographie (190) ; XVII. Proxénétisme (564) ; XVIII. « Sciences » sociales (961) ; XIX. Démographie (36) ; XX. Économie (1.381) ; XXI. Histoire (1.079) ; XXII. Sexes [Sexualité, Sexisme…] (339) ; XXIII. Violences (812) … et continuera d’évoluer.
* Ajout. Depuis le 11 juillet 2023. XXIV. Dialogues (2993)
21 novembre 2025
Cf. Hommes : https://www.marievictoirelouis.net/document.php?id=1205&mode=last
VI. Femmes
En noir. Nouveaux Items (et modifiés)
I. Femme : Femme La (1, 2, 3) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) ; Par ordre alphabétique ; Femme (Aragon Louis) ; Femme (« Assistante ») ; Femme (Avare) ; Femme (Aveuglement) ; Femme (« Avoir » une) ; Femme (« Au minimum ») ; Femme (« Bijou ») ; Femme (« Bon morceau ») ; Femme (« Bonne sœur») ; Femme (« Cadeau ») ; Femme (Caïn) ; Femme (« Castratrice ») ; Femme (« Charogne ») ; Femme (Chaste) ; Femme (« Chef d’œuvre ») ; Femme (« Cire ») ; Femme (« Cul ») ; Femme (« Culottée ») ; Femme (Culpabilité) ; Femme (D’Eaubonne Françoise) ; Femme (Définition) ; Femme (« Démodée ») ; Femme (« Dépendante ») ; Femme (Désespérée) ; Femme (Dickens Charles) ; Femme (Distraction) ; Femme (Effrontée) ; Femme (Égérie) ; Femme (Égoïsme) ; Femme (Elle) ; Femme (« Embonpoint ») ; Femme (« Emplette ») ; Femme (« Épave humaine ») ; Femme (« Étoffe ») ; Femme (Être) ; Femme (Expiation) ; Femme (Faire-valoir) ; Femme (« Fautive ») ; Femme (Fierté) ; Femme (« Flèche ») ; Femme (« Forteresse imprenable ») ; Femme (Franche) ; Femme (Freud Sigmund) ; Femme (« Fruit vert ») ; Femme (Gaie) ; Femme (« Idée ») ; Femme (« Gagne-pain ») ; Femme (« Garçonne ») ; Femme (Honneur) ; Femmes (Holocauste) ; Femme (Hugo Victor) ; Femme (« Idéale ») ; Femme (« Idiote ») ; Femme (« Imprenable ») ; Femme (« Infâme ») ; Femme (« Insatiable») ; Femme (« Instrument ») ; Femme (« Intérieur d’ ») ; Femme « Intouchable ») ; Femme (« Irresponsable ») ; Femme (« L’Encyclopédie ») ; Femme (Libération) ; Femme (Licence) ; Femme (Lily) ; Femme (Livres) ; Femme (Malade) ; Femme (« Manquée ») ; Femme (« Marchepied ») ; Femme (« Martyre chrétienne ») ; Femme (Masturbation) ; Femme (« Matière vivante ») ; Femme (« Mécanique ») ; Femme (« Météore ») ; Femme (Michelet Jules) ; Femme (Misère) ; Femme (Moi) ; Femme (« Morceau ») ; Femme (Nature) ; Femme (Naturalisée) ; Femme (« Négresse ») ; Femme (Nerveuse) ; Femme (« Occasion ») ; Femme (« On n’en a pas… ») ; Femme (« Os de seiche ») ; Femme (« Page blanche ») ; Femme (Pardon) ; Femme (« Pâte ») ; Femme (Paysage) ; Femme (Pensée) ; Femme (Portait) ; Femme (« Présent ») ; Femme (Procréation) ; Femme (« Pygmalion ») ; Femme (« Quelque chose ») ; Femme (Qu’une…) ; Femme (« Racée ») ; Femme (Racine) ; Femme (« Réceptacle ») : Femme (« Religion terrestre ») ; Femme (Renoncement) ; Femme (Résignée) ; Femme (Respectée) ; Femme (Ridicule) ; Femme (« Rocher ») ; Femme (« Rolls-Royce ») ; Femme (« Roue ») ; Femme (« Salade de fruit ») ; Femme (Secret) ; Femme (Sénèque) ; Femme (Sensibilité) ; Femme (« Sereine ») ; Femme (« Serrure ») ; Femme (« Soutenir ») ; Femme (Suicide) ; Femme (Suppliante) ; Femme (Taille) ; Femme (Territoire) ; Femme (Torturée) ; Femme (Trahison) ; Femme (« Tout-court ») ; Femme (« Tueuse ») ; Femme (« Une femme et un noir ») ; Femme (« Vendue ») ; Femme (« Vénéneuse ») ; Femme (Vérole) ; Femme (Vierge) ; Femme (Voltaire) ; (140)
II. Femmes (Artistes) : Par ordre alphabétique Abba (Marta) ; Actrices (1) Par ordre chronologique (1) ; Actrices françaises (d’antan) ; Adjani (Isabelle) ; Akerman (Chantal) ; Alain (Marie-Claire) ; Anémone ; Arbus (Diane) ; Ardant (Fanny) ; Arletty (1, 2, 3) ; Bacall (Lauren) ; Balzac (Honoré de) ; Barbara (1, 2, 3) ; Bardot (Brigitte) (1, 2, 3) ; Bell (Marie) ; Bellon (Yannick) ; Berganza (Teresa) ; Bernhardt (Sarah) (1, 2) ; Bonheur (Rosa) (1, 2) ; Boulanger (Nadia) ; Bourgeois (Louise) (1, 2) ; Callas (Maria) ; Capri (Agnès) (1, 2) ; Carol (Martine) ; Casarès (Maria) (1, 2) ; Célarié (Clémentine) ; Chanteuses algériennes (d’antan) ; Chanteuses françaises (d'antan) ; Clairon (Mademoiselle) (1, 2) ; Claudel (Camille) Par ordre chronologique (1, 2, 3) ; Claudel (Camille) / Rodin (Auguste) ; Cousturier (Lucie) ; Damia (1, 2) ; Dietrich (Marlène) (1, 2, 3) ; Dorval (Marie) ; Dubost (Paulette) ; Duc (Hélène) ; Duncan (Isadora) ; Dupré (Catherine, dite Mademoiselle de Seine) ; Duse (Eleonora) ; Fernandez (Esperanza) ; Ferrier (Kathleen) (1, 2) ; Feuillère (Edwige) ; Fontaine (Brigitte) ; Forestier (Sara) ; Foucher (Adèle) ; Fréhel ; Gardin (Blanche) ; Goya (Chantal) ; Giraud (Marie-Louise) ; Grimaud (Hélène) ; Guy (Alice) Par ordre chronologique (1, 2, 3) ; Holiday (Billie) ; Juliette ; Huppert (Isabelle) ; Kaplan (Nelly) (1, 2, 3) ; Kauffmann (Angelica) ; Khaltoum (Oum) ; Khalo (Frida) ; Malibran (Maria) ; Lecouvreur (Adrienne) ; Lens (Aline de) ; Lubin (Germaine) ; Magny (Colette) ; Mairesse (Valérie) ; Makeba (Myriam) ; Mercouri (Melina) ; Mergault (Isabelle) ; Messager (Annette) ; Monteiller (Chantal) (1, 2) ; Monroe (Marilyn) ; Moreno (Marguerite) ; Moreau (Yolande) ; Morisot (Berthe) ; Neel (Alice) ; Neher (Carola) ; Piaf (Édith) Par ordre chronologique (1, 2, 3) ; Presle (Micheline) ; Rama (Carol) (1, 2) ; Réjane ; Reinette l’Oranaise ; Rego (Paula) ; Renaud (Madeleine) (1, 2) ; Roget (Henriette) ; « Rockeuses » ; Saint Phalle (Niki de) (1, 2) ; Salomon (Charlotte) ; Sauvage (Catherine) ; Séraphine Louis (ou : Séraphine de Senlis) ; Seydoux (Laura) ; Seyrig (Delphine) (1, 2) ; Schumann (Clara) ; Solidor (Suzy) ; Sorel (Cécile) ; Streisand (Barbara [Barbra]) ; Sylvestre (Anne) ; Tailleferre (Germaine) ; Vaucaire (Cora) (1, 2) ; Varda (Agnès) Par ordre chronologique (1, 2, 3) ; Viardot (Pauline) (1, 2) ; Vigée-Lebrun (Élisabeth) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4) ; Yamina ; (139)
III. Femmes (Écrivaines) : Femmes (Écrivaines) (1, 2) ; Par ordre alphabétique Akhmatova (Anna) ; Allart de Méritens (Hortense) (1, 2) ; Aubenas (Florence) ; Audoux (Marguerite) ; Austen (Jane) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) ; Azzeddine (Saphia) ; Barthélémy-Madaule (Madeleine) ; Beck (Béatrix) ; Belot (Octavie) (1, 2, 3) ; Bernard (Catherine) ; Bespaloff (Rachel) ; Brontë (Charlotte) (1, 2) ; Brontë (Charlotte et Emily) ; Cardinal (Marie) (1, 2) ; Charles-Roux (Edmonde) ; Charrière (Isabelle de) ; Chauvet (Marie) (1, 2) ; Colet (Louise) (1, 2, 3, 4) ; Colette ; Colette (et Willy) (1, 2, 3) ; Compton-Burnett (Ivy) ; Delay (Florence) ; Delcourt (Marie) ; Desbordes-Valmore (Marceline) ; Dickinson (Emily) (1, 2) ; Dormoy (Marie) ; Eliot (George) ; Ferrante Elena) (1, 2) ; Fitzgerald (Zelda) ; Fouillée (Augustine) ; France Culture ; Graffigny (Françoise de) (1, 2, 3) ; Huber (Marie) ; Huch (Ricarda) ; Lagerlöf (Selma) ; Lambert (Madame de) (1, 2) ; Launoy (Marie-Catherine de) ; Mallet-Joris (Françoise) ; Malraux (Clara) ; Monnet (Anne-Marie) ; Montagu (Mary Mortley) ; Nothomb (Nathalie) ; O’Connor (Flannery) ; Pore[t]te (Marguerite) ; Rachilde (1, 2) ; Riccoboni (Marie-Jeanne) ; Radcliffe (Anne) ; Rochefort (Christiane) (1, 2) ; Roland (Madame) (1, 2, 3) ; Sablé (Madeleine de) ; Sainte-Soline (Claire) ; Sand (George) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) ; Sapienza (Goliarda) ; Sarraute (Nathalie) ; Ségur (Sophie de) ; Shelley (Mary) ; Staël (Germaine de) Par ordre chronologique (1, 2, 3) ; Torres (Tereska) ; Toussaint-Samson (Adèle) ; Tsvetaieva (Marina) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4) ; Vilmorin (Louise de) (1, 2, 3) ; Wharton (Edith) (1, 2) ; Wheatley (Phyllis) (1, 2) ; Wordsworth (Dorothy) ; (114)
IV. Femmes (Épouse (de) : Femmes (Épouses) (1, 2, 3, 4, 5) ; Par ordre alphabétique Agacinski (Sylviane) ; Agutte (Georgette) ; Arnault (Hélène) ; Aron (Suzanne) Par ordre chronologique (1, 2, 3) ; Bernanos (Jeanne) Par ordre chronologique (1, 2, 3) ; Beuve-Méry (Geneviève) ; Blanqui (Suzanne-Amélie) ; Bloy (Anne-Marie) ; Blum (Lise) Par ordre chronologique (1, 2, 3) ; Boudet (Paulette) ; Bourbon-Siciles (Marie-Amélie) ; Bourget (Minnie) ; Brossolette (Gilberte) ; Ceausescu (Elena) ; César ; Chirac (Bernadette) (1, 2) ; Claudel (Reine) ; Clésinger-Sand (Solange) ; Compton-Burnett (Ivy) (1, 2) ; Comtesse Almaviva ; Daudet (Julia) ; Derrida (Marguerite) (1, 2) ; Gaulle De (Yvonne) (1, 2, 3) ; Destouches (Lucette) Par ordre chronologique (1, 2, 3) ; Dolto (Françoise) ; Dreyfus (Lucie) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4) ; Duplantier (Raymond) ; Fillon (Penelope) (1, 2, 3) ; Freud (Martha) (1, 2, 3) ; Galese (Marie de) ; Gide (Madeleine) (1, 2, 3, 4, 5) ; Gisserot (Hélène) ; Gorbatchev (Raïssa) ; Gramsci (Iulca) ; Grave (Jean) ; Groult (Benoîte) ; Guérin (Marie) ; Guilloux (Renée) ; Hegel (Maria) ; Hitchcock (Alma) ; Hugo (Adèle) ; Janin (Adèle) ; Juppé (Isabelle) (1, 2) ; Kennedy (Jacqueline) ; Khrouchtchev (Nina) ; Kristeva (Julia) ; Kroupskaïa (Nadejda) (1, 2, 3, 4) ; Labori (Marguerite) ; Laclos (Marie-Solange de) ; Lang (Monique) ; Latour (Chantal) ; Lessing (Doris) ; Levasseur (Thérèse) ; Lévi-Strauss (Dina) (1, 2, 3) ; Linder (Ninette) ; Littré (Pauline) ; Maitron (Marcelle) ; Macron (Brigitte) (1, 2, 3) ; Malraux (André) ; Malraux (Clara) ; Mann (Katia) (1, 2, 3, 4, 5) ; Mauriac (Jeanne) ; Mauvillon (Madame) ; Marx (Jenny) (1, 2) ; Michelet (Athénaïs) (1, 2, 3, 4) ; Mitterrand (Danielle) ; Montaigne (Chassaigne Françoise de) ; Nietzsche (Friedrich) ; Orwell (George) ; Pasteur (Prénom inconnu) ; Péguy (Charlotte, Françoise) (1, 2, 3) ; (Épouses de) Policiers ; (Épouses de) Prisonniers politiques ; Pompidou (Claude) ; Poutine (Lioudmila) ; Quinet (Hermione) ; Reagan (Nancy) ; Régnier de (Marie) ; Rocard (Michèle) ; Roland (Madame) ; Rolland (Maria) ; Roosevelt (Eleanor) ; Roy (Tatiana) (1, 2) ; Ruiz (Valeria) ; Sinatra (Barbara) ; Soljenitsyne (Natalia) ; Stendhal ; Tirole (Nathalie) ; Tocqueville (Marie de) (1, 2, 3) ; Tolstoï (Sophie) (1, 2) ; Triolet (Elsa) ; Trotsky (Natalia) (1, 2, 3) ; Trump (Melania) ; Vaux de (Clotilde) ; Verlaine (Mathilde) ; Wilde (Constance) ; Woolf (Virginia) ; Zay (Madeleine) ; Zola (Alexandrine) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5) ; (156)
V. Femmes (Journalistes) : Femmes Journalistes (1, 2, 3) ; Par ordre alphabétique Adler (Laure) ; Broué (Caroline) (1, 2) ; Caster (Sylvie) ; (Fronde La) ; Gesbert (Patricia) ; Giroud (Françoise) Par ordre chronologique (1, 2, 3) ; Manceaux (Michèle) ; Ockrent (Christine) (1, 2) ; Saint-André (Alix de) ; Salamé (Léa) ; Sarraute (Claude) ; Taro (Gerda) Par ordre chronologique (1, 2, 3) ; (21)
VI. Femmes (Mères) : Femme (Mères) (1, 2, 3, 4, 5, 6) ; Par ordre alphabétique (Mères. Abderrhaim (Souad) ; (Mères. Aboulker (Isabelle) ; (Mères. Admirables ; (Mères. Akerman (Chantal) ; (Mères. Agout (Marie d’) ; (Mères. Agrippine ; (Mères. Aron (Raymond) ; (Mères. Assistance publique ; (Mères. Balzac (Honoré de) (1, 2, 3, 4) ; (Mères. Beaunez (Catherine) ; (Mères Bellil (Samira) ; (Mères. Berr (Hélène) ; (Mères. Blanqui Auguste) ; (Mères. Blum (Léon) ; (Mères. Brigitte ; (Mères. Burkhart Christiana) ; (Mères. Calamity Jane) ; (Mères. Capek Karel) ; (Mères. Catherine II) ; (Mères. Céline Louis-Ferdinand) (1, 2, 3, 4, 5) ; (Mères. Chaperons) ; (Mères. Charlotte de Prusse) ; (Mères. Chine (Début du XXème siècle) ; (Mères. Claudel Louise-Athanaïse) ; (Mères. Collin (Françoise) ; (Mères. Compton-Burnett Ivy) (1, 2, 3) ; (Mères. Darlan Eva) ; (Mères. D’Eaubonne Françoise) ; (Mères. De Gaulle Charles) ; (Mères. Degenfeld Louise de) ; (Mères. Dhavernas (Odile) ; (Mères. Duc d’Enghien) ; (Mères. Duncan Isadora) ; (Mères. Eichmann Adolf) ; (Mères. Emmanuelle Sœur) ; (Mères. Ferrante Elena) ; (Mères. Fillon Penelope) ; (Mères. Garde des enfants) ; (Mères. Giroud Françoise) ; (Mères. Goldoni Carlo) ; (Mères. Goncourt Edmond et Jules de) ; (Mères. G.P.A) ; (Mères. Halimi Gisèle) ; (Mères. Hugo Victor) (1, 2) ; (Mères. Kautsky Karl) ; (Mères. Kazan Elia) ; (Mères. Khalo Frida) ; (Mères. Klein (Mélanie) ; (Mères. Lacordaire Jean-Baptiste Henri) ; (Mères. Léautaud Paul) ; (Mères. Lefebvre Catherine) ; (Mères. Le Goff Jacques) ; (Mères. Le Pen Marine) ; (Mères. Lessing Doris) ; (Mères. Levasseur Thérèse) ; (Mères. Marie-Antoinette) ; (Mères. Marivaux) (1, 2, 3) ; (Mères. Mountbatten Edwina) ; (Mères. « Martyres ») ; (Mères. Mauriac François) (1, 2) ; (Mères. Monde (Le) ; (Mères. Monica) ; (Mères. Napoléon Par ordre chronologique (1, 2, 3) ; (Mères. Oldenbourg Zoe) ; (Mères. Péguy Charles) ; (Mères. Rilke Rainer Maria) ; (Mères. Rocancourt Christophe) ; (Mères. Roosevelt Eleanor) ; (Mères. Rougeot André) ; (Mères. Rousseau (Jean-Jacques) (1, 2, 3) ; (Mères. Roussel Nelly) ; (Mères. Sackville-West Lady) ; (Mères. Sacrifiées) ; (Mères. Sand George) (1, 2, 3, 4, 5, 6) ; (Mères. Schumann Clara) ; (Mères. Servan-Schreiber Denise) ; (Mères. Sévigné Madame de) ; (Mères. Staël Germaine de) (1, 2) ; (Mères. Simenon Georges) ; (Mères. Staline Joseph) ; (Mères. Tchékhov Anton) ; (Mères. Tolstoï Léon) (1, 2) ; (Mères. Thatcher Margaret) ; (Mères. Tristan Flora) ; (Mères. Vernes Jules) ; (Mères. Voltaire) ; (Mères. Zola Émile) (1, 2) ; (118)
VII. Femmes (Nom) : Femmes (Nom) (1, 2, 3, 4, 5, 6) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) ; Femmes (Prénom) (1) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) ; (59)
VIII. Femmes (« Politiques ») : Femmes (Politiques) ; Femmes (Politiques) ; Par ordre alphabétique Addams (Jane) ; Alliot-Marie (Michèle) (1, 2) ; Aubry (Martine) (1, 2, 3) ; Autain (Clémentine) (1, 2) ; Barèges (Brigitte) ; Batho (Delphine) (1, 2) ; Benghabrit (Nouria) ; Bhutto (Benazir) ; Bouchardeau (Huguette) ; Colette ; Coutelle (Catherine) ; Cox (Jo) ; Cresson (Édith) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4) ; Dati (Rachida) (1, 2, 3) ; Duflot (Cécile) ; Fraisse (Geneviève) ; Garaud (Marie-France) ; Giroud (Françoise) (1, 2, 3) ; Guigou (Élisabeth) ; Joly (Eva) ; Kosciusco-Morizet (Nathalie) ; Kustener (Brigitte) ; Lagarde (Christine) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5) ; Lepage (Corinne) ; Le Pen (Marine) ; Lienemann (Marie-Noëlle) ; Macron (Brigitte) (1, 2, 3, 4) ; Maréchal (Marion) (1, 2) ; Mégret (Catherine) ; Ministres ; Panafieu (Françoise de) ; Panot (Mathilde) ; Pau-Langevin (George) ; Pécresse (Valérie) (1, 2, 3) ; Pelletier (Monique) (1, 2) ; Pénicaud (Muriel) ; Piat (Yann) ; Pompadour (Madame de) ; Radjavi (Maryam) ; Roudy (Yvette) ; Royal (Ségolène) Par ordre chronologique (1, 2, 3) ; Rudd Amber ; Saunier-Seïté (Alice) ; Schiappa (Marlène) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77) ; Sid Cara (Nafissa) (1, 2) ; Suzman (Helen) ; Taubira (Christiane) ; Thatcher (Margaret) (1, 2) ; Vautrin (Catherine) ; Veil (Simone) (1, 2) ; Warren (Elizabeth) ; Weiss (Louise) ; Zana (Leyla) (1, 2) ; (161)
IX. Femmes (Remarquables) : Femme « Remarquables » ; Par ordre alphabétique Albaret (Céleste) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4) ; Ambapali ; Antigone ; Arthaud (Florence) ; Aubrac (Lucie) ; Avila (Thérèse d’) (1, 2, 3, 4, 5) ; Ayoub (Mouna) ; Ballabanoff (Angelica) ; Baker (Joséphine) (1, 2) ; Barín Kobané ; Bashkirtseff (Marie) (1, 2) ; Bellil (Samira) ; Benziane (Sohane) ; Bettignies (Louise de) ; Bidault (Suzanne) ; Bigillion (Victorine) ; Binet (Sophie) ; Blixen (Karen) ; Boadicée (Reine) ; Bonaparte (Marie) ; Bonaparte (Mathilde) ; Boudicca ; Bourlier (Colette) ; Bovy (Berthe) ; Budde (Marianne) ; Catherine de Bourbon ; Catherine II ; Cavell (Edith) ; Ceaușescu (Elena) ; Christine de Suède (1, 2, 3) ; Clerc (Thérèse) ; Cléopâtre ; Colliard (Lucie) (1, 2) ; Collombel-Pagnol (Joséphine-Marie) ; Colman (Lucy) ; Curie (Marie) ; Craven (Elisabeth) ; D’Agoult (Marie) (1, 2) ; Daschkoff Princesse ; Daubresse (Marie) ; David-Neel (Alexandra) ; Davis (Angela) ; Decker (Marie-Laure de) ; De Cleyre (Voltairine) (1, 2) ; Djoumbé (Fatouma Soundi) ; Delange (Frédérique) ; Demuth (Hélène) ; Denis (Marie-Louise) ; Desroches Noblecourt (Christiane) (1, 2) ; Desrumaux (Martha) ; Dooh Bunya (Lydie) ; Dourova (Nadejda) (1, 2) ; Drouet (Juliette) (1, 2) ; Du Deffand (Madame) (1, 2) ; Du Châtelet (Émilie) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5) ; Dulac (Geneviève) ; Duncan (Isadora) ; Élisabeth de Bohème (1, 2, 3) ; Eltahawy (Mona) ; Eve ; Fallaci (Oriana) (1, 2) ; Faye (Safi) ; Ferrand (Élisabeth) ; Galigaï (Eleonora) ; Gellhorn (Martha) (1, 2, 3) ; Goldman (Emma) ; Gorbanevskaïa (Natalia) ; Grouzdieva (Olga) ; Halimi (Gisèle) ; Hébuterne (Jeanne) ; Hemmings (Sally) ; Hepburn (Katharine) ; Herman (Liselotte) ; Hessel (Helen) ; Holiday (Billie) ; Humbert (Thérèse) ; Jablonowska (Maria Anna Louisa) ; Jacquemart (Justine) ; Jeanne d’Arc ; Jesenskà (Milena) (1, 2, 3) ; Kahina (La) (1, 2) ; Kautsky (Louise) ; Kerviel (Madame) ; Kiki de Montparnasse ; Klarsfeld (Beate) ; Kollontaï (Alexandra) ; Kowalewski (Sofia, Sophie, Sonia) ; Labourbe (Jeanne) ; Lacasse (Victoire) ; Lachaux (Melle de) ; Lacoin (Élisabeth) (1, 2) ; Lafargue (Laura) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4) ; Lagroua-Weil-Hallé (Marie-Andrée) ; La Rochejaquelein (Madame de) ; La Vallière (Madame de) ; (Lavoisier Marie-Anne Pierrette) ; Lefèvre Dacier (Anne) (1, 2) ; Lefort (Gertrud von) ; Leguay (Catherine) ; Léo (André) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4) ; Lespinasse de (Julie) ; Levasseur (Thérèse) (1) Par ordre chronologique (1, 2, 3) ; Lou Andreas Salomé (1, 2, 3) ; Luxemburg (Rosa) (1, 2, 3) ; Luxemburg (Rosa) & Zetkin (Clara) ; Macciocchi (Maria. A) ; Madame Simone ; Maier (Vivian) ; Mallet (Isabelle) ; Manchu (Rigoberta) ; Marie ; Mademoiselle Mars ; Mère Teresa (1, 2) ; Michel (Louise) (1, 2) ; Missy (Mathilde de Morny) ; Mladic (Anna) ; Monica ; Monnier (Adrienne) (1, 2, 3) ; Morawiecki (Laurence) ; Morgenstern (Sophie) ; Morris (Violette) (1, 2) ; Mota (Gisela) ; Necker (Suzanne) ; Nehru (Indira) ; Nin (Anaïs) ; Ninon de Lenclos (1, 2) ; Noailles (Anna de) (1, 2) ; Noël (Marie) (1, 2) ; Pahlavi (Farah) ; Marquise de Païva ; Parks (Rosa) ; Pascal (Jacqueline) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4) ; Pathé (Odile) ; Paz (Magdeleine) Par ordre chronologique (1, 2, 3) ; Pechkova [Ekaterina Pavolvna] ; Pencalet (Joséphine) ; Peron (Evita) ; Perrot (Michelle) ; Pingeot (Anne) (1, 2, 3) ; Pirogova (Anna Stépanovna) ; Pizzey (Erin) ; Phoolan Devi (1, 2) ; Planiol (Thérèse) ; Pougy (Liane de) ; Prédine (Françoise) ; Price (Leontyne) ; Rachel ; Rand (Ayn) ; Réal (Grisélidis) ; Récamier (Juliette) ; Rendu (Sœur Rosalie) ; Reverdy (Michelle) ; Riccoboni (Marie-Jeanne) ; Riffaud (Madeleine) ; Robert (Marthe) ; Roland (Pauline) ; Romilly Jacqueline de (1, 2) ; Rondeaux (Madeleine) ; Roosevelt (Eleanor) (1, 2) ; Rothschild (Gudule) ; Roussopoulos (Carole) ; Rykiel (Sonia) ; Saartjie Baartman ; Salomé ; Sand (George) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5) ; Satrapi (Marjane) ; Schloss (Simone) ; Schopenhauer (Adèle) ; September (Dulcie) ; Séverine ; Sharawi (Huda) ; Sophie ; Souvestre (Marie) ; Spiridonova (Maria) ; Staël (Germaine de) Par ordre chronologique (1, 2, 3) ; Stein (Édith) ; Sullerot (Évelyne) ; (Suze de la Henriette) ; Sylvestre (Anne) ; Tabouis (Geneviève) ; Taratouta (Olga) ; Thiam (Awa) ; Tillion (Germaine) ; Tomyris ; Traoré (Assa) ; Tristan (Flora) ; Vaillant-Couturier (Marie-Claude) ; Verny (Françoise) (1, 2) ; Vida (Movahed, Narges Hosseini…) ; Viollis (Andrée) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5, 6) ; Voronianskaïa (Élisabeth) ; Walentynowicz (Anna) ; Weil (Simone) (1, 2) ; Woodhull (Victoria) ; Zassoulitch (Véra) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4) ; (281)
X. Femmes : Femmes (1, 2, 3, 4, 5, 6) ; Par ordre alphabétique Femmes (Abaissement) ; Femmes (Abêtissement) (1, 2, 3) ; Femmes (« Abandonnées) ; Femmes (Achat / Vente) (1) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) ; Femmes (Accouchements) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) ; Femmes (Adultère) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) ; Femmes (Africaines) ; Femmes (Âge) ; Femmes (Âgées) (1, 2) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) ; Femmes (Agricultrices) ; Femmes (Aiguilles) (1, 2) ; Femmes (Aimables) ; Femmes (Alibis) ; Femme (Aliénées) (1) Par ordre chronologique (1, 2) ; Femmes (Allaitement) ; Femmes (Alcoolisme) (1, 2) ; Femmes (Algériennes) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4) ; Femmes (Anarchistes individualistes) ; Femmes (« anciennes ») (1, 2, 3) ; Femmes (Amants) (1, 2, 3, 4, 5) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) ; Femmes (Ambition) ; Femmes (Amies) (1, 2) Par ordre chronologique (1) ; Femmes (Amoureuses) (1) Par ordre chronologique (1) ; Femmes (Animalisation) (1) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,) ; Femmes (Apparence) (1) Par ordre chronologique (1, 2, 3) ; Femmes (Appel de Coluche) ; Femmes (Arpètes) ; Femmes (Assassinées) ; Femmes (Assassinées. Chateaubriand François-René de) ; Femmes (Assassinées, violées, harcelées, battues) (1, 2) ; Femmes (Assises) ; Femmes (« Asservies ») ; Femmes (Attirance pour les hommes courageux) ; Femmes (Attirance pour les hommes ‘forts’) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4) ; Femmes (Attirance pour les hommes incarnant des idées progressistes) ; Femmes (Attirance pour les hommes politiques) ; Femmes (« Attachées ») (1, 2) ; Femmes (Autisme) ; Femmes (Autodéfense) ; Femmes (Avortements) (1) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) ; Femmes (Bagnes) ; Femmes (Balzac Honoré de) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) ; Femmes (« Bas-bleus ») (1) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) ; Femmes (« Battues ») (1) Par ordre chronologique (1) ; Femmes (Beauté) (1, 2) Par ordre chronologique (1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29) ; Femmes (Bégueules) (1, 2) ; Femmes (Besoin d’être aimées) ; Femmes « Bêtes ») (1, 2) ; Femmes (Biens) (1, 2, 3, 4) ; Femmes (Bijoux) ; Femmes (« Bonnes-à-tout-faire », employées-de-maison, gouvernantes, femmes-de-chambre, femmes-de-ménage, femmes-de-peine, femmes-de-charge, femmes-de-journée, filles-de-cuisine…) (1, 2, 3, 4) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) ; Femmes (« Bons Pasteurs ») ; Femmes (Bouleversées) ; Femmes (Bourgeoises) (1, 2 ,3) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) ; Femmes (« Bouquets ») (1, 2, 3) ; Femmes (« Bouteilles ») (1, 2) ; Femmes (« Cause de trouble ») ; Femmes (Catholiques) ; Femmes (Charité) (1) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) ; Femmes (« Cent millions deux fois ») ; Femmes (Chefs) ; Femmes (Chômage) ; Femmes (« Chevaux ») ; Femmes (« Chiennes ») ; Femmes (Choix) ; Femmes (« Choses ») (1, 2, 3, 4, 5, 6) ; Femmes (« Chouchoutes ») ; Femmes (CICR. Comité international pour la Croix Rouge) ; Femmes (Cigarettes (1, 2) ; Femmes (« Cocottes ») ; Femmes (Colère) (1, 2, 3) ; Femmes (Comment faire disparaître les femmes ?) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47) ; Femmes (Comment faire disparaitre les hommes) (1, 2) ; Femmes (Comment meurent les femmes ?) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64) ; Femmes (Commune La) (1, 2) ; Femmes (« Communes à tous ») (1, 2) ; Femmes (Communisme. Soviétique) ; (Communistes) (1, 2) ; Comparaison entre femmes Par ordre alphabétique (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) ; Femmes (Comparaison entre femmes. Voltaire) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28) ; Femmes (Compétences politiques) (1, 2) ; Femmes (« Comptes ») ; Femmes (Concurrence entre femmes) (1) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) ; Femmes (Confucius) ; Femmes (« Connasses ») ; Femmes (Conscience de classe. Aristocratie) (1, 2, 3) ; Femmes (Conscience de classe. Bourgeoisie) ; Femmes (Conscience de classe. Ouvrière) ; Femmes (Conscience de classe. Absence de) ; Femmes (« Consentantes ») ; Femmes (« Contemplatives ») ; Femmes « Convenances » (1) Par ordre chronologique (1) ; Femmes (« Coquettes ») Par ordre chronologique (1, 2, 3) ; Femmes (« Coût ») (1, 2, 3) ; Femmes (« Créatures ») (1, 2, 3) ; Femmes (Criminelles) ; Femmes (Culpabilité) ; Femmes (« de chambre ») (1, 2) ; Femmes (« de pouvoir ») ; Femmes (« Défaite historique ») ; Femmes (« Défense des femmes ») ; Femmes (« Délicates ») ; Femmes (Dénis) ; Femmes (Dénis de grossesse) (1, 2) ; Femmes (Dentellières) ; Femmes (Dépendantes) ; Femmes (Déportées dans les camps Staliniens) ; Femmes (Devenir une femme) (1) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) ; Femmes (Dévouement) (1) Par ordre chronologique (1, 2, 3) ; Femmes (« D’exception ») (1, 2) Par ordre chronologique (1) ; Femmes (Diderot Denis) ; Femmes (Dignité) (1, 2, 3) ; Femmes (« Distinguées ») (1) Par ordre chronologique (1) ; Femmes (Dons) (1, 2, 3) ; Femmes (Dots) ; Femmes (« Dures ») (1, 2) ; Femmes (Échange des femmes) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) ; Femmes (Écrits de femmes lus par des hommes) ; Femmes (Église catholique) ; Femmes (« Embarras intimes ») ; Femmes (Embryons) (1, 2, 3) ; Femmes (Émotions) ; Femmes (« Émouvantes ») ; Femmes (Enceintes) (1, 2, 3) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) ; Femmes (Enfants) ; Femmes (Enfants Et) ; Femmes (Enfermées) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) ; Femmes (Enterrement) ; Femmes (« Entremetteuses ») (1, 2, 3) ; Femmes (« Entretenues ») ; Femmes (Épisodes) ; Femmes (Esclaves) (1) Par ordre chronologique (1, 2, 3) ; Femmes (Esclavage) ; Femmes (« Espèce ») (1) ) ; Femmes (Espérance) ; Femmes (Espionnes) ; Femmes (Esprit de contradiction) ; Femmes (Estime) ; Femmes (Et) ; Femmes (État) ; Femmes (Êtres humains) (1, 2) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4) ; Femmes (Excréments) ; Femmes (Expériences) ; Femmes (« Face cachée des hommes ») ; Femmes (« Faciles ») (1, 2) ; Femmes (« Faibles ») (1) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) ; Femmes (Fausses-couches) ; Femmes (« Favorites » des rois) ; Femmes (« Femelles ») (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) ; Femmes (« Féminin ») (1, 2, 3) Par ordre chronologique (1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) ; Femmes (Féminisation); Femmes (Femmelettes) ; Femmes (« Figures féminines ») ; Femmes (« Fil à la patte ») ; Femmes (« Filles ») (1) Par ordre chronologique (1, 2, 3) ; Femmes (« Filles de la charité ») ; Femmes (« Filles-Mères ») ; Femmes (« Flacons ») ; Femmes (Fleurs) (1, 2) ; Femmes (« Folie ») (1, 2, 3) Par ordre chronologique (1, 2) ; Femmes (Fonctions) ; Femmes (Fond de décor) ; Femmes (Formation) (1, 2) ; Femmes (« [un] formidable moteur scénaristique et un accélérateur émotionnel ») ; Femmes (« au Foyer ») (1) Par ordre chronologique (1) ; Femmes (Fortes) (1, 2, 3) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4) ; Femmes (Fouque Antoinette) ; Femmes (« Fragiles » et/ou « vulnérables ») (1, 2) ; Femmes (Françaises) (1, 2) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4) ; Femmes (« Frigides ») (1) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5) ; Femmes (« Froides ») (1, 2) ; Femmes (Frontières) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) ; Femmes (Fumier) ; Femmes (Fusils) (1, 2, 3) ; Femmes (« Gentilles ») (1, 2) ; Femmes (Ghiliak) ; Femmes (« Gibier ») ; Femmes (Gitanes) ; Femmes (Gloire) (1, 2) ; Femmes (Grands-mères) ;Femmes (Grégoire Ménie) (1, 2) ; Femmes (« Grisettes ») (1) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4) ; Femmes (« Grosses ») ; Femmes (Grève) ; Femmes (Grossesses) ; Femmes (« Gueuses ») ; Femmes (Hardies) ; Femmes (« Héroïnes ») (1) Par ordre chronologique (1, 2) ; Femmes (Heureuses) (1) Par ordre chronologique (1) ; Femmes (Hiérarchie. Entre elles) (1, 2) ; Femmes (« Hommasses ») (1, 2, 3, 4, 5) ; Femmes (« Honnêtes et courageuses ») ; Femmes (« Horizontales ») ; Femmes (Humbles) (1, 2) ;Femmes (Humour) (1, 2, 3, 4) ; Femmes (« Hystériques ») (1) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5, 6) ; Femmes (Identités) ; Femmes (Images d’elles-mêmes) ; Femmes (Imaginaire) ; Femmes (Impuissantes) ; Femmes (Infantilisation) ; Femmes (« Inactives ») ; Femmes (Infirmières) (1, 2) ; Femmes (Inuits) ; Femmes (« Intellectuelles ») (1) Par ordre chronologique (1, 2, 3) ; Femmes (Intelligentes) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) ; Femmes (Jalouses) (1, 2, 3) ; Femmes (Jeunes filles) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) ; Femmes (Jolies) (1, 2) ; Femmes (Jouir) ; Femmes (Khmers rouges) ; Femmes (Lâcheté) ; Femmes (Lesbiennes) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28) ; Femmes (Lesbiennes assimilées aux ‘gays’) (1, 2) ; Femmes (de Lettres) ; Femmes (Licenciées) (1, 2) ; Femmes (Lits) (1, 2) ; Femmes (Livres) ; Femmes (Luttes) ; Femmes (« Machines ») (1, 2, 3, 4, 5) ; Femmes (Maison) (1, 2, 3) ; Femmes (« Maîtresses ») (1, 2, 3) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5, 6) ; Femmes (« Maîtresses de maison ») (1) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4) ; Femmes (« Mal baisées ») ; Femmes (Malédiction) ; Femmes (Malheureuses) (1, 2) ; Femmes (« Manager » de femmes) ; Femmes (Mannequins (1) Par ordre chronologique (1, 2, 3) ; Femmes (Maquillage) (1, 2) Par ordre chronologique (1, 2) ; Femmes (« Marchandise ») (1, 2) ; Femmes (« Market women ») ; Femmes (Masochisme) (1, 2, 3) ; Femmes (« Matelas ») ; Femmes (« Médaille des évadés ») ; Femmes (« Même les femmes ») (1, 2) ; Femmes (Ménagères) ; Femmes (Ménopause) ; Femmes (Menteuses) (1, 2) ; Femmes (Mépris) ; Femmes (Métier) (1, 2) ; Femmes (Meubles) ; Femmes (Mineures. George Sand) ; Femmes (Miroir) ; Femmes (« Misérables ») ; Femmes (Mission) ; Femmes (« Mission historique ») ; Femmes (« Moches ») (1, 2) ; Femmes (Mode) (1) Par ordre chronologique (1) ; Femmes (Modèles) (1, 2) ; Femmes (Modestes) (1, 2, 3) ; Femmes (« du Monde ») (1, 2, 3, 4, 5, 6) ; Femmes (« Mulets ») ; Femmes (Muses) (1, 2) ; Femmes (Naïves) ; Femmes (Nationalisme) (1, 2) ; Femmes (Naturalisation) ; Femmes (Nazisme) (1, 2, 3, 4, 5, 6) ; Femmes (Nombre) ; Femmes (« Nounous ») ; Femmes (Nourrices) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) ; Femmes (« Nous les femmes ») (1, 2) ; Femmes (Nues) (1, 2) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5) ; Femmes (« Nulles ») ; Femmes (« Objets ») (1, 2) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4) ; Femmes (« Oies blanches ») ; Femmes (ONU. Commission de la condition de la femme) ; Femmes (Orgasme) (1) Par ordre chronologique (1) ; Femmes (Ouvrières) ; Femmes (Orgueil) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5, 6) ; Femmes (Originales) ; Femmes (« Ornements [décoratifs] ») Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49) ; Femmes (Paraître) ; Femmes (Parcours) ; Femmes (Paresseuses) ; Femmes (Paroles) (1, 2) Par ordre chronologique (1) ; Femmes (Partage des femmes) (1, 2) ; Femmes (« Partie noble de l’humanité ») ; Femmes (Pas ennemies des hommes) ; Femmes (Paternité) ; Femmes (Paysannes) ; Femmes (Peine de mort) (1) Par ordre chronologique (1, 2) ; Femmes (« Perdues ») (1, 2) Par ordre chronologique (1) ; Femmes (Perte de temps) ; Femmes (« Petites mains ») (1, 2, 3) ; Femmes (« Pétroleuses ») (1, 2) ; Femmes (Peurs) (1, 2) Par ordre chronologique (1, 2, 3) ; Femmes (Pionnières (1, 2, 3) ; Femmes (« Pipelettes ») ; Femmes (« Pisseuses ») ; Femmes (« Plafond de verre ») (1, 2, 3) Par ordre chronologique (1, 2, 3) ; Femmes (Plaisir) (1, 2) Par ordre chronologique (1, 2) ; Femmes (Plantes) ; Femmes (dites « à-plateaux ») (1, 2) ; Femmes (Pleurs) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28) ; Femmes (Plus de femmes) (1, 2, 3) ; Femmes (Potentiel) ; Femmes (Pour Le Monde) (1, 2) ; Femmes (Pour Libération) ; Femmes (Poussette) ; Femmes (Pouvoirs sur les hommes) (1, 2) ; Femmes (« Précaires ») ; Femmes (« Préférées ») ; Femmes (Priorité) ; Femmes (« Propriétés des hommes ») (1, 2) ; Femmes (« Propriété morale des femmes ») ; Femmes (Protéger) (1) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5) ; Femmes (Pudeur) ; Femmes (« Puritaines ») (1) Par ordre chronologique (1) ; Femmes (Quantité) ; Femmes (« Quantité négligeable ») ; Femmes (Quartiers populaires aux périphéries des villes ; Femmes (« Quitter un homme ») (1) Par ordre chronologique (1) ; Femmes (Rebelles) ; Femmes (« Rebuts ») ; Femmes (Regards) ; Femmes (Règles) (1) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53) ; Femmes (Reines) ; Femmes (Religieuses) (1, 2) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) ; Femmes (Renard Jules) ; Femmes (Réparations dues aux femmes) ; Femmes (« Repos du guerrier ») ; Femmes (« Repoussoir ») ; Femmes (« Réputation ») (1, 2) ; Femmes (Respect) ; Femmes (Résistantes) (1, 2, 3) ; Femmes (Retraites) ; Femmes (Revanches) (1, 2, 3) ; Femmes (Révolution française) ; Femmes (Rideaux) ; Femmes (Rien) (1) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4) ; Femmes (Rousseau Jean-Jacques) ; Femmes (Russie. 1928) ; Femmes (Salaires) (1, 2) ; Femmes (Salons) ; Femmes (Salopes) (1, 2) ; Femmes (Sand George) (1, 2) ; Femmes (Saoudiennes) (1, 2) ; Femmes (Secrétaires) ; Femmes (Scientifiques) ; Femmes (« Séduisantes ») ; Femmes (Sensibles) (1, 2) ; Femmes (Sentiments) ; Femmes (Servantes) (1, 2, 3) ; Femmes (« Seules ») (1, 2, 3, 4, 5, 6) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) ; Femmes (Sexes [...]) ; Femmes (Shakespeare) ; Femmes (Sicile. Années [19]50) ; Femmes (Sida) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) ; Femmes (Sida. Risques) ; Femmes (Silence) (1, 2, 3, 4, 5) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5) ; Femmes (Solidaires) (1) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5) ; Femmes (Sororité) (1, 2, 3) Par ordre chronologique (1, 2, 3) ; Femmes (Sorcières) (1, 2) ; Par ordre chronologique Femmes (« Sottes ») (1, 2, 3) ; Femmes (Souffrance) (1, 2) Par ordre chronologique (1, 2) ; Femmes (Statut) ; Femmes (Stendhal) ; Femmes (S.T.O) ; Femmes (« Supérieures ») ; Femmes (Symboles (1, 2, 3) ; Femmes (Syndicalistes) ; Femmes (Syphilis) ; Femmes (Tabliers) ; Femmes (Tact) (1, 2) ; Femmes (« Taxi girls ») ; Femmes (Tempérament) (1, 2) ; Femmes (« Terrain ») ; Femmes (« Thés de femmes ») ; Femmes (« Tire-bottes ») ; Femmes (Tocqueville Alexis de) ; Femmes (« Tombées ») ; Femmes (« Tondues » à la Libération) (1, 2, 3, 4) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) ; Femmes (Traitées de « putes ») ; Femmes (Traitées grossièrement) ; Femmes (Travail) (1) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28) ; Femmes (Travail-dit-ménager [ou domestique) (1, 2, 3, 4) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) ; Femmes (Tricot) ; Femmes (« Trompées ») (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) ; Femmes (Trotsky) ; Femmes (Utiles) ; Femmes (Valeur) (1, 2) ; Femmes (Validité des jugements sur…) ; Femmes (« Valises ») ; Femmes (Variables d’ajustement) ; Femmes (« Vénales ») (1, 2, 3) ; Femmes (Vengeances) (1, 2, 3) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) ; Femmes (« Vente ») ; Femmes (Vertu) (1, 2) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5, 6) ; Femmes (Veuves) (1, 2, 3, 4, 5) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42) ; Femmes (Vies des femmes) (1, 2, 3) Par ordre chronologique (1) ; Femmes (Victimes) (1, 2, 3) ; Femmes (« Vieilles filles ») (1, 2) ; Femmes (Vieillesse) ; Femmes (Violées. Zoo) ; Femmes (« Voilées ») (1, 2, 3, 4, 5) Par ordre chronologique (1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) ; Femmes (Volcans) ; Femmes (Volonté) ; Femmes (Voltaire) ; Femmes (Yeux fermés) ; (2555)
XI. Femmes /Hommes (Comparaison) : Femmes / Hommes (Comparaison) (1, 2) ; Par ordre alphabétique Arletty ; Astell (Mary) ; Balzac (Honoré de) (1, 2, 3) ; Confiance ; Conte (Paulo) ; Corneille (1, 2) ; Cossery (Albert) ; David-Neel (Alexandra) ; Dhavernas (Odile) ; Diderot (Denis) ; Dostoïevski (Fiodor) ; Eliot (George) ; Flaubert (Gustave) ; Finkielkraut (Alain) ; Gentz (Friedrich) ; Giacometti (Alberto) ; Goncourt (Edmond et Jules de) ; La Bruyère (Jean de) ; La Fontaine (Jean de) ; Marquez (Gabriel García) ; Novalis ; Obama (Barak) ; Pivot (Bernard) ; Prévert (Jacques) ; Prévost (Antoine François) ; Robert (Paul) ; Sévigné (Madame de) ; Société des membres de la Légion d’honneur ; Thackeray (William Makepeace) ; (34)
21 novembre 2025. 3781 items
I. Femme :
Femme (1) : Il ne suffit ni de naître « femme », ni de devenir « femme » ; encore faut-il s’interroger, et en découvrir - progressivement - les incidences, les conséquences politiques du fait d’être une femme.
Femme (2) : 1983. Françoise Collin [1928-2012], auteure de :
« Je suis une femme, mais ‘je’ n’est pas une femme. »
Valable aussi pour : « féministe », pour « femme [qualifiée de, considérée comme, se définissant comme] lesbienne » … 1
La question peut et doit être prolongée : Qu’est-ce que signifie : « je » [soi], « une femme », « des femmes », « être », « lesbienne » autant de termes, autant de qualificatifs, de questions qui peuvent, qui doivent, alors se complexifier à leur tour. (Cf. Patriarcat)
Femme (3) : Une femme qui n’est ni une amante, ni une mère est-elle, encore ? déjà ? une femme ? Beaucoup, sans se poser la question, en ont douté. (Cf. Femmes. Devenir une femme)
Par ordre chronologique. Femme :
Femme (1) : 1835. Honoré de Balzac [1799-1850], dans Le père Goriot, auteur de :
« Il lui manquait ce qui crée une seconde fois la femme, les chiffons et les billets doux. » 2 (Cf. Femmes. Devenir une femme, Langage. Zeugma)
Femme (2) : (2 janvier) 1864. 1984. Alors que George Sand [1804-1876], dans une lettre à Augustine de Bertholdi [1825-1905], avait écrit : « Nous n’avons plus que Lambert et sa femme qui est très gentille et excellente femme, mais ils partent ces jours-ci. », je lis dans une note de Georges Lubin [1904-2000] :
« George Sand a écrit ‘femme’ qui n’a pas paru [dans les publications antérieures] assez distingué, et a été remplacé par ‘personne’. » 3 (Cf. Langage, Patriarcat)
Femme. Victor Hugo :
Femme (3) : 1869. Victor Hugo [1802-1885], dans L’homme qui rit, auteur de :
« Si la femme signifie faute, comme je ne sais plus quel concile l’a affirmé, jamais femme n’a été plus femme qu’en ces temps-là. » 4
Femme (4) : 1869. Victor Hugo [1802-1885], dans L’homme qui rit, auteur de :
« [Déa] était tout juste assez femme. » 5 (Cf. Femmes. Devenir une femme)
Femme (5) : 1869. Victor Hugo [1802-1885], dans L’homme qui rit, auteur de :
« La femme c’est de l’argile qui désire être fange. » 6
-------------
Femme (6) : 1975. Je lis dans une note des Oeuvres de Jules Vallès [1832-1885] de La Pléiade :
« Emma Bovary est, et restera, aux yeux de Vallès, l’émouvante et terrible [?] provinciale ; une héroïne qu’il a sentie [?] et comprise [?] plus que toute autre [?], et qui, pour lui, est un peu la femme. » Ce que ne remet pas en cause La Pléiade. 7
Femme (7) : 1982. Anne Quéré [1936-1995], théologienne féministe protestante, s’interroge :
« Quand vous étudiez la représentation de la femme à travers la littérature, à travers les âges, à travers les mentalités, vous êtes épouvantés. Qu’est-ce que c’est qu’une femme ? D’abord, ce n’est jamais une femme. C’est un démon, disent les Pères de l’Église. C’est un ange, répondent les romantiques. C’est une bête, mais allez savoir laquelle. Une poule, une grue, une tigresse, une chatte si elle aime, une vache si elle enseigne, un chameau si elle administre, une lapine si elle enfante, si elle est pieuse une punaise de sacristie, et presque toujours une dinde ou une bécasse. Un véritable zoo. » 8 (Cf. Culture. Littérature, Femmes. Animalisation des femmes, Penser. Théologie)
Femme (8) : 1989. Élisabeth Badinter, auteure de :
« Poullain de la Barre, Louise d’Épinay, Condorcet, Simone de Beauvoir et quelques autres, vous qui avez eu la clairvoyance et le courage de tenir le discours de la ressemblance, soyez-en remerciés. Grâce à vous, nous autres femmes, sommes définitivement intégrées dans l’humanité, adultes et émancipées. En dépit des grimaces et des réticences toujours multiples, nous pouvons répondre à la question initiale : ‘qu’est-ce qu’une femme ? Un animal raisonnable. Bref, un Homme comme tout le monde’. » 9 (Cf. Femmes. Femme. Qu’est-ce qu’une femme ? Animalisation des femmes. Politique. Animalisation du monde)
Femme (9) : 2002. Sylviane Agacinski, dans son Journal interrompu, auteure de :
« Je serais bien incapable de définir ce qu’est une femme et n’ai pas besoin de le faire. Mais je sais d’un savoir certain, et quelle que soit ma part de virilité, que je ne suis pas un homme. » 10 (Cf. Hommes. « Virils »)
Plus pertinent qu’il ne m’est apparu au premier abord : Femme, tentez de vous penser homme ; homme, tentez de vous penser femme… J’ai essayé : exercice impossible.
* Ajout. 26 juillet 2025. D’autres l’espèrent, le croient, le veulent possible. Et surtout veulent nous imposer leurs aspirations comme relevant de l’évidence. (Cf. Êtres humains. L.G.B.T, Langage. Genre)
Femme (10) : 2004. Michel Tauriac [1927-2013], dans le livre réalisé avec Philippe de Gaulle [1921-2024] pour l’écriture de De Gaulle, mon père [1890-1970], débuta le chapitre 15 intitulé Des Femmes, par cette question :
« La femme dans la société a toujours beaucoup compté pour le Général. Avant lui, personne n’en avait fait autant pour elle socialement. Il appartenait pourtant à une génération qui la reléguait souvent à la seconde place. Lui, la mettait sur un piédestal. Et manifestement, elle attirait son regard. Que représentait-elle pour lui ? » 11 (Cf. Patriarcat, Histoire. Historiographie. Patriarcale)
-------------
Femme. Par ordre alphabétique :
Femme (« Assistante ») : (13 novembre) 2023. Entendu sur Radio courtoisie (radio d’extrême-droite) [une rediffusion. 1991] : « ma fidèle assistante ».
Femme (Avare) : 1975. Maurice Mességué [1921-2017] raconte :
« J’ai soigné très longtemps [Maurice] Utrillo [1883-1965]. Il était marié avec Lucie Valore [1878-1955] [qui] était extrêmement avare. À l’époque, il y a 15 ou 18 ans (milieu des années [19] 50), je prenais (pour sa consultation) 5000 anciens francs et Lucie Valore trouvait que c’était trop cher. ‘Aussi, disait-elle, allez chercher les crayons de couleur de vos enfants, Maurice va vous faire des dessins.’ Et c’est ainsi que je possède un nombre incalculable de dessins d’Utrillo, car jamais elle n’a voulu payer le prix de mes consultations. » 12 (Cf. Culture. Art, Femmes. Épouse de, Économie. Argent)
Femme (Aveuglement) : Elle attribuait à sa délicatesse le soin que son mari portait à lui cacher ses infidélités. (Cf. Famille. Couple)
Femme (« Avoir » une) : 1978. Christiane Rochefort [1917-1989], dans Ma vie, revue et corrigée par l’auteur, écrit :
« Si j’avais une femme, elle répondrait au téléphone aux lettres aux huissiers aux persécuteurs elle remplirait les formulaires règlerait les factures classerait le courrier organiserait mes rendez-vous ferait réparer la machine à laver changerait les abat-jours déferait les paquets surveillerait les plantations jouerait avec les chats balayerait sous le lit irait au marché chercherait les charters, pendant que moi j’écrirai Les Sœurs Karamazovna.
Mais je ne peux pas avoir une femme, parce que, je ne pourrais pas laisser tout le sale boulot à quelqu’un pour qui j’aurais un minimum de sympathie. Et quelqu’un pour qui je n’aurais pas le minimum, comment pourrais-je le supporter en permanence à la maison ? Je me demande comment ils font. » 13 (Cf. Hommes, Féminismes, Langage. Verbe. Avoir)
Femme (« Bijou ») : 1857. Léon Tolstoï [1828-1910], dans Jeunesse, auteur de :
« Anna Dmitrievna elle-même était un bijou : petite, fluette, le teint frais, des mains fines est élégantes, toujours animée et vêtue à son avantage. […] » 14
Femme (« Bon morceau ») : (5 février) 1861. Émile Zola [1840-1902] - qui se reproche d’être devenu « affreusement gourmand » - écrit à Paul Cézanne [1839-196] :
« Boisson, nourriture, tout me fait envie, et je prends le même plaisir à dévorer un bon morceau qu’à posséder une femme. »
Il évoque en fin de lettre sa « maîtresse qui ne l’aime pas du tout. » 15 (Cf. Êtres humains, Corps. Zola Émile, Relations entre êtres humains. Amour. « Faire l’amour », Langage. Verbe. Avoir. Zeugma)
Femme (« Bonne sœur ») : Un homme, au fils de sa compagne :
« Ta mère, c’est pas une bonne sœur ». (Cf. Femmes. Religieuses)
Femme (« Cadeau ») : 1878. Émile Zola [1840-1902], dans Une page d’amour, auteur de :
« Rosalie [la cuisinière] était un cadeau [pour Hélène, veuve] de l’abbé Jouve. Il l’avait prise à la gare d’Orléans, le jour où elle débarquait, de façon qu’elle ne connaissait pas un pavé de Paris. C’était un condisciple, le curé d’un village beauceron, qui la lui avait envoyée. » 16 (Cf. Femmes. Enfermées)
Femme (Caïn) : « Caïn était dans la tombe » … et regardait son épouse…
N.B. Caïn eut un fils, nommé Énoch. Un tableau de Fernand Cormon [1880] au musée d’Orsay s’intitule : Caïn fuyant avec sa famille.
Femme (« Castratriste ») : Mécontente des critiques qu’elle lui avait, à sa demande, transmises, il / elle la traita de « castratrice ». Mais de quoi donc pouvait-elle être « castrée » ?
Ou, était-ce elle qui devait être « castrée » ou plus justement l’homme qui, en parlant d’elle, parlait de lui, craignait pour lui ? (Cf. Sexes […])
Femme (Chaste) : (4 janvier) 1867. George Sand [1804-1876], dans une lettre à Francis Laur [1844-1934], auteure de :
« Chaste, j’ai vécu, jeune ou vieille, et calme. » 17
Femme (« Charogne ») : (31 août) 1862. Léon Tolstoï [1828-1910] écrit dans son Journal :
« Kokhanovskaïa [pseudonyme de la poétesse Nadiejda Stièpanovna Sokhanski. 1823-1884] est une charogne, et toutes sont des charognes, desséchées dans leur crinoline. » 18
Femme (« Chef d’œuvre ») : 1935. Lu dans le Journal de Paul Léautaud [1872-1956] : Lucien Michelot [1850-1929] à Marie Dormoy [1886-1974], auteur de :
« J’estime que mon plus beau chef d’œuvre, c’est toi. » 19 (Cf. Êtres humains. Soi, Hommes, Patriarcat)
Femme (« Cire ») : 1958. Alfred Hitchcock [1899-980] concernant Kim Novak dans Sueurs Froides, auteur de :
« Kim n’est qu’une inconsistante cire qui m’a coûté les plus grandes peines à modeler. J’ai tout fait. » 20 (Cf. Hommes, Patriarcat)
Femme (« Cul ») : 2016. Un banquier à son épouse, mariée avec lui depuis 30 ans, universitaire, laquelle invoquait ses « droits », alors qu’il voulait qu’elle « dégage » :
« Ton cul, tu crois que c’est une tirelire ? » (Cf. Droit, Hommes. Grossiers, Mariage, « Plan ‘Cul’ »)
Femme (« Culottée ») : 1982. Françoise Dolto [1908-1988], dans Sexualité féminine, concernant son rapport sur la « libido féminine » au Congrès de psychanalyse d’Amsterdam en 1960, auteure de :
« À la sortie du Congrès, après mon intervention, Lacan [Jacques. 1901-1981] m’a dit : ‘Eh bien pour parler comme tu parles, tu es culottée !’. Je lui ai demandé : ‘Alors, tu t’inscris en faux sur tout ce que j’ai dit ?‘ ’Je n’ai pas dit ça, m’a-t-il répondu: ‘J’ai dit que tu étais culottée’. Je n’ai pas pu en tirer autre chose. » 21 (Cf. « Sciences » sociales. Psychanalyse. Lacan Jacques)
Femme (Culpabilité) : (15 février) 1794. Germaine de Staël [1766-1817], dans une lettre à Louis de Narbonne [1755-1813], lui écrit :
« […] Ai-je eu tort dans mes lettres ? Ah, tant mieux si j’ai eu tort ; vous ne serez pas si coupable, je pourrais vous croire encore quelque intérêt pour moi. […] » 22 (Cf. Êtres humains. Culpabilité, Femmes. Écrivaines. Staël Germaine de)
Femme (D’Eaubonne Françoise) : 2001. Françoise d’Eaubonne [1920-2005], dans Mémoires irréductibles, auteure de :
« […] Mais j’ai gagné quoi [d’avoir repris les relations avec son amant] ? Quand il ne peut s’agir que de victoires locales, la défaite que l’on repousse à force d’exploits ne vaut-elle pas infiniment mieux ? Quelle femme comprendra, un jour, cette vérité toute simple ? C’est à désespérer d’appartenir à un tel sexe. » 23 (Cf. Femmes. Amants, Féminismes, Patriarcat, Sexes. Femmes)
Femme (« Démodée ») : Une femme « démodée » : une femme cohérente, sinon avec elle-même, du moins avec son passé ? bien dans ses vêtements ? insouciante au regard des autres ? refusant les assignations ?
Valable aussi pour les hommes, à ceci près que jamais « la mode » n’a joué pour les hommes le rôle, la fonction, la dépendance, la contrainte qui fut la sienne pour les femmes. Jusqu’à ce qu’elles l’ignorent… (Cf. Êtres humains. Mode. Vêtements, Femmes. Mode)
Femme (« Dépendante ») : 1976. Jean-Paul Sartre [1905-1980] (concernant sa mère), dans ses Entretiens sur moi-même, auteur de :
« Je vois le rapport à l’argent qu’a eu ma mère ; elle a d’abord reçu de l’argent de son mari, puis de son père, puis elle a été demandée en mariage par un autre homme, mon beau-père, qui l’a entretenue jusqu’à ce qu’il meure ; à la fin de sa vie, elle a vécu en partie de ce que mon beau-père lui avait laissé, et en partie de certaines sommes que je lui donnais. Elle a été, d’un bout à l’autre de sa vie, entretenue par des hommes et elle n’a eu aucun rapport direct avec le capital. » 24
Mais, dans le même livre, je lis :
« Une fois, ma mère m’a donné douze millions pour payer mes impôts », suivi de :
« Je venais de découvrir que je n’avais plus d’argent. C’est là, je crois, que ma mère m’avait donné douze millions pour payer mes impôts. » 25
Relativise heureusement le qualificatif d’ « intellectuel », ainsi que celui de « femme dépendante ». (Cf. Femmes. Mères. Femmes. « Entretenues », Hommes. « Intellectuels », Famille, Patriarcat, Économie, « Sciences » sociales. Philosophie)
Femme (Désespérée) : 1921. Milena Jesenskà [1896-1944], dans Vivre, évoquant l’immense pauvreté, à Vienne (Autriche), écrit :
« [Mais] hier, j’ai assisté à un spectacle horrible. Mon regard a été arrêté par la silhouette d’une femme, pâle comme un fantôme, tapie derrière les piliers de l’église. Ici, point d’affiche. Seulement, une terrible douleur. Pas de suppliques, pas de larmes, juste un visage muet à force de lamentations.
Elle tenait dans ses bras un enfant qui venait de mourir. Il était tout couvert de plaques rouges.
Mais quand je me suis approchée, elle m’a soudain repoussée d’un geste où il y avait tant de mépris pour tout, tant de solitude de l’être qui mendie, que prise de terreur, je me suis enfuie, comme si c’était moi qui avais besoin de me sauver. » 26 (Cf. Êtres humains. Frontières. Sans domicile fixe, Corps. Visage, Enfants. Jesenskà Milena, Femmes. Charité. Mères. Pleurs. Remarquables)
* Ajout. 6 janvier 2022. Cette phrase : « comme si c’était moi qui avais besoin de me sauver… » me concerne. (Cf. Êtres humains. Sans domicile fixe)
* Ajout. 26 mars 2025. À la relecture, je ne comprends pas bien pourquoi j’ai écris cela…
Femme (Dickens Charles) : 1850. Charles Dickens [1812-1870], dans David Copperfield, auteur de :
« En finissant [la chanson], il [Markham] nous proposa de boire à la santé de ‘la femme’ ! Je fis des objections et je ne voulus pas admettre le toast. Je n’en trouvais pas la forme assez respectueuse. Jamais je ne permettrais qu’on portât chez moi pareil toast autrement qu’en ces termes : ‘les dames’. » 27 (Cf. Langage)
Femme (Distraction) : 1833. Alfred de Musset [1810-1857], dans Les caprices de Marianne, met dans la bouche de Marianne cette analyse :
« Qu’est-ce après tout qu’une femme ? L’occupation d’un moment, une ombre vaine qu’on fait semblant d’aimer pour le plaisir de dire qu’on aime. Une femme ! c’est une distraction. Ne pourrait-on dire quand on en rencontre une : ‘Voilà ma belle fantaisie qui passe !’ […] » 28
Femme (« Effrontée ») : 1936. Louis Aragon [1897-1982], dans Les beaux quartiers, auteur de :
« Il redressa la tête, et rencontra, droit dans le sien, le regard qui n’avait pas bougé. L’effrontée. » 29
Femme (Égérie) : Vous ne voulez pas reconnaître les qualités intellectuelles et / ou politiques d’une femme, qualifiez-la d’ « égérie ».
Ce qualificatif - entendu concernant Susan George, ancienne présidente d’Attac - évite de la lire, de la critiquer, de la considérer selon ses mérites. Vous pouvez alors assimiler les plus belles d’entre elles à des publicités vivantes pour Lancôme, Chanel, ou elles ne sont plus que paraître. (Cf. Femmes. Artistes. Adjani Isabelle. « Intellectuelles », Langage)
Terme qui a remplacé celui de « muse », trop ‘daté’ …
Analyse valable aussi pour : « icône » concernant :
- Alice Schwarzer en février 2014,
- Rosa Luxemburg [1871-1919], en mars 2014,
- Gloria Steinem en novembre 2016 (Le Monde Diplomatique),
- Virginia Woolf : « icône de la lutte pour la parité des sexes », le 26 juillet 2019 (France Culture),
- Innna Shevchenko. [Une Femen au G7], « icône féministe et leader du mouvement international Femen », le 24 août 2019 (Le Monde).
Analyse valable aussi pour « Femmes. Remarquables », que j’emploie et utilise : ? (Cf. Femmes. Muses)
Femme (« Égoïsme ») : (5 décembre) 1864. Caroline B. [Brame] [1847-1892], auteure, dans son Journal intime, de :
« Ah ! L’égoïsme est un affreux défaut et cependant, on est tenté de dire : Et moi ? » 30 (Cf. Êtres humains. Soi)
Femme (Elle) : 2007. Valérie Toranian, alors directrice de la rédaction de Elle, auteure de :
« Notre identité est dans ce mélange -‘dosage subtil entre le fond et la forme, le sujet de société et de mode, la réflexion et la beauté, un certain engagement et une vraie légèreté’ - parce que nous cherchons sans cesse à réconcilier les deux parts de la femme : la part de féminisme qui est en nous, avec nos irritations et nos révoltes, et la part de féminité, qui renvoie à nos envies d’être belles, d’êtres drôles, de séduire -. » 31
« Les deux parts de la femme » : ou comment devenir schizophrène. (Cf. Féminismes. Elle, Patriarcat. « Féminité », « Sciences » sociales. Psychanalyse)
Femme (« Embonpoint ») : (14 avril) 1801. Choderlos de Laclos [1741-1803], dans une lettre à son épouse, respectée et aimée (et réciproquement) :
« Je suis bien aise de ce que tu me mandes de ta santé, et même de ton embonpoint.
De toi, bonne chère amie, plus il y en a et mieux c’est. » 32 (Cf. Dialogues, Corps. Femmes, Hommes. Remarquables. Laclos Choderlos de)
Femme (« Emplette ») : (15 décembre) 1759. Voltaire [1694-1778], dans une lettre à François Chennevières [1699-1779] (concernant mademoiselle de Bazincourt qui, sortie du couvent, séjourna une année [oct. 1759-nov. 1760] chez Voltaire [1694-1778] et Marie-Louise Denis [1712-1790], écrit :
« Melle de Bazincourt [1700 (environ)-1788 (environ)] est une bonne emplette, et de bonne emplette, je peux en parler ainsi sans conséquence, à mon âge. »
Marie-Louise Denis [1712-1790] avait, pour sa part, écrit, la concernant :
« Cette fille a de l’esprit. [Elle publiera en 1768 un Abrégé historique des figures de la Bible mis en vers français.] Je voudrais pouvoir lui faire du bien. […] [et] la faire venir auprès de moi. »
Enfin, Voltaire emploiera, à nouveau, le terme d’ « emplette » concernant « un petit garçon de douze ans, Bussi » qu’il recommande afin qu’il puisse entrer à l’Opéra-Comique. 33 (Cf. Êtres humains. Achat, Femmes. Achat, Patriarcat. Voltaire)
Femme (« Épave humaine ») : 1995. Lu dans Jean Tulard, Guide des films. 1895-1995. L. Z, concernant Les requins de Gibraltar [1947. Emil-Edwin Reinert] :
« Stella, une épave humaine est transformée en lady pour les besoins de la cause du sinistre Gordon […]. » 34 (Cf. Culture. Cinéma)
Femme (« Étoffe ») : (16 avril) 1860. Lettre d’Émile Zola [1840-1902] à Paul Cézanne [1839-1906] :
« (Concernant « l’amour (dans le mariage comme ailleurs »)). Je croirais plutôt qu’il n’y a que des bons numéros, quant aux mauvais, c’est l’homme qui les fait lui-même. Je m’explique : dans toute femme, il y a l’étoffe d’une bonne épouse, c’est au mari de disposer de cette étoffe le mieux possible. Tel maître, tel valet : tel mari, telle épouse. […] » 35 (Cf. Femmes. Épouse de, Hommes, Famille. Mariage, Relations entre êtres humains. Amour, Patriarcat)
Femme (Être) : Se savoir être, c’est ne jamais être seule. (Cf. Êtres Humains. Soi, Femmes. « Seules »)
Femme (Expiation) : 1973. Madame Marthe Massenet [?-?], dans un livre intitulé Madame Veuve, rapporte la prière qu’elle fit, après la mort de son mari, à son dieu :
« À celui qui voit les cœurs, je dis simplement : ‘Pierre croyait en Toi, Seigneur. C’était un juste, un homme de vérité et de bonté. Fais qu’il soit heureux. S’il s’est trompé, s’il a commis des fautes, qu’elles retombent sur moi, qu’elles soient expiées par ma douleur. Aie pitié, Seigneur, puisque j’accepte…’ » 36
Terrible… (Cf. Femmes. Veuves, Relations entre êtres humains. Compassion. Pitié, Politique. Religion)
Femme (« Faire-valoir ») : 1924. Gina Lombroso [1872-1944] (fille de son père) sans doute la femme auteure la plus antiféministe de l’entre-deux guerres, dont les livres eurent un énorme succès, auteure de :
« […] Une femme élégante, une maison élégante donnent assurément au mari et aux personnes qu’il reçoit l’illusion du bonheur, de la richesse, et par conséquent lui donne du lustre, illusion et lustre auxquelles l’homme est extrêmement sensible.
Il tolère en effet parfaitement que la femme tienne plus ou moins bien la maison, qu’elle soit plus ou moins riche, plus ou moins intelligente, qu’elle soit plus ou moins bien vêtue quand il est seul avec elle, si, au moment opportun, elle sait présenter une maison qui paraisse belle, des enfants qui paraissent bien élevé-es, si elle sait paraître riche, bien vêtue, heureuse, si elle sait lui faire bonne figure devant les étrangers, si elle représente une valeur que les autres lui envient, si elle sait mettre au bon jour les autres biens qu’elle possède et lui en donner conscience à lui-même. » 37 (Cf. Êtres humains. Soi, Femmes. Aiguilles, Heureuses. Intelligentes, Maison. « Maîtresses de maison ». Ornements [décoratifs], Hommes, Relations entre êtres humains. Faire-valoir, Langage. Verbe. Être, Patriarcat, Économie. Valeur)
Femme (« Fautive ») : (6 janvier) 1663. Samuel Pepys [1633-1703], dans son Journal :
« [Toutefois], j’étais quelque peu irrité par la négligence de ma femme, qui a laissé son écharpe, son corselet et ses vêtements de nuit dans la voiture qui nous a ramenés aujourd’hui de Westminster ; j’avoue qu’elle me les avait confiés - mais elle est fautive de ne s’être pas assuré que je le savais effectivement sortis de la voiture. […] » 38 (Cf. Hommes. Irresponsables)
Femme (Fierté) : 1854. George Sand [1804-1876] évoquant sa rupture, alors adolescente, avec Dieu, dans Histoire de ma vie, écrit :
« […] Je ne voulais pas descendre dans son respect en risquant de l’irriter.
Je ne sais pas si j’ai raison de regarder la fierté comme un des principaux devoirs de la femme, mais il n’est pas en mon pouvoir de ne pas mépriser la passion qui s’acharne.
Il me semble qu’il y a là un attentat contre le ciel, qui seul donne et reprend les vraies affections.
On ne doit pas plus disputer la possession d’une âme que celle d’un esclave. […] » 39
Mais tout le passage concernant sa décision est passionnant. (Cf. Êtres humains. Âmes, Politique. Esclavage)
Femme (« Flèche ») : 1994. Hubert Juin [1926-1987], en conclusion de sa Préface à L’Art d’aimer d’Ovide, auteur de :
« […] C’est là que se mesure le génie d’Ovide, la femme est la flèche dont le poème est la cible. »
- Et ce, quelques lignes après avoir écrit :
« Son génie (celui d’Ovide), je crois, fut de mettre le monde au féminin : c’est ce qui le fait inoubliable. » 40 (Cf. Êtres humains. Aimer. L’art d’aimer. Ovide, Femmes. « Féminin »)
* Ajout. 30 juillet 2019. Wajdi Mouawad, traitant de son travail de metteur en scène, auteur de :
« Je suis un très mauvais archer. J’ai beaucoup de difficulté à tirer la flèche tout de suite dans la cible. » 41
Femme (« Forteresse imprenable ») : 1880. Fiodor Dostoïevski [1821-1881], dans Les frères Karamazov, auteur de :
« […] Elle est d’un caractère indépendant ; c’est une forteresse imprenable pour tous, telle une femme légitime, car elle est vertueuse. » 42 (Cf. Femmes. Vertu)
Femme (Franche) : (25 décembre) 1863. George Sand [1804-1876], dans une lettre à Stanislas de Charnal [1830-1880], auteure de :
« Monsieur, Je suis franche, c’est pour ça que j’ai beaucoup d’ennemis. » 43
Femme (Freud Sigmund) : 1930. Sigmund Freud [1856-1939], dans Le malaise dans la culture, auteur de :
« […] La vie en commun des hommes fut ainsi fondée doublement, par la contrainte au travail créée par les nécessités extérieures, et par le pouvoir de l’amour, qui ne voulait pas être privé, du côté de l’homme, de l’objet sexuel qu’est la femme, et, du côté de la femme, de cette partie détachée d’elle-même qu’est l’enfant. » 44 (Cf. Enfants, Femmes. « Objet », Sexes. « Objet sexuel »)
Femme (« Fruit Vert ») : 1995. Lu dans : Jean Tulard, Guide des films. 1895-1995. LZ, concernant le film Sylvia Scarlett [1935. George Cukor] :
« Pour la performance de Katharine Hepburn [1907-2003], ici, délicieux fruit vert […]. » 45 (Cf. Culture. Cinéma, Femmes. Artistes. Remarquables)
Femme (« Gagne-pain ») : 1966. Couplet de la chanson Pigalle :
« P´tit´s femm´s qui vous sourient / En vous disant : ‘Tu viens chéri‘ / Et Prosper qui dans un coin / Discrèt´ment surveill´ son gagn´ pain », chantée par Georges Ulmer, Les Compagnons de la chanson, Charles Dumont, Patachou…
Fin : « Mais au monde, il n’y a qu’un seul Pigalle ! » (Cf. Culture. Patriarcale. Cinéma. Tenue de soirée, Proxénétisme. Chansons)
Femme (Gaie) : 1865-1869. Léon Tolstoï [1828-1910], dans La guerre et la paix, auteur de :
« À chaque mot qu’il disait ou qu’elle disait, Natacha éclata de rire, non point parce que ce qu’ils disaient étaient drôles, mais parce qu’elle était gaie et ne pouvait contenir sa joie, qui s’exprimait par le rire. » 46 (Cf. Femmes. Rires, Langage. Parole, Penser)
Femme (« Garçonne ») : 2012. Monique, interviewée dans le film Les invisibles :
« Si on prend des airs de garçons, ce n’est pas parce qu’on est des ‘garçonnes’ ; c’est pour plaire aux femmes. » 47
Quel plaisir de lire de telles évidences…
Même si, sans doute, les réalités sont plus complexes… (Cf. Culture. Cinéma, Femmes. Lesbiennes)
Femme (Holocauste) : 1916. Mgr Tissier (évêque de Chalons), dans La femme au foyer, auteur de :
« La concorde domestique comme la paix sociale est le fruit de l’holocauste de l’intérêt propre au bien des autres. » 48 (Cf. Patriarcat, Politique. Religion)
Femme (Honneur) : (27 juillet) 1935. Lu, dans le Journal particulier de Paul Léautaud [1872-1956] un article du Quotidien, qu’il reproduit en note :
« Drame. Une jeune fille attache son fiancé à un arbre et le poignarde.
Vigo, 26 juillet [1935].
Une jeune fille a tué son fiancé dans des circonstances vraiment particulières où elle a mis la ruse au service de la jalousie. Elena Amos et Jésus Filloy, fiancés depuis plusieurs mois, se promenaient dans un bois de pins, près du village d’Estreda. Faisant semblant de jouer, Elena attacha Jésus à un arbre, à l’aide d’une corde. Toujours en jouant, elle lui banda les yeux. Puis sortant un couteau de son corsage, elle le planta dans la gorge du jeune homme et s’enfuit. Jésus réussi à se détacher mais mourut avant d’arriver à l’hôpital. La meurtrière, arrêtée, a déclaré qu’elle avait voulu défendre son honneur car elle savait que son fiancé avait deux maîtresses. Elle employa le stratagème de la corde et du couteau afin que le jeune homme ne puisse pas lui échapper. » 49
- Renouvelle les réflexions sur l’honneur patriarcal ? À moins qu’il en s’agisse d’une réécriture patriarcale d’une toute autre réalité… (Cf. Femmes. Jeune filles, Justice, Patriarcat. Honneur, Politique. Ruses, Violences)
Femme (Hugo Victor) : 1830. Victor Hugo [1802-1885], dans Hernani, concernant Doña Sol, auteur de :
« […] « Ah ! je tombe à vos pieds ! Ayez pitié de nous !
Grâce ! Hélas ! monseigneur, je ne suis qu’une femme,
Je suis faible, ma force avorte dans mon âme,
Je me brise aisément. Je tombe à vos genoux ! » (Cf. Relations entre êtres humains. Pitié)
Femme (« Idéale ») : 1995. Lu dans Jean Tulard, Guide des films. 1895-1995. L.Z, concernant Signé Charlotte [1984. Caroline Huppert] :
« Mathieu […] se trouve partagé entre Charlotte, la fantasque, et Christine, la sage, qui sont peut-être deux facettes de la femme idéale. » 50 (Cf. Culture. Cinéma, Penser. Pensées. Binaires)
Femme (« Idée ») : (5-7 avril) 1794. Benjamin Constant [1767-1830] écrit à Isabelle de Charrière [1740-1805] :
« Oh ! ménagez-vous, portez-vous bien, vivez. Vous êtes la seule idée sur laquelle je puisse m’arrêter. Dans ce désert où je vais, vous serez mon seul espoir. » 51
Femme (« Idiote ») : 2001. Doris Lessing [1919-2013], dans Le rêve le plus doux, auteure de :
« Une fois qu’elle s’était enlisée dans un marais d’humiliation et de culpabilité, avec quelle facilité alors il pouvait lui donner la sensation d’être idiote ! » 52 (Cf. Femmes. Intelligentes, Patriarcat)
Femme (« Imprenable ») : (26 février) 1815. Benjamin Constant [1767-1830] écrit dans son Journal intime :
« Assez bien travaillé. Diné chez Mme de Staël, avec Juliette [Récamier. 1777-1849]. Soirée tête à tête avec elle. J’ai eu de nouveau de la douleur. Cette maudite femme est imprenable. » 53 Elle n’est pas maudite parce que femme ; elle est maudite parce qu’elle refuse de coucher avec lui. Je comprends mieux la banalité de l’injure ‘salope’ que tant d’hommes ont à la bouche.
Femme (« Infâme ») : 1961. Dialogue du film : Une femme est une femme de Jean- Luc Godard [1930-2022] :
« Angela, tu es infâme ».
« Non », répond-elle « Je suis une femme. » 54 (Cf. Culture. Cinéma, Dialogues)
Femme (« Insatiable ») : Son amie de cœur était revenue, il lui fit comprendre que leurs relations étaient terminées. Elle s’était habituée à lui qui n’encombrait pas sa vie. Elle en prit donc aisément acte, mais n’accepta pas que sa décision fut à effets quasi immédiats. Elle fit en sorte qu’une petite rallonge eut lieu. Il en prit acte et s’exécuta.
Des années, après, elle apprit par une amie commune qu’il la jugeait « insatiable ».
* Ajout. 1er janvier 2020. 1966. François Mauriac [1885-1970], dans ses Mémoires intérieurs, traite Louise Colet [1801-1876] de « muse insatiable ». 55 (Cf. Femmes. Écrivaines. Colet Louise. Muses)
Femme (« Instrument ») : 1961. Pauline Réage (alias Dominique Aury [1907-1998]), dans Histoire d’O, auteure de :
« […] O se sentit pesée et jaugée pour l’instrument qu’elle savait bien qu’elle était, et ce fut comme forcée par son regard et pour ainsi dire malgré elle qu’elle retira ses gants […]. » 56 (Cf. Pornographie. Histoire d’O)
Femme (« Intérieur » d’) : (juillet) 2016. Entendu évoquer, lors de la visite (fort intéressante) de la Maison de la Beurière à Boulogne-sur-Mer, les femmes de marins comme étant : « des femmes d’intérieur au travail à l’extérieur ».
On découvre dans ce petit musée que ces femmes travaillaient notamment comme « ramendeuses », « laceuses », « moulières », « sautrières », « verrotières ».
Sur le site internet de cette Maison de la Beurière, est évoqué : « le travail à quai et le labeur sans cesse renouvelé de la femme, de son travail en bord de mer ou en atelier [nécessaire à] à la subsistance du ménage et l'éducation des enfants... »
Entendu aussi que l’on ne devient « matelote » que lorsqu’on épouse un matelot.
(Cf. Culture. Musées, Femmes. Travail, Langage. Féminisation du langage)
Femme (« Intouchable ») : 1932. Louis Ferdinand Céline [1894-1961], dans Voyage au bout de la nuit, concernant sa mère [Marguerite Guilloux. 1868-1965], auteur de :
« […] Elle croyait au fond que les petites gens de sa sorte étaient faits pour souffrir de tout, que c’était leur rôle sur la terre, et que si les choses allaient récemment aussi mal, ça devait tenir encore, en grande partie à ce qu’ils avaient commis bien des fautes accumulées, les petites gens... Ils avaient dû faire des sottises, sans s’en rendre compte, bien sûr, mais tout de même ils étaient coupables et c’était déjà bien gentil qu’on leur donne ainsi l’occasion d’expier leurs indignités. C’était une ’intouchable’ ma mère. » 57 (Cf. Femmes. Aliénées. Mères, Politique. Guerre, Économie. « Pauvres Les »)
Femme (« Irresponsable ») : 1995. Lu dans Jean Tulard, dans Guide des films. 1895-1995. L-Z, concernant :
- Un cottage à Dartmoor [1929. Antony Asquith, d’après Herbert Price] : « [Sally] s’était laissée séduire par un riche fermier. » 58 (Cf. Culture. Cinéma, Hommes. Irresponsables. Séducteurs)
Femme (« L’Encyclopédie ») : (28 février) 1763. Voltaire [1694-1778], dans une lettre à Adrien-Michel-Hyacinthe Blin de Sainmore [1733-1807], écrit :
« Vous m’étonnez beaucoup d’aimer l’article Femme [écrit par De Desmahis. 1723-1761] 59 dans l’Encyclopédie ; cet article n’est fait que pour déshonorer un ouvrage sérieux. » 60 (Cf. Corps. Femmes. Voltaire, Patriarcat, Penser. L’Encyclopédie)
Femme (Libération) : L’une des décisions de sa vie qu’elle pouvait qualifier de libératoire, bien que / quoique spontanée, impensée (ou presque…), fut de lui proposer un rendez-vous pour lui demander s’il voulait bien être son amant.
Il refusa intelligemment (et donc élégamment) ce qui paracheva un processus de libération dont sa requête était alors l’incarnation. Lui, n’eut que plus de valeur à ses yeux.
Femme (Licence) : 1794. Raconté par Gustave Flaubert [1821-1880], d’après des souvenirs de famille :
« À Bayeux, la jeune fille qui représentait la liberté portait sur la poitrine ou sur le dos de l’inscription suivante : ‘Ne me tournez pas en licence.’ » 61 (Cf. Femmes. Jeunes filles, Patriarcat)
Femme (Lily) : 1977. Pierre Perret (à écouter, mais à défaut…), auteur de :
« On la trouvait plutôt jolie, Lily / Elle arrivait des Somalies, Lily / Dans un bateau plein d'émigrés / Qui venaient tous de leur plein gré / Vider les poubelles à Paris
Elle croyait qu'on était égaux, Lily / Au pays d'Voltaire et d'Hugo, Lily / Mais, pour Debussy, en revanche / Il faut deux noires pour une blanche / Ça fait un sacré distinguo
Elle aimait tant la liberté, Lily / Elle rêvait de fraternité, Lily / Un hôtelier, rue Secrétan / Lui a précisé, en arrivant / Qu'on ne recevait que des Blancs
Elle a déchargé des cageots, Lily / Elle s'est tapée les sales boulots, Lily / Elle crie pour vendre des chou-fleur / Dans la rue, ses frères de couleur / L'accompagnent au marteau-piqueur
Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily / Elle se laissait plus prendre au piège, Lily / Elle trouvait ça très amusant / Même s'il fallait serrer les dents / Ils auraient été trop contents
Elle aima un beau blond frisé, Lily / Qui était tout prêt à l'épouser, Lily / Mais, la belle-famille lui dit / ‘Nous n'sommes pas racistes pour deux sous / Mais on veut pas de ça chez nous’
Elle a essayé l'Amérique, Lily / Ce grand pays démocratique, Lily / Elle aurait pas cru sans le voir / Que la couleur du désespoir / Là-bas, aussi ce fût le noir
Mais, dans un meeting à Memphis, Lily / Elle a vu Angela Davis, Lily / Qui lui dit ‘viens, ma petite sœur’ / ‘En s'unissant, on a moins peur’ / ‘Des loups qui guettent le trappeur’
Et c'est pour conjurer sa peur, Lily / Qu'elle lève aussi un poing rageur, Lily / Au milieu de tous ces gugus / Qui foutent le feu aux autobus / Interdits aux gens de couleur
Mais, dans ton combat quotidien, Lily. Tu connaîtras un type bien, Lily / Et l'enfant qui naîtra, un jour / Aura la couleur de l'amour / Contre laquelle on ne peut rien
On la trouvait plutôt jolie, Lily / Elle arrivait des Somalies, Lily / Dans un bateau plein d'émigrés / Qui venaient tous de leur plein gré / Vider les poubelles à Paris. » (Cf. Politique. Racisme. Antiracisme)
Femme (Livres) : (22 janvier) 1889. Edmond de Goncourt [1822-1896] note dans son Journal une réaction d’Émile Zola [1840-1902] :
« Ma femme n’est pas là… Eh bien, je ne vois pas passer une jeune fille comme celle-ci sans me dire : ‘Ça ne vaut-il pas mieux qu’un livre ?’ » 62 (Cf. Culture. Livres, Femmes. Jeunes filles, Langage. Critique mot : « Ça »)
N.B. Jeanne Rozerot [1867-1914] était sa maîtresse et lui, son amant, depuis un mois.
Femme (Malade) : 1933. D. H. Lawrence [1885-1930], dans La coccinelle, auteur de :
« Son audace naturelle et son instinct anti-philanthropique ne trouvaient pas d’issue et ne devaient pas en trouver, pensait-elle. De sorte que son tempérament se retournait contre elle et cela expliquait l’usure de ses nerfs et la lente consomption qui la minait. Sa maladie n’était qu’instinct insatisfait et colère inconsciente. » 63
Femme (« Manquée ») : 1979. Je lis dans une note de La Pléiade du tome 1 des Journaux et carnets de Léon Tolstoï [1828-1910] présenter Valéry Arséniev comme « la fiancée manquée de Tolstoï ». 64
Femme (« Marchepied ») : 1932. François Mauriac [1885-1970], dans Le nœud de vipères, auteur de :
« Si j’avais eu, à ce moment, une femme qui m’eut aimé, jusqu’où ne serais-je pas monté ? » 65 (Cf. Femmes, Hommes, Famille. Couple)
Femme (Martyre chrétienne) : 1969. Je lis dans un Dictionnaire des femmes célèbres :
« Blandine (Sainte), jeune esclave chrétienne martyrisée à Lyon, sous le règne de Marc-Aurèle […] survécut sans se plaindre aux fauves, au gril rouge, à un taureau furieux, et qu’il fallut l’achever. » 66
N’était-ce pas, plus ou moins, ce que l’on apprenait encore au catéchisme dans les années [19]50 [et avant]. Et, plutôt, aux petites filles ? (Cf. Politique. Esclavage. Tortures)
Femme (Masturbation) : (5 juin) 1857. Jules Michelet [1798-1874], dans son Journal, écrit :
« Une dame, tout à fait négligée par son mari, m’avoua que, deux fois par an, elle se soulageait dans un rêve. » 67 (Cf. Enfants. Masturbation, Hommes. Masturbation, Relations entre êtres humains. Amour. « Faire l’amour », Sexes. Masturbation)
Femme (« Matière vivante ») : 1992. Je lis dans Un Dictionnaire des femmes célèbres que Serge Lifar [1905-1986] nommait la danseuse Claire Motte [1937-1986] sa « matière vivante ». 68 (Cf. Êtres humains)
Femme (« Mécanique ») : 1876. Émile Zola [1840-1902], dans Son excellence Eugène Rougon, auteur de :
« C’était tout de même, une étrange mécanique qu’une femme. Jamais il n’avait eu l’idée d’étudier cela. Il commençait à entrevoir des complications extraordinaires. » 69
Femme (« Météore ») : (13 mars) 2021. Sur France Culture, Gérard Courtois, journaliste, s’adressant à Amélie de Montchalin, ministre, auteur de :
« Vous avez effectué un parcours de météore ». 70 (Cf. Femmes. Imprenables. Parcours)
N.B. « Météore » : « Personne ou chose qui brille d'un éclat très vif mais passager ». (Cf. Femmes. « Choses »)
Femme (Michelet Jules) : 1991. Lu dans La Pléiade cette présentation de La femme - 1859 - de Jules Michelet [1798-1874] :
« L’ouvrage est très anatomique et physiologique. »
Peut-être, sans doute, cette présentation - qui a le mérite d’être une grille de lecture - me permettra de lire ce livre que jamais ne n’ai réussi à lire. 71
Femme (Misère) : 1837-1843. Honoré de Balzac [1799-1850], dans les Illusions perdues, auteur de :
« Camus [abandonné par sa maîtresse - Coralie - qu’il continue cependant à ‘entretenir’] résolut d’attendre que la misère lui rendit la femme que la misère lui avait déjà livrée. » 72
Femme (Moi) : 1774. Julie de Lespinasse [1732-1776], auteure de :
« Ce moi dont parle Fénelon [1651-1715] est encore une chimère : je sens positivement que je ne suis point moi.
Je suis vous ; et pour être vous, je n’ai aucun sacrifice à faire.
Votre intérêt, vos affections, votre bonheur, vos plaisirs, ce sont là, mon ami, le moi qui m’est cher et qui m’est intime.
Tout le reste m’est étranger : vous seul dans l’univers pouvez m’occuper et m’attacher.
Ma pensée, mon âme ne peuvent désormais être remplies que par vous et des regrets déchirants. […].» 73 (Cf. Êtres humains. Âmes. Soi, Relations entre êtres humains. Amour, Femmes. Aliénées. Remarquables. Lespinasse Julie de, Patriarcat)
Femme (« Morceau ») : 1995. Jean Tulard, dans son Guide des films. 1895-1995. L-Z, concernant La montagne du dieu cannibale [1978. Sergio Martino], auteur de :
« Ce film d’aventures exotiques a le mérite d’être bien fait, d’offrir quelques beaux morceaux sadiques (Ursula Andress attachée nue pour être livrée aux sévices des féroces Pukas) […]. » 74 (Cf. Culture. Cinéma, Femmes. « Attachées », Violences. Violences à l’encontre des femmes)
Femme (Nature) : (20 mars) 1849. Hippolyte Taine [1828-1893], dans une lettre à Lucien-Anatole Prévost-Paradol [1829-1870], auteur de :
« Pour moi, je trouve la nature plus belle que la femme. » 75 (Cf. Langage. Article singulier)
Femme (Naturalisée) : (16-20 août) 2021. France Culture nomme la série démissions - La grande traversée - consacrées à Louise Michel [1830-1905] intitulée : Louise Michel, femme tempête.
* Ajout. 18 août 2021. Je découvre qu’une émission antérieure de France Culture [9 avril 2020] consacrée à Louise Michel s’intitulait : Louise Michel : louve et agneau. (Cf. Femmes. Animalisation des femmes. Remarquables)
Femme (« Négresse ») : Années [19]50. Billie Holiday [1915-1959], à une personne qui lui demandait comment elle allait, lui répondit :
« Comme tu vois, toujours négresse ». 76 (Cf. Femmes. Artistes. Holiday Billie, Politique. Racisme)
Femme (Nerveuse) : 1954. Écouter Odette Laure [1917-2004] chanter Je suis nerveuse… (Cf. Relations entre êtres humains. Amour. « Faire l’amour »)
Femme (« Occasion ») : 1909. Léon Bloy [1846-1917], dans Le sang du pauvre, auteur de :
« Un homme riche est rencontré au seuil d’un mont-de-piété - Que faites-vous ici ? Vous ne venez sans doute pas pour engager. - Je cherche une occasion. On rencontre quelques fois de petites femmes aimables privées d’amis et forcées par la misère de mettre en gage ce qu’elles peuvent avoir de plus précieux. Il y en a qui pleurent, ce qui les rend plus jolies. On se fait leur sauveur et neuf fois sur dix, en s’y prenant bien, on est récompensés. Cela ne coûte pas cher et on a fait une bonne action. […] » 77 (Cf. Femmes. Pleurs, Hommes, Relations entre êtres humains. Charité, Patriarcat, Économie. « Pauvres Les »)
Femme (« On n’en a pas ») : (22 mars) 2023. Lu dans Le Canard enchaîné la réaction d’un « stratège » macronien concernant l’éventuel remplacement d’Élisabeth Borne à Matignon :
« Il faut au moins qu’elle tienne jusqu’au 3 avril. [Pour dépasser le record d’Édith Cresson, soit 10 mois et 18 jours]. À moins de la remplacer par une femme, mais on n’en a pas. » (p.2) (Cf. Femmes. « Politiques », Patriarcat, Politique)
Femme (« Os de seiche ») : 1837-1943. Honoré de Balzac [1799-1850], dans les Illusions perdues, qualifie à trois reprises madame de Bargeton d’ « os de seiche », la première fois du fait de Lucien [de Rubempré] (p.181), la seconde de Lousteau (p.336), la troisième de Balzac, sans porte-parole (p.349). Après, elle sera nommée « la seiche ». 78 (Cf. Femmes. Animalisation des femmes. Balzac Honoré de)
Femme (« Page blanche ») : (1er août) 2024. Entendu sur France Culture - de la part du biographe de Kamala Harris [!] - :
« Elle est une page blanche ».
Femme (Pardon) : 1846. Honoré de Balzac [1799-1950], dans La cousine Bette, auteur de :
« Il fut comme une femme qui pardonne les mauvais traitements d’une semaine à cause des caresses d’un furtif raccommodement. » 79 (Cf. Relations entre êtres humains. Caresses. Pardon, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
Femme (« Pâte ») : 1869. Victor Hugo [1802-1885], dans L’homme qui rit, auteur de :
« Heureusement, Dea n’était point de cette argile. La pâte à faire toutes les femmes n’avait point servi pour elle. C’était une nature rare que Dea. […] » 80 (Cf. Êtres humains. « Pâte humaine », Patriarcat)
Femme (Paysage) : (12 février) 1946. Michel Leiris [1901-1990], dans son Journal, auteur de :
« Mme Césaire [Suzanne. 1915-1966], qui a la couleur de l’or et se situe aux confins les plus extrêmes de la finesse et de la sauvagerie : on a plaisir à être devant elle, comme devant un merveilleux paysage qui serait intelligent. » 81 (Cf. Femmes. Intelligentes, Hommes. Grossiers, Politique. Colonialisme)
Femme (Pensée) : 1966. Jacques Prévert [1900-1977], dans Fatras, auteur de :
« La femme est une pensée, la plus forte de la nature, mais c’est une pensée dansante. » 82
Femme (Portait) : On a tant assimilé, tant réduit, tant défini les femmes par leur apparence, qu’une femme qui veut simplement exister, être appréciée, être jugée par elle-même, en elle-même, doit, pour se conformer aux canons en vigueur, se défier de son image et même de toute représentation d’elle-même. (Cf. Femmes. Apparence. Maquillage)
Femme (« Présent ») : (5 février) 1761. Voltaire [1694-1778] écrit à la duchesse Louise-Dorothée de Saxe-Gotha [1710-1767] :
« On prétend, Madame que la princesse votre fille fera le bonheur d’un prince d’Angleterre, c’est assurément le plus beau présent qu’on puisse faire à cette nation. » 83 (Cf. Hommes, Famille. Mariage, Patriarcat. Voltaire)
Femme (Procréation) : Tant qu’une femme mettra au monde un enfant, la ‘fonction d’usage’ de toutes les femmes sera perpétuée. À moins que… ? Jusqu’à ce que… ? Plus utile pour la réflexion féministe que la fallacieuse recherche de la pseudo égalité. (Cf. Politique. Front National. Le Pen Jean-Marie, Démographie)
Femme (« Pygmalion ») : 1909. Un exemple de femme qui aurait pu être considérée comme une femme « Pygmalion » : Ruth Morse dans Martin Eden de Jack London [1876-1916], Mabel Happlegarth [1873-1915] dans ‘sa’ vie. À ceci près, que l’illustration renforce le stéréotype… (Cf. Penser. Pensées. Méthode. Analogie)
Par ordre chronologique. Femme. Marivaux :
Femme (« Quelque chose ») : 1727. Marivaux [1688-1763], dans La vie de Marianne, auteur de :
« Voilà ce que c’est, reprit Mme Darcire ; et puisque vous savez qui elle est, par quel accident se trouve-t-elle exposée à de si étranges extrémités ? Nous avons jugé, par tout ce qu’on nous en a dit, que ce doit être une femme de quelque chose. » 84 (Cf. Femmes. « Choses »)
Femme (« Qu’une femme ») : 1750. Marivaux [1688-1763], dans La colonie, auteur de :
« Arthénice. « Vous n’êtes qu’une femme, dites-vous ? Hé, que voulez-vous donc être pour être mieux ? » 85 (Cf. Hommes. Féminisme. Marivaux)
-------------
Femme (« Racée ») : (25 janvier) 1950. Cécile Sorel [1873-1966] présente Réjane [1856-1920] notamment comme « élégante, fine et racée. ».
Fernand Gregh [1873-1960] la qualifie de « sensiblement sensuelle. Ça se voyait d’ailleurs a son physique même et en particulier à sa figure qui était, comment dirais-je ? offerte. Elle avait la bouche d’une amoureuse ». Et il poursuit : « La seule petite restriction que je me permettrais de faire au portrait que Madame Cécile Sorel vient d’en faire c’est quand elle dit qu’elle était racée… Elle était racée, mais du Faubourg, et pas du Faubourg Saint-Germain. Non. Elle était assez fille du peuple… du peuple de Paris. D’ailleurs son nom même le disait : elle s’appelait Réju. [...] » 86 Plus insupportable encore, odieux même, à l’écoute… (Cf. Culture, Corps. Femmes, Politique. Démocratie. Peuple, Patriarcat. Mépris des femmes. Sorel Cécile)
Femme (Racine Jean) : 1691. Jean Racine [1639-1699], dans Athalie, auteur de :
« […] La peur d’un vain remords trouble cette grande âme
Elle flotte, elle hésite, en un mot, elle est femme ». (Acte III, Scène III) (Cf. Êtres humains. Âmes, Femmes. Peur, Relations entre êtres humains. Remords, Patriarcat)
Femme (« Réceptacle ») : 1995. Lu dans Jean Tulard, Guide des films. 1895-1995. LZ, concernant : 40 M2 [1986. Tevfik Baser] :
« […] Rien ne rapproche ici Turna de son mari, sinon d’être le réceptacle de son enfant. » 87 (Cf. Culture. Cinéma, Êtres humains, Corps. Vagins, Enfants, Femmes. Enceintes, Famille)
Femme (Renoncement) : Elle crut devoir renoncer à elle pour ‘être’ à lui. Elle se fit carpette. Il s’y couchât sur ce qu’il considéra - à juste titre - comme un don, plus tard, comme un dû : après usage, il l’épousseta, la plia, la rangea, remercia et s’en alla choisir une autre… carpette.
Femme (« Religion terrestre ») : (fin janvier) 1833. Honoré de Balzac [1799-1850] écrit à Ewelina Hanska [1801-1882] :
« Renoncer à la femme, à ma seule religion terrestre ! »
Et le 29 novembre 1833, il lui écrit : « Tu es toute ma religion […] un Dieu idolâtré. » 88 (Cf. Politique. Religion)
Femme (Résignée) : 1860. George Eliot [1819-1880], dans Le moulin sur la Floss, auteure de :
« Et, vous, vous n’êtes pas résignée : vous essayez seulement de vous engourdir. » 89
Femme (Respectée) : 1997. Odile Quintin, « ancien chef de Bureau Unité égalité des chances à la Commission européenne », concernant Marcelle Devaud [1908-2008], dans les années 1980, « son mentor dans les problématiques d’égalité [des chances dans les politiques européennes », auteure de :
« […] Elle est très respectée des hommes, parce qu’elle ne prend pas un ton de revendication. Elle a une approche d’affirmation, de valorisation du rôle que peuvent jouer les femmes dans la vie économique et sociale. Elle ne crie pas. Elle discute et négocie. » 90 (Cf. Féminismes, Politique. Égalité des chances. Europe)
Femme (Ridicule. Taine Hippolyte) : (10 avril) 1849. Hippolyte Taine [1828-1893], dans une lettre à sa sœur Virginie [1830-1890], auteur de :
« Ne montre pas ton goût pour les arts, la littérature, la science ; garde ces choses en toi-même ; là où tu es [chez des amis], elles sembleraient ridicules ; tu paraitrais enthousiaste et romanesques. Écris-moi et parle-moi de tout ce que tu penses […]. » 91 (Cf. Culture. Patriarcale, Femmes. Silence, Famille. Frères et sœurs, Penser, Histoire. Taine Hippolyte)
N.B. Combien de frères se sont-ils nourris de, enrichis par leur sœur - qu’ils contribuaient souvent eux-mêmes aussi à nourrir ?
Femme (« Rocher ») : (15 mars) 1926. L’abbé Mugnier [1853-1944], dans son Journal, après que Pierre Drieu la Rochelle [1893-1945] lui ait demandé « si la femme avait une âme » poursuit :
« Il a été question aussi de la femme, rocher auquel on attache son ancre. » 92 (Cf. Êtres humains. Âmes, Hommes. « Intellectuels ». Drieu La Rochelle Pierre, Patriarcat. Drieu La Rochelle Pierre)
Femme (« Rolls-Royce ») : (26 août) 2016. Guillaume Gallienne, au terme de l’émission : Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal, auteur de :
« Merci à mes Rolls-Royce de cette émission… » suivent les noms des femmes qui travaillent, avec lui, pour lui, dans ‘son’ émission. 93 (Cf. Langage. Possessif)
Femme (« Roue ») : 1880. Émile Zola [1840-1902], dans le cadre des Soirées de Médan, dans sa nouvelle, L’attaque du moulin, auteur de :
« Une écluse était aménagée, la chute tombait de quelques mètres sur la roue du moulin, qui craquait en tournant, avec la toux asthmatique d’une fidèle servante vieillie dans la maison. Quand on conseillait au père Merlier de la changer, il hochait la tête en disant qu’une jeune roue serait plus paresseuse et ne connaîtrait pas si bien le travail […]. » 94 (Cf. Femmes. Maison. Servantes)
Femme (« Salade de fruit ») : 1959. Bourvil [1917-1970] chante Salade de fuit, dont voici une strophe :
« […] Salade de fruits, jolie, jolie, jolie
Tu plais à mon père, tu plais à ma mère
Salade de fruits, jolie, jolie, jolie
Un jour ou l'autre il faudra bien
Qu'on nous marie […] »
Femme (Secret) : Lors d’une rencontre fortuite, qui ne devait donc pas se reproduire, elle lui confia deux de ses secrets : dans sa grande maison, elle se couchait tous les soirs à 20 heures et elle détestait sa mère.
Femme (Sénèque) : 63-64. Sénèque [4 avant J.C-65 après J.C], dans ses La constance du sage, auteur de :
« Il y a des gens assez déraisonnables pour s’imaginer qu’une femme pourrait les offenser. »
« […] La femme est toujours un être inconsidéré qui, à moins d’être devenue savante et très instruite, est rétive et ne peut résister à ses désirs. » 95 (Cf. Patriarcat)
Femme (Sensibilité) : (26 janvier) 1922. Katherine Mansfield [1888-1938], auteure de :
« J’ai un esprit d’une sensibilité effroyable, qui accueille toutes les impressions ; voilà la raison pour laquelle je suis si complètement entraînée et vaincue. »
À méditer… 96
Femme (« Sereine ») : 1689. Jean Racine [1639-1699], dans Esther, auteur de :
« Tout respire, en Esther, l’innocence et la paix
Du chagrin le plus noir, elle écarte les ombres
Et fait des jours sereins de mes jours les plus sombres. » 97
N.B. Enfin, disons - justement - qu’elle rend les jours d’Assuérus « sereins ».
Femme (« Serrure ») : 1942. Alberto Savinio [1891-1952], dans Hommes, racontez-vous, auteur de :
« Depuis la mort déjà lointaine de […], Baratta était restée sans homme, autant dire une serrure sans clé. Après bien des tergiversations, elle se décida à choisir un autre mari. […] » 98 (Cf. Femmes. Veuves, Sexes. [...])
Femme (Soutenir) : (Début des années) 1960. Lu dans Le Guide des jeunes ménages, dans le chapitre intitulé : ‘Habillement’, à la rubrique : ‘Pour Madame’, dans la sous rubrique ‘Gaines et Soutien-gorge’ :
« Dans toutes les occasions de la vie journalière, la femme a besoin d’être soutenue. […] » 99 (Cf. Êtres humains. Mode, Corps. Soutien-gorge, Patriarcat, Proxénétisme)
Femme (Suicide) : 1881. Lettre de Séverine [1855-1929], jeune, désespérée, à Jules Vallès [1832-1885], après que ses parents lui eurent refusé de le rejoindre à Londres, et écrite avant de se tirer une balle dans la poitrine :
« Je meurs de ce qui vous fait vivre. De révolte. Je meurs de n’avoir été qu’une femme alors que brûlait en moi une pensée virile et ardente. Je meurs d’avoir été une réfractaire. Aimez-moi un peu pour cela et gardez en cet esprit que j’ai si fort aimé et si profondément compris une place à votre navée petite amie. »
Heureusement elle ne mourut pas et sa famille, résignée, la laissa désormais agir à sa guise. Et elle devint : Séverine. 100 (Cf. Êtres humains. Suicide, Femmes. Comment meurent les femmes ? Remarquables. Séverine, Hommes. « Virils »)
Femme (« Suppliante ») : 1961. Dalida [1933-1987] chante : « Garde moi la dernière danse pour moi » :
« Vas danser toutes les danses que tu veux / Dans les bras de celles que tu entraînes au loin / Vas sourire des sourires merveilleux / Pour les danseuses dont tu tiens la main […]
Chantes et ris mais je t'en supplie / Pour une autre que moi / Ne donne pas ton cœur / Et n'oublies pas que ce sera toi / Qui me conduiras ce soir chez moi / Oh garde bien la dernière danse pour moi. »
Femme (Taille) : 2013. Louis Joinet [1934-2019], dans Mes raisons d’état. Mémoires d’un épris de justice, évoquant en 1983 les accusations concernant le CICP [Centre international de culture populaire, dénommé ‘Centre anti-impérialiste’], 14 rue de Nanteuil, dont son épouse était la présidente depuis 1982, d’être un « local de réunion de groupes terroristes européens » écrit :
« Et c’est Germaine, ma Germaine haute comme trois pommes, qui régnait sur ce nid de serpents, dans le temps que lui laisseraient ses multiples activités médicales et sociales ! » 101 (Cf. Femmes. Épouse de. « Politiques », Patriarcat)
Femme (Territoire) : (février) 1933. Anaïs Nin [1903-1977], dans son Journal, auteure de :
« Le territoire de la femme est ce que laisse intact le désir direct de l’homme. L’homme attaque le centre vital. La femme remplit la circonférence. » 102
Confus, mais puissant ? (Cf. Corps, Femmes. Frontières)
Femme (Torturée) : 1961. Robert Davezies [1923-2007], dans Le temps de la justice, transcrit les paroles - dont je ne reproduis que la fin - d’une jeune algérienne de 19 ans, arrêtée en avril 1957, mise nue, torturée à la villa Susini, à Alger, par un parachutiste - dont le chef Feldmeyer était un Allemand - donc par l’armée française :
« […] Alors ils m’ont enfoncé dans la bouche un chiffon trempé dans de l’huile d’auto. - Qui est ton chef ? - Je savais que quelqu’un avait parlé. - L’un d’eux, trapu, vingt-cinq ans : - ‘Nous allons lui mettre l’électricité là. Ça lui tuera les microbes’. J’ai levé le doigt. - Non. Faites de moi ce que vous voulez. Ne faites pas cela. - Il a répondu : -‘Parce que tu es vierge. Bon. On va te le faire dans les gencives.’ - Ils m’ont écoutée. - Ils l’ont fait. J’ai cru que mes dents allaient tomber. - Quelques jours après, les deux de devant sont tombées. - Puis ils m’ont mis l’électricité aux seins avec des pinces. -‘Parle, parle, qui c’est ? Tel jour tu étais ici, tel jour, tu étais là’. - Feldmeyer m’a mordu les lèvres jusqu’au sang. J’ai craché sur lui. Il mangeait le crachat. - C’est bon. - C’était un géant, je vous l’ai dit. - Il m’a détachée de la planche, m’a liée les bras et les jambes. Alors en me tenant pas les pieds, il m’a emporté la tête en bas, et il m’a enfoncée la tête, à plusieurs reprises, dans la cuvette sale des WC, puis, j’avais encore la tête dedans, il a tiré la chasse. - Ils m’ont fait encore la baignoire. L’eau était sale, infecte. La baignoire c’est le pire de tout. […] » 103 (Politique. Guerre. Algérie)
Femme (Trahison) : 1734. Montesquieu [1689-1755], dans les Considérations sur les causes de la grandeur des romains et de leur décadence, auteur de :
« La bataille d’Actium se donna. Cléopâtre fuit et entraina Antoine avec elle. Il est certain que dans la suite elle le trahit (Voyez Dion. Livre 1).
Une femme à qui Antoine avait sacrifié le monde entier le trahit. » 104 (Cf. Femmes. Remarquables. Cléopâtre, Hommes. « Grands », Historiographie. Patriarcale)
Femme (« Tout-court ») : (22 août) 2021. Entendu sur France Inter :
« Joséphine Baker [1906-1975] sera la première femme noire au Panthéon, la sixième femme tout-court. » (Cf. Culture. Patriarcale, Femmes. Remarquables)
Femme (« Tueuse ») : (4 décembre) 2024. Lu dans Le canard enchaîné (p.7), dans l’article consacré aux Mémoires d’Angela Merkel [Liberté, Albin Michel. 2004], ‘Mutti’, pas mutique, sous un portrait physiquement particulièrement dépréciatif :
« […] Elle passe sous silence son passé de tueuse, elle qui joignit sa pierre à celle des autres, pour faire chuter son mentor, Helmut Kohl [1930-2017], pris dans de sales affaires de corruption, et pour y préparer la succession. »
Femme (« Une femme et un Noir ») : (16 janvier) 2009. Noam Chomsky (à propos de la compétition entre Barak Obama et Hillary Clinton à la présidence des États-Unis) auteur de :
« Je crois que ce qui a été assez marquant dans la campagne démocrate, c’est qu’il y a eu une femme et un noir. » 105 Non : il y a eu une femme qualifiée de blanche et un homme qualifié de noir, c’est à dire deux êtres humains (un homme et une femme) qualifiés l’un par la seule couleur de sa peau, l’autre par le seul fait d’être une ‘femme’. L’inanité - apolitique - d’une telle opposition mérite d’autant plus d’être notée qu’elle émane d’un penseur - politique - tant vanté… (Cf. Penser. Pensées, Binaires. « Oui » ou « Non »)
* Ajout. 30 novembre 2015. (21 juin) 2015. Du même Noam Chomsky :
« Si vous allez dans le hall du MIT [Massachusetts Institute of Technologie, où il a enseigné] aujourd’hui, vous verrez parmi les personnes une moitié composée de femmes, peut-être un tiers de minorités. » 106 (Cf. Droit. Minorités, Hommes. « Intellectuels », Patriarcat, Politique. Minorités, Économie. Coronavirus)
* Ajout. 26 janvier 2018. 2010. Nelson Mandela [1918-2013], dans Un long chemin vers la liberté, évoquant l’Université Sud-africaine de Johannesburg - dont il était à la faculté de droit en 1943 « le seul étudiant africain » - écrit :
« Notre professeur de droit, Mr. Hahlo, était un intellectuel strict qui ne tolérait pas beaucoup l’indépendance de ses étudiants. Il avait une curieuse conception du droit quand on en est arrivé aux femmes et aux Africains : ni les uns ni les autres, a-t-il dit ne pouvaient devenir avocats. Il considérait que la loi était une science sociale et que les femmes et les Africains n’étaient pas suffisamment disciplinés pour en maitriser la complexité. » 107 (Cf. Droit, Êtres humains, Justice. Avocat-es, Hommes. « Politiques », Patriarcat, « Sciences » sociales)
Femme (« Vendue ») : 2003. Christine Ockrent, dans Françoise Giroud. [1916-2003] une ambition française, auteure de :
« Christiane Collange propose à son frère de transformer Madame Express en un magazine féminin à part entière (sic). Cette idée n’intéresse pas Jean-Jacques [Servan-Schreiber. 1924-2006] ; pour s’en débarrasser, il vend le projet à Pierre Lazareff [1907-1972] sans même en prévenir Christiane.
- ‘Et moi, qu’est-ce que je deviens ? lance celle-ci à son frère ?
- Je t’ai vendue avec, répond-il sans ciller. » 108 (Cf. Femmes. « Féminin », Dialogues)
Femme (« Vénéneuse ») : 2012. Lu, à la recherche sur le net du synonyme de « sulfureux » :
« Au sens figuré : Qui évoque l’enfer, l’hérésie, le démon qui sent le soufre. Se dit d’une femme ‘vénéneuse’. » 109 (Cf. Langage. Féminisation du Langage. Critique de mots : « Sulfureux »)
Femme (Vérole) : (22 octobre) 1822. Eugène Delacroix [1798-1863], dans son Journal, écrit :
« Mardi dernier - c’était le 15 - une petite femme de 19 ans, appelée Marie, est venue chez moi le matin pour poser. J’ai risqué la vérole avec elle. » 110
Femme (Vierge) : 1862. Victor Hugo [1802-1885], dans Les misérables évoquant la « servante » de Monsieur Maboeuf, « une variété de l’innocence », écrit :
« La pauvre bonne vieille femme était vierge. » Et il poursuit significativement :
« Aucun de ses rêves n’était allé jusqu’à l’homme. » 111 (Cf. Êtres humains, Corps, Femmes. Âgées. Servantes, Langage. Féminisation du langage. Hugo Victor)
-------------
II. Femmes (Artistes) :
Par ordre alphabétique. Femmes. Artistes :
Femmes (Artistes. Abba Marta) : Marta Abba [1900-1986], actrice et amour impossible de Luigi Pirandello [1867-1936] fut nommée par lui : sa « divine inspiratrice ». Il lui a dédicacé son dernier texte avant de mourir, ainsi : « À Marta Abba, pour que je ne meure pas ». 112
- L'éditeur italien U. Mursia a entrepris en 1971 une réédition des pièces de Pirandello dont Marta Abba détenait le copyright et qui appartiennent aux dix dernières années (1926-1936) de l'activité théâtrale du dramaturge sicilien.
« Tous les textes sont établis par Marta Abba elle-même, qui met à profit les nombreux documents inédits que lui a légués Pirandello. » 113
Femmes. Artistes. Actrices :
Femmes (Artistes. Actrices) (1) : Combien d’actrices ont-elles été détruites à vie - elles et / ou leur carrières - du fait des rôles que des metteurs en scènes, des réalisateurs, des producteurs - qui, eux, ont souvent construit leur carrière et gagné leur argent grâce à elles et sur elles - leur ont demandé de jouer ?
Par ordre chronologique. Femmes. Artistes. Actrices :
Femmes (Artistes. Actrices) (1) : 1850. François-René de Chateaubriand [1768-1848], dans les Mémoires d’Outre-tombe (avant la révolution) auteur de :
« Les actrices protégeaient les auteurs et devenaient quelquefois l’occasion de leur fortune. » 114
Femmes (Artistes. Actrices françaises d’antan) : 1929-1944. Arletty [1898-1992], Annabella [1907-1996], Joséphine Baker [1906-1975], Mireille Balin [1909-1968], Sylvia Bataille [1908-1993], Marie Bell [1900-1985], Blanchette Brunoy [1915-2005], Colette Mars [1916-1995], Marguerite Deval [1868-1955], Pauline Carton [1884-1974], Muse Dalbray [1903-1998], Danielle Darrieux, [1917-2017] Josette Day [1914-1978], Paulette Dubost [1910-2011], Edwige Feuillère [1907-1998], Simone Renant [1911-2004], Françoise Rosa [1891-1974] 115 (Cf. Femmes. Artistes. Chanteuses d’antan)
Femmes (Artistes. Adjani Isabelle) : (16 mai) 2018. Lu :
« L’Oréal vient de recruter comme ‘ambassadrice‘ Isabelle Adjani. Un contrat estimé, selon les pros à 400.00 euros qui a fait retrouver à l’actrice son apparence d’antan. » 116 (Cf. Êtres humains. Corps, Femmes. Apparence, Économie. Publicité)
Femmes (Artistes. Akerman Chantal) : (7 novembre) 2013. Écouter les nombreux documents sonores concernant Chantal Akerman [1950-2015], lors de la nuit de France Culture qui lui fut consacrée et notamment l’interview d’elle, le 7 novembre 2013, par le regretté [par moi…] Alain Veinstein, pour la publication de son livre, Ma mère rit. [2013] 117 (Cf. Femmes. Mères)
Femmes (Artistes. Alain Marie-Claire) : 2013. Marie-Claire Alain [1926-2013] organiste « avoua » à Marie-Louise Girod [1915-2014], elle-même organiste :
« Savez-vous que ce jour-là [lors d’un récital pendant la guerre], vous m’avez donné l’espoir de devenir une virtuose de l’orgue en dépit du fait que j’étais une femme ! » 118
De la vertu de l’exemple, mais le « en dépit » laisse un goût amer… (Cf. Femmes. Artistes. Girod Marie-Claire)
Femmes (Artistes. Anémone) : (30 avril) 2019. Anémone [1950-2019], auteure de :
« J’aurais bien aimé coucher avec un producteur, mais ils préféraient me faire travailler. »
Non, Anémone n’était ni « très folle », ni [irra] tionnelle » [Michel Blanc], ni « une fille qui s’était laissée aller » [Josiane Balasko], ni « largement fêlée » [Patrice Leconte].
Elle était une actrice qui avait démontré sa grande liberté de penser - qui en paya le prix- et qui avait le courage de dire « en public » ce que tant n’osent pas même penser « en privé ». (Cf. Féminismes. Humour)
Femmes (Artistes. Arbus Diane) : Diane Arbus [1923-1971] : Après les photographies de mode, elle dévoile, révèle, faire voir ce que le monde ne veut pas voir : l’humanité des ‘monstres’, des exclu-es, des marginaux-marginales, des pauvres, des laid-es, des étonnant-es, des inquiétants-e, des vivant-es, ainsi que le travestissement des autres.
Elle s’est suicidée.
Auteure de : « J’ai grandi en me sentant immunisée, exemptée des circonstances. Il y a une chose dont je n’ai pas souffert, c’est de ne jamais sentir l’adversité. J’étais confinée en dehors de la réalité. »
Femmes (Artistes. Ardant Fanny) : (18 septembre) 2019. Fanny Ardant, interrogée concernant la pièce dans laquelle elle joue, évoquant le metteur en scène, répond : « ça le regarde » et poursuit :
« J’aime bien l’idée : ‘Faites de moi ce que vous voulez’. » 119
Par ordre chronologique. Femmes. Artiste. Arletty :
Femmes (Artistes. Arletty) (1) : Arletty [1898-1992], après avoir, à 16 ans, perdu son premier amour, tué dans les premiers jours de la guerre de 1914-1918, auteure (sans date) de :
« Je ne serai jamais une veuve de guerre, ni une mère de soldat. » 120 (Cf. Femmes. Mères. Veuves, Politique. Guerre. Femmes)
Femmes (Artistes. Arletty) (2) : 1987. Arletty [1898-1992], auteure de :
« Je pouvais me balader dans dîner où il y avait beaucoup de monde, personne ne me pinçait les fesses, j’aime autant vous le dire, métier ou pas métier… » [Rires] (Cf. Comparaison Femmes / Hommes, Violences. Violences à l’encontre les femmes)
Auteure aussi de : « L’argent, c’est fait pour les fadas… » 121 (Cf. Économie. Argent)
Femmes (Artistes. Arletty) (3) : (20 décembre) 2021. Jacques Prévert [1900-1977] fit ce compliment concernant Arletty : [1898-1992] :
« Elle est pareille dedans, pareille dehors. » 122
-------------
Femmes (Artistes. Bacall Lauren) : 1979. Lauren Bacall [1924-2014], dans son Autobiographie, auteure de :
« […] Bon, le passé est le passé. Il m’a formée, m’a appris beaucoup de choses, mais le présent m’importe davantage. Je lutte pour acquérir le droit à mon identité propre ; je ne veux pas qu’on m’identifie pour l’éternité à un rôle joué à dix-neuf ans. Jusqu’à présent, j’ai toujours plus ou moins perdu cette bataille. Peut-être ne la gagnerai-je jamais. Mais je ne cesserai jamais le combat. » 123 (Cf. Patriarcat. Filliation)
Femmes (Artistes. Balzac Honoré de) : 1846. Honoré de Balzac [1799-1850], dans La cousine Bette, auteur de :
« […] Que pouvais-je faire de plus ? Dans la carrière du théâtre, une protection nous est nécessaire à toutes au moment où nous y débutons. Nos appointements ne soldent pas la moitié de nos dépenses, nous nous donnons donc des maris temporaires. » (Cf. Culture. Théâtre, Femmes. Travail, Homme. Époux, Famille. Mariage, Langage. Verbe. Mots. Critique de : « Protéger », Patriarcat. Domination masculine, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
La force d’une analyse… 124
Par ordre chronologique. Femmes. Artistes. Barbara :
Femmes (Artistes. Barbara) (1) : Barbara [1930-1997], auteure, compositrice, interprète de chansons inoubliables, dont trois, plus particulièrement, évoquent les violences de son père à son encontre : Au cœur de la nuit, L’aigle noir, Nantes. (Cf. Violences. Violences à l’encontre des enfants. Violences à l’encontre des femmes)
Femmes (Artistes. Barbara) (2) : Barbara [1930-1997] déclara :
« Je ne suis pas une chanteuse, je suis une femme qui chante. » 125
Femmes (Artistes. Barbara) (3) : 1998. Barbara [1930-1997], dans ses Mémoires interrompus, écrit concernant son père :
« […] Je garderai longtemps le souvenir du mélange de fascination, de peur, de mépris, de haine et d’immense désespoir que je ressentirai lorsque je le retrouvais mort, à Nantes, vingt ans plus tard (sans nouvelles de lui) … » 126 (Cf. Femmes. Peur, Relations entre êtres humains. Haine, Violences. Incestueuses)
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Artistes. Brigitte Bardot :
Femmes (Artistes. Bardot Brigitte) (1) : (13 septembre) 2012. Brigitte Bardot, auteure de :
« J’ai toujours fait ce qui m’a plu […] Je sais que j’ai plus de couilles que beaucoup d’hommes. Ils pourraient prendre exemple sur moi. J’ai toujours assumé ce que j’ai fait ou ce que j’ai dit. » 127
De la fragilité des mythes : un seul jugement pertinent les fait éclater comme une bulle de savon… (Cf. Êtres humains, Corps, Patriarcat, Penser. Mythe, Sexes. Hommes)
* Ajout : 4 mars 2017. Marine Le Pen aux fins de justifier son refus du « port du voile dans l’espace public » avait déclaré :
« La France, c’est Brigitte Bardot. » 128
De la fragilité des comparaisons… (Cf. Relations entre êtres humains. Comparaison, Patriarcat, Politique. Extrême-droite. Nationalisme)
Femmes (Artistes. Bardot Brigitte) (2) : (10 mars) 2017. Brigitte Bardot, auteure de :
« J’ai été prisonnière de moi-même toute ma vie. »
129 (Cf. Êtres humains. Soi)
Femmes (Artistes. Bardot Brigitte) (3) : (20 février) 2019. Brigitte Bardot soutient les « Gilets jaunes » parce qu’ « ils ont des couilles. » 130 (Cf. Êtres humains, Corps, Patriarcat, Sexes. Hommes)
-------------
Femmes (Artistes. Bell Marie) : 2001. Jean-Claude Brialy [1933-2007], dans Le ruisseau des singes, se souvient de Marie Bell [1900-1985] et écrit notamment :
« Elle avait été sociétaire à la Comédie française à l’époque où les femmes pouvaient y entrer grâce à un ministre ou à un ami influent […]. »
Il rapporte aussi l’une de ses réactions, adressée à Félicien Marceau [1913-2012], auteur et metteur en scène de la pièce de théâtre, Madame Princesse dans laquelle elle jouait :
« Dis donc, Félicien, Claudel et Racine ne m’ont jamais emmerdée. Ce n’est pas toi qui vas commencer. » 131
Femmes (Artistes. Bellon Yannick) : 1996. Yannick Bellon [1924-2019], au terme d’un interview, affirma :
« […] Nous (les femmes ou : les femmes cinéastes ?) n’avons plus rien à prouver. » 132 (Cf. Femmes. « Nous les femmes »)
Femmes (Artistes. Berganza Teresa) : (20 mars) 2020. Teresa Berganza, grande chanteuse mozartienne, auteure de : « Quelle vie difficile… […]. »
Et elle répète : « C’est une vie sacrifiée. »
Sur France Musique, je lis, concernant la même émission : « Ma vie n’a m’a pas été facile […] » 133
Par ordre chronologique. Femmes. Artistes. Sarah Bernhardt :
Femmes (Artistes. Bernhardt Sarah) (1) : (30 juillet) 1897. Jules Renard [1864-1910], dans son Journal, auteur de :
« Ces pièces de vers, ce sont des coques vides, et l’on met Sarah Bernardt [1844-1923], dedans. » 134
Femmes (Artistes. Bernhardt Sarah) (2) : 1923. Sarah Bernhardt [1844-1923], dans ses Mémoires, après avoir évoqué, à la Comédie Française, l’ « un des plus beaux triomphe de sa carrière », auteure de :
« Quelques artistes furent très contents, les femmes surtout, car il est une chose à remarquer dans notre art : les hommes jalousent les femmes beaucoup plus que les femmes ne se jalousent entre elles. J’ai rencontré beaucoup d’ennemis parmi les hommes comédiens, et très peu parmi les femmes comédiennes. […] » 135 (Cf. Êtres humains. Autocritique, Femmes. Jalouses, Patriarcat, Penser. Pensées. Bernhardt Sarah)
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Artistes. Rosa Bonheur :
Femmes (Artistes. Bonheur Rosa) (1) : (28 novembre) 1898. Rosa Bonheur [1822-1855], dans sa « Lettre testament », écrit notamment :
« […] Nous avons le droit, étant libres et célibataires toutes deux (concernant Anna Klumpke [1856-1942] et elle-même), de nous donner par notre travail les jouissances du confortable avec l’argent que nous gagnons par notre travail.
Ma famille m’ayant toute ma vie assez mal jugée en mon droit de vivre librement, après avoir d’abord fait mon devoir envers elle et ayant droit après à l’indépendance de toute personne majeure gagnant elle-même sa vie…
Je suis libre de faire ce qu’il me plaît et de défendre une bonne fois pour toutes l’honneur des autres (Nathalie) et le mien.
Je n’ai donc rien à me reprocher envers ma famille, et j’ai pensé que maintenant j’avais le droit de vivre pour moi et de disposer à mon gré de mon bien personnel, n’ayant eu ni enfant, ni tendresse pour le sexe fort, si ce n’est pour une franche et bonne amitié pour ceux qui avaient tout mon estime. […]
Quant à mes deux neveux, ce sont des hommes solides et bien portants, ils n’ont qu’à faire comme moi, car les hommes ayant la force physique ne doivent pas, s’ils sont fiers et braves, compter sur l’héritage d’une femme dont le travail a souvent été interrompu par les conditions de son sexe et qui ont fait avec raison penser aux hommes justes et dignes de ce titre, que l’homme est fait pour travailler pour la femme et les enfants ; mais hélas ! les femmes ont souvent été obligées de les remplacer quand ils manquent à leur devoir.
Je termine cette longue lettre explicative de ma volonté et de ma justice de tester en faveur d’une compagne artiste comme moi, gagnant noblement sa vie comme moi, désirant ainsi que moi continuer de travailler en paix, continuer sa carrière d’artiste et m’accompagner loyalement jusqu’au dernier jour de mon voyage en ce monde. » 136 (Cf. Femmes. Lesbiennes, Hommes. Force physique, Famille, Économie)
Femmes (Artistes. Bonheur Rosa) (2) : 1909. Rosa Bonheur [1822-1889], concernant Nathalie Micas [1824-1889], avec laquelle elle vécut jusqu’à la mort de cette dernière, auteure de :
« Souvent je me suis enfermée dans la chambre de Nathalie [après sa mort] pour songer aux côtés tragiques de ma vie. Quelle aurait été mon existence sans le dévouement et l’existence de mon amie ! Et pourtant on a cherché à rendre suspecte l’affection que nous éprouvions l’une pour l’autre. Il semblait extraordinaire que nous fassions bourse commune, que nous nous soyons légué réciproquement tous nos biens. Si j’avais été un homme, je l’aurais épousée et l’on n’eut pu inventer toutes ces sottes histoires. Je me serais créé une famille, j’aurais en des enfants qui auraient hérité de moi et personne n’aurait eu le droit de réclamer. » 137 (Cf. Relations entre êtres humains. Amour, Femmes. Dévouement. Lesbiennes, Famille. « Mariage pour tous »)
* Ajout. 20 août 2020. Entendu sur France Culture, concernant Rosa Bonheur [1822-1889] présentée comme une « femme à facettes » [!], aussi ainsi qualifiée d’« un peu lesbienne revendiquée ». 138 (Cf. Femmes. « Hommasses ». Lesbiennes, Langage. Adverbe)
-------------
Femmes (Artistes. Boulanger Nadia) : 1979. Ned Rorem [1923-2022], l’un des élèves de Nadia Boulanger [1887-1979], compositrice, chef d’orchestre et enseignante, déclara la concernant :
« Pour ce qui concerne la pédagogie musicale - et par extension la création musicale - elle est la personne la plus influente qui ait jamais vécu. »
Elle fut, toujours selon lui, « le plus grand maître depuis Socrate ». 139
* Ajout. 12 juillet 2020. Parmi ses élèves [estimés à 1.200], Quincey Jones, Aaron Copland, George Gershwin, Leonard Bernstein, Michel Legrand, Philippe Glass…
* Ajout. 29 janvier 2021. Écouter le récit de l’extraordinaire enfance d’Émile Naoumoff, très jeune élève de Nadia Boulanger.
- Lorsqu’elle l’entendit, enfant, pour la première fois, elle dit à ses parents :
« Je le prends comme élève pendant 10 ans. »
- À sa mère qui évoquait sa fatigue et son besoin de vacances, elle répondit :
« Quand on a les dons d’Émile, on ne prend pas de vacances ». Il n’en prit jamais.
- À la veille de sa mort, après 9 ans et demi de leçons quotidiennes de plus 3 heures et plus, Nadia Boulanger lui dit :
« […] Je sais que tu sais que tu me dois beaucoup. Mais je t’en dois bien plus. »
Mais ces phrases qui, parmi tant d’autres, m’ont frappée, ne sauraient rendre compte de la nature de leurs relations, ni de sa ‘pédagogie’, terme, en l’occurrence, bien grossier. (Cf. Enfants. Pédagogie) 140
Par ordre chronologique. Femmes. Artistes. Louise Bourgeois :
Femmes (Artistes. Bourgeois Louise) (1) : Louise Bourgeois [1911-2010], auteure de :
« Pour exprimer des tensions familiales insupportables, il fallait que mon anxiété s'exerce sur des formes que je pouvais changer, détruire et reconstruire. » 141
Parmi ses œuvres : La Destruction du père (1974) et Maman (2005).
* Ajout. 13 octobre 2014. Sans oublier le terrifiant Fillette [1968]. Le concernant - il s’agit de la représentation d’un monstrueux phallus transpercé par un câble - il faut lire les aberrantes présentations, commentaires, interprétations qui en ont été faites afin d’en masquer l’évidence, à savoir qu’un phallus a terrifié une petite fille. Et que Louise Bourgeois ait peu ou prou participé à en masquer la signification, n’invalide pas le jugement. (Cf. Violences. Violences. Incestueuses)
Femmes (Artistes. Bourgeois Louise) (2) : (11 septembre) 2019. Jean Frémon, concernant Louise Bourgeois [1911-2010], :
« Tout ce qui l’intéresse, elle l’intègre dans son œuvre. » 142
-------------
Femmes (Artistes. Callas Maria) : 1959. Maria Callas [1923-1976], auteure de :
« Je suis libre parce que je ne fais pas de concession. » 143 (Cf. Relations entre êtres humains. Concession, Penser. Liberté, Politique. Céder)
Par ordre chronologique. Femmes. Artistes. Agnès Capri :
Femmes (Artistes. Capri Agnès) (1) : Agnès Capri, [1907-1976], auteure de :
« Je voulais des gens propres ». Se sont exprimé-es dans son café-théâtre : Caura Vaucaire, Germaine Montero, Serge Reggiani, Jean Sablon, Juliette Gréco, Marc Ogeret, Catherine Sauvage, Pierre Louki, Georges Moustaki, les Frères Jacques…144 Bravo, l’artiste !
Femmes (Artistes. Capri Agnès) (2) : 1938. Agnès Capri [1907-1976] se remémore :
« [En 1938] J‘avais un contrat avec Pathé Marconi…un contrat à vie ; ils avaient créé une collection pour moi. Et puis, il y a eu la guerre, l’invasion, les nazis. Et on a supprimé les artistes juifs de Pathé Marconi. Et, quand je suis revenue, après Alger, en 1944, il y avait la même secrétaire. Alors, elle a accepté de retirer mes disques, à condition que je les paie. Et puis, comme j’ai mis huit jours de plus pour aller les chercher - j’avais très peu d’argent - elle les a envoyés à la casse en disant au directeur que ça ne se vendait pas. Et on a tout cassé. » 145 (Cf. Femmes. Chanteuses françaises d’antan, Économie. « Casse »)
-------------
Femmes (Artistes. Carol Martine) : 1966. Martine Carol [1920-1967], auteure, au terme de sa vie, à 46 ans, après quatre mariages, de :
« [Enfant], j’ai toujours préféré les garçons. Quoique, maintenant, j’ai des très bonnes amies filles. Et je les préfère. Enfin, c’est moins dangereux. Maintenant je préfère être avec des femmes qu’avec des hommes. » 146
Par ordre chronologique. Femmes. Artistes. Maria Casarès :
Femmes (Artistes. Casarès Maria) (1) : 1949. Maria Casarès [1922-1996], auteure de :
« Soyez donc une femme. Luttez ! » 147 (Cf. Culture. Cinéma, Politique. Luttes)
Femmes (Artistes. Casarès Maria) (2) : (21 mai) 2022. Entendu sur France Culture, Maria [Victoria] Casarès [1922-1996] dire :
« Je n’ai rien pris à qui que ce soit. »
Et elle a beaucoup donné. 148
-------------
Femmes (Artistes. Célarié Clémentine) : (7 avril) 1994. Clémentine Célarié embrasse sur la bouche, un homme séropositif, présent comme elle au Sidaction aux fins de démontrer les risques et les non risques de la non-contamination. Initiative spontanée, superbe et courageuse - qu’elle qualifie de « bêtise » - mille fois plus parlante que tout discours. (Cf. Relations entre êtres humains. Exemple, Politique. Exemple)
* Ajout. 17 juillet 2019. 2015. Pour comparaison de date : dans le premier tome des Éditions de La Pléiade des Œuvres de Michel Foucault [1926-1984], la chronologie présentée par Daniel Defert, « militant anti-sida, président fondateur de la première association française de lutte contre le sida Aides [1984-1991] » [Wikipédia] et par ailleurs son compagnon, ne fait aucune référence au sida concernant sa mort. Le terme de sida est cité dans le second tome. 149 (Cf. Hommes. « Intellectuels », Relations entre êtres humains. Sida)
Femmes (Artistes. Chanteuses algériennes d’antan) : (2 novembre) 2024. Écouter l’émission de France Culture de Zoé Sfez, La série musicale. Les divas algériennes [Cheikha Remitti, Reinette l’Oranaise, Souad Massi, Raja Meziane, Beihdja Raha, Cheikha Tetma, Fadila Dziriya, Chaba Fadela…]
Femmes (Artistes. Chanteuses françaises d’antan) : Yvette Guilbert [1865-1944], Anna Thibaud [1861-1948], Damia [1889-1978], Berthe Sylva [1885-1941], Fréhel [1891-1951], Colette Renard [Colette Raget. 1924-2010], Yvonne George [1896-1930], Mistinguett [Jeanne Florentine Bourgeois. 1875-1956], Germaine Montero [1909-2000], Agnès Capri [1907-1976], Marie Dubas [1894-1972], Lisette Jambel [1921-1976], Lys Gauty [1900-1994], Lucienne Boyer [1901-1983], Lily Pons [1898-1976], Germaine Béria [1891-1950], Marianne Oswald [1901-1985], Suzy Solidor [Suzanne Marion, Rocher. 1900-1983], Lucienne Delyle [1913-1962], Jacqueline François [1922-2009], Jeanne Aubert [1900-1988], Lucienne Dugard [1901-1968], Arletty [1898-1992], Germaine Sablon (considérée généralement comme la seule artiste résistante ; chante notamment Le chant des partisans) [1899-1985], Anna Marly (elle aussi résistante ; a participé, elle aussi, à la création du Chant des partisans) [1917-2006], Darty Paulette [1871-1944], Andrée Turcy [dite Andrée Turc [!]. 1891-1974], Christine Sèvres [1931-1981], Germaine Lix [1893-1986], Catherine Sauvage [1929-1998], Esther Lekain [1870-1960], Emma Valadon dite Thérésa [1837-1913], Suzanne Gabriello [Suzanne Galopet. 1932-1992], Mireille [Mireille Hartuch. 1906-1996], Cora Vaucaire [1918-2011], Mirane Esbly [?-?], Gribouille [Marie-France Gaite. 1941-1968], Cora Madou [Jeanne Odaglia. 1891-1971], Rina Ketty [Cesarina Picchetto. 1911-1996], Pierrette Bruno [1928-2015], Annette Lajon [1901-1984], Colette Magny [1926-1997], Édith Piaf [1915-1963], Patachou [Henriette Eugénie Ragon. 1918-2015], Simone Bartel [1922-?], Georgette Plana [1917-2013], Claire Leclerc [1915-2009], Léo Marjane [1912-2016], Florelle [Odette Rousseau. 1898-1974], Régine Flory [1888-1924], Pia Colombo [1934-1986], les sœurs (Louise et Odette) Étienne [1924-2016, 1928-2013], Elyane Célis [1914-1962] [Belge], Yvonne Printemps [1894-1977], Monique Morelli [1923-1993], Polaire [Émilie Marie Bouchaud. 1883-1939], Danielle Messia [1956-1985], Joséphine Baker [Freda Josephine Mc Donald. 1906-1975], Renée Lebas [1917-2009], Nita Berger [?-?], Lily Fayol [1914-1999], Eugénie Buffet [1866-1934], [Nicole Louvier [1933-2003], Dalida [Iolanda Gigliotti. 1933-1987], Magali Noël [Magali Noëlle Guiffray. 1931-2015], Christine Sèvres [1931-1981], France Aubert [?-?], Rosalie Dubois [1932-], Colette Chevrot [?-?], Annie Fratellini [1932-1997], Odette Laure [1917-2004], Michèle Arnaud [1917-1998], Lina Margy [1909-1973], Jeanne Moreau [1928-2017], Nita-Jo / Nitta-Jô [Jeanne Daflon. 1890-?], Ginette Garcin [1928-2010], Micheline Dax [Micheline Etevenon. 1924-2014], Rose Avril [1920-1973], Yvonne Darle [?-?], Simone Réal [?-?], Mathé Altéry, Mick Micheyl [Paulette Jeanne Renée Michey. 1922-2019], Emma Liebel [1873-1928], Miura [-?], Lily Lian [Liliane Lebon. 1917-2020], Yvette Giraud [1916- 2014], Denise Benoit [1919-1973], Lily Fayol [1914-1999], Lily Vincent [1926-2009] [Belge], Maurane [1960-2018], Marie Laforêt [1919-2019], Zizi Jeanmaire [1924-2020], Pola Negri [1897-1987] actrice, mais entendu d’elle une chanson : « Paradis »] Juliette Gréco [1927-2020], Suzy Delair [1917-2020], Anne Sylvestre [1934-2020] et ses inoubliables chansons féministes, Catherine Ribeiro [1941-2024]. Sans oublier Mado Robin [1918-1960] qui, extraordinaire cantatrice, ne méprisait pas les chansons (« Le temps des cerises »). (Cf. Femmes. Artistes. Actrices françaises d’antan)
Et, parmi celles qui, bien que toujours d’antan (pour moi…), n’en sont pas moins toujours présentes : Mama Béa [Béatrice Telkielski], Catarina Valenta, Marie Josée Neuville [Josée Françoise Deneuville], Line Renaud, Brigitte Bardot, Hélène Martin, Catherine Bardin, Michèle Bernard, Nana Mouskouri (Grecque de nationalité), Valérie Lagrange, Alice Dona, Georgette Lemaire, Francesca Solleville, Dominique Grange, Marie-Paule Belle, Régine [Regina Zylbeberg], Simone Langlois, Françoise Hardy, Nicoletta, Nicole Croisille, Hélène Delavault, Véronique Pestel, Isabelle Aubret, Sabine Viret, Dani, …
Et enfin, bien sûr, Brigitte Fontaine, Sapho, sans oublier la compositrice Marguerite Monnot. [10 juillet 2015]
Que de merveilles, de destins ! Que de pertes de mémoire, que l’on peut néanmoins au moins partiellement se remémorer… lorsque des archives existent toujours, encore.
Si je ne cite pas les jeunes chanteuses, les chanteuses contemporaines, à l’exception d’Agnès Bihl, la seule explication est celle de ma méconnaissance, de mon incompétence donc.
Par ordre chronologique. Femmes. Artistes. Mademoiselle Clairon :
Femmes (Artistes. Clairon Mademoiselle) (1) : (23 juillet) 1765. Voltaire [1694-1778], termine ainsi sa lettre à Claire-Josèphe-Hippolyte Léris de La Tude - dite mademoiselle Clairon - [1723-1803] :
« Adieu, Mademoiselle, soyez aussi heureuse que vous méritez de l’être. Croyez que je vous admire autant que je méprise les ennemis de la raison et des arts, et que je vous aime autant que je les déteste. Conservez-moi vos bontés. Je sens tout ce que vous valez. C’est beaucoup dire. » 150 (Cf. Femmes. Artistes. Lecouvreur Adrienne. Heureuses, Relations entre êtres humains. Admiration)
Femmes (Artistes. Clairon Mademoiselle) (2) : (5 août) 1765. Voltaire [1694-1778], dans une lettre de Nicolas-Claude Thieriot [1697-1772], écrit :
« Melle Clairon dit en prenant congé de M. le maréchal de Richelieu que son cœur était à M. de Valbelle, son âme à M. de Voltaire et son talent au roi. » 151 (Cf. Êtres humains. Âmes)
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Artistes. Camille Claudel :
Femmes (Artistes. Claudel Camille) (1) : « (À partir de) 1913. Camille Claudel [1864-1943], internée, auteure de :
- [à sa mère. mars 1913] : « Cela va-t-il durer longtemps cette plaisanterie-là ? Y en a-t-il pour longtemps ? Je voudrais bien le savoir. Après avoir tant souffert. C’est une drôle de surprise. »
- [à M. Pinard. mars 1913] : « Je me trouve par suite de combinaisons machiavéliques enlevée et internée de force à Ville Evrard. Si vous pouviez dire un mot pour moi, je vous en serais reconnaissante. »
- [à Henriette de Vertus. automne 1913] : « J’ai été enlevée par un cyclone moi et mon atelier, mais par un singulier effet de la tornade, mes plâtras ont filé directement dans la poche de Rodin et consorts, tandis que mon infortunée personne s’est trouvée transportée délicatement dans un enclos grillagé en compagnie de plusieurs aliénés. Je fais mon possible pour figurer honorablement dans cette aimable corporation : je n’y fais pas trop mauvaise figure. »
- [à son frère, Paul Claudel. 1915] : « J’aimerais mieux une place de bonne que continuer à vivre ainsi. »
- [à son frère Paul Claudel. mars 1927] : « Ce n’est pas ma place au milieu de tout cela, il faut me retirer de ce milieu : après 14 ans aujourd’hui d’un vie pareille, je réclame la liberté à grands cris. »
- [à son frère, Paul Claudel. mars 1930] : « Cela fait 17 ans que Rodin et les marchands d’objets d’art m’ont envoyé faire pénitence dans un asile d’aliénés. Après s’être emparés de l’œuvre de toute ma vie en se servant de B. (en note : probablement Philippe Berthelot [1866-1934]), pour exécuter leur sinistre projet, ils me font faire des années de prison qu’ils auraient si bien mérité eux-mêmes... Tout cela au fond sort du cerveau diabolique de Rodin. Il n’avait qu’une idée c’est que lui, étant mort, je prenne mon essor comme artiste et que je devienne plus que lui : il fallait qu’il me tienne dans ses griffes après sa mort comme pendant sa vie. »
- [à son frère, Paul Claudel. 1932/33] : « Dis-toi bien, Paul, que ta sœur est en prison. En prison et avec des folles qui hurlent toute la journée, font des grimaces et sont incapables d’articuler trois mots sensés. Voilà le traitement que, depuis près de vingt ans, on inflige à une innocente. »
- [à son frère Paul Claudel. novembre-décembre 1938] : « Mon cher Paul,
Hier, samedi, j’ai bien reçu les cinquante francs que tu as bien voulu m’envoyer et qui me seront bien utiles, je te l’assure (l’économe ne m’ayant pas encore payé les cinquante francs qu’il me doit malgré qu’on ait fait un bon il y a plus d’un mois). Tu vois combien il y a de difficultés dans cet asile et qui sait si ce ne sera pas pire dans quelque temps.
Je suis bien fâchée de savoir que tu es toujours souffrant, espérons que cela se remettra peu à peu. J’attends la visite que tu me promets pour l’été prochain, mais je ne l’espère pas ; c’est loin Paris, et Dieu sait ce qui arrivera d’ici là ?
En réalité, on voudrait me forcer à faire de la sculpture ici, voyant qu’on n’y arrive pas on m’impose toutes sortes d’ennuis.
Cela ne me décidera pas, au contraire.
À ce moment des fêtes, je pense toujours à notre chère maman. Je ne l’ai jamais revue depuis le jour où vous avez pris la funeste résolution de m’envoyer dans les asiles d’aliénés ! Je pense à ce beau portait que j’avais fait d’elle dans l’ombre de notre beau jardin. Les grands yeux où se lisait une douleur secrète, l’esprit de résignation qui régnait sur toute sa figure, ses mains croisées sur ses genoux : tout indiquait la modestie, le sentiment du devoir poussé à l‘excès, c’était bien là notre pauvre mère. Je n’ai jamais revu le portait (pas plus qu’elle !). Si jamais tu en as entendu parler, tu me le diras.
Je ne pense pas que l’odieux personnage [Rodin] dont je te parle souvent ait l’audace de se l’attribuer, comme mes autres œuvres, ce serait trop fort, la portrait de ma mère ! […]
Ta sœur en exil. »
N.B. Cette lettres, si vraie concernant leur mère, pour lui, accablante, a été laissée, dans son Journal [6 juillet 1938] sans la coller. 152
- En octobre 1943, Camille Claudel est inhumée dans le cimetière de l’asile d’aliéné-es de Monfavet, celle à qui Rodin écrivait en 1897 :
« Un génie comme vous est rare. » 153 (Cf. Êtres humains. Cerveaux, Femmes. « Seules ». Bonnes-à-tout-faire, Fitzgerald Zelda. Pelletier Madeleine. Séraphine Louis. Comment meurent les femmes ? Hommes. Remarquables, Claudel Paul [pour le relevé dans son Journal de ce qui concerne sa sœur], Politique. Prison)
Femmes (Artistes. Claudel Camille) (2) : 1987. Henri Guillemin [1903-1992] écrit, concernant la santé mentale de Camille Claudel [1964-1943], internée :
« Le dossier médical de Camille, qui nous a été révélé par Reine-Marie Paris (une petite-fille de Claudel [1868-1955]) parle de ‘bouffées délirantes’ dont elle était victime. Mais les quelques lettres que nous avons d’elle témoignent toutes (en italique) d’un indéniable et douloureux équilibre mental. Elle conjure, elle supplie qu’on la délivre de son ‘exil’, de son martyre. Elle dit : ‘Je n’ai pas mérité cela’. » 154
Mais la suite du texte d’Henri Guillemin, concernant la responsabilité d’Auguste Rodin, jugée simplement « bien injuste », est de mauvaise foi, aisément lisible. (Cf. Relations entre êtres humains. Mauvaise foi, Histoire. Historiographie. Patriarcale)
Femmes (Artistes. Claudel Camille) (3) : 2016. Je lis sur Wikipédia concernant Paul Claudel [1868-1955] :
« En septembre 1913, la sculptrice Camille Claudel, sœur de Paul, est internée en asile d’aliénés à la demande de la famille et à l'instigation de son frère Paul qui décide d'agir immédiatement après la mort de leur père. En trente ans d'hospitalisation, Paul Claudel ne va voir sa sœur qu'à douze reprises. Lors de la rétrospective qui lui fut consacrée en 1934, des témoins ont rapporté que Paul Claudel s'emporte : il ne veut pas qu'on sache qu'il a une sœur folle. À la mort de celle-ci, en 1943, Paul Claudel ne se déplace pas : Camille est inhumée au cimetière de Montfavet accompagnée du seul personnel de l'hôpital ; quelques années plus tard, ses restes sont transférés dans une fosse commune, ni Paul ni les membres de la famille Claudel n'ayant proposé de sépulture. » (Cf. Femmes. Aliénées)
Femmes (Artistes. Claudel Camille / Rodin Auguste) : 1894. Lu dans le Journal des Goncourt, le 10 mai 1894 :
« Marx (Roger, critique d’art) me parle ce matin, de la sculpteuse Claudel, de son collage un moment avec Rodin, collage pendant lequel il les a vus travailler ensemble, amoureusement, tout comme devait travailler Prud’hon et Melle Mayer. Puis un jour, pourquoi, on ne le sait, elle a quelque temps échappé à cette relation, puis l’a reprise, puis l’a brisée complètement. Et quand c’est arrivé, Marx voyait entrer chez lui Rodin tout bouleversé, qui lui disait en pleurant qu’il n’avait plus aucune autorité sur elle. » 155 (Cf. Hommes. Remarquables. Rodin Auguste, Patriarcat)
N.B. « Être à la colle » : vivre ensemble sans être mariée-s. (Cf. Langage. Verbe. Être)
-------------
Femmes (Artistes. Cousturier Lucie) : (4 septembre) 2019. Je lis dans Le Canard enchaîné à l’occasion de l’exposition Arts lointains au musée du Quai Branly, le nom de Lucie Cousturier [1876-1925] qui est évoqué en ces termes, concernant « l’origine du goût européen pour les arts africains :
« L’occasion de présenter les aquarelles de la peintre et écrivaine Lucie Cousturier, proche de Fénéon [1861-1944], qui prit fait et cause pour les tirailleurs Sénégalais. ».
Lire Wikipédia, la concernant. 156 (Cf. Culture. Musées, Histoire)
Par ordre chronologique. Femmes. Artistes. Damia :
Femmes (Artistes. Damia) (1) : Damia [1889-1973], bouleversante, dénommée « la tragédienne de la chanson ».
* Ajout. 28 août 2023. Pour l’historien Louis Chevalier [1911-2001], elle, comme les autres chanteuses dites réalistes, elles aussi des tragédiennes, s’inscrivait dans une longue tradition historique. Elle influencera en outre nombre de celles qui se sont inscrites dans son sillage.
Femmes (Artistes. Damia) (2) : (11 juin) 1929. Michel Leiris [1901-1990], dans son Journal, écrit :
« Vu Damia [1889-1973], à la sortie [de la Revue nègre du Moulin-Rouge] ; c’est une géante majestueuse ; haute et forte comme un tour, vêtue d’une façon luxueuse et extraordinairement démodée ; elle parle comme un cataclysme de la nature ; nul aspect corrompu, seulement la vie et la santé, avec tous les excès qu’un trop plein de force peut causer. Je ne la croyais tout de même pas aussi étonnamment belle. Elle domine tout et tout parait malingre à côté d’elle. […] » 157
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Artistes. Marlène Dietrich :
Femmes (Artistes. Dietrich Marlène) (1) : Marlène Dietrich [1901-1992], une femme généreuse, courageuse. L’entendre chanter « La vie en rose » réconcilierait avec ‘l’amour’. 158 (Cf. Relations entre êtres humains. Amour)
Femmes (Artistes. Dietrich Marlène) (2) : 1984. Marlène Dietrich [1901-1992], dans Marlène D., auteure de :
« […] Je n’ai jamais reproché à von Sternberg [Joseph von Sternberg. 1894-1969] son ton cinglant. Il avait tous les droits. Parce qu’il était l’homme qui me protégeait. Parce qu’il était aussi mon ami. Ses paroles étaient toujours justes. Il avait toujours raison. Je ne lui rendrai jamais assez grâce. […] Un maître. »
Dans le même livre, je lis : « Je n’ai pas découvert Dietrich, remarquait souvent von Sternberg, Je suis un professeur et ce professeur a été frappé par une jolie femme, a soigné sa présentation exalté ses charmes, masqué ses imperfections, la façonnée pour cristalliser en elle une représentation aphrodisiaque. »
Je lis ensuite sur Wikipédia : « Dans ses souvenirs, Sternberg affirmera avoir créé de toutes pièces le mythe de Marlène et minimisera le rôle de son interprète, qui protestera. » (sans source) 159
Femmes (Artistes. Dietrich Marlène) (3) : 1984. Marlène Dietrich [1901-1992], dans Marlène D. rapporte que, pour le film L’ange bleu [1930], elle, certes alors inconnue fut payée, cinq mille dollars et Emil Janings [1884-1950], « cet acteur psychopathe », deux cent mille dollars. 160 (Cf. Êtres humains. Valeur, Économie. Argent)
-------------
Femmes (Artistes. Dorval Marie) : 1848. Marie Dorval [comédienne. 1798-1849], dans une lettre à George Sand [1804-1876], qualifie sa « profession » de « haïssable ». 161
Femmes (Artistes. Dubost Paulette) : 1992. Écouter Paulette Dubost [1910-2011] évoquer sa vie : une bouffée de bonheur. 162
Femmes (Artistes. Duc Hélène) : 2005. Hélène Duc [1917-2014], dans Entre cour et jardin, auteure de :
« Les blessures que nous font les metteurs en scène, parfois simplement en ne nous choisissant pas, ne cicatrisent jamais. Si l’on peut tout supporter quand on se sent aimé, on s’écroule quand on ne l’est pas assez. » 163 (Cf. Culture, Êtres humains. Relations entre êtres humains. Aimer)
Femmes (Artistes. Duncan Isadora) : 1927. Isadora Duncan, [1877-1927], dans Ma vie, auteure de :
- « Mon art était déjà en moi quand j’étais petite fille, et c’est grâce à l’esprit héroïque et aventureux de ma mère qu’il ne fut pas étouffé. »
- « Mon idée, en fait de danse, était qu’il fallait exprimer les sentiments et les émotions de l’humanité. »
- « Je méditais sur les différences étranges qui séparent l’Art de la Vie, et je me demandais si une femme peut vraiment être une artiste, car l’Art est un maître exigeant qui réclame tout pour lui seul, et une femme qui vit donne tout à la vie. Quoi qu’il en soit, pour la seconde fois, [enceinte], j’étais immobilisée, séparée de mon art. »
- « Donnez la beauté, la liberté et la force aux enfants. Donnez l’art au peuple qui le demande. La grande musique ne doit pas être plus longtemps gardée pour le bonheur de quelques privilégiés cultivés ; elle doit être donnée gratuitement aux masses ; elle leur est aussi nécessaire que l’air et le vin, car elle est le vin spirituel de l’humanité. »
- « Dans ce théâtre, j’espérais réaliser mon rêve de ramener les arts de la musique, de la tragédie et de la danse à leurs formes les plus pures. »
- « L’Art donne unité et harmonie à ce qui, dans la vie, est chaos et discorde. »
- « L’impulsion de mon art était trop forte. Je ne pouvais l’arrêter même pour plaire à celui que j’aimais. » 164 (Cf. Culture, Femmes. Remarquables. Duncan Isadora, Famille. Mariage. Duncan Isadora, Politique. Démocratie. « Masses ». Peuple)
Femmes (Artistes. Dupré Catherine, dite Mademoiselle de Seine) : (18 avril) 1732. Voltaire [1694-1778] écrit à Jean-Baptiste-Nicolas de Formont [1694-1758] :
« Vous savez que la petite Dufresne [Catherine-Marie-Jeanne Dupré, dite mademoiselle de Seine. 1705-1767], in articulo mortis [à l’article de la mort] a signé un billet conçu en ses termes : ‘Je promets à dieu et à M. le curé de Saint-Sulpice de ne jamais remonter sur le théâtre.’ » Elle ne tint pas sa promesse et remonta sur les planches en 1733. 165
En souvenir de toutes les avanies - le terme étant trop faible - imposées par l’église catholique aux artistes, comédiens, comédiennes… (Cf. Patriarcat. Église catholique)
Femmes (Artistes. Duse Eleonora) : 1927. Concernant Eleonora Duse [1858-1924], Isadora Duncan [1877-1927], dans Ma vie, qui fut son amie, écrivit cet hommage :
- « […] Eleonora Duse était un être exceptionnel. Son cœur était si grand qu’il pouvait contenir toute la tragédie du monde, son esprit était le plus radieux qui ait jamais lui à travers les sombres tristesses de cette terre. » Ce, après avoir écrit :
- « […] La Duse n’aimait pas qu’on la dévisageât. Elle prenait les petites allées, les sentiers, pour éviter d’être vue pas la foule. Elle n’aimait pas comme moi la pauvre humanité. Elle considérait la plupart de ces gens comme de la canaille, alors qu’ils la regardaient de tous les yeux éblouis. Cela tenait à sa nature avant tout exagérément sensible. Elle s’imaginait que les gens la critiquaient. Quand elle avait personnellement affaire au peuple, personne ne montrait plus qu’elle de douceur et de bonté. » Et aussi :
- « Eleonora n’était qu’une femme, malgré tout son génie [...]. » 166 (Cf. Femmes, Politique. Démocratie. Peuple)
Par ordre chronologique. Femmes. Artistes. Kathleen Ferrier :
Femmes (Artistes. Ferrier Kathleen) (1) : Le chef d’orchestre Bruno Walter [1876-1962], concernant la chanteuse contralto Kathleen Ferrier [1912-1953], auteur de :
« Parmi les grands choses qui me sont arrivées dans ma vie, c’est d’avoir rencontré Kathleen Ferrier et Gustave Malher [1860-1911]. Et je dis bien dans cet ordre. » 167
Femmes (Artistes. Ferrier Kathleen) (2) : 2004. Elisabeth Schwarzkopf [1915-2006], dans Les autres soirs. Mémoires, écrit concernant le concert du 15 juin 1950 :
« Quand Kathleen [Ferrier. 1912-1953] attaquait son Agnus de la Missa Solemnis [Beethoven. 1827], avec son souffle et son timbre incomparable, et cette sensibilité qui, à l’évidence était une spiritualité, la salle entière retenait ses larmes. Et Karajan [Herbert Von. 1908-1989], cet homme si volontairement impassible et dur, Karajan, lui, ne les retenait pas ! » 168 (Cf. Hommes. Pleurs)
-------------
Femmes (Artistes. Feuillère Edwige) : 2005. Hélène Duc [1917-2014], dans son livre Entre cour et jardin, présente ainsi Edwige Feuillère [1907-1998] :
« On a beaucoup écrit sur Edwige Feuillère, mais quelle que soit la qualité de l’analyse et de l’approche, c’est dans son livre, Les feux de la mémoire, qu’elle se découvre et qu’on la découvre le mieux. Elle ne se livre pas, mais elle donne beaucoup d’elle-même. Avec élégance et mesure, comme toujours. […]
Elle allie à sa passion intérieure une superbe intelligence et un sens critique vis à vis d’elle-même. Jamais une bavure, jamais le ‘flou’, jamais de procédé pour esquiver une difficulté de mouvement ou de texte. Elle soulève la montagne en souriant. Tous ses rôles sont des festivals de virtuose. […]
Elle est passée du cinéma au théâtre et du réalisme au lyrisme et à la pure poésie de Claudel avec simplicité et naturel, non pas sans effort sans doute, mais comme si de rien n’était, comme s’il lui était imparti de donner toutes les nuances, la force, les subtilités au texte. […]
Edwige est à mes yeux la plus symbolique, la plus variée, la plus complète des actrices de ces temps. Peut-être aussi la plus pure, car elle semble n’avoir jamais été entachée d’aucune complaisance, d’aucune intrigue, ni d’aucune mesquinerie. Mais elle était sans doute, comme tous les élus, solitaire dans son âme. » 169 (Cf. Êtres humains. Âmes)
Femmes (Artistes. Fernandez Esperanza) : 2002. Esperanza Fernandez, guitariste, auteure de :
« […] Mon premier disque, j’ai attendu très longtemps avant de le faire, car je voulais murir comme artiste et comme femme. Je ne regrette pas de ne pas avoir enregistré ce disque plus tôt. Aujourd’hui, je suis très heureuse car j’ai fait ce que je souhaitais sans être manipulée par personne. Dans ce disque se reflète tout ce que j’ai fait durant ma carrière. Je chante déjà depuis 20 ans. […] » 170 (Cf. Femmes. Heureuses)
Femmes (Artistes. Fontaine Brigitte) : Une fois encore, ‘on’ fera semblant de découvrir, après la disparition de Brigitte Fontaine, l’importance de son œuvre.
Femmes (Artistes. Forestier Sara) : (7 novembre) 2017. Sara Forestier, sur France 2, explicite son refus d’être maquillée et coiffée, avant d’être interviewée. Elle pose sa responsabilité en tant qu’actrice :
« Il y a une injonction à être sexy, toujours, à être glamour, alors qu'une femme, n'est pas que ça. […] Mon métier, ce n'est pas d'être sexy, ce n'est pas d'être glamour, c'est de créer de l'émotion. » 171 (Cf. Corps, Sexes. Sexualité)
Femmes (Artistes. Foucher Adèle) : 1821. Victor Hugo [1802-1885] écrit à Adèle Foucher [1803-1868] dont il est le cousin et qui deviendra son épouse :
- le 16 mars 1821 : « […] Cultive ton talent charmant [le dessin], mais que ce ne soit jamais pour toi qu’un talent charmant, jamais un moyen d’existence. Cela me regarde. Je veux que dans la vie ce soit toi qui aies tout le plaisir, toute la gloire ; moi, toute la peine. […] »
- Une note précise : « Victor Hugo était hostile aux femmes artistes et en particulier à Julie Duvidal. » [professeure de dessin d’Adèle Foucher].
- le 1er/ 2 novembre 1821 : « Tu me parles d’une artiste pour laquelle tu me demandes de l’estime. Je ne demande pas mieux. Mais pourquoi est-elle artiste ? Tu connais là-dessus mes invariables idées, plutôt du pain et de l’eau ! […] »
- le 31 octobre 1821 : « Je me demande d’où peuvent venir tes douleurs de côté. J’en connais une cause, sur laquelle, je consulterai certainement quelque médecin célèbre. La peinture te nuit, du moins j’en suis persuadé.
Les attitudes fatigantes que cet art oblige à prendre, les principes vénéneux qui s’échappent continuellement en vapeur subtile des couleurs, qui sont pour la plupart minérales, en voilà plus qu’il n’en faut pour attaquer les organes extérieurs et intérieurs du corps. La plupart des peintres ont la santé dégradée.
Ô mon Adèle, serai-je condamné à voir cette funeste expérience se renouveler sur toi, sur le seul être qui me fait chérir la vie !
Si ton mari [le mariage n’a pas eu lieu] avait l’autorité de tes parents, il se contenterait de te voir cultiver ton talent charmant pour le dessin, et ne s’exposerait pas, en te livrant au travail de la peinture, à voir tes heureuses dispositions te devenir fatales.
Je consulterai certainement quelque médecin célèbre sur les dangers de ce travail pour un être aussi frêle et aussi délicat qu’une jeune fille.
Que n’ai-je quelque pouvoir sur toi ! J’ai craint un moment autrefois que tu ne destinasses à la profession d’artiste, profession incompatible avec le rang que tu dois occuper dans la société.
Aujourd’hui que tu ne cultives la peinture que comme talent d’agrément, je tremble encore, et bien plus, car c’est pour ta santé. »
- le 12 et 13 novembre 1821 : « Va mon Adèle, aime-moi comme je t’aime, et je me charge du reste. […]
Et surtout, ne me parles plus de travailler, etc., etc., Chaque fois que tu touches cette corde, tu m’affliges vivement. Aie quelque croyance en mes forces. […] »
- le 13 et 15 décembre 1821 : « Sache, chère et charmante amie, que tu as la plus belle des sciences, celle de toutes les vertus. Au reste, les connaissances futiles et purement relatives que tu voudras posséder ne serve en rien au bonheur. Tout ce qui s’acquiert ne vaut pas la peine de s’acquérir. »
- le 3 février 1822 : « Il suffit qu’une femme appartienne au public sous un rapport pour que le public croit qu’elle lui appartient (vérifier) sous tous. Comment d’ailleurs supposer qu’une jeune fille conserve une imagination chaste et par conséquente des mœurs pures après les études qu’exige la peinture, étude pour lesquelles il faut d’abord abjurer la pudeur, cette première vertu de l’homme et de la femme. Ensuite, convient-il à une femme de descendre dans la classe des artistes, classe dans laquelle se rangent comme elle les actrices et les danseuses ? Je t’expose ici des idées sévères, mais qui sont justes selon le monde et selon la morale. Ces idées d’ailleurs ne sont pas nées d’hier chez moi et il y a bien longtemps que je te les ai communiquées et l’exemple que tu as sous les yeux ne les confirme que trop. C’est pour cela que j’ai toujours applaudi à ta répugnance pour la peinture, même considérée comme talent d’agrément. »
- le 8 février 1822 : « Quant aux artistes, je t’ai toujours conseillé de ne pas les voir. J’ai toujours pensé de même sur cette profession qui déconsidère, certes les femmes, puisqu’elle déconsidère les hommes. […]
Je ne doute pas que ces idées ne s’accordent avec les tiennes. Ainsi, n’en parlons plus. »
- le 5, 6, 8 et 9 février 1822 : Lettre d’Adèle Foucher à Victor Hugo :
« Tu exposes des préjugés bien sévères en condamnant la peinture, même comme talent d’agrément. Mais puisque tu trouves cela nuisible, je te crois. […] » 172 (Cf. Culture. Art « d’agrément », Droit. Droits / Devoirs, Êtres humains. Pudeur, Femmes. Jeunes filles. Pudeur. Vertu, Hommes. Remarquables. Hugo Victor, Famille. Mariage, Patriarcat, Penser. Pensées. Préjugés)
N.B.1. Les résistances d’Adèle Foucher avant la dernière lettre citée sont nombreuses.
Il faudrait les ajouter.
N.B.2. Je vois dorénavant d’un tout autre regard les (mauvais) dessins de Victor Hugo.
Femmes (Artistes. Fréhel) : Fréhel [1891-1951], auteure de :
« Fermez vos gueules. J’ouvre la mienne » [au public du Bœuf sur le toit]. 173
La vie bouleversante d’une femme bouleversante…
Femmes (Artistes. Gardin Blanche) : (29 mai) 2017. Blanche Gardin, lors de la 29ème cérémonie des Molière, concernant les artistes accusés de viols, d’agressions, de harcèlements, en réaction à l’injonction si souvent entendue, citée par elle :
« Il faut savoir séparer l’homme de l’artiste », auteure - courageuse - de cette forte conclusion :
« D'ailleurs c'est bizarre cette indulgence qui ne s'applique qu'aux artistes. Par exemple, on ne dit pas d'un boulanger : ‘Oui, d'accord, c'est vrai, il viole un peu des gosses dans le fournil mais, bon, il fait des baguettes extraordinaires ! » 174 (Cf. Relations entre êtres humains. Indulgence, Violences. Viols)
Femmes (Artistes. Goya Chantal) : 1962. Chantal Goya, concernant le tournage de Masculin Féminin, se souvient :
« J’avais 18 ans. […] Godard [1930-2022] voulait que je sois à poil dans la salle de bains et j'ai dit non. Je me suis cachée sous le lavabo. Marlène (Jobert) s'est déshabillée, m'a dit de ne pas m'en faire, qu'elle passerait à deux reprises devant la caméra de façon à faire croire qu'il s'agissait de moi une fois. Tu parles ! Godard avait bien vu. Il m'a dit : vous ne serez jamais une star. Je lui ai répondu : la seule « Vedette » [en synonyme de « star »] que j'ai, c'est ma machine à laver. » 175 (Femmes. « Féminin ». Nudité)
Ce sont aussi par ce type de réactions, jamais, en tant que telles, politiquement analysées, que les femmes s’opposent, résistent aux hommes. Nul-le n’est besoin pour cela d’être qualifiée de féministe, encore moins d’intellectuelle. (Cf. Culture. Cinéma, Femmes. « Féminin », Violences. Violences à l’encontre des femmes. Godard Jean-Luc)
Femmes (Artistes. Girod Marie-Louise) : 2003. Dans un livre consacré à l’organiste Marie-Louise Girod [1915-2014], je lis qu’elle aurait choisi l’orgue « pour que le public ne la voit pas. » La lecture du livre ne permet pas s’arrêter à cette analyse. 176 (Cf. Femmes. Artistes. Alain Marie-Claire)
Femmes (Artistes. Grimaud Hélène) : 2003. Dans un livre autobiographique, Variations sauvages, la musicienne Hélène Grimaud rapporte le message que lui avait transmis, au terme d’une master class, le pianiste et chef d’orchestre, Léon Fleischer :
- « […] Restez à l’écart tant que vous n’avez pas trouvé votre propre système […] On m’a dit que vous vouliez continuer seule. C’est une entreprise tout à fait louable et vous avez tout ce qui faut pour parvenir. Allez-y. »
Elle y évoque aussi le regard que l’on portait sur elle :
- « ‘Trop belle pour être intelligente’, par exemple. Ou : ‘Ravissante comme elle l’est, elle n’a pas besoin de travailler’ Ou : ‘Combien dites-vous d’heures de travail par jour ?’ et je comprenais que mon interlocuteur convertissait ces heures en un gigantesque gâchis, du pur gaspillage eu égard à la frivolité d’une existence à laquelle mes cheveux blonds et mes yeux bleus me donnaient droit. » 177 (Cf. Femmes. Intelligentes)
Par ordre chronologique. Femmes. Artistes. Alice Guy :
Femmes (Artistes. Guy Alice) (1) : 2018. Alice Guy [1873-1968] : première femme réalisatrice [française] de cinéma [elle le fut de plus de mille films] ; certains disent avant George Méliès, [1861-1938] sa Fée aux choux datant du début de l’année 1896. 178
Femmes (Artistes. Guy Alice) (2) : (11 décembre) 2019. Écouter la remarquable émission au cours de laquelle les femmes [Je relève, sans pouvoir distinguer les apports de chacune, les noms de Claire Clouzot, Nicole-Lise Bernheim, Delphine Seyrig, Liliane de Kermadec, Colette Audry] tout à la fois révèlent l’immense importance d’Alice Guy [1873-1968] et récusent les arguments défendus par les hommes pour en dénier l’importance.
Une grande leçon d’analyse critique féministe de l’historiographie patriarcale. 179 (Cf. Culture, Patriarcat, Penser. Méthode, Histoire. Historiographie. Patriarcale)
Femmes (Artistes. Guy Alice) (3) : (12 septembre) 2020. Une seconde émission de France Culture très riche redonne l’importance qui fut la sienne à Alice Guy.
Elle réalisa trois films que l’on peut qualifier de féministes : Les résultats du féminisme, Madame a des envies, An american citizen (qui pourrait être considéré comme dénonçant les violences à l’encontre des femmes). 180
* Ajout. 7 juin 2025. 1984. Lire, concernant Alice Guy, Dominique Desanti [1914-2011], La femme au temps des années folles. 181
-------------
Femmes (Artistes. Holiday Billie) : 1939. Billie Holiday [1915-1959] chanta, en 1939, pour la première fois Strange fruit, l’un des premiers chants antiracistes, 16 ans avant que Rosa Parks [1913-2005] refusa de laisser son siège dans un bus. 182 (Cf. Femmes. Remarquables. Parks Rosa)
Femmes (Artistes. Huppert Isabelle) : (9 août) 2021. À l’écoute d’une émission de France culture consacrée au film La leçon de piano [1993] de Jane Campion, présenté, commenté par Isabelle Huppert, celle-ci est introduite par une longue présentation des films auxquels elle a participé. Je me demande comment cela pouvait être supportable. Et puis, plutôt, je me suis demandée : comment peut-on ne pas penser que cela puisse être vécu comme insupportable par d’autres ? Et, enfin, à quel point cela est inapproprié ?
N.B. Cette analyse critique est valide pour toutes les personnes invitées dans le cadre de cette série d’émissions ; donc, l’attribuer à Isabelle Huppert n’est pas juste.
Femmes (Artistes. Juliette) : 1997. Juliette, merveilleuse interprète de : Rimes féminines. Entre autres chansons… (Cf. Femmes. « Féminin »)
Par ordre chronologique. Femmes. Artistes. Kaplan Nelly :
Femmes (Artistes. Kaplan Nelly) (1) : 2018. Nelly Kaplan [1931-2020], auteure de :
« Je n’ai jamais su négocier. » 183 (Cf. Culture. Cinéma. La fiancée du pirate)
Femmes (Artistes. Kaplan Nelly) (2) : (2 août) 2025. [1ère diffusion. 20 décembre 1956] Entendu, sur France Culture, dans une passionnante émission : Les rêves perdus d’Abel Gance, Abel Gance [1889-1981], vanter les mérites de « mademoiselle Kaplan » [1931-2020], qui alors travaillait avec lui.
Femmes (Artistes. Kaplan Nelly) (3) : [Même jour] (2 août) 2025. Vu sur TCM, trois films réalisés par Nelly Kaplan [1931-2020], consacrés à trois peintres : Picasso [1881-1973], Rodolphe Bresdin [1822-1885], Gustave Moreau [1826-1898].
-------------
Femmes (Artistes. Kauffmann Angelica) : 1792. Élisabeth Vigée-Lebrun [1755-1842] raconte dans ses Souvenirs, sa rencontre avec Angelica Kauffmann [1741-1807], qu’elle considère comme l’« une des gloires de notre sexe » :
« J’ai été voir Angelica Kauffmann que j’avais un extrême désir de connaître. Je l’ai trouvée bien intéressante, à part son beau talent, par son esprit et ses connaissances. C’est une femme qui peut avoir cinquante ans, très délicate, sa santé s’étant altérée par suite du malheur qu’elle a eu d’épouser d’abord un aventurier qui l’avait ruinée. Elle s’est remariée depuis à un architecte qui est pour elle un homme d’affaires. Elle a causé avec moi beaucoup et très bien, pendant les deux soirées que j’ai passées chez elle. Sa conversation est douce ; elle a prodigieusement d’instruction, mais aucun enthousiasme, ce qui, vu mon peu de savoir, ne m’a point électrisée.
Angelica possède quelques tableaux des plus grands maîtres, et j’ai vu chez elle plusieurs de ses ouvrages ; ses esquisses m’ont fait plus de plaisir que ses tableaux, parce qu’elles sont d’une couleur Titianesque. […] » 184
Femmes (Artistes. Khaltoum Oum) : 1985. Lu sur Wikipédia concernant l’enterrement d’Oum Khaltoum [1878-1985] :
« Des stars du cinéma, des poètes, des hommes d'affaires, des ambassadeurs, des ministres ainsi que de nombreux anonymes ont formé un cortège de plus d'1,5 km (pour environ trois millions de personnes vivant au Caire) formant le deuxième plus grand rassemblement d'Égypte, après les funérailles de Nasser [1918-1978]. Les Cairotes se sont emparés du cercueil et l'ont promené pendant trois heures dans les rues du Caire avant de le conduire à la mosquée al-Sayyid Husayn, une des favorites d'Oum Kalthoum. » 185
* Ajout. 10 mars 2020. Elle était notamment nommée « l’astre de l’Orient », la « quatrième pyramide » …
De l’alliance de l’amour, de la culture, du nationalisme arabe…
Femmes (Artistes. Khalo Frida) : 2017. Entendu concernant Frida Khalo [1907-1954] :
« Elle a construit sa légende [...], son personnage […], son positionnement […]. »
Non. Elle a vécu, comme elle a pu et comme elle a voulu. 186 (Cf. Femmes. Mères)
Femmes (Artistes. Malibran Maria) : Maria Malibran dite La Malibran [1808-1836] :
« Merveille des merveilles » disait d’elle Frédéric Chopin [1810-1849].
Morte, des conséquences d’une chute de cheval, à 28 ans.
Femmes (Artistes. Lecouvreur Adrienne) : (27 août) 1761. Voltaire [1694-1778], dans une lettre à Claire-Josèphe-Hippolyte Léris de la Tude Clairon [mademoiselle Clairon] [1723-1830], auteur de :
« […] Lorsque le curé de Saint-Sulpice, Languet, le plus faux et le plus vain de tous les hommes, refusa la sépulture de Melle Lecouvreur [Adrienne. 1692-1730], qui avait légué mille francs à son église, je dis à tous vos camarades assemblés qu’ils n’avaient qu’à déclarer qu’ils n’exerceraient plus leur profession [de comédien-nes] jusqu’à ce qu’on eût traité les pensionnaires du roi comme les autres citoyens qui n’ont pas l’honneur d’appartenir au roi (sic). Ils me le promirent et n’en firent rien. Ils préférèrent l’opprobre avec un peu d’argent, à un honneur qui leur eu valu davantage. »
N.B. Lu sur Wikipédia : « Elle fut enterrée à la sauvette par des amis du maréchal de saxe et de Voltaire dans le marais de la grenouillère (actuel Champs de mars). Voltaire, scandalisé exprime son indignation dans le poème La mort de Melle Lecouvreur :
Et dans un champ profane on jette à l’aventure
De ce corps si chéri les restes immortels. […]
Dieux ! pourquoi mon pays n’est-il plus la patrie ?
Et de la gloire et des talents ?’ » (Cf. Femmes. Artistes. Clairon Mademoiselle)
Femmes (Artistes. Lens Aline R. de) : Aline R. de Lens [1881-1925], auteure, dans son Journal [1902-1924], de :
« Maintenant, j'ai l'enthousiasme, l'ambition, les joies du travail. Je suis au début, j'ai le droit d'espérer, de faire des rêves.
Je me sens fière vis à vis des hommes. Pour les uns, je suis seulement une rivale, pour les autres, je suis une égale puisque je travaille comme eux pour me faire une position comme eux. Je suis entrée dans une école [Les Beaux-Arts] qui leur était primitivement destinée, en concourant avec eux…
Ils n'ont pas le droit de ne voir en moi qu'une femme comme les autres, sœurs de toutes celles qui ne vivent que pour eux, par eux, instrument d'amour…L'amour, je le supplie de m'épargner.
Je n'ai jamais aimé l'amour, jamais aimé aucun homme. Je suis calme, je suis tranquille, toute à mon travail. L'amour serait un grand malheur pour moi, il briserait tout ce qui fait ma vie, je n'y pense pas, je ne le cherche pas, je le redoute…
Ah ! que l'amour m'oublie ! Je me suis garée du mariage, des toquades de jeunes filles…Mais il y a l'amour-passion, l'amour souverain, l'amour fou. […]
Il passerait sur moi comme un cyclone en ne laissant que des ruines. […]
Moins on y pense, moins on a de chances qu'il vienne. Et puis, j'ai vraiment bien autre chose à faire ! » 187 (Cf. Femmes. Ambition, Relations entre êtres humains. Aimer. Amour, Famille. Mariage)
Femmes (Artistes. Lubin Germaine) : 1965. Germaine Lubin [1890-1979], interrogée sur sa carrière d’artiste lyrique, débuta ainsi :
« Je ne serai pas modeste. J’ai eu du succès tout de suite. […] » 188 (Cf. Femmes. Modestes)
Femmes (Artistes. Magny Colette) : Colette Magny [1926-1997] : une somptueuse chanteuse, de somptueuses chansons. Une femme poète, politique, droite, diverse, toujours en recherche de nouveautés, récusant tout formalisme, bouleversante, courageuse, militante et réprimée dans son oeuvre, comme de droit. Et, me concernant, de si beaux souvenirs de jeunesse…
Auteure de : « Je suis pure comme un diamant ! Je n’ai fait que ce que je voulais ! Moi je préfère avoir une bonne image de moi. Je ne veux pas avoir des mains sales. » [1986] [Wikipédia]
Auteure de : « Les cris de notre action guideront notre action ».
Auteure de : « Vous dénoncez », lui disait-on.
« Non. J’expose », répondait-elle. (Cf. Dialogues)
Écouter : Quand j’étais gamine, Ras la trompe, King-Kong… (Cf. Violences. Viols. Violences à l’encontre des enfants)
Femmes (Artistes. Mairesse Valérie) : 2016. Découvrir, ce jour, que Valérie Mairesse a été la seule actrice française ayant travaillé avec Andreï Tarkovski [1932-1986], l’avoir entendue évoquer cette expérience 189, se remémorer qu’elle avait joué dans le film d’Agnès Varda, L’une chante, l’autre pas [1977] et concomitamment se souvenir du rôle qu’elle avait dû jouer dans les émissions de télé de Laurent Ruquier (ce que Wikipédia nomme : « rejoindre la bande de Laurent Ruquier ») juge une société ; et incidemment sa conception de la « culture ». (Cf. Culture, Femmes. Artistes. Varda Agnès)
Femmes (Artistes. Makeba Myriam) : 2010. Lu dans le livre de Ryszard Kapuściński [1932-2007] consacré au Négus [1894-1975] que lors de la création de l’OUA (Organisation de l’unité africaine) en 1963, l’empereur d’Éthiopie « fit venir Myriam Makeba [1932-2008] de Hollywood pour un cachet de 25.000 dollars afin qu’à l’issue du banquet, elle charme les oreilles des dirigeants africains de chants Zoulous. »
En lisant le livre cité concernant la situation de l’Éthiopie d’alors, on comprend mieux la signification politique de cette invitation et la responsabilité politique de Myriam Makeba. 190 (Cf. Culture. Hollywood)
Femmes (Artistes. Mercouri Mélina) : 1974. Mélina Mercouri [1920-1994] relate, dans Je suis née Grecque, le rôle (important) qu’elle a joué contre la dictature des colonels en Grèce [1967-1975] ; et elle écrit :
« […] Il faut qu’une chose reste : ma colère. Ma colère est la raison d’être de ce livre. » 191 (Cf. Culture, Femmes. Colère, Politique. Fascisme)
Femmes (Artistes. Mergault Isabelle) : (juillet-Août) 2017. Isabelle Mergault, auteure de :
« Plus je suis libre, mieux je me porte. » 192
Bien vécu, bien vu, bien analysé…
Femmes (Artistes. Messager Annette) : (13 mars) 2024. J’apprécie, j’aime tout particulièrement Annette Messager pour ce qu’elle dit, pour ce qu’elle crée, pour la diversité des matériaux qu’elle utilise, de la multiplicité de ses formes d’expression, au gré de ses évolutions personnelles.
Sentiment qu’il n’y a pas de rupture entre la femme - simple, ouverte, vraie, non oppressive - et l’oeuvre. (Cf. Culture. Messager Annette)
* Ajout. 17 mars 2024. Comme c’est le cas pour Françoise Hardy [1944-2024].
Femmes. Artistes. Chantal Monteiller :
Femmes (Artistes. Monteiller Chantal) (1) : (22 janvier) 2022. Chantal Monteiller, concernant Frida Khalo [1907-1954] :
« Moi, j’aime les gens orgueilleux. » 193 (Cf. Femmes. Orgueil)
Femmes (Artistes. Monteiller Chantal) (2) : (22 janvier) 2022. Chantal Monteiller, concernant la manière dont sa mère a été traitée, auteure de :
« J’ai vu le fascisme quotidien de la connerie. » 194 (Cf. Politique, Fascisme)
-------------
Femmes (Artistes. Moreno Marguerite) : (21 décembre) 1907. Lu dans le Journal littéraire de Paul Léautaud [1872-1956] :
« Valette [Henri. 1858-1935] me racontait ce soir cet autre mot de Moreno [Marguerite. 1871-1948], à propos de son mariage avec le cabot Jean Daragon. Quelqu’un s’étonnait qu’elle épousât ce garçon qui n’a pour lui que sa carrure et son physique, alors qu’elle avait connu des hommes comme Mendès [Catulle. 1841-1909] et comme Schwob [Maurice. 1859-1928] et vécu avec eux : ‘Ah, vous savez, j’en ai assez des cerveaux’, répondit-elle. » 195
Cette réaction me rappelle l’une de mes amies qui venait de divorcer et qui me disait : « Je cherche un plombier ». Sans mépris, m’a-t-il semblé, mais je doute qu’elle l’ait cherché. (Cf. Êtres humains. Cerveaux, Hommes. « Intellectuels »)
Femmes (Artistes. Monroe Marilyn) : Marilyn Monroe [1926-1962], auteure de :
« À Hollywood, on vous donnait 1.000 dollars pour un baiser et cinquante cents pour votre âme. » 196 Constat valant profonde analyse politique. (Cf. Culture. Hollywood, Êtres humains. Âmes, Relations entre êtres humains. Baiser, Économie. Hollywood)
Femmes (Artistes. Moreau Yolande) : (11 octobre) 2023. Lu dans Le Canard enchaîné [p.6] la critique son film La fiancée du poète :
« Réalisatrice et interprète de Mireille, Yolande Moreau signe un film dégagé de toute pesanteur, inventif et par moments féerique. Son credo ? Il n’y a pas de vie perdue ou ratée. Mais il y a toujours une artiste, une illusionniste ou une âme forte pour nous le faire comprendre. »
Femmes (Artistes. Morisot Berthe) : 1895. Le certificat de décès Berthe Morisot [1841-1895] portait la mention : « sans profession ». 197
Femmes (Artistes. Neher Carola) : Carola Neher [1900-1942] fut notamment l’interprète de Polly, l’épouse du bandit Mackie, dans L’Opéra de quat’ sous [1931] [G W Pabst. 1885-1967]. Elle fut, selon Georges Sadoul [1904-1967], « fusillée par Hitler ». 198
* Ajout. 6 octobre 2016. Je découvre par Wikipédia, qu’après avoir signé une pétition, avec d’autres artistes en 1933 contre Hitler, Carola Neher fuit l’Allemagne nazie, émigre en Russie, est arrêtée, le 25 juillet 1936, avec son mari, dénoncé comme Trotskyste, séparée de son fils, puis condamnée à dix ans de camp où elle décède du typhus. Sur les mensonges et les diverses lâchetés, notamment communistes, la concernant, lire Wikipédia (France) qui reprend Wikipédia (Allemagne).
Femmes (Artistes. Neel Alice) : Alice Neel [1900-1984], auteure de :
- « Je suis une collectionneuse d’âmes. »
- « Toute ma vie a été perturbée par les hommes. »
- « J’ai toujours eu besoin de la libération des femmes. »
Et, j’ai entendu, la concernant, cette pertinente analyse :
- « Elle fait des tableaux comme on fait de l’histoire orale. » 199 (Cf. Histoire. Orale)
Par ordre chronologique. Femmes. Artistes. Édith Piaf :
Femmes (Artistes. Piaf Édith) (1) : 1963. Un souvenir personnel concernant Édith Piaf [1915-1963] : j’entre [le 10 octobre 1963], dans le prisunic du Boulevard du Roule à Neuilly : toutes les vendeuses pleuraient : elles avaient appris la mort d’Édith Piaf.
* Ajout. 13 janvier 2020. Une foule immense (les chiffres varient de 100.000 à 500.000 personnes) accompagna le cortège funèbre au cimetière du Père Lachaise.
Femmes (Artistes. Piaf Édith) (2) : 2001. Édith Piaf [1915-1963] à Jean-Claude Brialy [1933-2007], rapporté par lui :
« Au fond, tu vois l’idéal, pour moi, ce serait de sortir en ville avec Delon [Alain] parce qu’il est le plus beau, de rire avec toi parce que tu es le plus drôle, et de rentrer le soir avec Belmondo [Jean-Paul] parce qu’il doit être un champion au lit. » 200 (Cf. Hommes, Patriarcat)
Femmes (Artistes. Piaf Édith) (3) : 2017. J’écoute Édith Piaf chanter l’émouvante chanson de Marguerite Moreno [1871-1948] : C’était un jour de fête et dont la chute, concernant l’amant qui l’avait abandonnée est : « C’était un sale dégoûtant ». Or, je ne la retrouve dans aucune des transcriptions des paroles telles que lisibles sur internet. (Cf. Culture, Féminismes. Censure)
-------------
Femmes (Artistes. Presle Micheline) : (9 au 13 mai) 2005. Micheline Presle [1922-2024], sur France Culture (podcast), auteure de :
- « Je garde le climat d’un livre, d’un film, et puis j’oublie »
- « Mon instinct ne me trompe pas »
- « Dire son âge, c’est lui accorder de l’importance »
- « Quand on a un intérêt pour la vie, on y trouve des intérêts »
- « Ma mort ne m’intéresse pas »
- « Je prends un temps fou à ne rien faire »
Par ordre chronologique. Femmes. Artistes. Carol Rama :
Femmes (Artistes. Rama Carol) (1) : 1996. Rama Carol [1918-2015], auteure de :
« Je peins par instinct ; je peins par passion et par colère, et par violence et par tristesse et par un certain fétichisme, et par joie et par mélancolie mêlées, et surtout par rage. » 201 (Cf. Femmes. Colère)
Femmes (Artistes. Rama Carol) (2) : 2015. Dans un article du Monde la concernant, l’artiste italienne, Carol Rama, est qualifiée de : « vieille dame indigne », de « mamie indigne », […] « qui a toujours préféré l’écart » : « anomalie sauvage, excentrique, animale ».
Concernant le fait qu’elle et ses œuvres aient été ignorées jusqu’à l’âge de 85 ans, je lis :
« Était-on vraiment passé à côté de quelque chose ? »
Je lis aussi que « son parcours n’obéit qu’à un ordre : celui, scandaleux du corps. »
Puis est évoqué l’un de ses « amis » qui « au cœur de l’Italie fasciste des années 1930 » l’a décrite comme « maîtresse, diable et putain », tandis que l’appartement de l’ « inconnue des berges du Pô » […] est présenté comme « l’antre d’une sorcière, quasi : un musée hors d’âge, qui rappelle que Turin, avec Londres et San Francisco, serait l’une des pointes de la magie noire. »….
L’encart est ainsi rédigé : « Apogée, sans doute, ses années 1960 ne sont qu’éclaboussures, goudron et menstrues, glue apocalyptique, moisissure et éclat atomique » tandis que les deux sous-titres de l’article s’intitulent : « Prothèse et démembrement » et « Magie noire ».
On comprend mieux, à la lecture de ce texte immonde, dont l’intégralité serait à dénoncer, comment on en est venu à brûler les sorcières. 202 (Cf. Culture, Corps, Femmes. Animalisation des femmes. Parcours. Sorcières, Justice. Sorcières, Patriarcat)
-------------
Femmes (Artistes. Réjane) : 1936. Lu dans Les beaux quartiers d’Aragon [1897-1982] :
« Réjane [1856-1920]. C’est bien simple. Elle était tout bonnement éblouissante. Chaque mot qu’elle disait retentissait dans la salle comme un coup en plein cœur. Elle avait fait du naturel le plus terrible artifice. » 203
Femmes (Artistes. Rego Paula) : (9 août) 2020. Marie-Laure Bernadac, concernant Paula Rego, auteure de :
« Aucune femme artiste n’est allée aussi loin dans la dénonciation des violences faites aux femmes - ‘L’excision, l’avortement.’. » 204 (Cf. Corps. Femmes, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
Femmes (Artistes. Reinette l’Oranaise [dite]) : 1991. Sultana Daoud [1918-1998], musicienne chanteuse juive algérienne, répond à la question :
« Le fait que vous ne soyez pas arabe n’est pas une gêne pour cet art ? » :
« C’est ce qui a fait que je me suis appliquée le plus qu’il était possible de le faire. Étant donné que je ne suis pas musulmane, je n’ai pas voulu qu’on me trouve des fautes de prononciation. Alors j’ai tout fait, j’ai pris le chemin de manière à ce que je fasse cette musique à la perfection. Je voulais être à la hauteur de ma tâche. » 205
Quelle leçon ! (Cf. Dialogues)
Par ordre chronologique. Femmes. Artistes. Madeleine Renaud :
Femmes (Artistes. Renaud Madeleine) (1) : 1966. Madeleine Renaud [1900-1994], concernant son « premier mari, Charles Granval » [1882-1943], auteure de :
« Il était un grand homme de théâtre. Il était de l’école au fond de Jean Louis [Barrault. 1910-1994], il était pour la Comédie Française de cette époque, un grand anarchiste. […] C’était absolument un homme admirable au point de vue esprit, intelligence. Et je lui dois surtout d’avoir été très sévère avec moi. Et comme [quand] il m’a épousée, j’avais à peine 20 ans, ça m’a servi d’avoir un maître sévère à côté de moi. » 206 (Cf. Relations entre êtres humains. Admiration, Famille. Mariage, Féminismes. Renaud Madeleine, Hommes. « Grands », Politique. Pouvoir, Patriarcat, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
Femmes (Artistes. Renaud Madeleine) (2) : 1980. (et après. sans date) Madeleine Renaud [1900-1994], auteure de :
« Jean-Louis [Barrault. 1910-1994] et moi, nous avons pu construire notre vie sans passer par l’épreuve des conflits. Comment est-ce possible ? Je vois pour ma part ce qui nourrit notre entente sans réserve : j’ai une telle confiance en lui, en son esprit, en son intelligence, en son instinct que, si d’aventure, je n’appréciais pas énormément l’un de ses projets, je me dirais : ‘Après tout, je ne m’y connais pas ! » 207 (Cf. Féminismes. Renaud Madeleine)
-------------
Femmes (Artistes. « Rockeuses ») : (21 juin) 2025. [1ère diffusion. 23 avril 1988] Écouter la remarquable émission de France Culture : « Rockeuses ». Une histoire du rock au féminin.
Femmes (Artistes. Roget Henriette) : (4 mars) 2024. Henriette Roget [1910-1992], « pianiste, organiste, pédagogue, compositrice », sur France Musique, auteure de :
« C’était bien, mais pas transcendant. J’ai arrêté la composition à 50 ans, parce que ce que j’avais à dire n’était pas suffisamment pour continuer. »
Femmes. Artistes. Niki de Saint Phalle :
Femmes (Artistes. Saint Phalle Niki de) (1) : 2010. Niki de Saint Phalle [1930-2002], auteure de :
« Je veux être une première. Un défi. »
Son mari, Jean Tinguely [1925-1991] : « Tu fais du boulot de salle de bains. » 208
Femmes (Artistes. Saint Phalle Niki de) (2) : 2010. Niki de Saint Phalle [1930-2002], auteure de :
« J’ai écrit ce livre - Mon secret - d’abord pour moi-même, pour tenter de me délivrer enfin de ce viol qui a joué un rôle si déterminant dans ma vie. Je suis une rescapée de la mort, j’avais besoin de laisser la petite fille en moi parler enfin...
J’ai longtemps pensé que j’étais une exception, ce qui m’isolait encore plus ; aujourd’hui j’ai pu parler à d’autres victimes d’un viol : les effets calamiteux sont tous les mêmes : désespoir, honte, humiliation, angoisse, suicide, maladie, folie, etc.
Le scandale a enfin éclaté ; tous les jours des révélations jaillissent sur ce secret si jalousement gardé pendant des siècles : le viol d’une multitude d’enfants, filles ou garçons, par un père, un grand-père, un voisin, un professeur, un prêtre, etc.
Après le Secret j’ai l’intention d’écrire un autre livre adressé aux enfants, afin de leur apprendre à se protéger : parce que l’éducation qu’on leur donne les laisse sans défense contre l’adulte... » 209 (Cf. Culture. Patriarcale, Êtres humains, Enfants, Penser. Saint Phalle Niki de, Violences. Violences. Incestueuses)
-------------
Femmes (Artistes. Salomon Charlotte) : 2016. Je lis ceci concernant Charlotte Salomon [1917-1943], sur France Culture :
« Lorsqu'en 1940, à 23 ans, Charlotte Salomon apprend par son grand-père un lourd secret familial - toutes les femmes de sa famille, dont sa mère, ont mis fin à leur vie -, elle décide pour conjurer cette fatalité de créer ‘quelque chose de vraiment fou et singulier’ et s'attelle à son œuvre... […]
La jeune artiste juive allemande a fui Berlin un an auparavant pour se réfugier dans le sud de la France, à Villefranche, auprès de ses grands-parents. Charlotte Salomon fait face à la fois à l'avancée inexorable de la guerre et à la terrible révélation. Elle se met fiévreusement à l'ouvrage. En moins de deux ans, elle crée une œuvre complexe mêlant peinture, écriture et musique. Un cheminement fulgurant de 1325 gouaches, depuis la première image, celle du suicide de sa tante en 1913, dont elle porte le prénom, jusqu'à celle où, en 1940, elle choisit de vivre, de devenir artiste et se représente face à la mer, portant sur son corps le titre de son œuvre : ‘Leben ? oder Theater ?’ Vie ? ou Théâtre ? ‘C'est toute ma vie’, dit-elle au médecin de Villefranche lorsqu'elle lui confie son œuvre en 1943. Quelques mois plus tard, Charlotte Salomon est déportée à Auschwitz où elle meurt dès son arrivée. » 210
N.B. Entendu : on « arrive » à Auschwitz. Non. Pas plus qu’au goulag… (Cf. Femmes. Prénoms, Langage. Verbe)
* Ajout. 13 janvier 2020. Dans le même sens, on ne « monte » pas à l’échafaud…
* Ajout. 17 juillet 2022. Dans le même sens, à l’occasion de la commémoration de la rafle du Vel d’hiv’, entendu sur France Inter : des juifs ont « pris le train » à Pithiviers. (Cf. Langage. Verbe)
Femmes (Artistes. Sauvage Catherine) : 1985. Catherine Sauvage [1929-1998], auteure de :
« Je crois que finalement j’ai réussi ma vie. » 211 (Cf. Femmes. Chanteuses françaises d’antan)
Femmes (Artistes. Séraphine Louis ou Séraphine de Senlis) : Séraphine Louis [1864-1942], auteure de :
« Ça, des fleurs et des fruits qui n’existent pas ? Des fleurs de folle, ils disent… Mais elles existent puisque je les vois. » 212
- Comme tant d’autres, jugée folle, meurt dans un asile psychiatrique. (Cf. Femmes. Fleurs)
* Ajout. Cf. aussi (14 avril) 1912. Alexandra David-Neel [1868-1969], dans une lettre écrite de Kalimpong [Bengale], à son mari, auteure de :
« Ce sont les enfants et les êtres à la mentalité grossière qui croient que les visions et les rencontres spirituelles se voient avec les yeux et se présentent sous une forme matérielle. » 213 (Cf. Enfants, Penser)
* Ajout. Cf. aussi 1813. : Germaine de Staël [1766-1817], dans De l’Allemagne, auteure de :
« L’un des premiers caractères du naïf, c’est d’exprimer ce qu’on sent ou qu’on pense, sans réfléchir à aucun résultat, ni tendre à aucun but. » 214 (Cf. Penser)
- De tous autres regards sur les dites ‘maladies mentales’, sur le monde, sur la « folie », l’« imaginaire », la « réalité », la « culture »… (Cf. Culture, Êtres Humains. Soi, Femmes. Écrivaines. Staël Germaine de, Penser. Imaginer, Politique, « Sciences » sociales. Psychanalyse. Psychiatrie)
* Ajout. Cf. aussi 1980. : Maurice Genevoix [1890-1980], dans Trente mille jours, auteur de :
« Cette propension au rêve, cette dangereuse aptitude à n’accepter du monde que des réalités compatibles avec mes passions, mes désirs et à refuser le reste, pour le moins à n’en pas tenir compte, m’a très tôt fait créditer d’un grain de folie. » 215 (Cf. Penser)
* Ajout. 14 août 2022. 2022. Jean Malaurie [1922-2024], évoquant Gaston Bachelard [1884-1962], auteur de :
« L’imaginaire est une réalité. » 216
* Ajout. 1er décembre 2023. En affirmant : « elles existent puisque je les vois », Séraphine Louis nie-t-elle la réalité du monde, ou affirme-t-elle que sa perception doit être reconnue par le monde comme étant sa réalité et acceptée en tant que telle ?
Femmes (Artistes. Seydoux Laura) : (11 octobre) 2017. Laura Seydoux, actrice, dans The Guardian, auteure de :
« Je rencontre des hommes comme Harvey Weinstein, tous les jours. Le cinéma est ma vie : j’ai joué dans de nombreux films au cours des 10 dernières années. Je connais donc toutes les façons par lesquelles l’industrie du film traite les femmes avec mépris. […]
La première fois qu’un réalisateur m’a fait une remarque déplacée, j’avais environ 20 ans. Je respectais beaucoup son travail. Nous étions seuls et il m’a dit : ‘J’aimerais pouvoir faire l’amour avec toi. J’aimerais pouvoir te baiser.’
Il a dit cela d’une manière d’une manière mi- enjouée, mi- sérieuse. J’étais très en colère : j’essayais de faire mon travail et il m’a rendu très mal à l’aise. Il avait eu des relations sexuelles avec toutes les actrices qu’il avait filmées.
Un autre réalisateur avec qui j’ai travaillé filmait de très longues scènes de sexe qui duraient des jours. Il rejouait les scènes encore et encore dans une sorte de stupeur. C’était très grossier.
Un autre réalisateur a essayé de m’embrasser. Comme Weinstein, j’ai dû le repousser physiquement. Il a agi comme un fou, hors de lui, car je ne voulais pas avoir de relations sexuelles avec lui. » 217 (Cf. Culture. Hollywood, Relations entre êtres humains. Baiser. Amour. « Faire l’amour », Femmes. Colère, Patriarcat. Weinstein Harvey, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
Par ordre chronologique. Femmes. Artistes. Delphine Seyrig :
Femmes (Artistes. Seyrig Delphine) (1) : Delphine Seyrig [1932-1990], auteure (sans date) de :
« On va me mettre en compétition avec des femmes plus jeunes, et ça, je ne veux pas. » 218 (Cf. Culture, Femmes. Concurrence entre femmes)
Femmes (Artistes. Seyrig Delphine) (2) : 1972. Delphine Seyrig [1932-1990], auteure, au procès dit de Bobigny, de :
- « J’ai avorté plusieurs fois, mais j’ai également accouché. J’ai un enfant qui a maintenant 16 ans, que j’ai eu à une époque où je n’avais pas vraiment les moyens d’élever un enfant. J’étais alors économiquement faible. […]
- J’ai choisi d’avorter parce que j’ai estimé que c’était mon droit de ne plus avoir d’enfant. […]
- Cela a été un choix purement personnel, je n’ai demandé l’avis de personne ni pour avoir un enfant, ni pour ne pas en avoir.
- J’estime que le choix en revient à moi-même puisque c’est moi qui le porte et qui l’élève.
- Je dois dire par ailleurs, que je suis complice d’avortements, quotidiennement, soit en donnant de l’argent, soit en donnant des adresses, soit en prêtant ma maison pour que l’on pratique des avortements, ce qui s’est produit avant-hier pour la dernière fois. »
- Réaction de Me Gisèle Halimi [1927-2020] : ‘Monsieur le Procureur, j’aime mieux être à ma place qu’à la vôtre ! …’ » 219 (Cf. Êtres humains, Corps, Enfants, Femmes. Avortements, Justice. Juges)
-------------
Femmes (Artistes. Schumann Clara) : Clara Schumann [1819-1896], auteure dans une lettre écrite à son futur mari, de :
« Mon art, c’est toi. » (Cf. Culture, Êtres Humains. Soi, Femmes. Épouse de. Mères. Schumann Clara) 220
Femmes (Artistes. Solidor Suzy) : 1978. 213 peintres [dont Jean Cocteau, Marie Laurencin, Raoul Dufy, Maurice de Vlaminck, Yves Brayer, Francis Picabia, Kees Van Dongen, Man Ray, Francis Bacon, Tamara de Lempika…] ont peint la (grande) chanteuse Suzy Solidor [1900-1983]. Elle se remémore :
« Quand je les revois comme ça (les tableaux d’elle), c’est pas moi que je vois, c’est tous les artistes… Je revois Kissing, je revois Foujita, je revois tous les copains ; c’est ça qui m’apporte beaucoup… Je me connais par cœur, hélas… » Je lis aussi la concernant :
Elle a aidé dans son cabaret à apprendre à chanter de nombreuses jeunes personnes, dont Charles Trenet.
Elle fut la première à chanter des chansons et à réciter des poèmes, « en y mettant beaucoup de soi-même, sans grandiloquence, comme on parle ».
Elle rapporte (notamment) une phrase de Jean Cocteau à Jean Marais la concernant : « Tu vois Solidor, quand elle est nue, eh bien ! c’est un gentleman ! … »
Et elle commente : « C’est merveilleux ! … Il n’y a que Cocteau qui pouvait dire des choses comme cela, et que ce soit charmant, et pas gênant… » 221 (Cf. Êtres humains. Soi, Femmes. Chanteuses françaises d’antan. Nues, Hommes. « Gentleman »)
Femmes (Artistes. Sorel Cécile) : Deuxième guerre mondiale. Cécile Sorel [1873-1966] accusée d’avoir ‘fréquenté’ des Allemands pendant la guerre, réagit en ces termes :
« Les allemands n’auraient jamais mis les pieds chez moi si vous ne les aviez pas laissés entrer. » 222 (Cf. Hommes. « Politiques », Politique. Guerre)
Femmes (Artistes. Streisand Barbara) : (14 janvier) 2024. Entendu sur France Musique (en podcast) Barbara [Barbra] Streisand, auteure de :
« Chaque chanson est une pièce de théâtre en miniature. »
Femmes (Artistes. Sylvestre Anne) : (26 septembre) 2017. Anne Sylvestre [1934-2020], auteure, de :
« Je crois que je ne me suis jamais vraiment prise au sérieux. Mais je prends au sérieux ce que je fais. Je sais ce que je fais, je sais ce que j’écris. Je sais la valeur de ce que je fais. » 223 (Cf. Êtres humains. Valeur, Femmes. Remarquables. Sylvestre Anne)
Femmes (Artistes. Tailleferre Germaine) : 1984. Lire, concernant Germaine Tailleferre [1892-1983] Dominique Desanti [1914-2011], La femme au temps des années folles.
Auteure de : « J’espère, en ces temps où une ‘femme compositeur’ semblait encore une excentrique, avoir inspiré à beaucoup de filles la décision de s’y essayer, au Conservatoire ou ailleurs. » 224
Mais lire surtout, la concernant, Wikipédia.
Par ordre chronologique. Femmes. Artistes. Agnès Varda :
Femmes (Artistes. Varda Agnès) (1) : 1962. Agnès Varda [1928-2019], concernant son film, Cléo de 5 à 7, auteure de :
« En ce moment, la mode consiste à dire qu’il n’y a pas de communication possible […]
C’est une notion qu’Antonioni cultive avec ferveur, Resnais aussi. […]
Moi, je ne suis pas d’accord [...]
Je crois aux ‘rencontres’. Suivant leurs possibilités, les gens se rencontrent un instant, une minute ou une vie. Ils ont une rencontre ou dix rencontres dans leur existence, ou ils n’en ont aucune. Mais tout le monde a besoin, peu ou prou, de ça. Ceux qui le savent sont déjà moins malheureux que ceux qui ne le savent pas. […]
Ce besoin est essentiel. Il faut le dire d’une façon presque primaire, parce que c’est très important. […] » 225 (Cf. Culture. Cinéma, Êtres humains, Relations entre êtres humains)
Femmes (Artistes. Varda Agnès) (2) : 2017. Interviewée sur France Culture, Agnès Varda [1928-2019] se souvient, après avoir été photographe, de son premier film :
« Je n’avais pas de modèle au cinéma. Le fait d’avoir été sans connaissances m’a donné du culot. Cette liberté que je me suis donnée, je l’ai gardée après. » 226
Femmes (Artistes. Varda Agnès) (3) : 2019. Interviewée par Laure Adler, à 90 ans, Agnès Varda [1928-2019] lui dit :
« Je vis beaucoup dans le présent. J’aime beaucoup la réalité de chaque jour. » 227
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Artistes. Cora Vaucaire :
Femmes (Artistes. Vaucaire Cora) (1) : 1971. Cora Vaucaire [1918-12011], après avoir constaté : « On ne s’est pas pris beaucoup au sérieux », se souvient, en 1971, de ses débuts dans la chanson, Rive gauche (St Germain des pré) :
« J’étais la plus solitaire et je reste la plus solitaire de toutes les actrices, ou les artistes de ce métier, parce que je n’ai appartenu à aucun milieu, à aucun cercle, à aucune chapelle. À rien. Et cela me gêne beaucoup. Je le regrette. […] »
Et elle poursuit :
« On était - en évoquant aussi Mouloudji [1922-1994], Catherine Sauvage [1929-1998] - plutôt des francs-tireurs. » 228 (Cf. Femmes. Chanteuses françaises d’antan)
Femmes (Artistes. Vaucaire Cora) (2) : (26 avril) 2020. Cora Vaucaire [1918-12011], auteure de :
- (concernant le choix de ses chansons) : « Je n’ai pas d’hormones mâles. Je suis vraiment féminine ; et ça me gêne. Mais il faut oser. » Elle évoque alors les chansons de Pierre Mac Orlan [1882-1970] ;
- « On continue pour les jours de grâce » ;
- « Les chansons sont un petit morceau de vie » ;
- « Je veux des chansons qui seront chantées dans 50 ans et dans 100 ans et on dira : c’est tout neuf ». 229
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Artistes. Pauline Viardot :
Femmes (Artistes. Viardot Pauline) (1) : (11 décembre) 1862. George Sand [1804-1875], dans une lettre au mari de Pauline Viardot [1821-1910] Louis Viardot [1800-1883], auteure de :
« Dites-lui que je l’adore toujours, l’artiste, la mère, la fille à moi, tout enfin […]. » 230
Femmes (Artistes. Viardot Pauline) (2) : (juillet-août) 2021. Remarquable série de huit émissions d’une heure Le fabuleux destin de Pauline Viardot [1821-1910] consacrée par France Musique à cette femme non moins remarquable.
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Artistes. Élisabeth Vigée-Lebrun :
Femmes (Artistes. Vigée-Lebrun Élisabeth) (1) : 1792. Élisabeth Vigée-Lebrun [1755-1842], dans ses Souvenirs, auteure de :
« Mon travail ne me privait point du plaisir journalier de parcourir Rome et ses environs. J’allais toujours seule visiter les palais qui renfermaient des collections de tableaux et de statues afin de n’être point distraite de ma jouissance par des entretiens ou des questions souvent insipides. » 231 (Cf. Femmes. « Seules »)
Femmes (Artistes. Vigée-Lebrun Élisabeth) (2) : 1792. Élisabeth Vigée-Lebrun [1755-1842], dans ses Souvenirs, auteure de :
[Après avoir évoqué la visite à Parme de sept à huit élèves peintres], elle leur montre son tableau nommé La Sybille, elle poursuit :
« Tous témoignèrent d’abord une surprise bien plus flatteuse pour moi que n’auraient pu l’être les plus gracieuses paroles ; plusieurs s’écrièrent qu’ils avaient cru que ce tableau avait été fait par un des maîtres de leur école, et l’un d’eux de jeta à mes pieds les larmes aux yeux.
Je fus d’autant plus touchée, d’autant plus ravie de cette épreuve, que ma Sybille a toujours été un de mes ouvrages de prédilection.
Si mes lecteurs, en lisant ce récit, m’accusent de vanité, je les supplie de réfléchir qu’un artiste travaille toute sa vie pour avoir deux ou trois moments pareils à celui dont je parle. » 232 (Cf. Relations entre êtres humains. Vanité)
Femmes (Artistes. Vigée-Lebrun Élisabeth) (3) : 1792. Élisabeth Vigée-Lebrun [1755-1842], dans ses Souvenirs, écrit :
« […] Un orgueil que je ne crois pas blâmable m’a toujours fait craindre que l’on puisse attribuer à la protection les succès que je désirais obtenir ; soit à tort, soit à raison, je n’ai jamais voulu devoir qu’à ma palette ma réputation et ma fortune. » 233 (Cf. Êtres humains. Soi, Corps, Femmes. Orgueil. Réputation)
Femmes (Artistes. Vigée-Lebrun Élisabeth) (4) : (16 août) 2021. Entendu, concernant Elisabeth Vigée-Lebrun [1755-1842], sur France Culture :
« Elle est incontestablement une ambitieuse » ; « C’est une femme qui voulait faire carrière » ; « Quand elle dit : Je n’ai pas eu de maître’, elle se vante. ».
J’entends aussi : « irritant », « complaisance », « besoin d’être auprès des puissants », « le défaut qu’il faut lui reprocher », « esthétique un peu tyrannique » ; « montages plus ou moins heureux », « il n’y a plus de naturel », « déséquilibre entre la tête et le corps », puis, concernant les cous qu’elle peint (mal) - et, après avoir évoqué celui de Marie-Antoinette [1755-16 octobre 1793] :
« On n’a qu’une envie, c’est de lui filer un coup de guillotine » [!] …
Lu aussi sur France Culture : « Elle fut une femme libre, indépendante financièrement » - et autre formulation plus signifiante :
« Elle n’a que sa palette pour vivre » - qui revendiqua son statut d'artiste (sic). Aucun lien, aucun évènement ne parvinrent à entraver sa liberté. C'est une trajectoire exceptionnelle que la sienne. »
La discrétion de la présentation de son escroc de mari - qu’elle dénonce pourtant, dans ses Mémoires, avec force et clarté - ; au même titre que les nombreuses difficultés auxquelles elle fut confrontée et qu’elle dût résoudre, est particulièrement notable, tandis que ses « coussins », ses « chapeaux » … sont vantés avec passion. 234 (Cf. Culture. Patriarcale. France Culture, Relations entre êtres humains. Haine, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
-------------
Femmes (Artistes. Yamina) : 1931. Colette [1873-1954], lors d’un voyage dans le sud Marocain (en 1931), auteure de :
« Notre guide et la femme indistincte échangèrent quelques répliques en arabe. […]. Je compris qu’elle protestait vivement et qu’il insistait sur un ton rude. Enfin, elle s’effaça et nous pria d’entrer. […]
- ‘Elle est Yamina’, présenta le guide arabe. […]
Pendant qu’elle préparait le thé vert, nous la suivions de notre curiosité offensante d’étrangers. […]
Elle ne parlait français, mais savait recevoir. […]
Elle nous rangea, assis, contre la muraille […] et dansa pour nous. […]
Elle dansa comme toutes les Ouled-Naïl, avec ses bras et ses mains, les charmants pieds inquiets ne faisant que tâter le sol comme un dalle brulante. Elle dansa aussi avec ses reins, et avec les muscles de son petit ventre énergique. Puis, elle se reposa un moment […]
Le guide réclamait qu’elle dansa nue. Nue, elle revint au milieu de la chambre, entre nous et les deux musiciens qui maintenant lui tournait le dos. […]
Elle dansa, n’en sachant pas d’autres, les mêmes danses.
Mais comme elle était nue, elle cessa de rire et nous reprit son regard qui ne daigna plus, désormais, rencontrer les nôtres. Son regard s’en alla, franchissant nos têtes, chargé d’une gravité et d’un mépris souverains, rejoindre, au loin, le désert invisible. » 235 (Corps. Nudité. Femmes. Dignité, Patriarcat. Colonialisme)
-------------
III. Femmes (Écrivaines) :
Femmes (Écrivaines) (1) : Toni Morrison [1931-2019] présentée comme la « première femme afro-américaine à avoir reçu le prix Nobel de littérature » au lieu et place de « Toni Morrison, l’écrivaine ».
Femmes (Écrivaines) (2) : 2018. 39 % des femmes parmi les 381 auteur-es de la « rentrée littéraire » 2018. 236
Par ordre alphabétique. Femmes. Écrivaines :
Femmes (Écrivaines. Akhmatova Anna) : (6 août) 2020. Je lis sur la présentation de Geneviève Brisac de La Grande Traversée de France Culture consacrée à Anna Akhmatova [1889-1966] :
« C’est à Tachkent [1941] aussi, selon Nadejda Mandelstam [1899-1980] qu’elle renonce à masquer son intelligence comme elle l’a fait jusque-là pour ne pas effrayer les hommes de son entourage. » 237
À comparer avec cette autre présentation d’elle - même jour - par Camille Renard faite sur France Culture :
« Poétesse adulée, icône des lettres russes, muse de Modigliani […] immortalisée par les plus grands artistes de son temps […] amante généreuse, trois fois remariée […]. » (Cf. Femmes. Muses. Servantes)
Par ordre chronologique. Femmes. Écrivaines. Hortense Allart de Méritens :
Femmes (Écrivaines. Allart de Méritens (Hortense) (1) : Hortense Allart de Méritens [1801-1879] Rééditer ses écrits ; ou du moins, une sélection.
Femmes (Écrivaines. Allart de Méritens (Hortense) (2) : 1855. Voici le portrait d’Hortense Allart [1801-1879] par George Sand [1804-1876] :
« Madame Hortense Allart, écrivain d’un sentiment très élevé et d’une forme très poétique, femme savante toute jolie et toute rose, disait Delatouche [Henri de. 1785-1851] ; esprit courageux, indépendant ; femme brillante et sérieuse, vivant à l’ombre avec autant de recueillement et de sérénité qu’elle saurait porter de grâce et d’éclat dans le monde ; mère tendre et forte, entrailles de femme, fermeté d’homme. » 238
-------------
Femmes (Écrivaines. Aubenas Florence) : 2010. Florence Aubenas, auteure d’un beau, juste et noble livre : Le quai de Ouistreham 239 ; un livre qui en dévoilant les mensonges dont nous sommes quotidiennement abreuvé-es, m’a fait l’effet d’un détergent ; un livre qui prolonge les belles enquêtes de Marcelle Capy [1891-1962] et Aline Valette [1850-1899] (mais aussi les écrits de Marguerite Audoux [1863-1937] et de Madeleine Riffaud [1924-2024]) ; un livre qui conduit à s’interroger sur la finalité, la fonction, l’apport, en réalité sur l’appauvrissement de la sociologie [du travail] par rapport à [la complexité de] la réalité, telle qu’ici présentée. (Cf. Femmes. Travail, Féminismes. Enquêtes, « Sciences » sociales. Sociologie)
Femmes (Écrivaines. Audoux Marguerite) : 1991. Marguerite Audoux [1863-1937], romancière, auteure notamment de Marie-Claire et de L’atelier de Marie-Claire.
Son biographe, enfermé dans une fausse alternative et faute de vouloir / pouvoir trancher entre « la couturière » et « la femme de lettres », l’appela : « La couturière des lettres ». 240
Par ordre chronologique. Femmes. Écrivaines. Jane Austen :
Femmes (Écrivaines. Austen Jane) (1) : 1818. Jane Austen [1775-1817], auteure, dans Persuasion (Chapitre 23), de :
« […] Les livres, tous écrits par les hommes […]
Oui, s’il vous plait, pas de références à des exemples tirés de livres. Les hommes en racontant leurs histoires ont eu sur nous tous les avantages. Ils ont eu une éducation tellement supérieure à la nôtre. Ce sont eux qui ont eu la plume à la main. Je ne reconnais pas aux livres la propriété de prouver quoi que ce soit. » 241
- Une si réelle radicalité, si mal analysée, voire si déformée par le journaliste comme par le spécialiste dans l’émission citée en note, doit être connue, pensée, approfondie. (Cf. Culture. Livres, Enfants. Éducation, Féminismes, Patriarcat. Penser le patriarcat)
Femmes (Écrivaines. Austen Jane) (2) : (24 janvier) 1929. Lu dans le Journal d’André Gide [1869-1951], concernant Jane Austen [1775-1817] :
« À peu près achevé Pride and Préjudice [Orgueil et préjugés. 1813] commencé à Alger, où Jane Austen atteint la perfection, mais où l’on sent assez vite (comme dans Marivaux [1688-1763]) qu’elle ne se risquera pas sur des sommets exposés à des vents trop forts. Une exquise maîtrise de ce qui peut être maitrisé. Charmante différenciation des personnages moyens (sic). Réussite parfaite et triomphe aisé de la décence. Quelle femme charmante ce dut être ! Incapable de toute ivresse, mais forçant presque de penser [?] : mieux vaut ainsi. [?] » 242 (Cf. Patriarcat, Penser. Préjugés)
Femmes (Écrivaines. Austen Jane) (3) : (26 décembre) 1932. Lu dans le Journal de Julien Green [1900-1998], Les années faciles, concernant Jane Austen [1775-1817] :
« Le procédé de Jane Austen consiste à opposer entre elles les qualités morales qu’elle s’efforce de personnifier, et si je trouve ce procédé un peu mécanique, je me rends au charme d’un écrivain dont le sourire n’est jamais une grimace et à qui l’émotion n’arrache jamais un cri, car les personnes bien élevées ne crient pas.
Jane Austen reste toujours un peu en deçà de ce qu’elle veut dire, avec une réserve exquise qui n’est qu’à elle, mais son trait n’en est pas moins d’une netteté admirable. Auprès d’elle, Charlotte Brontë apparaît quelqu’un d’échevelé. » 243 (Cf. Femmes. Écrivaines. Brontë Charlotte)
Femmes (Écrivaines. Austen Jane) (4) : (12 juin) 1944. Lu dans le Journal d’André Gide [1869-1951], concernant Jane Austen [1775-1817] :
« J’achève, à grandes lampées, Sense and sensibility [1811] ; moins captivant sans doute que Pride and Préjudice [1813] ou que Emma [1815] (pour autant qu’il m’en souvienne) mais d’une sureté de dessin admirable, et remplissant le cadre à ravir. Comparable à certains portraits d’Ingres [1780-1867], ou plutôt : de Chassériau [Théodore. 1819-1856]. Le ciel est un peu bas, un peu vide ; mais quelle délicatesse dans la peinture des sentiments ! Si nul démon majeur n’habite Jane Austen, en revanche une compréhension d’autrui jamais en défaut, jamais défaillante. La part de satire est excellente et des plus finement nuancées. Tout se joue en dialogue et ceux-ci sont aussi bons qu’il se puisse. Certains chapitres sont d’un art parfait. » 244 (Cf. Dialogues)
Femmes (Écrivaines. Austen Jane) (5) : 2001. Pietro Citati [1930-2022], dans Portraits de femmes, auteur de :
« Elle [Jane Austen [1775-1817] avait été l’ombre et la lumière, la raison et la sensibilité, l’intelligence ironique et la tendresse, le douloureux silence et la séduction, le bonheur, la tranquillité, la froideur et l’épanouissement. Tel fut, je crois, son multiple visage. » 245
Femmes (Écrivaines. Austen Jane) (6) : (11 juin) 2016. Selon Alain Jumeau, Jane Austen [1775-1817] a inventé « le style indirect libre en tant que technique narrative » ; elle fut, toujours selon lui, à ce titre, une « pionnière » qui « ouvrit la voie au roman moderne ». 246 (Cf. Femmes. Pionnières, Langage. Style)
Femmes (Écrivaines. Austen Jane) (7) : (9 février) 2019. De même Alain Jumeau, mais après une réécoute, près de trois ans après, de son analyse, auteur de :
« Je suis encore persuadé après plusieurs relectures de ses romans, que les romans de Jane Austen [1775-1817] rendent intelligents. […]
Le personnage principal, qui est en fait une femme, chemine de l’erreur vers la lucidité, et ce cheminement vous le suivez de très, très près avec un empathie extraordinaire grâce à la technique du style indirect libre. Et si vous partagez la pensée d’un personnage, vous suivez son cheminement et vous devenez de plus en plus lucide, à la fois sur les autres et sur vous-même. » 247 (Cf. Langage. Style)
-------------
Femmes (Écrivaines. Azzeddine Saphia) : 2007. Saphia Azzeddine, auteure de Confidences à Allah : un grand (petit) livre qui explose tout sur son passage. 248
Femmes (Écrivaines. Barthélémy-Madaule Madeleine) : 1992. Henri Guillemain [1903-1992] interrogé par Jean Lacouture [1921-2015] sur les raisons pour lesquelles il n’a pas écrit ‘son’ livre sur Marc Sangnier [1873-1950], répondit :
« Parce qu’il a été très bien fait par Madame Barthélémy-Madaule. [1911-2001] Je n’avais donc rien à dire. » 249
Femmes (Écrivaines. Beck Béatrix) : Publier les œuvres complètes de Béatrix Beck [1914-2008] : ?
Il faudrait tout lire, ce que je n’ai pas fait.
Par ordre chronologique. Femmes. Écrivaines. Octavie Belot :
Femmes (Écrivaines. Belot Octavie) (1) : 1756. Octavie Belot [Octavie Durey de Meinières, « née Guichard, veuve Belot, remariée au président Durey de Meinières » 1719-1805], auteure notamment des Réflexions d’une Provinciale sur le Discours de Monsieur Rousseau, citoyen de Genève. En voici le fier commencement :
« Je vais peut-être encore aigrir M. Rousseau [1712-1778], contre les effets de la raison perfectionnée. Il ne verra qu’avec indignation, l’audace d’une femme qui ose penser & même écrire. Cependant, si je ne m’exagère pas mes droits et mes facultés, il me semble que faisant partie du genre humain je puis élever ma faible voix jusqu’au Philosophe qui adresse la parole au genre humain. » 250 (Cf. Langage. Genre, Penser, « Sciences » sociales. Philosophie)
Femmes (Écrivaines. Belot Octavie) (2) : (26 mars) 1759. Voltaire [1694-1778], dans une lettre à Octavie Belot [1719-1805] qu’il ne connaissait pas, mais qui lui avait envoyé ses « ouvrages », lui écrit :
« […] Je serais enchanté de vos ouvrages si vous n’étiez qu’un homme. Jugez quels sont mes sentiments quand je sais que vous êtes de ce sexe qui a civilisé le nôtre et sans lequel nous n’aurions été que des sauvages comme Jean-Jacques [Rousseau. 1712-1778], veut que nous soyons.
La plupart des personnes de votre espèce n’ont réussi qu’à plaire. Vous savez plaire et instruire. On m’a dit, madame, que votre société est aussi aimable que vos livres […] » 251 (Cf. Femmes. Noms, Relations entre êtres humains. Injures. Voltaire, Patriarcat. « Espèce », Sexes. Femmes)
Femmes (Écrivaines. Belot Octavie) (3) : (28 mars) 1763. Voltaire [1694-1778], dans une lettre à Octavie Belot [1719-1805], lui écrit :
« Mme Dupuits, ci-devant Melle Corneille [1742-1805], prétend qu’elle vous a vue, et que vous êtes fort belle ; il est étonnant qu’avec cela vous fassiez des livres, et de bons livres. […] » 252 (Cf. Patriarcat. Voltaire)
-------------
Femmes (Écrivaines. Bernard Catherine) : (10 juin) 2017. Concernant Catherine Bernard [1663 (?) -1712], dont j’ignorais tout jusqu’à ce jour, je ne peux que renvoyer à l’émission que France Culture lui a consacrée et à la présentation qui en est faite et publiée. Pour ma part, plus sans doute que son exclusion de la sphère intellectuelle française depuis plus de trois siècles - et pourtant ! - c’est sa radicalité qui m’a frappée. Je pense notamment à la lecture qui nous y est présentée de son Riquet à la houppe. 253
Femmes (Écrivaines. Bespaloff Rachel) : 2006. Pour connaître Rachel Bespaloff [1895-1949], lire les quatre pages que Maurice Nadeau [1911-2013], qui tient notamment ses sources de Jean Wahl [1888-1974], lui consacre. 254
* Ajout. 18 octobre 2016. 2003. Lire aussi l’Introduction de Monique Jutrin des Lettres [de Rachel Bespaloff] à Jean Wahl. 1937-1947 :
« Sur le fond le plus déchiqueté de l’histoire ». 255
Par ordre chronologique. Femmes. Écrivaines. Charlotte Brontë :
Femmes (Écrivaines. Brontë Charlotte) (1) : (21 décembre) 1847. Charlotte Brontë [1816-1855] sous le nom de Currer Bell, dans la Préface de la deuxième édition de Jane Eyre [1847], auteure de :
« (Après avoir évoqué La Foire aux Vanités [1848] de William Makepeace Thackeray [1811-1863] Pourquoi ai-je fait allusion à cet homme ? Lecteur, j’ai fait allusion à lui parce que je pense voir en lui une intelligence plus profonde et plus exceptionnelle que ses contemporains ne l’ont encore reconnu : parce que je le teins pour le premier regénérateur social de notre époque, pour la maître véritable de ce petit groupe d’ouvriers qui s’efforcent de redresser notre système déformé ; parce que je pense que nul commentateur de ses écrits n’a encore trouvé de comparaison qui lui convienne, des termes qui définissent convenablement son talent. […] Enfin, si j’ai fait allusion à M. Thackeray, parce que c’est à lui (s’il veut bien accepter l’hommage de quelqu’un qui lui est complètement inconnu) que j’ai dédié cette deuxième édition de Jane Eyre. » 256 (Cf. Hommes. Remarquables)
Femmes (Écrivaines. Brontë Charlotte) (2) : (2 juillet) 1932. Lu dans le Journal de Julien Green [1900-1998], Les années faciles, concernant Charlotte Brontë [1816-1855] :
« Relu une partie de Jane Eyre [1847], simplement pour ne pas oublier ce que c’est qu’un grand roman. J’aime les maladresses de ce livre, ce mélange de gaucherie et d’audace, l’intraitable sérieux de l’auteur. »
-------------
Femmes (Écrivaines. Brontë Charlotte et Emily) : (17 juillet) 1932. Lu dans le Journal de Julien Green [1900-1998], Les années faciles, concernant Charlotte Brontë [1816-1855] et [Emily Brontë. 1818-1848] :
« Ce que je reproche à Charlotte Brontë, c’est de ne pas avoir osé autant qu’elle l’aurait pu. Cette femme si souvent hardie avait d‘étranges timidités lorsqu’il s’agissait de transposer, alors qu‘Emily elle, se jetait dans l’imaginaire avec la fougue du génie. Pourtant, il y a de belles invraisemblances dans Jane Eyre [1847], mais dans Villette [1853], on a trop souvent l’impression que chaque personnage a son modèle et chaque situation sa contrepartie dans la vie réelle, ce qui me gêne. » 257 (Cf. Femmes. Écrivaines. Austen Jane)
Par ordre chronologique. Femmes. Écrivaines. Marie Cardinal :
Femmes (Écrivaines. Cardinal Marie) (1) : 1975. Marie Cardinal [1928-2001], auteure de l’inoubliable (pour moi et tant d’autres) : Les mots pour le dire. 258 Un livre dont l’écriture a refondé sa vie ; un livre dont la lecture peut bouleverser la nôtre ; un livre magistral. (Cf. Famille. Cardinal Marie, Famille. Divorce. Église catholique, Patriarcat. Église catholique, « Sciences » sociales. Psychanalyse)
Femmes (Écrivaines. Cardinal Marie) (2) : 2004. Virginie Talmont, dans Inceste. Récit, auteure de :
« Par hasard, dans l’appartement de Biarritz de mon grand-père, je tombe sur ce livre, Les mots pour le dire. C’est le titre qui m’a attirée. Les mots. Moi qui cherchais toujours le sens de mes mots. Les mots pour le dire. Les mots pour parler de ses maux. Si je pouvais les trouver, ces mots, pour parler de ses maux, pensais-je, peut-être que ça irait mieux, peut-être que mon cœur arrêterait de me faire souffrir. […]
J’ouvre le livre. L’auteu [e], une femme, se met à parler sous mes yeux. De ses malaises à elle. De ses crises d’angoisse, à elle. De son sang, de sa folie. De ses cachets qui, seuls, parviennent à la calmer. Elle se met à déverser un flot chaotique de paroles, des mots dans tous les sens, c’est terrible. Elle se met à raconter comment, un beau jour, elle se retrouve dans une petite impasse. Avec, au bout, le cabinet d’un drôle de docteur, pas comme les autres, un psychanalyste. […]
Là, là, précisément, je prends peur, je vomis, tellement j’ai peur. Je pleure, je vomis, j’étouffe, et vite, vite, vite, je referme le livre. […]
Quelle est cette folle qui ose écrire cela ? Je regarde : Marie Cardinal. […]
Le problème ? Je me suis vue dans ce livre. La folle dont elle parle, c’était moi. […] » 259 (Cf. Culture. Livres, Êtres humains. Soi, Femmes. « Folles », Langage. Mots, « Sciences » sociales. Psychanalyse)
-------------
Femmes (Écrivaines. Charles-Roux Edmonde) : 1971. Question de Jacques Chancel à Edmonde Charles-Roux [1920-2016] : « Féministe ? » :
Réponse : « Moi ? féministe ! Ah dieu, non ! Ah, ça, vraiment pas ! Là, vous tombez mal ! Non, non, Pourquoi être féministe ? C’est tout à fait inutile. C’est dépassé. On n’est pas en Arabie Saoudite, dans des pays où les femmes sont tenues en tutelle…Il faut être des femmes d’abord. Et ça suffit largement. En tout ça, moi, ça me suffit ! » 260 (Cf. Féminismes. Antiféminisme)
Femmes (Écrivaines. Charrière Isabelle de) : (4 octobre) 1794. Isabelle de Charrière [1740-1805] écrit à Benjamin Constant [1767-1830] :
« Moi, j’ai mis en matière de comédies moi-même, presque toutes mes idées sur les rangs de la société, les besoins des hommes et sur la pitié, les égards, l’impartialité, que je demande pour les autres, ainsi que sur le courage, l’industrie et l’impartialité que je veux qu’on ait pour moi et relativement à soi. » (Cf. Êtres humains. Soi)
Par ordre chronologique. Femmes. Écrivaines. Marie Chauvet :
Femmes (Écrivaines. Chauvet Marie) (1) : 1960. 2005. Concernant Marie Chauvet [1916-1973], lu, dans Le Monde Diplomatique concernant son livre, écrit en 1960, Amour, Colère et folie ceci :
« Un roman est une histoire. Celui-ci a d’abord une histoire. Aussi tragique que ces années 1960, celles du Duvaliérisme, qui fracassent la société haïtienne. Il a donc une histoire, celle de sa livraison. Marie Vieux-Chauvet publie son livre en 1968 chez Gallimard. Une charge terrible contre les monstres, ou les monstruosités, qu’engendre un régime bestial. La famille de l’auteure, déjà inquiétée, prend peur. La police politique a eu vent du brûlot. Le mari rachète les exemplaires arrivés à Port-au-Prince et finalement, à Paris, tout le stock de Gallimard. On ne trouvera plus le livre que sous le manteau. L’auteure respectera l’omerta, mais ne pardonnera pas à sa famille et continuera aux États-Unis, quelques années durant, sa carrière de romancière. L’ouvrage est enfin publié en 2005. » (Éditions Soley) 261
Après lecture : un grand, grand livre… (Cf. Relations entre êtres humains. Pardon, Femmes. Colère, Famille)
Femmes (Écrivaines. Chauvet Marie) (2) : 2015. Le livre de Marie Chauvet [1916-1973] Amour, colère et folie, réédité en 2015, est alors précédé d’une préface signée de Marilyse Charlier, Régine Charlier, Pierre Chauvet, présentant une autre version de la genèse de ce livre, dont voici un passage :
« […] La famille de l’auteur, déjà éprouvée par l’exécution arbitraire de trois de ses membres craint de nouvelles représailles. Lors d’un séjour en France, Pierre Chauvet, le mari de l’auteur est alerté par un diplomate haïtien de cette nouvelle menace qui pèse sur la famille. Rentrant d’urgence à Port-au Prince, il rachète les exemplaires déjà distribués sur place et les détruit. De son côté, Marie Vieux-Chauvet obtient de l’éditeur qu’il sursoie à la distribution de l’ouvrage. Quelques années plus tard, ses enfants rachètent l’intégralité du stock restant et le mettent discrètement en vente. Jusqu’à son épuisement en 2000, le livre est vendu à certains particuliers ainsi que dans deux librairies, l’une à New York, l‘autre en Haïti.
Ces précisions nous paraissent nécessaires, et viennent en réponse aux allégations de certains esprits en quête de sensationnel.
La famille de l’auteur n’a jamais eu honte de ses écrits.
Marie Vieux-Chauvet n’a pas été non plus une martyre ou une femme désabusée, elle qui se définissait simplement comme : ‘Un élément de la nature’. Les épreuves n’ont fait que renforcer sa détermination à la lutte, sa joie de vivre, se générosité, et l’optimisme qui lui a permis de surmonter l’étouffement de sa plus belle œuvre.
Marie Vieux-Chauvet peut bouleverser, choquer parfois, mais faire pitié ? Jamais ! Ni sainte, ni martyre, elle fut simplement une femme qui détestait par-dessus tout le cynisme, la veulerie et l’injustice. » 262 (Cf. Relations entre êtres humains. Pitié, Femmes. Colère, Famille)
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Écrivaines. Louise Colet :
Femmes (Écrivaines. Colet Louise) (1) : Pour une juste appréciation des relations de Gustave Flaubert [1821-1880] et Louise Colet [1810-1876], lire la Correspondance de Flaubert, ainsi que L’Indomptable Louise Colet [1986] qui réhabilite justement cette femme, « obstinément victime de la muflerie masculine » selon le critique Albert Thibaudet [1874-1936]. 263
Concernant ses propres écrits [que je n’ai pas lus, à l’exception de sa correspondance], lire la présentation qui en fut faite par Thierry Poyet, Relire Louise Colet, évidemment [2015] qui en donne l’envie. 264 (Cf. Femmes. Remarquables. Chatelet Madame du, Relations entre êtres humains. Amour. Flaubert Gustave, Histoire. Historiographie. Patriarcale)
Femmes (Écrivaines. Colet Louise) (2) : (5 janvier) 1931. Lu dans le Journal de Julien Green [1900-1998], Les années faciles :
« Lecture des lettres de Flaubert […] Liaison toute traversée d’orages (avec Louise Colet). Toute occasion lui semble bonne pour contredire et rabrouer cette femme qu’il devait détester autant qu’il la désirait. Quel mépris, il y a dans cette phrase : ‘Tâche un peu d’employer quelque chose de ton esprit dans les rapports que tu as avec moi.’ (I. 343). » 265 (Cf. Femmes. Insatiables, Hommes. Grossiers, Relations entre êtres humains. Aimer. Colet Louise)
* Ajout. 26 octobre 2021. George Sand [1804-1876], dans une lettre à son ami Gustave Flaubert [1821-1880], la traite, malheureusement, de « folle ». [28/29 février 1872].
Femmes (Écrivaines. Colet Louise) (3) : 1964. Maurice Nadeau [1911-2013], dans sa Préface à la Correspondance de Gustave Flaubert. Lettres à Louise Colet. 1846-1851, auteur, notamment, de :
« Louise n’est pas très intelligente et son orgueil de femme la fait se piquer au jeu » ; « Louise, une femme vindicative » ; « ses productions littéraires qui, en qualité, ne dépassent pas l’honnête moyenne » ; « Elle ne rechigne pas à payer discrètement en nature les services qu’on lui tend » ; « Les admirateurs du grand homme la condamnèrent avec ensemble : bornée, ambitieuse, chimérique, vindicative et bas-bleu dans toute l’acception du terme » ; « sa tête d’oiselle » ; « oubliant qu’elle en est pas à sa première liaison » ; « elle revient à la charge avec une obstination de bête à l’abattoir » ; « son attachement charnel à Flaubert » ; cette semence - celle de Flaubert - tombe malheureusement sur un sol infertile » ; « elle met une sourdine à ses jérémiades » ; « au lieu de sortir de sa féminité, elle s’y englue »…
Quand on pense aux immenses pouvoirs que Maurice Nadeau eu, pendant des dizaines d’années, sur les lettres, sur la culture, sur l’édition, sur la politique française, on ne peut que s’étonner que certain-es s’étonnent encore de la si maigre place dévolue aux femmes : on comprend mieux aussi leur focalisation sur le nombre… (Cf. Culture. Patriarcale, Femmes. « Bas-bleus », Hommes. « Intellectuels », Relations entre êtres humains. Attachement, Féminismes. Antiféminisme, Patriarcat) 266
Femmes (Écrivaines. Colet Louise) (4) : 1983. Lu dans le tome IV de la Correspondance d’Émile Zola [1840-1902] :
« Louise Colet […] est surtout connue aujourd’hui comme la destinataire d’un grand nombre de lettres de Flaubert, où il exprime ses idées littéraires. » Deux injustices. 267 (Cf. Culture. Patriarcale)
N.B. Il me semble que, pour nombre d’hommes, qu’un des leurs - a fortiori jugé « grand » - exprime son amour à une femme, serait s’abaisser.
-------------
Femmes. Écrivaines. Colette :
Femmes (Écrivaines. Colette) : 1996. Colette [1873-1932], dans Mes vérités, auteure de :
« Ce plaisir, qu'elle [‘la femme’] réclame avec tant d'efforts, tant de violence, tant de lyrisme quelquefois, si elle ne découvre pas qu'elle pourrait s'en passer, je la plains ! » 268 (Cf. Femmes. Plaisir, Relations entre êtres humains. Amour. « Faire l’amour »)
Par ordre chronologique. Femmes. Écrivaines. Colette et Willy :
Femmes (Écrivaines. Colette et Willy) (1) : Willy, [1859-1931] premier mari de Colette, retrouvant les cahiers des manuscrits des premières Claudine, abandonnés dans un tiroir, déclara :
« Nom de Dieu, je ne suis qu’un con ! » On sait en effet l’usage qu’il fit de sa découverte. Colette, se rappelant cet épisode, poursuit :
« Et c’est comme ça que je suis devenue écrivain. » Et lui aussi…
- Concernant la période où, mariée, elle a vécu avec lui, Colette la décrit ainsi :
« Ma séquestration n’avait lieu qu’à la campagne. Il fallait que je sois un peu bouclée, car le chantage était partout autour de moi. » Puis :
« J’étais un peu cloîtrée - le mot ‘séquestrée’ dépasserait ma conception et surtout ma discrétion. » Et enfin :
« Je crois que beaucoup de femmes errent d’abord, comme moi, avant de prendre leur place, qui est en de ça de l’homme. » 269
* Ajout. 16 septembre 2015. J’achète hier une édition datée de 1931 d’un livre de Colette, Claudine s’en va, signé Willy et Colette Willy. J’y lis en page de garde ceci :
« La collaboration, Willy-Colette ayant pris fin, il devenait indispensable de rendre à chacun la part qui lui est due, et de remplacer la signature unique de ces volumes [par Willy donc] par celle de WILLY et COLETTE WILLY. Des motifs purement typographiques ont voulu que mon nom fût placé avant celui de Colette Willy, alors que toutes les raisons, littéraires et autres, eussent exigé que son nom fût à la première place. WILLY. » 270
* Ajout. 22 octobre 2016. J’achète aujourd’hui un livre signé Colette Willy : La Vagabonde (Paul Ollendorff. 51ème édition. 1910) et un autre signé Colette (Colette Willy) : Chéri (Arthème Fayard. Copyright by Colette. 1920). Et sur la page de garde, il est écrit : Ouvrages du même auteur (11 titres) suivi de : En « collaboration » avec Willy : Claudine à l’école, Claudine à Paris, Claudine en ménage. Claudine s’en va. (Cf. Relations entre êtres humains. Discrétion, Femmes. Noms)
Femmes (Écrivaines. Colette et Willy) (2) : (26 juillet) 2016. Entendu ce jour, sur France Culture, présenter Willy comme : « un homme qui lui fit découvrir l’amour et la littérature. » 271 (Cf. Culture, Patriarcat)
Femmes (Écrivaines. Colette et Willy) (3) : 2019. Lu dans 501 écrivains, Un tour du monde de la littérature :
« En 1906, Colette quitte ce négrier de mari. Le divorce est prononcé en 1910. » 272 (Cf. Hommes, Famille. Divorce)
-------------
Femmes (Écrivaines. Compton-Burnett Ivy) : 1988. (traduction française) Lu, sur la quatrième de couverture de Serviteur et servante, concernant Ivy Compton-Burnett [1884-1969],
- Mary Mac Carty [1912-1989] : « À côté des romans de Ivy Compton-Burnett, les tragédies domestiques de François Mauriac [1885-1970] ne sont que d’aimable plaisanteries. Ses livres sont grouillants de vie comme des paniers de crabes. »
- Vita Sackville-West [1892-1962] : « Tous les héros de Ivy Compton-Burnett forment une famille effroyablement dramatique dès avant le drame. L’orage est moins impitoyable sur Les hauts de Hurlevent ou chez les Atrides. »
- Pierre Gripari [1925-1990] : « Une fois livrée à elle-même, une famille de Compton-Burnett est naturellement tortionnaire. Elle s’organise d’une façon toute spontanée sur le modèle de la meute, avec un mâle ou une femelle dominant, hiérarchie, droit du plus fort. »
- Angus Wilson [1913-1991] : « Les quelques vingt romans quelle écrivit sont dans la littérature moderne ce qui se rapproche le plus de L’Enfer de Dante, dont il rappelle par les sévérités du style les plus sulfureuses cadences. »
- Mario Praz [1896-1982] : « Ces romans semblent avoir écrits par une furie à froid qui grave chaque réplique en trempant sa plume dans le vitriol. On n’ose en dire davantage de peur de brûler le papier. »
- David Cecil [1902-1986] : « Chaque personnage dans ses livres est le démon chargé d’en tourmente un autre et tus accourent dans ces demeures déverser leur fiel et s’en reviennent chargés d’un butin de peur, d’humiliation et de haine. Monde pour lequel il n’y a de solitude pour personne, où l’on s’épie, s’évite, se fit. Dans ces huis clos tout devient immédiatement des paroles ou un secret ; ni le silence ni la paix, n’ont cours. » 273
Les dialogues dans l’œuvre d’Ivy Compton-Burnett [1884-1969] : souvent, du grand art, taillés comme des pointes d’épée, ciselés comme des diamants. (Cf. Dialogues, Femmes. « Femelles » », Hommes. « Héros », Famille)
Femmes (Écrivaines. Delay Florence) : Florence Delay, académicienne, fille d’académicien (sans la réduire à ce statut, mais sans considérer qu’il soit secondaire), à la question :
« Est-ce qu’il y a des fois, dans votre vie ou vous vous êtes sentie féministe, où vous vous êtes dites féministe ? », elle répondit :
« Ici, je crois que le travail est fait, même s’il y a encore des inégalités. Dans d’autres pays que le mien, oui… »
Le déni et le nationalisme ne sont pas morts… 274 (Cf. Culture. Nationalisme, Féminismes, Langage. Académie française)
Femmes (Écrivaines. Delcourt Marie) : 1931. 1934. André Gide [1869-1951], dans son Journal, écrit :
- le 2 janvier 1931 : Lu : « Avec un intérêt très vif, la Vie d’Euripide [1930] de Marie Delcourt [1891-1979] », suivi d’une étude critique de ce livre, le 21 août 1940.
- le 20 septembre 1940 : Lu : « L’Eschyle [1934] de Marie Delcourt avec grand intérêt et profit. » 275
Femmes (Écrivaines. Desbordes-Valmore Marceline) : 1825. Marceline Desbordes-Valmore [1786-1859], auteure de :
« L’orage de tes jours a passé sur ma vie / J’ai plié sous ton sort, j’ai pleuré de tes pleurs / Ou ton âme a monté, mon âme l’a suivie / Pour aider tes chagrins, j’en ai fait mes douleurs. » Début du poème intitulé : Dors, lequel se termine par :
« Moi, je suis l’humble lampe émue à ton côté. » 276 (Cf. Êtres humains. Âmes, Femmes. Humbles. Pleurs)
Par ordre chronologique. Femmes. Écrivaines. Emily Dickinson :
Femmes (Écrivaines. Dickinson Emily) (1) : Emily Dickinson [1830-1886] écrit à 15 ans :
« Le rivage est plus sûr, mais j’aime me battre avec les flots. » 277
Femmes (Écrivaines. Dickinson Emily) (2) : Emily Dickinson [1830-1886] :
« Elle n’a presque jamais quitté sa maison et elle a tout compris » a-t-on dit d’elle. 278
Ouvre de larges horizons… (Cf. Femmes. Maison)
* Ajout. 3 août 2024. Cf. Femmes Écrivaines. Flannery O’Connor [1925-1964] 279
-------------
Femmes (Écrivaines. Dormoy Marie) : 1994. Louis Nucéra [1928-2000], dans Mes ports d’attache, auteur de :
« Je me souviens des rencontres [chez Georges Brassens. 1921-1981] avec Marie Dormoy [1886-1974], au salon, celles-là. Elle avait consacré trente ans de sa vie à ce monument littéraire qu’est le Journal de Léautaud [Paul. 1872-1956]. Brassens lui en était infiniment reconnaissant/ c’est avec un infini respect qu’il la recevait et l’écoutait, l’interrompant pour approfondir un détail, mieux connaitre un trait de caractère de Valéry, d’Émile Bernard, de Rémy de Gourmont, de Jules Renard, de Rachilde, de Suarès, bref pour en savoir plus sur l’histoire de nos Lettres. » 280
Femmes (Écrivaines. Eliot George) : 1919. Virginia Woolf [1882-1941], concernant George Eliot [1819-1880], auteure de :
« […] L’issue fut triomphale pour elle, quel qu’ait pu être le destin de ses créatures ; et quand nous rappelons tout ce qu’elle a osé, tout ce qu’elle a accompli, la façon dont, malgré tous les obstacles qui jouaient contre elle (le sexe, la santé, les conventions), elle a cherché toujours plus de savoir, toujours plus de liberté jusqu’au jour où le corps, accablé par son double fardeau, s’effondra, épuisé, nous devons poser sur sa tombe toutes les brassées de lauriers et de roses que nous possédons. » 281
* Ajout. 26 décembre 2020. Sur France Culture, Mona Ozouf, auteure de :
« Elle passe pour une prêcheuse ». Ah bon ? Qui donc l’a affirmé ? Et comment peut-on à ce point - honteusement - déprécier une oeuvre si riche, si intelligente, si sensible, si brillante ?
Alain Finkielkraut pour sa part affirme qu’elle « n’est jamais démonstrative ». Il est des critiques plus enrichissantes… Mais comment pourrait-il parler intelligemment de ce qu’il ne connait manifestement pas le moins du monde ? 282
* Ajout. 27 janvier 2022. Début de l’émission de France Culture : L’économie selon George Eliott [1819-1880] :
« Henry James [1843-1916] la décrivait comme ‘magnifiquement laide et délicieusement hideuse’… »
Ça finira donc jamais ? 283 (Cf. Économie)
Femmes. Écrivaines. Elena Ferrante :
Femmes (Écrivaines. Ferrante Elena) (1) : Ses livres : une œuvre capitale.
Je savais juste en décidant de lire les livres d’Elena Ferrante qu'elle avait eu un énorme succès mondial, ce qui était plutôt pour moi dissuasif...
Ce qui m'a particulièrement frappée au-delà de l'incroyable vertige de sa construction, et de la force, la vérité, la justesse des personnages, c'est qu'elle écrit - comme relevant de l'évidence - ce que les femmes taisent depuis des siècles. En ce sens, seule une femme aurait pu écrire ce qu'elle écrit, ce qui ouvre de nouveaux horizons sur l'universalité des « chefs d'œuvres ».
La relation entre les deux amies est ce qui me paraît le plus construit, le moins crédible : les relations des femmes aux hommes - entre autres...- est, pour moi, ce qui est le plus fort, le plus original, le plus subversif. (Cf. Féminismes. Ferrante Elana)
Femmes (Écrivaines. Ferrante Elena) (2) : Trois grandes romancières italiennes - en réalité, celles connues de moi - l’ont précédée : Elsa Morante [1919-1985], Goliarda Sapienza [1924-1985], Oriana Fallaci [1926-2006] … Et, bien d’autres encore, encore à connaître…
-------------
Femmes (Écrivaines. Fitzgerald Zelda) : 1930. Zelda Fitzgerald [1900-1948], épouse de Francis Scott Fitzgerald [1896-1940], auteure, alors internée, de :
« Je suis ce petit poisson qui nage sous le requin et qui vit de ses restes. C’est ce que je suis. » 284 Vampirisée par son mari. 285 (Cf. Femmes. « Folie ». Épouse de)
Femmes (Écrivaines. Fouillée Augustine) : 1877. Augustine Fouillée [1833-1923] fut, sous le pseudonyme de G. Bruno, l’auteure du livre (publié en 1877) sans doute le plus lu en France, Le tour de la France par deux enfants : 500 éditions, environ 9 millions d’exemplaires vendus. 286 Concernant ses analyses morales et politiques, voici quelques une de ses « leçons » :
- « Le nom d’un père honoré est une fortune pour les enfants » (p.7) ;
- « O mon frère, marchons toujours la main dans la main, unis par un même amour pour nos parents, notre patrie et notre devoir » (p.9) ;
- « Les enfants d’une même patrie doivent s’aimer et se soutenir comme les enfants d’une même mère » (p.13) ;
- « Le courage ne consiste pas à ne point être ému en face d’un danger, mais à surmonter son émotion ; c’est pour cela qu’un enfant peut être aussi courageux qu’un homme » (p.20) ;
- « Le vrai bonheur est dans la maison de la famille » (p.125) ;
- « Il y a eu parmi nos pères et nos mères dans le passé des hommes et des femmes héroïques : le récit de ce qu’ils ont fait élève le cœur et excite à les imiter » (p.132) ;
- « Comme ils sont heureux ceux qui ont un père, une mère, un foyer auquel viennent s’asseoir, après le travail, tous les membres de la famille unis par la même affection ! » (p.156) ;
- « Soumettons-nous à la loi, même quand elle nous parait dure et pénible » (p.210) ;
- « Une famille unie par l’affection possède la meilleure des richesses » (p.254) ;
- « Le courage rend égaux les riches et les pauvres, les grands et les petits dans la défense de la patrie » (p.262) ;
- « Nous jouissons tous les jours, et souvent sans le savoir, de l’œuvre des grands hommes : c’est un bienfait perpétuel qu’ils laissent après eux » (p.266). (Cf. Culture, Enfants, Femmes. Maison, Hommes. « Grands », Famille, Patriarcat, Économie. « Pauvres Les »)
Femmes (Écrivaines. France Culture) : (janvier) 2015. Entendu sur France Culture :
« Lydie Salvayre brosse sept portraits intimistes et enlevés des plus grandes figures littéraires et féminines du début du XXe siècle. Emily Brontë, Djuna Barnes, Sylvia Plath, Colette, Marina Tsvetaieva, Virginia Woolf et Ingeborg Bachmann ». Il est question de « sept folles » (deux fois), « sept allumées », « sept insensées », « sept imprudentes » … Sans oublier : « sept destins malheureux ». 287
Terrifiant… (Cf. Culture. Patriarcale, Femmes. « Féminin »)
Par ordre chronologique. Femmes. Écrivaines. Françoise de Graffigny :
Femmes (Écrivaines. Graffigny Françoise de) (1) : 1825. Le chevalier de Propiac [1759-1823], dans Le Plutarque des jeunes demoiselles. Abrégé des femmes illustres de tous les pays, écrit concernant Françoise de Graffigny [1695-1758] :
« Les lettres d’une Péruvienne […] [1747] est un des plus beaux ouvrages qui soient sortis de la plume d’une femme. » 288 (Cf. Patriarcat. Graffigny Françoise de)
* Ajout. 25 avril 2022. Les lettres d’une Péruvienne faisaient partie des livres trouvés, après sa mort, dans l’appartement de Louis-Antoine de Saint-Just [1767-1794]. 289
Femmes (Écrivaines. Graffigny Françoise de) (2) : 1992. Je lis dans le Dictionnaire des femmes célèbres de Lucienne Mazenod et Ghislaine Schoeller :
« (Françoise Graffigny) devint célèbre après la parution de ses Lettres d’une Péruvienne [1787]. Ce pastiche des Lettres Persanes [Montesquieu. 1721] suscita une vive critique de la part de Turgot [1727-1781] qui reprocha à l’auteur d’avoir été superficielle dans sa critique des mœurs. » 290
Jugée « superficielle » pour ne pas avoir reconnaitre la profondeur de ses analyses féministes. (Cf. Féminismes. Féministes. Graffigny Françoise de. Antiféminisme, Patriarcat. Graffigny Françoise de)
Femmes (Écrivaines. Graffigny Françoise de) (3) : (25 octobre) 2012. Sur YouTube, Henri Guillemin [1903-1992] présentant son Voltaire, présente madame de Graffigny ainsi : « une petite journaliste ». (Cf. Féminismes. Antiféminisme)
-------------
Femmes (Écrivaines. Huber Marie) : 1738. Marie Huber [1695-1753] est citée dans une note de la Correspondance de Voltaire [1694-1778], comme étant l’auteure de :
« Lettres sur la religion essentielle à l’homme distingué de ce qui n’en est que l’accessoire (Amsterdam. 1738). » 291 [Lisible sur Data. bnf.fr]
Femmes (Écrivaines. Huch Ricarda) : (15 octobre) 1929. Thomas Mann [1875-1955], dans une lettre à Gerhart Hauptmann [1862-1946], auteur de :
« […] J’accorderai par exemple de grand cœur le prix [Nobel de littérature] à notre intelligente et éminente Ricarda Huch. » En note :
« Ricarda Huch [1864-1947] : femme de lettre et historienne, pour protester contre le national-socialisme, elle quitta en 1933 l’Académie prussienne des arts. Ricarda Huch passe (sic) pour la seule femme vraiment éminente que l’Allemagne ait jamais produite après Annette Droste-Hülshoff [1797-1848]. » 292
Deux femmes « vraiment éminentes » en Allemagne, pour Gallimard, en deux siècles, n’est-ce pas trop ?
Femmes (Écrivaines. Lagerlöf Selma) : (mars) 1940. Lu dans le Journal de Vézelay de Romain Rolland [1866-1944] :
« Notre voyage coïncide avec les tristes jours des négociations de paix désastreuse de la Finlande, mal soutenue par l’Angleterre et la France, et trahie par ses voisines Suède et Norvège. La noble Selma Lagerlöf [1858-1940] expirera de douleur, au lendemain de la paix lamentable, qui livre au colosse Russe une partie de l’héroïque Finlande. » 293 Elle fut la première femme prix Nobel de littérature [1909].
Par ordre chronologique. Femmes. Écrivaines. Anne-Thérèse de Lambert :
Femmes (Écrivaines. Lambert Anne-Thérèse de) (1) : Anne-Thérèse de Lambert [1647-1733] auteure, notamment, de ces Maximes :
- « Il y a des princes de naissance, il y a des princes de mérite » ;
- « Rien de plus heureux qu’un homme qui jouit d’une considération qu’il ne doit qu’à lui ; rien de plus triste qu’un grand seigneur accablé d’honneurs et de respect qu’on ne rend qu’à sa dignité » ;
- « Avec de grands emplois et des principes vulgaires, on est toujours agité parce qu’on est toujours médiocre » ;
- « C’est par les sentiments qu’il faut se distinguer du peuple ; J’appelle peuple tout ce qui pense bassement et communément : la Cour en est remplie » ;
- « Qu’est-ce que des courtisans ? des glorieux qui font des bassesses et des mercenaires qui se font payer ». Une pensée prérévolutionnaire. 294 (Cf. Êtres humains. Courtisans, Hommes. Heureux, Politique. Démocratie. Peuple. Révolutions)
Femmes (Écrivaines. Lambert Anne-Thérèse de) (2) : 1886. Lu, dans le livre d’Octave Gréard [1828-1904] consacré à et intitulé « L’éducation des femmes par les femmes », concernant Anne-Thérèse de Lambert [1647-1733] :
« Il est peu de femmes qui aient pris à cœur la cause des femmes avec autant d’ardeur que la marquise de Lambert. Quand Fénelon réclame en leur faveur, au nom de la famille, de la société et de la religion, sa réclamation ne trahit que l’émotion généreuse d’un philosophe et d’un chrétien. Cette émotion, chez Madame de Lambert, s’anime de toute la vivacité du sentiment personnel froissé.
Sa dignité souffre à la pensée qu’on ne travaille que pour les hommes, comme s’ils formaient une espèce à part, tandis que les femmes sont sacrifiées, abandonnées, réduites à néant : dans leur jeunesse, on ne les occupe à rien de solide ; au cours de la vie, elles ne peuvent se charger ni du soin de leur fortune, ni de la conduite de leurs affaires ; elles sont livrées sans défense au monde, aux préjugés, à l’ignorance, au plaisir ; il suffit qu’elles soient belles, on ne leur demande rien de plus : on les tient quittes de tout le reste.’
Madame de Lambert ne se borne pas à établir une fois ses griefs : il n’est pas un écrit où elle n’y revient : elle les développe, les retourne en tous les sens, les aiguise. Elle essaye bien par moment de rendre dédain pour dédain : ‘Après tout, les hommes auront beau faire, ils n’ôteront jamais aux femmes la gloire d’avoir formé ce que les temps passé ont compté de plus honnêtes gens’ ; elle se répète ‘qu’il y a bien peu d’hommes qui soient en état de comprendre les femmes’.
Mais cette vengeance intime ne la satisfait point. Une telle inégalité de condition - que la nature n’a point créé et qui est l’œuvre de la force - l’humilie et l’irrite. Elle crie à l’usurpation, à l’injustice : ‘Quelle tyrannie que celle des hommes ! Ils prétendent que nous ne fassions aucun usage de notre intelligence ni de nos sentiments : ils veulent que la bienséance soit aussi blessée quand nous ornons notre esprit que quand nous livrons notre cœur ; en vérité c’est étendre trop loin leurs droits’. […] » 295 (Cf. Droit, Relations entre êtres humains. Bienséance. Dédain, Hommes. Tyrans, Féminismes, Patriarcat. « Espèce », Penser. Pensées. Préjugés)
-------------
Femmes (Écrivaines. Launoy Marie-Catherine de) : (27 mars) 1752. Voltaire [1694-1778], dans une lettre, en anglais, adressée à Sir Edwards Fawkener [1694-1758], évoque « parmi les meilleurs livres [français] connaissant l’histoire », l’ouvrage de Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, baronne d’Aulnoy [1650-1705], intitulé Mémoires de la cour d’Espagne, [Paris, 1690 [?]] qu’il considère comme « le seul livre d’histoire où l’on trouve les coutumes espagnoles. » 296
Un autre titre : Relation du voyage d’Espagne en 1691 de Madame d’Aulnoy. (Cf. Histoire)
Femmes (Écrivaines. Mallet-Joris Françoise) : 1983. Françoise Mallet-Joris [1930-2016], auteure de :
« […] C’est au fond une démarche assez saine d’oublier ce qu’on a fait. Parce qu’on a une fraîcheur… pour se remettre en route. C’est terrible si on se sent propriétaire de ce qu’on a fait. Je crois qu’il faut oublier, il faut recommencer… » 297
Femmes (Écrivaines. Malraux André) : 1967. André Malraux [1901-1976], dans ses Antimémoires, fait part d’une conversation avec Charles de Gaulle [1890-1970], à la Libération qui l’interrogeait sur « les intellectuels » :
« […] Je ne parle pas des acteurs, mais des spectateurs. Depuis le XVIIIème siècle, il y a en France une école des ‘âmes sensibles’. Dans laquelle les femmes de lettres jouent d’ailleurs un rôle assez constant. »
La curieuse réaction de Charles de Gaulle ne manque pas d’intérêt : « Mais pas comme infirmières ».
Ce à quoi André Malraux, futur ministre de la Culture, poursuivant sa ‘pensée’, clôt l’échange :
« La littérature est pleins d’âmes sensibles dont les prolétaires sont les bons sauvages. » 298 (Cf. Culture. Patriarcale, Penser)
Femmes (Écrivaines. Malraux Clara) : 1966. Clara Malraux [1897-1982], après avoir rencontré André Malraux [1901-1976], auteure de :
« De retour à la maison, je dis à ma mère : ‘C’est agréable d’être intelligente, car on plait aux hommes intelligents’. Curieuse constatation qui ne trouve sa preuve qu’en soi, ma propre intelligence me portant garante de l’intelligence d’un autre. […] »
Puis, se remémorant ces premières rencontres, elle poursuit ainsi :
« Il (André Malraux) me parla de l’éternel féminin que je croyais réservé aux poèmes de Laforgue [Jules. 1860-1887], il me révéla l’existence de la misogynie, révélation qui, je dois bien le reconnaître me porta un fier coup.
Comment ce n’était pas en moi-même que j’étais jugée ?
Je m’étais à peu près résignée à ce que ce fût, partiellement, en tant que juive, que demi-étrangère, mais quoi il me faudrait désormais tenir compte, par-dessus le marché d’une sous-estimation de principe opérée par une moitié de l’humanité et que je devrais vaincre pour parvenir à l’égalité avec ceux-là peut être qui ne me valaient pas ?
J’étais stupéfaite.
Depuis peu, je me savais plus vivante, intellectuellement, que mon frère aîné, depuis longtemps plus intelligente que mon jeune frère. Et puis, il y avait cette sorte de privilège accordé aux filles de ma famille.
Au demeurant, je n’avais qu’à regarder autour de moi pour constater que, vraiment, les femmes de mon entourage, étaient sinon plus intelligentes, du moins plus cultivées que leurs compagnons, absorbés, eux, par la nécessité de gagner de l’argent. […] » 299
Si souvent juste… (Cf. Êtres humains. Privilégiés, Femmes. « Féminin ». Intelligentes. Remarquables, Hommes. « Intellectuels ». Malraux André)
Femmes (Écrivaines. Monnet Anne-Marie) : (6 décembre) 1945. Anne-Marie Monnet [?-?] recevant le prix Femina pour son livre : Le chemin du soleil, auteure de :
« Je ne suis pas du tout une femme de littérature, je ne suis pas du tout un femme de lettres. » 300
Femmes (Écrivaines. Montagu. Mary Mortley) : 1844. William Makepeace Thackeray [1811-1863], dans Barry Lyndon, auteur de :
« Elle était filleule de la vieille Mary Mortley Montaigu [1689-1762], et comme cette fameuse vieille du siècle dernier, avait des prétentions considérables à être un bas-bleu et un bel esprit. » Et, en note, je lis :
« Lady Mary Mortley Montaigu, femme de l’ambassadeur britannique en Turquie, a laissé une correspondance de premier ordre qui n’est pas loin de la mettre sur un pied d’égalité avec madame de Sévigné. »
Pourquoi pas l’inverse ? 301 (Cf. Femmes. « Bas-bleus »)
Femmes (Écrivaines. Nothomb Amélie) : (12 mars) 2020. Je n’ai lu aucun des nombreux livres de Nathalie Nothomb, mais je pourrais l’écouter pendant des heures.
Quelle formidable liberté de pensées, sans aucun doute, acquises de hautes luttes. 302
Femmes (Écrivaines. O’Connor Flannery) : Flannery O’Connor [1925-1964], auteure de :
« Ma maladie s’appelle Lupus, je prends une drogue appelée ACTH, et j’essaie de vivre…
J’ai assez d’énergie pour écrire, et comme c’est là tout ce que je dois faire ici-bas, je peux me déclarer satisfaite. » 303
Femmes (Écrivaines. Pore[t]te Marguerite) : Concernant Marguerite Porette [1250-1310], lu sur Wikipédia :
« Femme de lettre mystique et chrétienne, née vers 1250, brûlée le 1er juin 1310. […] Marguerite Porette, béguine, exprime son mysticisme dans un livre intitulé Mirouer des simples âmes anéanties. Il présente l'Amour de l'âme touchée par Dieu, et fait parler l'Amour et la Raison en des dialogues allégoriques. Rapidement ce livre et sa doctrine feront scandale. Son procès fut conduit en faisant appel à une double consultation des universitaires parisiens. Une commission de théologiens se prononça sur une liste d'une quinzaine d'extraits que leur présenta l'inquisiteur, qui demanda parallèlement à un groupe de canonistes de se prononcer sur le comportement de Marguerite, qui devait être jugée relapse, pour avoir enfreint la première condamnation. Rassemblant ces deux expertises, Guillaume de Paris prononça simultanément la condamnation du livre et de son auteur. Remise au bras séculier, elle fut brûlée le 1er juin 1310 en place de Grève à Paris. » 304 (Cf. Êtres humains. Âmes, Dialogues, Justice. Procès, Penser. Théologie)
Par ordre chronologique. Femmes. Écrivaines. Rachilde :
Femmes (Écrivaines. Rachilde) (1) : (14 février) 1911. Lu, concernant Rachilde [1860-1953], le récit d’une rencontre au Mercure de France avec Guillaume Apollinaire [1880-1918], retranscrit dans son Journal Intime :
« Au Mercure, il y a une dame en jupe culotte, Madame Judith Gérard [?], Rachilde [dont il reprend les analyses] : ‘Ça m’a été commode d’être habillée en garçon pendant six ans. Mon directeur m’avait dit : ‘200 fr. par mois et en homme ou à la porte‘. Je n’avais pas à choisir. Et que d’économie de toilette. […]
J’allais parfois au poste pour port d’habit masculin. Au commissariat, j’exhibais l’autorisation du préfet de police [obtenue en 1885] …
La première fois que mon mari (M. Vallette, directeur du Mercure de France) m’a vue, j’étais à Bullier ayant au bras une superbe putain. Samain [Albert. 1858-1900 (?)] me présente à Vallette qui se détourne en disant : ‘Oh non ! pas ça !’ Je le trouvais godiche. Mais le pantalon m’a fait une réputation que je ne méritais pas. Il a nui à mes livres. » 305 (Cf. Êtres humains. Vêtements, Femmes. Lesbiennes. Réputation, Patriarcat)
Femmes (Écrivaines. Rachilde) (2) : 2022. Je lis dans une note de La Pléiade des Journaux et lettre de Franz Kafka [1883-1924] que Rachilde [1860-1953], ‘était considérée en son temps comme ‘la spécialiste du mystère sexuel’, notamment à cause de son roman, Monsieur Venus [1884]. » 306
-------------
Femmes (Écrivaines. Radcliffe Ann) : 1837-1843. Honoré de Balzac [1799-1850], dans les Illusions perdues, évoquant le refus du livre de Lucien [de Rubempré] par un éditeur, écrit :
« J’aurais mieux aimé un roman dans le genre de madame Radcliff [1764-1823]. » Une note précise :
« Cette romancière anglaise avait publié, entre 1789 et 1795, cinq ‘romans noirs’ qui avaient créé un monde et engendré (sic) une littérature romanesque nouvelle. En France, ses Mystères d’Udolphe et L’Italien ou Le Confessionnal des pénitents noirs, avaient été traduits en 1897. Un moment réprimé sous l’Empire, la vogue avait repris en 1815. Les premiers romans de Balzac, sont, à leur manière, des ‘romans noirs’. (Alice M. Killen, Le roman terrifiant ou Roman noir, 1923). » 307
Femmes (Écrivaines. Riccoboni Marie-Jeanne) : Lu sur Wikipédia, concernant Marie-Jeanne Riccoboni [1713-1892], que Denis Diderot [1713-1784] avait écrit :
« Cette femme écrit comme un ange, c’est un naturel, une pureté, une sensibilité, une élégance qu’on ne saurait trop admirer. ».
Ses œuvres complètes ont été éditées en 7 volumes en 1780, suivies d’une nouvelle édition en 1786, puis en 6 volumes en 1818. Et aujourd’hui ?
Par ordre chronologique. Femmes. Écrivaines. Christiane Rochefort :
Femmes (Écrivaines. Rochefort Christiane) (1) : 1982. Après lecture du livre de Christiane Rochefort [1917-1998], Quand tu vas chez les femmes, 308 les liens, les différences avec Histoire d’O ne peuvent qu’être effectués. (Cf. Patriarcat, Pornographie. Histoire d’O, « Sciences » sociales. Philosophie. Christiane Rochefort)
Femmes (Écrivaines. Rochefort Christiane) (2) : 1990. Françoise Verny [1928-2004], dans Le plus beau métier du monde, évoque à deux reprises Christiane Rochefort [1917-1998], qu’elle considère comme l’« une des plus grandes romancières de ce temps » Les voici :
- en 1968 : « Christiane Rochefort, en ‘gauchiste’ confirmée, entend organiser [chez Grasset] des ‘sittings’ avec des écrivains pour débattre de l’organisation future de l’édition. Elle rêve comme Jean-Pierre Faye, d’une société où les auteurs, libérés de l’emprise capitaliste, s’éditeraient eux-mêmes. »
- en 1974, celle-ci lui propose d’adapter à l’écran, Les petits enfants du siècle [1961]. Christiane Rochefort accepte « son intervention, mais, par féminisme, refuse celle d’un homme [Michel Favart] », puis, « l’admet sans dissimuler qu’elle reste méfiante ». […] « Le film terminé, nous le montrons tremblant à Christiane. Celle-ci dont l’honnêteté n’est jamais entachée par les convictions, se déclare satisfaite ; ayant balayé les préjugés, elle étreint Michel. » 309 (Cf. Culture. Patriarcale, Penser. Débattre. Préjugés)
* Ajout. 26 décembre 2019. Éric Dussert, sur France Culture, ce jour, concernant Les petits enfants du siècle, auteur de : « Ma génération n’a pas lu ce texte ».
S’est-il interrogé pour savoir si les féministes de sa génération l’ont lu ? Et si la question avait un intérêt ? (Cf. Langage. Possessif)
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Écrivaines. Jeanne-Marie Roland :
Femmes (Écrivaines. Roland Jeanne-Marie) (1) : 1793. Jeanne-Marie Roland [1754-1793], avait confié ses manuscrits à un ami, L.-A Champagneux, lequel, craignant d’être arrêté, les avaient brulés :
« Il a jeté au feu mes manuscrits [ses Notices Historiques]. J’avoue que j’aurais préféré qu’il m’y jetât moi-même ». En prison, elle reprend son travail et dans ses Mémoires particuliers, elle écrit :
« J’ai senti toute l’amertume de cette perte que je ne réparerai point ; mais je m’indignerai contre moi-même de me laisser abattre par quoi que ce soit. Dans toutes les peines que j’ai essuyées, la plus vive impression de douleur est presque aussitôt accompagnée de l’ambition d’opposer mes forces au mal dont je suis l’objet, et de la surmonter, ou par le bien que je fais à d’autres, ou par l’augmentation de mon propre courage. Ainsi, le malheur peut me poursuivre et non m’accabler ; les tyrans peuvent me persécuter, mais m’avilir ? jamais, jamais ! » 310 (Cf. Politique. Tyrannie. Tyrans)
Femmes (Écrivaines. Roland Jeanne-Marie) (2) : 1793. Jeanne-Marie Roland [1754-1793], dans ses Mémoires particuliers, auteure de :
« Jamais, je n’eus la plus légère tentation de devenir auteur un jour : je vis de très bonne heure qu’une femme qui gagnait ce titre perdait beaucoup plus qu’elle n’avait acquis. Les hommes ne l’aimaient point et son sexe la critique ; si ses ouvrages sont mauvais, on se moque d’elle, et l’ont fait bien ; s’ils sont bons, on les lui ôte. Si l’on est forcé de reconnaître qu’elle en a produit la meilleure partie, on épluche tellement son caractère, ses mœurs, sa conduite et ses talents que l’on balance la réputation de son esprit par l’écart que l’on donne à ses défauts. » Lire la suite concernant le travail d’écriture qu’elle a effectué avec, pour, sans son mari. (Cf. Femmes. Réputation, Histoire. Roland Jeanne-Marie)
Femmes (Écrivaines. Roland Jeanne-Marie) (3) :
Deux jugements la concernant qui jugent leurs auteurs :
- 1853. Jules Michelet [1798-1874], dans son Histoire de la Révolution française, concernant Jeanne-Marie Roland [1754-1793], alors qu’un décret d’arrestation avait été lancé contre son mari [1754-1793] et qu’elle avait tenté d’arracher sa liberté, avant d’être elle-même arrêtée, auteur de :
« Il faut lire toute la scène dans ses Mémoires admirables, qu’on croirait souvent moins écrites d’une plume de femme que du poignard de Caton. Mais tel mot, arraché des entrailles maternelles, telle allusion touchante à l’irréprochable amitié, font trop sentir par moments, que ce grand homme est une femme, que cette âme, pour être si forte, hélas ! n’en était pas moins tendre. » 311 (Cf. Êtres humains. Âmes)
- 1876. Hippolyte Taine [1828-1893], dans Les origines de la France contemporaine, écrit, la concernant :
« Les Mémoires de Mme Roland [1754-1793], sont le chef d’œuvre de l’orgueil qui croit se déguiser et ne quitte jamais ses échasses. » 312 (Cf. Femmes. Orgueil, Hommes. « Grands », Patriarcat, Histoire. Taine Hippolyte. Révolution française. Roland Jeanne-Marie)
-------------
Femmes (Écrivaines. Sablé Madeleine de) : 1992. Je lis dans un Dictionnaire des femmes célèbres, en conclusion de la présentation de « Madame Madeleine de Sablé, née de Souvré. marquise de. Femmes de lettres françaises. [1599-1678] :
« Elle a laissé des Instructions pour enfants, une correspondance abondante et des maximes. Elle fut l’inspiratrice de Pascal [1623-1662] qui lui doit certaines de ses Pensées, et son nom est inséparable de celui de La Rochefoucauld. [1613-1680] » 313 (Cf. Hommes. Remarquables. La Rochefoucauld, Langage, Académie française. Delay Florence)
Femmes (Écrivaines. Sainte-Soline Claire) : (14 février) 1936. André Gide [1869-1951], dans son Journal, écrit :
« J’achève Journée [1934] de Claire Sainte-Soline [1891-1967] qui, dans les bonnes parties, ne le cède en rien aux meilleures de Marguerite Audoux [1863-1937]. Certains dialogues, avec la vieille tante, lorsque celle-ci cherche une raison d’être, sont excellents. Beaucoup moins réussis les dialogues imaginaires qui suivent le crime. » 314 (Cf. Dialogues)
Par ordre chronologique. Femmes. Écrivaines. George Sand :
Femmes (Écrivaines. Sand George) (1) : (28 septembre) 1858. George Sand [1804-1876], dans une lettre à François Buloz [1803-1877], auteure de :
« […] Enfin, le reproche de manque de sincérité adressé à tout l’ouvrage de l’Histoire de ma vie, est injuste et quand vous voudrez me prouver sur quelle chose et sur quelle personne j’ai menti sciemment et méchamment, je m’y rendrais, mais non pas auparavant. Jusque-là, permettez-moi de souhaiter aux hommes de mon temps autant de mansuétude et de philosophique douceur que mon cœur de femme en a prouvé et conservé. » 315 (Cf. Patriarcat. Penser le patriarcat. Sand George. Critique)
Femmes (Écrivaines. Sand George) (2) : (30 novembre) 1858. George Sand [1804-1876], dans une lettre à Aimé Chérest [1826-1885], auteure de :
« […] Il me suffira donc d’être défendue sous le rapport des bonnes intentions et de la sincérité. J’abandonne absolument l’orgueil littéraire à ceux qui en ont et je vous demande de parler de moi avec une sympathie qui sera la meilleure preuve en ma faveur. » 316 (Cf. Femmes. Orgueil)
Femmes (Écrivaines. Sand George) (3) : (13 décembre) 1859. George Sand [1804-1876], dans une lettre à Charles Edmond [1822-1899], auteure de :
« Ne me complimentez pas de ma facilité. Ne pas pouvoir s’arrêter pour réfléchir, c’est un autre défaut que le trop de réflexions et bien souvent je fais le projet d’aller doucement sans pouvoir y parvenir. Mon idée s’échappe dès qu’elle refroidit et comme ma mémoire est courte, je ne la retrouve plus. J’aimerais la garder un peu et la mûrir… impossible. » 317
Femmes (Écrivaines. Sand George) (4) : (4 février) 1862. George Sand [1804-1876], dans une lettre à l’abbé Georges Rochet [1803-1881], auteure de :
« À combien de périls et d’amertumes on échappe en écrivant ! » 318
Femmes (Écrivaines. Sand George) (5) : (18 novembre) 1862. George Sand [1804-1876], dans une lettre à M***, auteure de :
« […] Je n’ai jamais pu tirer quoi que ce soit d’un sujet qui ne m’était pas venu à moi seule. » 319
Femmes (Écrivaines. Sand George) (6) : (9 juin) 1870. George Sand [1804-1876], dans une lettre à sa fille Solange Clésinger-Sand [1828-1899], auteure de :
« Je trouve bon qu’à un moment donné le spectateur pénètre directement et sans voile dans la conscience de l’auteur[e]. » 320
Femmes (Écrivaines. Sand George) (7) : (29 juin) 1871. George Sand [1804-1876], dans une lettre à Stella Blandy [1836-1925] qui lui avait adressé son livre [« sans doute La dernière chanson »], auteure de :
« Je crois que vous devez continuer à écrire. Vous savez voir et peindre. En ce moment, on n’est guère porté à l’idylle, c’est portant bon, de se reposer de la réalité, et croyez que la fiction gracieuse et attendrie fait souvent plus de bien que le raisonnement. » 321 (Cf. Culture. « Mélo », Penser)
Femmes (Écrivaines. Sand George) (8) : (21 octobre) 1871. George Sand [1804-1876], dans une lettre à Henry Harisse [1829-1910], auteure de :
« [...] D’avance je vous dis que je ne suis pas de ceux qui prétendent que faire servir l’art à soutenir une thèse, c’est le rabaisser. Je suis de l’avis tout contraire. Le but élevé élève l’art, et quand on pense autrement, c’est peut-être qu’on embrouille une question mal posée. » 322
N.B. George Sand s’oppose ici à son ami Gustave Flaubert [1821-1880].
Femmes (Écrivaines. Sand George) (9) : (5 avril) 1872. George Sand [1804-1876], dans une lettre à Hippolyte Taine [1828-1893], auteure de :
« […] Car Flaubert [1821-1880] qui m’aime de tout son cœur personnellement, ne m’aime pas tant que ça littérairement. Il ne croit pas que je sois dans le bon chemin et il n’est pas le seul de mes amis qui me croie plus bienveillante qu’artiste. Moi, je ne sais rien de moi, sinon que j’ai toujours cru que l’art et la conscience c’était la même chose et quand on me dit le contraire, je ne suis point du tout persuadée… Mais alors je m’en prends à moi. Je me dis que si j’avais eu plus de talent j’aurais mieux fait accepter mon idéalisme. […] » 323 (Cf. Culture. Sand George, Êtres humains. Conscience. Soi. Sand George, Politique. Idéalisme)
Femmes (Écrivaines. Sand George) (10) : (8 octobre) 1872. George Sand [1804-1876], dans une lettre à Gustave Flaubert [1821-1880], auteure de :
« […] Tu veux écrire pour les temps. Moi, je crois que dans cinquante ans je serai parfaitement oubliée et peut être durement méconnue. C’est la loi des choses qui ne sont pas de premier ordre et je ne me suis jamais crue de 1er ordre. Mon idée a été plutôt d’agir sur mes contemporains, ne fut-ce que sur quelques-uns, et de leur faire partager mon idéal de douceur et de poésie. »
N.B. La note de Georges Lubin [1904-2000] doit être citée :
« Modestie dont nous avons vu maints exemples au cours de cette publication. » 324
Femmes (Écrivaines. Sand George) (11) : (21 juin) 1873. Chanson, citée par George Sand [1804-1876], écrite et chantée au Banquet du Caveau consacré aux Femmes célèbres :
« Au nom de la galanterie / Messieurs, ne soyons pas jaloux / Les femmes de notre patrie / Parfois se font dignes de vous, / Devant elles inclinons-nous ! / Entre cent noms pleins de lumières / Le nom de Sand aura régné / Et Boileau, Corneille, Molière / N’ont pas effacé Sévigné. » 325 (Cf. Hommes. Jaloux. « Galants », Relations entre êtres humains. Galanterie)
Femmes (Écrivaines. Sand George) (12) : (10 avril) 1874. George Sand [1804-1876], dans une lettre à Gustave Flaubert [1821-1880], auteure de :
« Il n’y a d’amusant que le travail qui n’a encore été lu à personne, tout le reste est corvée et métier, chose horrible ! » 326
Femmes (Écrivaines. Sand George) (13) : (24 novembre) 1874. George Sand [1804-1876], dans une lettre à Michel Lévy [responsable de la publication notamment des Mémoires de George Sand, publiées après sa mort en juillet-août 1876. 1821-1875], auteure de :
« Je pensais avoir des changements à faire, je n’en ai trouvé aucun en dehors des fautes typographiques. Ce que je pensais au moment où j’ai écrit ces mémoires, je le pense encore et je le pense de la même manière. Cet ouvrage n’a pas eu, je crois, un grand succès de vente, et que la presse a plus abîmé qu’elle en l’a encouragé, aura plus de succès par la suite des temps, quand je n’y serai plus. En le relisant, j’ai acquis la certitude qu’il touche juste en en plusieurs endroits, les problèmes de la vie individuelle dans ses rapports avec la vie générale. » 327
Femmes (Écrivaines. Sand George) (14) : (8 juin) 1876. L’acte de décès de George Sand la présente comme « sans profession ». 328
-------------
Femmes (Écrivaines. Sapienza Goliarda) : 1994. 1997. Angelo Maria Pellegrino, mari et éditeur de Goliarda Sapienza [1924-1996], en conclusion de sa Postface de L’art de la joie, écrit :
« […] Aux idées, par contre aux idées, elle était extrêmement attentive - elle se définissait en effet comme un écrivain idéologique, se calomniant elle-même à l’évidence, oui cœur et idées étaient sa seule nourriture littéraire. Pour le reste elle écrivait vraiment pour les lecteurs les plus purs et les plus lointains, les seuls qu’elle parvint à se sentit fraternellement proches. » 329 (Cf. Penser. Idées)
Femmes (Écrivaines. Sarraute Nathalie) : Nathalie Sarraute [1900-1999] publia son dernier livre, Ouvrez, à 97 ans.
Femmes (Écrivaines. Ségur Sophie de) : La comtesse de Ségur [1799-1874] était payée par Hachette au forfait, pas au pourcentage. (Cf. Économie)
Femmes (Écrivaines. Sévigné Madame de) : 1811. Concernant madame de Sévigné [1626-1696], voici qu’en écrivait madame de Genlis [1746-1830] :
« Il n’est dans la langue française, qu’un seul ouvrage que l’on ait jamais critiqué et qui, sans exciter l’envie, ait dans tous les temps réuni tous les ouvrages, et cet ouvrage fut écrit par une femme. Les Lettres de Madame de Sévigné offrent toujours un modèle parfait du style épistolaire, et un modèle unique, non seulement par le naturel, la grâce, l’esprit, l’imagination et la sensibilité qui les rendent si brillantes et si supérieures à tout ce que l’on connaît dans ce genre, mais encore par l’intérêt qu’inspirent et la femme estimable et charmante qui les écrivit, et les temps qu’elle retrace et les personnages dont elle parle. » 330 (Cf. Femmes. Noms, Famille. Mariage. Madame de Sévigné, Langage. Langue. Française, Patriarcat. Genlis Félicité de, Penser. Penseuses)
* Ajout. 30 août 2017. Après relecture de certaines de ces lettres, leur valeur ne me paraît pas mériter tant d’éloges…
* Ajout. 31 mars 2021.… Sans doute parce que le style ne me suffit pas… (Cf. Langage. Style)
Femmes (Écrivaines. Shelley Mary) : 1834. Mary Shelley [1797-1851] fille de Mary Wollstonecraft, morte à sa naissance, et de William Godwin, épouse de Percy B. Shelley ; trois de ses quatre enfants étant morts jeunes, auteure [en sus, en autres, de Frankenstein…], le 2 décembre 1834, de :
« La solitude a été la malédiction de mon existence. Qu’aurais-je fait si mon imagination n’avait pas été ma compagne ? […] Oh, mais pourtant mes rêves, mes chers rêves ensoleillés ! Ils ont peuplé le cimetière où j’ai été, si jeune, assignée à errer. » 331
Femmes (Écrivaines. Staal-Delaunay Marguerite-Jeanne de) : 1755. Concernant Marguerite-Jeanne Staal-Delaunay [1684-1750], Charles-Augustin Sainte-Beuve [1804-1869], dans ses Portraits littéraires [1864. T. III. p.454] la présente comme « le premier élève de La Bruyère [1645-1696] mais une élève devenue l’égale du maître », ajoutant encore :
« Nul écrivain ne fournirait autant qu’elle de pensées, neuves, vraies, irrécusables. » 332
Par ordre chronologique. Femmes. Écrivaines. Germaine de Staël :
Femmes (Écrivaines. Staël Germaine de) (1) : Germaine de Staël [1766-1817], auteure (sans date, sans source. Retrouver) de :
« Ils (les écrivains) croient se mettre à la portée de leurs lecteurs ; mais il ne faut jamais supposer à ceux qui vous lisent des facultés inférieures aux vôtres ; il convient mieux d’exprimer ses pensées telles qu’on les a conçues. On ne doit pas se mettre au niveau du plus grand nombre, mais tendre au plus haut terme de perfection possible : le jugement du public est toujours, à la fin, celui des hommes [et des femmes] les plus distingués de la nation. » 333
- Sans la référence aux « plus distingués », fort juste analyse, mise, en outre, en œuvre par elle. (Cf. Femmes. Remarquables. Staël Germaine de)
Femmes (Écrivaines. Staël Germaine de) (2) : (3 décembre) 1943. Jean Guéhenno [1890-1978], dans son Journal, fait lire à ses élèves De l’Allemagne (1810) de Germaine de Staël [lesquels « n’ont rien compris à cet éloge dithyrambique de l’Allemagne et ne concevaient pas qu’elle ait pu être si différente de ce qu’elle est aujourd’hui »]. Il écrit, la concernant :
« […] C’est notre honneur que, dans le temps même où Napoléon [1769-1821], trahissant et confisquant la Révolution, tentait d’asservir l’Allemagne et l’Europe, un écrivain de chez nous ait écrit cet éloge d’un peuple étranger et, au nom même de la Révolution, ait reconnu les divers peuples dans leur singularité et leur grandeur et fourni le principe d’une fédération européenne. » 334 (Cf. Femmes. Remarquables. Staël Germaine de, Politique. Nationalisme. Démocratie. Peuple. Révolutions)
Femmes (Écrivaines. Staël Germaine de) (3) : 2017. Germaine de Staël [1766-1817] est publiée - en 2017 ! - dans La Pléiade [Gallimard].
Sont publiés deux romans : Corinne ou l'Italie [1807], Delphine [1802] (aisément déjà disponibles) et De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales [1800], ses textes les plus connus.
- Ne sont notamment publiés ni De l’Allemagne, ni les Considérations sur la révolution française, ni Dix années d’exil, ni ses Réflexions sur le procès de la Reine, par une femme [août 1793. Marie-Antoinette [1755-16 octobre 1793] ni ses Réflexions sur la paix intérieure, ni De l’influence des passions sur le bonheur des individus et des nations, ni ses Réflexions sur le suicide, ni, ni … Sans évoquer sa remarquable et immense correspondance [publiée en 7 tomes chez Slatkine).
- Une femme qui pense, a fortiori lorsqu’elle pense le Politique, courageuse qui plus est, était alors dangereuse ; cela est toujours vrai, dans l’édition, pour Gallimard, en France, en 2017. (Cf. Culture. Patriarcale, Femmes. Remarquables. Staël Germaine de. D’Avila Thérèse, Patriarcat. Littérature, Politique)
* Ajout. 29 avril 2017. Pour rappel, les Mémoires de Saint-Simon [1675-1755] de La Pléiade comportent huit tomes et la seule Correspondance de Voltaire [1694-1778], treize tomes.
* Ajout. 14 avril 2019. Les Œuvres complètes de Germaine de Staël sont publiées - remarquablement - par les Éditions Honoré Champion : Œuvres critiques [3 tomes], Œuvres littéraires [4 tomes], Œuvres historiques [3 tomes], Correspondance générale [9 tomes].
-------------
Femmes (Écrivaines. Torres Tereska) : (12 juin) 1946. Georges Bernanos [1888-1948] écrit à madame Tereska Georges Torrès [1920-2012] :
« Madame, J’aime votre beau petit livre [Le sable et l’écume. Gallimard. 1946. 197p.], tout éclatant d’honneur, de jeunesse et de grande piété. J’y aime par-dessus tout cette retenue dans la confidence, cette discrétion à la fois si modeste et si fière, ce deuil porté si noblement, et qui ne s’attendrit jamais sur lui-même, afin de n’attendrir personne. […] » 335
- Madame Tereska Georges Torrès a publié 14 livres en français. Lire Wikipédia concernant sa vie et son œuvre. (Cf. Relations entre êtres humains. Discrétion, Femmes. Modestes)
Femmes (Écrivaines. Toussaint-Samson Adèle) : 1883. Adèle Toussaint-Samson [1826-1911], concernant le Brésil où elle vécut 12 ans (elle s’y installa avec son mari en 1849), se souvient :
« Ce spectacle de l’esclavage fut pendant les premières années de mon séjour au Brésil un des supplices de ma vie et ne contribua pas peu à me donner la nostalgie dont je pensais mourir.
À chaque moment, mon âme se révoltait ou saignait quand je passais devant ces leilões (encans) où de pauvres nègres montés sur une table étaient mis aux enchères et examinés aux dents et aux jambes comme des chevaux ou des mules ; quand je voyais l’enchère se couvrir et qu’une jeune négresse était livrée au fazendeiro qui la réservait à son service intime, tandis que son petit nègre était quelques fois vendu à un autre maître.
Devant toutes ces scènes de barbarie, mon cœur se soulevait de généreuses colères bouillonnaient en moi, et j’étais obligée de me faire violence pour ne pas crier à tous ces hommes qui faisaient commerce de chair humaine : ‘Carascos !’ [Bourreaux] comme je l’avais crié à ma voisine espagnole.
À peine était parvenue à me calmer que je rencontrais, quelques pas plus loin, un pauvre Noir portant un masque de fer ; c’était encore de cette façon que l’on punissait l’ivrognerie chez l’esclave. Ceux qui buvaient étaient condamnés à porter un masque de fer qui s’attachait derrière la tête avec un cadenas et qu’on ne leur enlevait qu’à l’heure des repas. On peut imaginer l’impression que causait ces hommes à tête de fer ! C’était effrayant ! Et jugez quel supplice sous cette chaleur tropicale.
Ceux qui avaient fuis étaient attachés par une jambe à un poteau ; d’autres portaient au cou un grand carcan, espèce de joug comme celui qu’on met aux bœufs ; d’autres étaient envoyés à la correcão [prison pénitentiaire] où […] quarante, cinquante, quelques fois soixante coups de fouet leur étaient administrés en plusieurs fois. Quand le sang coulait, on s’arrêtait ; leurs blessures étaient pansées avec du vinaigre et le jours suivant, on recommençait. »
Puis, malheureusement, après, elle justifie après l’esclavage pour, notamment, en dédouaner l’Empereur du Brésil. 336 (Cf. Êtres humains. Âmes. Esclavage, Corps. Dents, Femmes. Colère, Politique. Esclavage, Économie. « Pauvres Les », Histoire)
Par ordre chronologique. Femmes. Écrivaines. Marina Tsvetaieva :
Femmes (Écrivaines. Tsvetaieva Marina) (1) : Marina Tsvetaieva [1892-1941], auteure (sans date) de :
« Je refuse de vivre comme les loups. » 337 (Cf. Politique. Animalisation du monde)
Femmes (Écrivaines. Tsvetaieva Marina) (2) : 1980. Voici l’analyse féministe de Janna Ivina concernant Marina Tsvetaieva [1892-1941] :
« Tsvetaieva a enduré jusqu’au bout ce vide immense, cette crispation immobile, cette absence de stimulation, et elle a dû boire jusqu’à la lie la coupe inépuisable du quotidien.
Elle, que l’on qualifie de ‘poète important de son époque’ a passé sa vie, comme mille autres femmes, à faire la soupe, à raccommoder des chaussettes, à élever ses enfants.
Ni le mariage, ni le ‘milieu littéraire’ n’ont pu lui épargner cette pesanteur des tâches.
La société et la famille exigeaient d’elle qu’elle s’y consacre avant tout, comme toutes les femmes.
Le poète qui était en elle a dû se frayer une voie vers la lumière comme un arbre dans le bitume.
Si je raconte cette vie de Tsvetaieva, ce n’est pas pour m’en servir de prétexte afin de faire des reproches aux femmes que des conditions de vie aussi insoutenables empêchent de réaliser leurs potentialités créatrices ; c’est bien plutôt pour que cet exemple (exemple unique ‘envers et contre tous’) attire l’attention et la sympathie des maris et de la société…
Le destin tragique de Marina Tsvetaieva n’est qu’une preuve des capacités inouïes que peut recéler une femme, et non une dénonciation des insuffisances féminines. » 338 (Cf. Êtres humains. Vies. Vies-dites-privées, Femmes. « Féminin », Relations entre êtres humains. Reproches)
Femmes (Écrivaines. Tsvetaieva Marina) (3) : 2001. Voici, dans ses Portraits de femmes, l’analyse de Pietro Citati [1930-2022] concernant le poids des contraintes de la vie quotidienne (à Paris de 1925 à 1939), celles au sein desquelles vécut Marina Tsvetaieva [1892-1941] :
« La vie quotidienne, qu’elle avait toujours farouchement détestée, la tuait. Sans cesse, il fallait balayer, aller chercher de l’eau, laver le linge, monter le charbon, allumer le poêle, faire cuire une infecte viande de cheval, laver la vaisselle, descendre les ordures. Il n’y avait jamais d’argent pour rien : la note de gaz, du charbon, de la lumière, celle du laitier, du boulanger, excédait ses maigres ressources. Elle n’avait pas de place. Pas de temps. Elle n’avait pas de chaussures pour marcher. Tout était sale.
‘Je suis éternellement au milieu de la saleté, éternellement les brosses et le balai à la main, éternellement pressée, éternellement au milieu des fagots, du charbon et des cendres : un dépotoir vivant ! À genoux, je fais la servante - dont ne sait quoi ! je suis toute tachée de cendres, j’ai des mains de charbonnier - je ne parviens pas à faire partir le noir.’ » 339 (Cf. Êtres humains. Vies. Vies-dites-privées, Femmes. Servantes)
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Écrivaines. Louise de Vilmorin :
Femmes (Écrivaines. Vilmorin Louise de) (1) : (22 octobre) 1965. Louise de Vilmorin [1902-1969], auteure de :
« Moins il y a d’esclavage, moins il y a de bonheur. » Et de :
« Les femmes, elles veulent toutes être des hommes. »340 (Cf. Patriarcat, Politique. Esclavage)
Femmes (Écrivaines. Vilmorin Louise de) (2) : 1987. Louise de Vilmorin [1902-1969] confia, au terme de sa vie, à Jean Chalon, « son mal de vivre », lequel le rapporte ainsi :
« J’ai vécu et je suis triste de vivre. On m’a souvent offensée, blessée, abattue, mais j’ai refusé de prendre le parti du mal que l’on m’a fait, et des insultes que j’ai endurées. Folie que d’oublier le meilleur pour le pire. » 341
Une face cachée de la femme uniquement présentée comme frivole, mondaine, ce quelle fut…
Femmes (Écrivaines. Vilmorin Louise de) (3) : (21 mars) 2008. Comparer ce que dit Louise de Vilmorin de sa vie [1902-1969] avec le titre raffiné, délicat, respectueux de L’Observateur à sa mort :
« Louise de Vilmorin, la machine à plaire ».
On peut y lire en sus : « L’admiration que Malraux porte à l’écrivain s’adresse aussi à la femme. » (Relations entre êtres humains. Admiration, Féminismes. Antiféminisme, Patriarcat)
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Écrivaines. Edith Wharton :
Femmes (Écrivaines. Wharton Edith) (1) : (juin) 1904. Edith Wharton [1862-1937], dans une lettre à William C. Brownell [1851-1928] des Éditions Scribner, auteure de :
« Je vous retourne ci-joint les comptes rendus (de The Descent of man. La descendance de l’homme) avec mes remerciements.
Je n’ai jamais été beaucoup affectée par les critiques […] mais m’entendre dire continuellement que je ne suis qu’un écho de Mr. James [Henry. 1843-1916] (si j’apprécie grandement l’homme en lui, je suis incapable de lire ce que l’écrivain a produit depuis dix ans) [...] ne manque pas de me démoraliser quelque peu. » 342 (Féminismes. Antiféminisme, Langage. Possessif, Penser. Wharton Edith)
* Ajout. 17 août 2020. Encore ce jour, plus d’un siècle après, Edith Wharton est, sur France Culture, qualifiée de « double féminin de Henry James ». (Cf. Culture. Patriarcale, Femmes. « Féminin », Patriarcat. Permanence)
Femmes (Écrivaines. Wharton Edith) (2) : 1932. Edith Wharton [1862-1937], dans Les chemins parcourus. Autobiographie, sans être critique à l’égard d’Henry James [1843-1916], « peut être l’ami le plus intime que j’ai jamais eu » note certaines de ses réactions - propres à décourager quiconque de continuer à écrire - à ses écrits. Exemples :
« Vous aviez sous la main un sujet magnifique, dont vous auriez dû faire votre thème principal, que vous avez utilisé comme un simple incident et n’avez fait qu’effleurer » ; « Alors, ma chère petite, vous avez choisi le mauvais type de sujet » ; « C’est un épisode très louable, à mettre au crédit de sa carrière. Mais elle ne doit jamais recommencer. » 343 (Cf. Hommes, Patriarcat)
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Écrivaines. Phyllis Wheatley :
Femmes (Écrivaines. Wheatley Phyllis) (1) : 1773. Phillis Wheatley [1753-1784], née esclave, au Sénégal, achetée à Boston [États-Unis] par John et Susannah Wheatley. Toujours esclave, elle apprit l’anglais, le latin et le grec. Elle publia notamment à Londres en 1773, ses Poems on Various Subjects, Religious and Moral. Elle est considérée comme la première poétesse noire Américaine, le premier poète noir Américain. (Cf. Politique. Esclavage)
Femmes (Écrivaines. Wheatley Phyllis) (2) : (11 avril) 1774. Voltaire [1694-1778], un an après, écrit la concernant, sans la citer néanmoins :
« Fontenelle [1657-1757] avait tort de dire qu'il n'y aurait jamais de poètes chez les nègres.
Il y actuellement une négresse qui fait de très bons vers anglais. » 344
-------------
Femmes (Écrivaines. Wordsworth Dorothy) : (8 juin) 1961. Julien Green [1900-1998] écrit dans son Journal :
« Repris le journal de Dorothy Wordsworth [1771-1855]. Ce livre est sans doute ce qui se rapproche le plus de la poésie chinoise dans notre monde occidental. Avec la même attention qu’un chinois, elle regarde les nuages, les fleurs, les arbres, elle écoute la voix des vagues, suit toutes les nuances de couleurs dans la lumière. D’elle-même, elle disait qu’elle était un peu plus qu’une moitié de poète. » 345 (Cf. Culture. Patriarcale)
-------------
IV. Femmes (Épouse - compagne - de) :
Femmes. Épouse de :
Femmes (Épouse) (1) : Après plus de quarante années de mariage avec un mari odieux, après avoir abandonné toutes les tentatives, non plus même de le quitter, mais d’agir comme bon lui semblait, cinq enfants après, elle était, méconnaissable, devenue l’ombre de la femme - remarquable - qu’elle avait été. Confrontée à des situations qui exigeaient son autonomie de pensée, elle ne pouvait plus être que la triste caricature de son mari, minable par ailleurs.
Femmes (Épouse) (2) : Mariée à un homme qu’elle n’avait pas choisi, devenue sa « moitié », dépossédée de sa langue et ignorant celle qui lui était dorénavant nécessaire, vivant dans un pays dont elle ignorait l’essentiel, enfermée chez elle, devenue aphasique, elle fut, de nombreux tests à l’appui, caractérisée et considérée comme « bipolaire ». Ce fut la seule fois de sa vie où elle se vit gratifiée d’un deux : « la phase maniaque et la phase dépressive ».
Femmes (Épouse) (3) : Elle avait une forte personnalité. Son mari aussi. L’une et l’autre pensaient, espéraient, pour ne pas avoir à céder, qu’il ou elle vivrait le dernier / la dernière. Cette compétition les maintient en vie longtemps.
Femmes (Épouse) (4) : L’épouse effectuait pour le compte et au bénéfice de son mari ce que son orgueil viril lui interdisait de faire et ce qu’elle-même n’aurait jamais fait pour elle-même.
Femmes (Épouse) (5) : Moins que lui ; tout pour lui ; rien sans lui.
Par ordre alphabétique. Femmes. Épouse de :
Femmes (Épouse de. Agacinski Sylviane) : (15 décembre) 1998. Sylviane Agacinski, épouse de Lionel Jospin, alors premier ministre, dans Le Monde, auteure de :
« Quant à profiter de l’intimité, pour faire passer mes idées, ce n’est vraiment pas mon style. Sur aucun de sujets que l’on cite généralement, je n’ai développé ma position dans l’espoir de faire changer mon mari d’avis. Je crois que les femmes ne peuvent pas jouer sur tous les tableaux : avoir une activité propre et entretenir un pouvoir occulte. La modernité, ce n’est pas d’être épouse. C’est d’être femme et citoyenne. » 346
Comment une femme, une citoyenne peuvent-elles occulter l’épouse ? (Cf. Êtres humains)
* Ajout. 14 mars 2024. Élue (sic) à l’académie française. (Cf. Langage. Académie française)
Femmes (Épouse de. Agutte Georgette) : 1922. Georgette Agutte [1867-1922], peintre et sculptrice, épouse de Marcel Sembat [1862-1922], après sa mort brutale, se suicida, après avoir écrit sur un billet :
« […] Je sais que je ne peux vivre sans lui. Voilà douze heures qu’il est parti. Je suis en retard. » 347
Femmes (Épouse de. Arnault Hélène) : (5 mars) 2025. Je lis, dans l’article du Canard enchaîné (p.4), Travailler chez Bernard Arnaud, c’est pas du luxe, que l’épouse de Bernard Arnault, première ou deuxième fortune mondiale, lorsque, « à l’issue d’un repas chez les Arnault, les bouteille de vins ne sont pas terminées, madame photographie leur niveau. […] »
Par ordre chronologique. Femmes. Épouse de. Suzanne Aron :
Femmes (Épouse de. Aron Suzanne) (1) : Concernant Suzanne Aron [1907-1997] (née sous le nom de Suzanne Gauchon), son épouse, voici que Raymond Aron [1905-1983], interrogé sur les ambitions politiques qu’il aurait pu avoir, répondit :
« […] À un ou deux moments, j’ai eu le désir de l’action politique. Mais, fort heureusement, ma femme, ma compagne est une personne intelligente et beaucoup plus raisonnable que moi, m’a toujours dit que j’étais fait pour beaucoup de choses mais pas pour être un homme politique. » 348
Et pourtant ce n’est pas la place qu’il accorde à son épouse dans ses Mémoires qui révélerait ni son « intelligence », ni sa « raison ». 349
* Ajout. 31 juillet 2016. Dans ses Mémoires, Raymond Aron donne des explications beaucoup plus crédibles de son refus de devenir un « homme politique » que celles présentées comme relevant de l’influence de son épouse, concernant notamment son adhésion au RPF [Rassemblement du peuple français]. 350 (Cf. Femmes. Intelligentes, Hommes. « Intellectuels ». Aron Raymond, Relations entre êtres humains. Influence)
Femmes (Épouse de. Aron Suzanne) (2) : 1997. Je lis deux textes, dans le revue Commentaire, concernant Suzanne Aron [1907-1997], écrits après sa mort.
- Le premier d’Albert Palle, intitulé Un professeur d’énergie, dont la conclusion est :
« Suzanne Aron aurait pu, elle aussi, exercer une profession, écrire des livres, laisser une œuvre. Elle a choisi d’être la femme, la compagne, la mère. Un choix qui touche au plus profond de l’être. Il semble qu’elle ait toujours bien distingué entre le faire et l’être et refusé d’admettre qu’on n’est pas si on ne fait pas. Elle a été Suzanne Aron. » 351
- Le second, signé Nicolas Baverez, intitulé Éloge funèbre, qui se termine ainsi :
« […] Elle ne dévia jamais de la ligne de conduite qu’elle s’était tracée : soutenir, à travers l’homme qu’elle aimait, la construction d’une œuvre qui la dépassait. » 352
Femmes (Épouse de. Aron Suzanne) (3) : 1957. Je lis dans les Mémoires de Pierre Vidal-Naquet [1930-2006] concernant la création et les premières actions du Comité Maurice Audin [1932-1957] :
« Qui était présent ce soir-là, en dehors de Michel Croizet et de moi, je ne saurais le dire. Je me souviens cependant qu’il fut beaucoup question d’une pétition de femmes, signée notamment par Suzanne Aron, l’épouse de Raymond, visant à éviter la guillotine à une jeune Algérienne, Djamila Bouhired. » 353
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Épouse de. Jeanne Bernanos :
Femmes (Épouse de. Bernanos Jeanne) (1) : (novembre) 1938. Georges Bernanos [1888-1948], dans une lettre au père Bruckberger [1907-1998], auteur de :
« Je vous écris la joie dans mon cœur parce que je viens de refuser ma collaboration à un très puissant nouveau journal, très bien-pensant, financé par des industriels multimillionnaires. […] » et de :
« Jeanne a été épatante, comme toujours dans ces cas-là. » 354 (Cf. Politique. Morale, Économie)
Femmes (Épouse de. Bernanos Jeanne) (2) : (janvier) 1946. Georges Bernanos [1888-1948] écrit à son épouse :
« Ma bonne petite Jeannette, la maison est encore debout, et personne - à ma connaissance du moins - ne s’est encore suicidé. Tu peux donc dormir tranquille.
Depuis trois jours où cette satanée machine du tonnerre de Dieu t’a emportée, je me sens si désespérément seul. Mon cœur est parti avec le tien.
Hier soir, dans ma sacrée chambre, je me disais que tu devais être éreintée dans la tienne. Ta chère image est dans mon cœur et je respire aussi ton parfum dont notre chambre est imprégnée. Ma pensée est ton royaume. […]
Je voudrais bien que tu réussisses dans tes projets. Une bonne auto te consolerait un peu d’un mauvais mari. […]
Je t’aime, ma Jeannette, sais-tu que s’il me fallait choisir une Jeannette, c’est encore toi que je choisirais (Pauvre Jeannette !)
Que Dieu te garde.
Ton terriblement vieux mari au cœur si jeune. » 355
Femmes (Épouse de. Bernanos Jeanne) (3) : 1986. Je relève dans Georges Bernanos [1888-1948], à la merci des passants écrit par Jean-Loup Bernanos - fils de Georges Bernanos - concernant son épouse, Jeanne Talbert d'Arc [1893-1960], ceci :
- « […] Puis vint le départ pour le Brésil. Le cœur gros, ma mère confia son vieux père à un ami d’alors qui promit de s’en occuper, mais à qui la mort de celui-ci le laissa enterrer dans la vie commune. » […]
- « La vie quasi primitive menée à Vassouras et à Pirapora, dans un climat qu’elle supportait mal. Une alimentation à décourager le plus coriace des tubes digestifs. Six déménagements en sept ans (une trentaine au cours de leur existence). L’éternel tailleur bleu marine à lignes blanches qu’elle mettait lors des brefs séjours à Belo-Horizonte et Rio de Janeiro où son mari l’emmenait, pour lui faire plaisir, bien sûr, mais aussi parce qu’il ne pouvait pas se passer de sa présence. » […]
- « Les blouses merveilleusement brodées, véritables œuvres d’art, destinées à être vendues pour boucler les fins de mois. Les problèmes de santé : phlébite, épuisement nerveux, opération de la vésicule, d’une hernie, infection généralisée de la mâchoire, asthme. […] »
- « Pensez un instant à ce qu’était l’angoisse quotidienne de ma mère : d’abord son fils qui, à 16 ans et demi, s’engage dans de sanglants combats, puis manque de justesse d’être fusillé pour désertion. À cette heure, c’est son mari qu’elle guette, craint pour sa vie, et cependant, pas un instant elle ne se plaint, consciente qu’elle est du sens de l’honneur qui anime son mari et qu’elle partage avec une fidélité sans faille. Il en sera toujours ainsi. » […]
Mon père le savait bien qui disait souvent : ‘Ma femme a toujours pensé comme moi sur la question’. Peut-être même en abusa-t-il. » […]
- « De 1948 au 6 août 1960, où elle alla le rejoindre dans la ‘profonde éternité’, ma mère, au lieu de jouer les ‘glorieuses’, respectera la tradition, refusant honneurs et avantages, se tenant à l’écart de toute vie mondaine. Après avoir vécu 32 ans dans l’ombre d’un génie, elle s’abstiendra de profiter de son éclat. » 356
-------------
Femmes (Épouse de. Beuve-Méry Geneviève) : 1997. Je me souviens avoir lu dans sa nécrologie parue dans Le Monde :
« Je n’ai pas eu de mari, mes enfants n’ont pas eu de père, mais Le Monde a eu un directeur. »
N.B. Je n’ai pas pu retrouver la date exacte, mais je pense être proche de la citation qui m’avait à l’époque beaucoup marquée et que j’avais retranscrite. Il faudrait, pour confirmation, retrouver les archives du Monde après sa mort : 4 juin 1997, ainsi que celles de la nécrologie par Le Monde d’Hubert Beuve-Méry [1902-1989] qui en avait été le directeur. (Cf. Histoire. Archives)
* Ajout. 2 décembre 2016. Pour Françoise Giroud [1916-2003] « cette phrase fut probablement inventé, de toutes pièces, par l’un des journalistes de Beuve. »
Pourquoi écrire cela ? Pour diminuer cette femme ? Pour atténuer, effacer la subversion de l’analyse ? 357
* Ajout. 3 juin 2019. Lu dans Le Monde et ses lecteurs d’Abel Chatelain [1910-1971], la référence à un article de Françoise Giroud dans L’Express [13 avril 1956] consacré à Hubert Beuve-Méry [1902-1989] :
« Le patron n’est guère plus riche qu’eux (les rédacteurs), il fait voyager sa femme (une camarade de faculté) et ses quatre fils en troisième [classe]. » 358 (Cf. Langage. Verbe. Faire)
* Ajout. 27 mars 2025. 1979. Lu dans Jean-Noël Jeanneney, Jacques Julliard [1933-2023], Le Monde de Beuve-Méry ou le métier d’Alceste :
« En septembre 1928, il [Hubert Beuve-Méry] épouse Geneviève Deloye [1903-1997], une camarade de doctorat, dont il aime aujourd’hui à louer le discrétion et l’efficace (sic) dévouement. C’est tout.
Et, elle ne fait pas partie de la liste des 36 personnes interrogées (35 hommes et une femme), pour l’écriture de ce livre. (p.366) 359 (Cf. Femmes. Dévouement, Patriarcat, Histoire. Patriarcale)
Femmes (Épouse de. Blanqui Suzanne-Amélie) : 1971. Suzanne-Amélie Blanqui [1814-1841] mourut à 26 ans, le 31 janvier 1841, « après une longue maladie et une agonie d’un an », alors que Auguste Blanqui [1805-1881] était enfermé au Mont Saint Michel [de 1840 à 1844].
Dans Auguste Blanqui de Maurice Dommanget [1886-1976], je lis :
« Quand, égrenant ses souvenirs, [en 1880] Blanqui évoque le passé, c’est de sa femme qu’il parle le plus souvent. Et alors - suave vision qui illumine sa physionomie si parlante et si active - apparaît la silhouette de celle qui porta sept ans son nom et lui avait dit un jour :’Je sais bien que tu n’aimeras jamais que moi au monde !’ Il en fut ainsi en effet et Blanqui rappelait avec attendrissement qu’il avait été pour la dernière fois au théâtre avec elle près d’un demi-siècle auparavant. […] » Il est aussi question dans ce livre d’un portait peint par elle. 360
N.B. Une notice lui est consacrée dans Le Maitron. (Cf. Histoire. Patriarcale. Dommanget Maurice)
* Ajout. Le 27 août 1942, Jean Zay [1904-20 juin 1944], en prison, dans une lettre à son épouse, cite une lettre de 1880 d’Auguste Blanqui [1805-1881] - dont il se souvient qui avait « fait 38 ans de prison » - à Édouard Vaillant [1840-1915] :
« Le plus grand bonheur de la vie d’un homme de lutte, c’est d’avoir été aimé, d’avoir eu près de soi, dans l’incertitude et le danger, un cœur fidèle. » 361 (Cf. Femmes. Mères. Blanqui Auguste)
Femmes (Épouse de. Bloy Anne-Marie) : Anne Marie Bloy, [?-?], auteure de :
« Après Dieu, c’est à Léon Bloy [1846-1917] que je dois le bonheur inouï d’appartenir à l’Église catholique romaine. […] » 362 (Cf. Patriarcat. Église catholique)
Par ordre chronologique. Femmes. Épouse de. Lise Blum :
Femmes (Épouse de. Blum Lise) (1) : (1er mai) 1899. Jules Renard [1864-1910] écrit dans son Journal concernant Lise Blum [1881-1938] :
« Je dis à Léon Blum [1872-1950] que sa femme [Lise. 1872-1950] est de celles qui nous font sentir notre vulgarité ordinaire. On est respectueux et dérouté. On fait une plaisanterie : elles ne répondent pas, elles sourient à peine et nous voilà honteux. » 363 (Cf. Femmes. Renard Jules)
Femmes (Épouse de. Blum Lise) (2) : 1907. Léon Blum [1872-1950] publia sur la page de garde de son livre Du mariage l’avertissement suivant :
« [Ce livre] je l’ai médité longtemps, et en le relisant achevé je me sens plus persuadé que jamais de sa vérité fondamentale. […]
Je demande la permission de rendre publique la dédicace que j’en fais à ma femme, entendant signifier par-là que dans la conception de ce livre il n’entre pas de déception ni de rancune, mais au contraire un sentiment de reconnaissance, et qu’il fut écrit par un homme heureux. » (Cf. Hommes. Heureux) 364
Femmes (Épouse de. Blum Lise) (3) : Concernant notamment l’échec du couple et du mariage de Lise Blum [1872-1950] et Léon Blum [1872-1950], se référer à Pierre Birnbaum, Léon Blum, Un portrait. [Le Seuil. 2016] (Cf. Famille. Couple)
-------------
Femmes (Épouse de. Boudet Paulette) : 1988. Paulette Boudet [1922-2007], catholique, dans Ce combat n’est pas le tien, « raconte sa propre histoire, celle d’une épouse qui découvre que son mari entretient une liaison et qui chemine, dans la foi, jusqu’au pardon. » 365
Son livre lui est dédicacé en ces termes :
« À mon mari, en le remerciant pour l’aide qu’il m’a apportée et le nihil obstat qu’il m’a généreusement accordé. » 366
Difficile à lire, même trente ans après… (Cf. Relations entre êtres humains. Pardon)
N.B. « Nihil obstat » : formule latine de droit canon signifiant pour l’église catholique que ‘rien ne s’y oppose’ à la publication d’un texte, dès considéré comme conforme à la morale religieuse.
Femmes (Épouse de. Bourbon-Siciles Marie-Amélie) : 1848. Marie-Amélie de Bourbon-Siciles [1782-1866], épouse de Louis Philippe [1773-1850]. Alors que celui-ci, au troisième jour de la Révolution de 1848, le 24 février, était abandonné des derniers politiques qui l’entouraient et rédigeait son acte d’abdication, son épouse déclara :
« Vous ne connaissez pas le roi, c’est le plus honnête homme du royaume. » 367 (Cf. Hommes. « Politiques »)
Femmes (Épouse de. Bourget Minnie) : 1932. Edith Wharton [1862-1937], dans Les chemins parcourus. Autobiographie, écrit :
« Minnie Bourget [Julia Louise Amélien, née David. 1871-1932, épouse de Paul Bourget. 1852-1935] était une créature tellement rare, tellement pleine de délicatesse et de vibrations secrètes, mais tellement convaincue qu’elle n’était venue sur terre que pour être l’ombre attentive de son mari, que je n’ai jamais compris par quel heureux hasard j’ai pu franchir ce qu’on pourrait son invisibilité volontaire, et avoir accès à sa véritable personnalité. Mais il en fut ainsi ; et, de notre première rencontre, jusqu’au jour où la maladie qui devait l’emporter la contraignit finalement à cette réclusion à laquelle elle avait toujours aspiré, je n’ai jamais frappé en vain aux portes de sa confiance. Nous nous disputions sur de nombreux sujets ; et elle ne supportait aucune discussion sur un point que ses convictions rendaient sacré ; mais nous étions si profondément d’accord sur l’essentiel que les désaccords n’avaient aucune importance. Je ne sais guère ce qui nous unissait - peut-être la poésie, peut-être la peinture, ou les vieilles scènes historiées, mais aussi quelque chose de plus profond et de plus exquis, dont la beauté que nous adorions n’était qu’un indice fugitif. Mais je ne trouve aucun mot assez délicat et impondérable pour décrire les frémissements de ses ailes de Psyché, repliées mais jamais en repos ; elle est morte, maintenant, ses ailes ne frémissent plus, et une partie de moi-même est morte avec elle. » 368 (Cf. Femmes. Écrivaines. Wharton Edith. « Créatures »)
Femmes (Épouse de. Brossolette Gilberte) : 1946. Gilberte Brossolette [1905-2004], résistante, députée à l’assemble Constituante, sénatrice, vice-présidente du sénat de 1946 à 1954, épouse, puis veuve de Pierre Brossolette, résistant [1903-1944], auteure de :
« […] J’étais très bien accueillie par les hommes. J’étais la veuve de Pierre, ils avaient tous beaucoup de respect, ils projetaient sur moi l’admiration qu’ils avaient pour Pierre. J’étais en quelque sorte l’émanation de Pierre. »
Suivi de (concernant les femmes députées à la Libération) :
« Il y avait la veuve de Machin, la veuve de Truc, les communistes surtout ont su jouer de cette fibre-là et très peu de femmes avaient su professer leur indépendance. » 369 (Cf. Femmes. « Politiques ». Veuves, Relations entre êtres humains. Admiration)
Femmes (Épouse de. Ceausescu Elena) : 1997. Lu dans les Mémoires de Mikhaïl Gorbatchev [1931-2022] :
« Elena Ceausescu [1916-1989] me confia un jour, et pas sur un ton de la plaisanterie, que la Roumanie était trop petite pour un dirigeant de sa stature de son mari. » 370 (Cf. Hommes. « Modestes »)
Femmes (Épouse de César) : « Il ne faut pas que la femme de César soit soupçonnée » :
« Allusion à la célèbre réponse de César [Jules. 12 ou 213 juillet 100 avant J.C-44 avant J.C] aux juges qui s’étonnaient ce qu’il avait répudié sa femme, alors qu’il épargnait Claudius, ‘sacrilège’, qui s’était introduit sous un déguisement auprès de Pompéia au cours des Mystères de la Bonne Déesse : ‘C’est que la femme de César ne doit pas même être soupçonnée’. (Cf. Plutarque, Vies parallèles [?] des hommes illustres.) » (Cf. Histoire. « Longue ») 371
Par ordre chronologique. Femmes. Épouse de. Bernadette Chirac :
Femmes (Épouse de. Chirac Bernadette) (1) : 2001. Bernadette Chirac, auteure de :
- « […] Si je l’avais écouté (son mari), je n’aurais jamais rien fait ! » Et de :
- « […] Je me suis constamment ajustée à ce qu’il pouvait souhaiter de la part de son épouse. » Et, aussi, de :
- « […] Chez les crocodiles, les femelles montent la garde cependant que les mâles restent disponibles pour attaquer. Et c’est tout à fait symbolique de notre vie de couple. » 372 (Cf. Famille. Couple, Femmes. « Femelles »)
Femmes (Épouse de. Chirac Bernadette) (2) : 2016. Bernadette Chirac, auteure de :
« Je ne veux pas être prétentieuse…, mais les gens vous disent : ‘Madame Chirac, si vous n’aviez pas été là, il (Jacques Chirac) n’aurait jamais été président de la République’. » 373 Jugement aisément applicable à d’autres… (Cf. Hommes « Politiques ». Chirac Jacques)
-------------
Femmes (Épouse de. Claudel Reine) : 1940. Concernant Reine Sainte-Marie Perrin [1880-1973], épouse de Paul Claudel et mère de leurs cinq enfants, je lis dans le Journal de Vézelay de Romain Rolland [1866-1944], en 1940 :
« Entre sa femme légitime et lui (Paul Claudel), peu de sympathie. Il faut avouer qu’elle a bien des raisons de rancune. Il dit qu’elle ne lit pas ce qu’il écrit, qu’elle ne l’a jamais compris. Mais il rend hommage à la dignité avec laquelle elle a toujours rempli ses devoirs de mère et d’épouse, dans une pénible vie qu’elle n’aimait pas. Il ne semble pas qu’il l’ait beaucoup aidée. Avec la naïveté de son égoïsme dont il se targue quelques fois, il dit que, quand l’intérieur domestique était trop triste, et plein d’enfants malades ou d’ennuis, il préférait s’en aller de la maison, ‘parce qu’il avait le cœur trop sensible’.
À quoi sa femme répliquait que c’était par égoïsme. Il discutait encore là-dessus avec nous, avec une pointe d’humour paradoxal. […] » 374
Femmes (Épouse de. Clésinger-Sand Solange) : (13 août) 1858. Solange Clésinger-Sand [1828-1899] écrit à sa mère George Sand [1804-1876] :
« Tu veux le mot de l’énigme de mon être. Je crois qu’il n’est pas difficile à donner. Les évènements font les hommes ou tout au moins les modifient, les changent. Quand je me suis mariée, j’étais un enfant gâté, sans aucune notion, aucune idée de la vie. Si j’avais épousé un brave homme, intelligent, ferme et doux, si j’avais été unie à un Ernest [Périgois], j’aurais certainement fait la meilleure, la plus tranquille et peut-être la plus bourgeoise des femmes. J’ai eu au contraire pour mari un sacripant, un forcené, une bête sauvage et stupide. J’ai été démoralisée, toute jeune, à mon entrée dans la vie, par cet homme méchant et insensé. J’ai perdu la tête. À l’enfant gâté, a succédé l’être extravagant, faussé, absurde, l’oeuvre du sculpteur [Auguste Clésinger, sculpteur. 1814-1883]. […] » 375
De la ‘mauvaise mère’ au mauvais époux…
Femmes. Épouse de. Ivy Compton-Burnett :
Femmes (Épouse de. Compton-Burnett Ivy) (1) : 1929. Ivy Compton-Burnett [1884-1969], dans Frères et sœurs, auteure de :
« Sophia ne rendait la vie facile qu’à son mari. Elle était de ces femmes pour qui le mari suffit à remplir l’existence. Envers ses enfants, son affection exigeait plus qu’elle ne donnait. » 376 (Cf. Femmes. Mères, Famille. Couple)
Femmes (Épouse de. Compton-Burnett Ivy) (2) : 1929. Ivy Compton-Burnett [1884-1969], dans Frères et sœurs, auteure de :
« Je voudrais vous demander conseil ; je n’ai personne d’autre vers qui me tourner. Pas mon mari, en tout cas, je ne dois lui causer aucun souci. » 377
-------------
Femmes (Épouse de. Comtesse Almaviva) : 1796. Lorenzo de Ponte [1749-1838], dans le livret des Noces de Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart [1756-1791], concernant la comtesse Almaviva, auteur de :
« Oh ciel ! à quelle humiliation me réduit un mari cruel, qui, avec un mélange inouï d’infidélité, de jalousie et de dédain, après m’avoir aimée, ensuite offensée, enfin trompée, m’amène à rechercher maintenant l’aide de ma servante !
Où sont passés les beaux moments de tendresse et de plaisir ; que sont devenus les serrements de ces lèvres trompeuses ? Pourquoi, dès lors que tout se changeait pour moi en douleur et en larmes, le souvenir de ce bonheur est-il toujours gravé dans mon cœur ?
Si, du moins, ma constance à désirer son amour me donnait l’espoir de changer ce cœur ingrat ! » 378 (Cf. Femmes. « Trompées », Hommes. Infidèles)
Femmes (Épouse de. Daudet Julia) : Concernant son épouse Julia Daudet [1844-1940], née sous le nom de Allart, Alphonse Daudet [1840-1897] évoqua leur collaboration dans son Histoire de mes livres en ces termes :
« Pas un page qu’elle n’ait revue et corrigée. » Un peu court…, mais il faudrait lire ce livre (pas lu).
Une présentation de sa vie et de ses œuvres de cette écrivaine, poétesse, journaliste, est lisible dans les Annexes biographiques du 4ème tome de la Correspondance d’Émile Zola [1840-1902] 379
Femmes. Épouse de. Marguerite Derrida :
Femmes (Épouse de. Derrida Marguerite) (1) : 2010. Benoît Peeters, dans Trois ans avec Derrida. Les carnets d’un biographe, écrit :
« L’une des difficultés que je rencontre, en écrivant la biographie [de Jacques Derrida. 1930-2004] est de donner à Marguerite [son épouse, psychanalyste] la place qui lui revient. Elle fut, près de cinquante années durant, la première lectrice et la première interlocutrice, la proche entre les proches, quoi qu’il ait pu arriver. Mais pour évoquer cette présence et cet amour, je ne dispose ni de lettres, ni de documents. C’est au quotidien, dans le secret de la relation, que leur histoire s’est vécue - et que je peux seulement effleurer. Le biographe (celui que je suis en tout cas) est plus à l’aise dans l’évènementiel que dans la durée longue. » 380 (Cf. Hommes. « Intellectuels ». Derrida Jacques, Histoire. Peeters Benoît. Histoire des femmes)
Femmes (Épouse de. Derrida Marguerite) (2) : 2010. Benoît Peeters, dans Derrida, écrit :
« L’admission de Marguerite à la Société psychanalytique de Paris n’ira pas de soi ; en 1974, elle est d’abord ‘ajournée’ à la grande surprise de René Diatkine [1918-1998], l’un de ceux qui ont procédé à son contrôle. Lors d’une réunion, un des didacticiens aurait lancé : ‘Il faut bien vous rendre compte qu’en faisant entrer Mme Derrida, c’est à Jacques Derrida que vous ouvrez la porte. Acceptée l’année suivante, Marguerite ouvre un cabinet, rue des Feuillantines. Se spécialisant dans la psychanalyse d’enfants, elle essaie de se tenir aussi à distance que possible des luttes institutionnelles qui déchire le milieu psychanalytique. » (Cf. Hommes, Patriarcat, « Sciences » sociales. Psychanalyse) 381
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Épouse de. Yvonne de Gaulle :
Femmes (Épouse de. Gaulle de Yvonne) (1) : 1940. 1958. 1967. Charles de Gaulle [1890-1970], dans ses Mémoires, évoque son épouse Yvonne de Gaulle [1900-1979] en ces termes :
- Le 18 juin 1940, avant son départ en Angleterre, il écrit :
« Je priais monsieur de Margerie [1899-1980] d’envoyer sans délai à ma femme et à mes enfants, qui se trouvaient à Carantec, les passeports nécessaires pour gagner l’Angleterre. »
- En 1958, puis, pendant trois ans et demi, chef de l’État, Charles de Gaulle évoque toutes ses visites en France et écrit :
« Pendant le même temps, ma femme, en toute discrétion, est allée voir quelques trois cents hôpitaux, maternités, maisons de retraite, orphelinats, centres d’enfants malades ou handicapés. »
Charles de Gaulle écrit aussi :
« La résidence du Président est naturellement le cadre de continuelles visites, invitations et cérémonies. Comme tout compte, s’il s’agit du prestige de l’État, je tiens pour important qu’à cet égard, les choses se passent avec ampleur et mesure, bonne grâce et dignité. C’est bien aussi ce que veut la maîtresse de maison, ma femme. »
- Charles de Gaulle Il rapporte enfin la teneur de la réception au Vatican par Jean XXIII, [1967] qu’il termine ainsi :
« C’est à cela qu’il [le Pape] va consacrer son pontificat. Ma femme ayant été introduite, Jean XXIII nous bénit. Nous ne le reverrons plus. » 382 (Cf. Êtres humains. Handicapés, Femmes. « Maîtresses de maison », Relations entre êtres humains. Discrétion, Famille)
Femmes (Épouse de. Gaulle de Yvonne) (2) : 2004. Philippe de Gaulle [1921-2024] juge les relations entre son père et sa mère :
- « […] Elle vivait à travers mon père. En conséquence, tout ce qu’il ressentait se répercutait en elle. »
- « Elle n’avait pas son mot à dire. De toutes façons, en quoi a-t-elle jamais été en désaccord avec lui ? L’avons-nous une seule fois entendue s’opposer à lui autrement que par une réflexion bénigne ou un regard ? Elle entérinait toutes ses décisions sans discussion. »
- « Je ne cesserai jamais de faire remarquer que ma mère se conformait toujours aux désirs de son mari, même lorsqu’ils contrevenaient à ses propres souhaits. Sa mère en faisait autant avec mon grand-père. Peut-être demandait-elle parfois des explications. Il eut fallu en tout cas une oreille très fine pour surprendre la moindre discussion un peu animée derrière la porte de leur chambre. » (Cf. Femmes. Bourgeoises, Famille, Patriarcat) 383
Femmes (Épouse de. Gaulle de Yvonne) (3) : 2009. Danielle Mitterrand [1924-2011], après l’élection de François Mitterrand [1916-1996], en 1981, installe son secrétariat à l’Élysée et se souvient :
« Figurez-vous qu’un jour, un peu à l’étroit malgré tout, je désignai, au bout du couloir, une porte toujours fermée : ‘- Cette pièce est-elle occupée ? - C’est la chapelle de Madame de Gaulle’, me dit-on. Elle n’est donc plus utilisée depuis 13 ans ? »
Oh, la mauvaise idée que me souffle mon ‘petit malin’ : - ‘Une grande salle jouxtant mon secrétariat, quelle aubaine ! Attention ! Danielle, tu n’y penses pas ! Sacrilège, sacrilège !’
Il vaut mieux que je n’insiste pas. »
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Épouse de. Lucette Destouches :
Femmes (Épouse de. Destouches Lucette) (1) : 2018. David Alliot, après avoir présenté son livre Madame Céline - Lucette Destouches, épouse de Louis-Ferdinand Céline [1894-1961] - conclut sa présentation par cette phrase :
« Ce livre, c’est un peu l’envers du décor. » 384
Jugement valide pour tant de couples … (Cf. Famille. Couple)
Femmes (Épouse de. Destouches Lucette) (2) : 2018. David Alliot, auteur de Madame Céline [Tallandier. 429p. 2018], dans un interview à Radio courtoisie (radio d’extrême-droite), affirme :
« Elle n’a jamais eu un mot à l’encontre de son mari. »
Puis, en faisant part de sa rencontre avec elle, alors âgée de 105 ans, il rapporte ses propos concernant son mari :
« Vous savez, il n’était pas facile à vivre. »
Enfin, évoquant leur vie, David Alliot dit :
« Elle a tout subi, tout encaissé », évoque l’enfermement auquel elle était soumise, affirme qu’il a dû lui en faire voir « des vertes et des pas mûres » et que, du vivant de Céline [1894-1961], « elle n’avait pas voix au chapitre ». 385
Femmes (Épouse de. Destouches Lucette) (3) : (25 juillet) 2018. Lu dans Le Canard enchaîné concernant la présentation de ce même livre, Madame Céline :
« [Louis-Ferdinand Céline. 1894-1961] mari tyrannique, sans aucun doute. ‘Tous les jours [Lucette] devait faire ses entrechats et ses pointes sur le petit plancher, sous la surveillance de Céline, montre en main.’ Dans leur pavillon de Meudon, dont l’ex-dandy dépenaillé ne sort jamais, Lucette donne ses cours de danse au premier étage. Quand elle s’échappe à Paris, elle doit téléphoner chez elle tous les quarts d’heure pour rassurer l’ermite. Courage, fidélité et abnégation, elle mérite bien une médaille, mais laquelle ? » 386 (Cf. Hommes. Tyrans)
-------------
Femmes (Épouse de. Dolto Françoise) : 1992. Dans l’Autoportrait d’une psychanalyste de Françoise Dolto [1908-1988] rapporte cet échange qui a eu lieu entre elle et son mari, quinze jours avant sa mort, « un viatique d’amour » :
« Il m’a dit : ‘Alors, c’est vrai, tu ne m’as jamais trompé ?’ C’était extraordinaire ! Comment voulais-tu que je te croie ? Une femme comme toi ! Je ne t’arrivais pas à la cheville ! ». Et moi : « Mais, c’est moi qui ne t’arrivais pas à la cheville ! Tu ne te rends pas compte ! » 387 (Cf. Hommes. « Trompés », Relations entre êtres humains. Amour, Famille. Couple, « Sciences » sociales. Psychanalyse)
Par ordre chronologique. Femmes. Épouse de. Lucie Dreyfus :
Femmes (Épouse de. Dreyfus Lucie) (1) : 1894-1897. Voici quelques éléments de lettres adressées par Lucie Dreyfus [1869-1945] à son mari, Alfred Dreyfus [1859-1935] :
- 23 décembre 1894 : « Quel malheur, quelle torture, quelle ignominie ! Nous en sommes tous terrifiés, anéantis. Je sais comme tu es courageux, je t’admire. Tu es un malheureux martyr. Je t’en supplie, supporte encore vaillamment ces nouvelles tortures. Notre vie, notre fortune à tous sera sacrifiée à la recherche des coupables. Nous les trouverons, il le faut. Tu seras réhabilité. »
- 26 décembre 1894 : « Je te demande un immense sacrifice, celui de vivre pour moi, pour nos enfants, de lutter jusqu’à la réhabilitation. »
- 31 décembre 1894 : « Supporte vaillamment cette triste cérémonie [la dégradation], relève la tête et crie ton innocence, ton martyre à la face de tes exécuteurs. »
- 13 janvier 1895 : « Je suis fière de porter ton nom. » […]
- 22 janvier 1895 : Elle évoque « les efforts surhumains que nous faisons pour trouver dans notre pauvre intelligence la clé de l’énigme. » […]
- 27 janvier 1895 : « Nous n’aurons le droit de mourir que lorsque notre tâche sera accomplie, lorsque notre nom sera lavé de cette souillure. » […]
- 16 mars 1897 : « Puisque nous sommes malheureusement appelés à remplir un devoir sacré par respect pour notre nom, pour celui que porte nos enfants, élevons-nous à la hauteur de notre mission et ne nous abaissons pas à envisager toutes ces misères. Si nous sommes anéantis par la chagrin, ayons au moins la satisfaction du devoir accompli, raidissons-nous dans la tranquillité de notre conscience, et g ardons toute notre énergie, toute notre force à mener à bien notre réhabilitation.» […]
- Le 22 juillet 1906, Alfred Dreyfus sera officiellement « réhabilité ». 388 (Cf. Justice. Procès, Politique. Tortures)
Femmes (Épouse de. Dreyfus Lucie) (2) : 1894. Lors du procès de Rennes, Alfred Dreyfus exprime publiquement sa gratitude à son épouse :
« Après ma condamnation, j’étais décidé à me tuer, j’étais décidé à ne pas aller à ce supplice épouvantable d’un soldat auquel on allait arracher les insignes de l’honneur ; eh bien, si j’ai été au supplice, je puis le dire ici, c’est grâce à Mme Dreyfus qui m’a indiqué mon devoir et m’a dit que si j’étais innocent, pour elle et pour mes enfants, je devais aller au supplice la tête haute ! Si je suis ici, c’est à elle que je le dois.. » 389 (Cf. Famille. Couple, Justice. Procès. Dreyfus Alfred)
Femmes (Épouse de. Dreyfus Lucie) (3) : (18 novembre) 2019. Le rôle politique de Lucie Dreyfus - une femme admirable - est une fois encore niée dans le film de Roman Polanski, J’accuse. Et au-delà, celui des femmes, absentes ou malmenées.
Sans oublier toutes les autres critiques du film, notamment féministes… (Cf. Culture. Polanski Roman. Cinéma)
Femmes (Épouse de. Dreyfus Lucie) (4) : (24 avril) 2022. Vu sur France 5, le bon et beau, mais trop court documentaire [Delphine Morel] :
« Alfred et Lucie Dreyfus, je t’embrasse comme je t’aime ».
-------------
Femmes (Épouse de. Duplantier Raymond) : 1980. Louise Weiss [1893-1983], dans Combats pour les femmes, rapporte la campagne - efficace - de La femme Nouvelle menée dans la Vienne pour faire échouer l’élection de janvier 1936 du sénateur Raymond Duplantier [1874-1954], en diffusant notamment ses ignobles propos contre le vote des femmes et contre les femmes.
Son épouse demande à la rencontrer. Alors que Louise Weiss s’attendait à « une giclée de vitriol », elle entend :
«Ah, ma chère présidente ! Vous n'en avez pas assez dit contre mon mari. C'est un voyou et un bandit. Quand il présente Marguerite [sa fille] à ses amis, il l'appelle ‘sa volaille’. N'est-ce pas Marguerite ? Comme il voyage sans payer, il emmène avec lui, dans des pays qu'il ne m'a jamais montré, même en voyage de noces, des garces que j'aurais honte de rencontrer. Il vole l'État et il me prive d'amour. D'amour ! Oh ! Je sais bien qu'une femme comme vous peut s'en passer, mais moi, Madame, moi ! » Et Louise Weiss poursuit :
« Ces dames me proposèrent de continuer la campagne à mes côtés et me soumirent le texte d’un discours vengeur quelles auraient volontiers adressé, sous mon égide, aux électeurs de la vienne. Je leur opposais une fin de non-recevoir. – ‘Ne croyez pas que votre offre soit séduisante, leur expliquai-je. Le féminisme perdrait la face s’il épousait des querelles de ménages. Les discours du sénateur publiés à L’Officiel me suffisent.’
Mais madame Duplantier ne voulut rien entendre. Elle alla porter son texte à Cécile Brunschvicg [1877-1946] qui, sautant sur l’occasion de ne pas demeurer en reste avec moi, le publia dans La Française (à retrouver). Sa feuille (sic) fut condamnée pour diffamation. N’empêche qu’à l’automne [1935], du fait de La femme nouvelle, M. Duplantier ne fut pas renvoyé au Luxembourg où il avait siégé dix-huit ans d’affilée. » 390 (Cf. Relations entre êtres humains. Amour, Féminismes, Politique. Vote des femmes, Proxénétisme)
Par ordre chronologique. Femmes. Épouse de. Penelope Fillon :
Femmes (Épouse de. Fillon Penelope) (1) : (6 février) 2017. Concernant son épouse, Penelope Fillon, François Fillon, auteur de :
« Lorsque je l’ai rencontrée, ma femme votait travailliste [en Grande-Bretagne]. J’ai dû un peu l’influencer, elle est devenue proche du nouveau parti social-démocrate (avant que celui-ci ne fusionne avec les Libéraux britanniques). » 391 (Cf. Relations entre êtres humains. Influence, Famille. Couple)
Femmes (Épouse de. Fillon Penelope) (2) : 2017. Ségolène Royal défend Penelope Fillon, « une femme très digne, une mère de famille très respectable », « victime d’un dispositif qu’elle ignorait ». 392
Ségolène Royal ne pouvait-elle pas dire aussi que Penelope Fillon est, plus simplement, d’abord victime de son mari ? (Cf. Droit, Femmes. « Politiques ». Ségolène Royal. Mère, Hommes. « Politiques ». Fillon François, Famille, Patriarcat)
Femmes (Épouse de. Fillon Penelope) (3) : 2017. Lu dans Le Canard enchaîné (Journal de Penelope F. Une parodie, donc) :
« Heureusement que je peux m’exprimer dans ‘Le Canard’ ! Car pour le moment, il n’y a que François qui cause. Je ne peux même pas présenter mes excuses, ça devient gênant. God Dam ! Ce n’est pas parce que je m’appelle Penelope que je dois faire tapisserie ! Oui j’en ai gros sur la potatoe. Quand Ségolène dit de moi : ‘Elle était victime d’un dispositif qu’elle ignorait manifestement’, je passe pour une quiche. Et si j’osais le féminisme ? » 393
L’humour du Canard. Mais la souffrance que doit vivre cette femme me terrifie. Et j’oubliais leur dernier fils de 15 ans, à l’école, avec ses copain-es. (Cf. Femmes. Mères. Fillon Penelope)
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Épouse de. Martha Freud :
Femmes (Épouse de. Freud Martha) (1) : Sigmund Freud [1856-1939], délicat, écrivit :
« Le destin m’a été bon qui m’a octroyé la présence d’une telle femme. Je parle d’Anna (sa fille), bien sûr. » 394 (Cf. Hommes. Grossiers, « Sciences » sociales. Psychanalyse. Freud Sigmund)
Femmes (Épouse de. Freud Martha) (2) : 1985. Pour mémoire, le titre réjouissant du livre de Françoise Xenakis [1930-2018] Zut, on a encore oublié Madame Freud, premier (et seul ?) livre à avoir réhabilité les « épouses » de… 395 (Cf. Hommes. Freud Sigmund, Socrate, Hugo Victor, Marx Karl, Mahler Gustav)
Femmes (Épouse de. Freud Martha) (3) : 2006. Lu, dans un livre consacré à l’épouse de Sigmund [1856-1939] (sans source citée), Martha Freud [1861-1951] :
« Elle ressent douloureusement le fait que son mari ait laissé quatre sœurs sous la menace nazie : Dolfi, Mitzi. Paula et Rosa. Elle ignore bien sûr que toutes quatre périront en déportation ; malgré les efforts de Marie Bonaparte pour les faire sortir d’Autriche. Seule l’ainée, Anna… survivra à l’holocauste. » 396
- Et lui, leur frère, qu’a-t-il « ressenti » ?
* Ajout. 3 août 2018. Élisabeth Roudinesco, auteure de :
« On a reproché à Freud, de manière un peu honteuse, d’avoir abandonné ses sœurs. […] » « De « manière honteuse » : et pourquoi donc ? 397 (Cf. Femmes. Remarquables. Bonaparte Marie, « Sciences » sociales. Psychanalyse, Violences. Violences à l’encontre des femmes. Roudinesco Élisabeth)
-------------
Femmes (Épouse de. Kennedy Jacqueline) : 2011. Jacqueline Kennedy [1929-1994], dans Conversations inédites avec Arthur. M. Schlesinger, auteure de :
« […] Je me rappelle l’avoir dit dans un interview, après quoi j’ai reçu quantité de lettres en femmes en colère. On m’avait demandé : ‘Où trouvez-vous vos opinions ?’ (sic) et j’avais répondu : ‘Je trouve toutes mes opinions chez mon mari’. Ce qui est vrai. Comment aurais-je pu avoir des opinions politiques ? Les siennes étaient forcément meilleures.
[…] Nous formions un couple étrange, un peu comme au XIXème siècle ou comme en Asie. J’étais comme les épouses japonaises, les meilleures qui soient. » 398 (Cf. Femmes. Colère, Famille. Couple, Dialogues, Patriarcat)
Femmes (Épouse de. Khroutchtev Nina) : 2011. Jacqueline Kennedy [1929-1994], dans Conversations inédites avec Arthur. M. Schlesinger, auteure de :
- « Madame Khroutchtev, [1900-198] comme madame Dobryinine [épouse de l’ambassadeur d’URSS aux États-Unis], avaient vraiment des manières curieuses. Si je fumais, elles vous disaient : ‘Vous ne devriez pas fumer, les femmes russes ne fument pas’ ou bien : ‘Vous avez fait des études d’ingénieur ?’. Elles essayaient toujours de vous montrer combien elles vous étaient supérieures. Je suppose que c’est un complexe qu’elles avaient. J’essayais d’être polie, mais ce n’était jamais très agréable. »
- « À Paris, de Gaulle [1890-1970] m’avait prévenue : ‘Méfiez-vous, c’est elle la plus maligne’. » 399
Femmes (Épouse de. Galese Marie de) : Marie de Galese [1864-1954], épouse de 1883 à 1891 de Gabriel d’Annunzio [1863-1938], au terme de sa vie, auteure de :
- « Lorsque j’ai épousé mon mari, j’ai cru épouser la poésie. J’aurais mieux fait d’acheter pour trois francs cinquante, chacun des volumes de vers qu’il a publiés. »
- « Si je lui ai fait, lorsque nous nous sommes rencontrés, une grande impression, c’est qu’avant moi, il n’avait connu que des femmes à cinq francs. » 400 (Cf. Hommes. Remarquables. D’Annunzio Gabriel, Femmes. Concurrence entre femmes, Proxénétisme)
Par ordre chronologique. Femmes. Épouse de. Madeleine Gide :
Femmes (Épouse de. Gide Madeleine) (1) : (Avant) 1895. Madeleine Rondeaux [1869-1951], bien des années avant qu’elle ait épousé André Gide [1869-1951], lui écrit :
« À un moment, j’ai eu le sentiment très vif et très triste que nous aurions dorénavant chacun des sentiers séparés quand il s’agit du but. Dieu veuille qu’il n’en soit jamais rien…
J’ai été attristée, effrayée de sentir combien - plus que jamais - tu étais à toi-même ton seul but - ton seul souci - ton seul amour - qui t’envahit. André ! » 401 (Cf. Êtres humains. Soi, Famille. Couple)
Femmes (Épouse de. Gide Madeleine) (2) : 1895. Au retour de leur voyage de noces [sans aucune relation sexuelle entre eux], dans le train, André Gide [1869-1951] caressa les bras nus de trois écoliers qui s'amusaient à les lui tendre par la fenêtre du compartiment voisin, sous le regard même de Madeleine.
En 1951, il se décrit « haletant, pantelant […] goûtant de suppliciants délices. »
Elle lui dira à l’arrivée à la gare :
« Tu avais l'air ou d'un criminel ou d'un fou. » 402
Femmes (Épouse de. Gide Madeleine) (3) : 1918. Madeleine Gide [1867-1938], informée en 1918 des amours de son mari pour Marc Allégret [1900-1973], brûle toutes les lettres qu’il lui avait adressées jusqu’alors, provoquant chez Gide [1869-1951], un réel bouleversement :
« Je souffre comme si elle avait détruit notre enfant. »
En réponse à l’une de ses lettres, elle lui avait alors écrit (sans date) :
« André Cher, tu te méprends. Je n’ai pas de doutes sur ton affection. Et lors même que j’en aurais, je n’aurais pas à me plaindre. Ma part a été très belle. J’ai eu le meilleur de ton âme, la tendresse de ton enfance [Madeleine et André étaient cousin / cousine] et de ta jeunesse. Et je sais que, vivante ou morte, j’aurais l’âme de ta vieillesse. / J’ai toujours compris aussi tes besoins de déplacement et de liberté. Que de fois, dans tes moments de souffrances nerveuses, qui sont la rançon de ton génie, j’ai eu sur les lèvres de te dire : ‘Mais, pars, va, tu es libre, il n’y a point de porte à la cage où tu n’es pas retenu’. […]
Ce qui m’angoisse - et tu le sais sans te l’avouer - c’est la voie où tu t’es engagé, et qui te mènera à la perdition toi et les autres. Ne crois pas, là encore, que je te dise cela avec un sentiment de condamnation. Je te plains autant que je t’aime. C’est une terrible tentation qui s’est dressée devant toi et armée de toutes les séductions. Résister. / Adieu, au revoir. / Ta Madeleine » 403 (Cf. Êtres humains. Âmes, Famille)
Femmes (Épouse de. Gide Madeleine) (4) : (septembre) 1942. 1943. André Gide [1869-1951], dans son Journal, écrit, la concernant, quatre ans après la mort de son épouse :
« Tout ce que je dois à Em. me revient au cœur, et je pense constamment à elle depuis quelques jours, avec le regret, le remords d’être demeuré si souvent et si fort en reste d’elle. Que de fois, j’ai dû lui paraître dur, insensible ! Que j’ai mal répondu à ce qu’elle était en droit d’attendre de moi !... Pour un sourire d’elle aujourd'hui, je crois que je quitterais la vie, ce monde où je ne pouvais pas la rejoindre. »
Et, le 11 janvier 1943, il écrit :
« Tout ce qu’elle attendait de moi et que je n’ai pas su lui offrir : que dis-je, qui lui était dû… certains jours j’y pense sans cesse. […] Je songe tristement à tous les soins que j’aurais dû avoir pour elle, et je reste et resterai, dans l’attente du sourire dont elle m’aurait récompensé. Dans quel état d’aveuglement j’ai vécu ! » 404 (Cf. Hommes. Insensibles, Famille, Relations entre êtres humains. Remords)
Femmes (Épouse de. Gide Madeleine) (5) : 1951. André Gide [1869-1951] écrit un texte d’analyse et d’autocritique Et nuc manet in te [Et maintenant elle survit en toi] concernant son analyse de ses relations avec son épouse, lequel est suivi des passages du Journal [1889-1939], ayant trait à Madeleine qui ne figurent pas dans le volume précédant de La Pléiade. Textes essentiels. 405 (Cf. Êtres humains. Autocritique)
-------------
Femmes (Épouse de. Gisserot Hélène) : (27 octobre) 1986. Hélène Gisserot, concernant les conditions dans lesquelles elle a été nommée, dans le gouvernement de Jacques Chirac, « déléguée à la condition féminine » se souvient :
« […] Le décret du 4 avril 1986 indiquait que Philippe Séguin, ministre des affaires sociales et de l'emploi, recevait ‘les attributions précédemment dévolues au ministre des droits des femmes’, mais c'était tout. […]
C'est dans ce contexte qu'un mardi, fin mars ou début avril, à 13 heures, j'ai reçu un coup de téléphone de Philippe Séguin me demandant si j'acceptais de prendre la responsabilité de déléguée à la Condition féminine. J'ai eu un instant d'hésitation. J'allais demander, par prudence, quelques heures de réflexion, quand mon mari, qui était là, m'a dit : ‘Accepte’. Je n'ai même pas demandé le temps de réflexion nécessaire ! Peut-être était-ce de l'imprudence de ma part, mais aujourd'hui je me félicite de l'avoir fait. » 406 (Cf. Femmes. « Féminin ». « Politiques »)
Femmes (Épouse de. Gorbatchev Raïssa) : 1991. Raïssa Gorbatchev [1932-1999] lors d’un séjour avec son mari Mikhaïl Gorbatchev [1931-2022] à Latché, dans la maison de campagne de monsieur et madame Mitterrand, en présence de Christine Ockrent qui rapporte ses phrases, déclara :
« Il faut le ménager, vous savez, sans lui, ce serait le chaos, personne n’y a intérêt, personne. […] Il faut que la Perestroïka aboutisse, et après, nous pourrons, Mikhaïl et moi, peut-être dans une maison à nous, enfin vivre sans cette pression. Il faut qu’il puisse continuer son travail. La situation est terrible, chez nous. Trop de gens sont perdus et cherchent à se raccrocher à une autorité, n’importe laquelle, à un pouvoir fort. On sait bien que le fascisme naît dans ce lit-là, dans la misère, dans les promesses et dans le nationalisme. » 407 (Cf. Femmes. Journalistes. Ockrent Christine, Relations entre êtres humains. Promesse, Politique. Fascisme)
Femmes (Épouse de. Gramsci Iulca, Giulia, Julca) : (27 février) 1933. Antonio Gramsci [1891-1937] écrivit à sa belle-sœur, Tania, la sœur de son épouse, Iulca, [Giulia, Julca], ceci :
« […] Tu connais ma façon de penser : ce qui est écrit acquiert une valeur ‘morale’ et pratique, laquelle va bien au-delà du simple fait d’être écrit, qui n’est cependant qu’une chose purement matérielle….Ma conclusion, pour résumer est la suivante : j’ai été condamné le 4 juin 1928 [il fut arrêté le 8 novembre 1926] - par le Tribunal spécial, c’est à dire par un collège bien défini d’hommes que l’on pourrait indiquer par leur nom, leur adresse et leur profession dans la vie civile. Mais cela est une erreur. Ce qui m’a condamné c’est un organisme beaucoup plus vaste, dont le Tribunal spécial n’a été que la manifestation extérieure et matérielle, qui a rédigé l’acte de condamnation légal.
Je dois dire que parmi ces ‘condamnateurs’, je crois et je suis même fermement convaincu qu’il y a eu aussi Iulca, inconsciemment, et une autre série de personnes moins inconscientes.
C’est du moins ma conviction, une conviction désormais ancrée en moi parce que c’est la seule qui explique une série de faits successifs et concordants. […]
Ne vas pas croire que mon affection pour Iulca ait diminué.
D’après ce que je peux en juger moi-même, elle me paraît avoir plutôt augmenté, du moins dans un certain sens. Je connais par expérience le milieu où elle vit, sa sensibilité et la façon dont un changement a pu intervenir en elle. […]
Il m’est arrivé de penser que toute ma vie a été une grande (grande pour moi) erreur, une énorme bévue. […] » 408
L’épouse de Gramsci résidait en Russie où il se sont connus. Elle n’est revenue en Italie qu’une seule fois avec leur premier fils en 1925, puis repartit en Russie. Depuis la condamnation de son mari, ni elle, ni ses enfants n’ont revu leur mari et père, avant sa mort, en mai 1937. Il a pour sa part maintenu le contact pendant toutes ces années avec beaucoup de recherches de vérités, et beaucoup d’élégance. Quel rôle a joué la Russie soviétique, puis stalinienne ? Essentielle sans aucun doute.
Quant à la succincte explication donnée par Sergi Caprioglio qui a co-traduit et présenté les Lettres de prison de Gramsci, elle n’est pas acceptable :
« Elle rentra à Moscou en 1926 (à quelle date ?) et fut atteinte d’une grave maladie nerveuse qui l’empêcha de retourner en Italie pour revoir son mari. » (p.10)
Dans Wikipédia, elle n’est pas citée ; elle n’existe pas.
Femmes (Épouse de. Grave Jean) : 1930-2009. Jean Grave [1854-1939], dans Mémoires d’un anarchiste, auteur de :
« Quelques mois après notre retour [expulsé de « la libre Helvétie ! » en 1885], j’éprouvais l’affreuse douleur de perdre ma femme en couches [Clotilde Benoît. 1863-octobre 1885], emportée par la fièvre, ainsi que l’enfant, un superbe garçon. »
Une note cite une lettre de Pierre Kropotkine [1842-1921] datée du 7 novembre 1885 :
« C’est avec une vive douleur que j’apprends ce que vous m’écrivez : … Perdre tout à la fois : femme, être aimée, amie, camarade de lutte - C’est trop de douleur. » 409
Femmes (Épouse de. Groult Benoîte) : 2016. Dans les chroniques nécrologiques qui ont paru à la mort de Benoîte Groult [1920-2016], je lis dans :
- Le Monde : « Paul Guimard et Benoîte Groult furent des proches de François Mitterrand. [1916-1996] » 410
- Libération [après avoir évoqué son mari, Paul Guimard [1921-2004], « un écrivain à succès et proche de Mitterrand dont il fut brièvement le conseiller en 1981] » :
« […] Mitterrand, elle le connut bien, elle aussi - entre les parties de pêche en Irlande et les grandes tablées - il fut un ami fidèle et un amant passager. » 411 (Cf. Femmes. Amants, Hommes. « Politiques ». Mitterrand François)
Femmes (Épouse de. Guérin Marie) : 2017. Daniel Guérin [1904-1988] épouse en 1934 Marie Fortwängler [?-1974], militante communiste lorsqu’il la connut.
Elle n’apprendra, longtemps après son mariage, aux alentours de 1968, qu’il était « bisexuel », comme il se nomme lui-même.
Leur fille, Anne, née en 1936, écrit :
« S’il ne cohabite plus depuis des lustres avec sa femme, ils restent profondément attachés l’un à l’autre, sans toujours bien s’entendre. Marie milite avec lui dans des organisations libertaires. Daniel l’entoure de ses soins. La mort de Marie en 1979 le laisse désemparé. » 412 Un peu rapide ?
Wikipédia ne la nomme même pas. Daniel Guérin, « homosexuel », ne fut donc pas même, pour Wikipédia, ni mari, père… [mai 2017] (Cf. Hommes. Homosexuels, Patriarcat. Guérin Daniel, Historiographie. Patriarcale. Éditions La Découverte)
Femmes (Épouse de. Guilloux Renée) : 1997. Mona Ozouf se remémore l’épouse de Louis Guilloux [1899-1980], Renée Tricoire [?-?] « qui avait été, pour [elle] en quatrième, à Saint Brieuc, un éblouissant professeur dont les explications d’Iphigénie [lui] restent encore très présentes. » 413
La biographie de Louis Guilloux, telle que présentée par La société des amis de Louis Guilloux, ne fait référence, la concernant, qu’en citant la date de leur mariage en 1924, à Toulouse.
* Ajout. 22 décembre 2017. Je lis dans la Correspondance Jean Guéhenno-Louis Guilloux à la suite d’une note évoquant l’adresse des « beaux-parents de Louis Guilloux » :
« Il a épousé René Tricoire en août 1924. »
Elle est évoquée par lui, dans une lettre (de mi-septembre 1928 ?) ainsi :
« Ma femme est nommée à Angers, où nous serons avant le premier octobre. Nous sommes ravis. Belle ville. Excellent climat pour moi, etc… Nous déménageons. Il est possible que nous ayons une maison toute de suite. Cela retarde un peu Proudhon. […] Écris […] à l’École normale de filles d’Angers à l’adresse de ma femme. » 414
Femmes (Épouse de. Hegel Maria) : (13 juillet) 1811. (26 mars) 1819. Maria Hegel [Marie Von Tucher. 1791-1855], nouvellement mariée, écrivait entre les lignes d’une lettre de Friedrich Hegel [1770-1831] à Caroline Paulus, épouse de Heinrich Paulus :
- « Hegel est aussi de ces gens dépourvus d’espoir qui n’attendent rien, qui ne désirent rien », elle ajoute dans un post-scriptum :
« [...] Aussi longuement que s’étende mon seigneur et maître dans son épitre, et aussi humble que soit le petit coin qu’il m’assigne, je sais que la bonne Caroline Paulus ne me perd pas du regard. J’ai déjà auparavant élevé ma petite voix pendant le discours de mon maître, mais, à chaque fois, je ne me suis de nouveau respectueusement tue, quoi que j’eusse volontiers confirmé encore plus longuement bien des choses puis rappelle, à six reprises, toujours écrit entre les lignes, que bien que non nommée par lui, elle existe. Enfin. […] » 415
- Le 26 mars 1819, huit ans plus tard, Marie Hegel écrit, dans un post-scriptum d’une lettre de Hegel à Niethammer [1766-1848] :
« Je vois mon Hegel satisfait de son métier, gai avec moi et avec les enfants et apprécié à sa valeur - ce qui vaut mieux que tout pour une bonne épouse. » Domestiquée ? 416
On peut lire aussi, toujours dans sa Correspondance, deux poèmes d’amour qu’Hegel, fiancé, lui a adressée en 1811. 417 (Cf. « Sciences » sociales. Philosophie. Hegel Friedrich)
Femmes (Épouse de. Hitchcock Alma) : Alma Reville [1899-1982], scénariste, monteuse, assistante - elle travaillait dans le cinéma bien avant de connaître Alfred Hitchcock [1899-1980], et alors qu’il n’était qu’au début de sa carrière.
Il déclara après leur mariage :
« En bon Britannique, je ne pouvais pas supporter l'idée qu'une femme occupe des fonctions supérieures aux miennes. »
Lorsqu’il reçut un prix pour l’ensemble de son œuvre, il a tenu à mentionner « quatre personnes » particulièrement précieuses pour lui :
« La première est monteuse, la deuxième scénariste, la troisième est la mère de ma fille, Pat, et la quatrième est une merveilleuse cuisinière qui fait toujours des miracles. Elles se nomment Alma Reville. » 418
Je lis aussi dans Wikipédia qu’elle « apparaît aux génériques des films de son mari, et à l’occasion d’autres réalisateurs », qu’elle est « la scénariste attitrée de plusieurs œuvres de son mari » mais, après Le grand alibi [1950] qu’ « elle ne sera plus créditée au générique des films qu’il réalise. »
Enfin, dans le film Truffaut-Hitchcock, on entend :
« Hitchcock n’a jamais fait un film sans consulter sa femme. » 419
Qui saura jamais ce que les films d’Hitchcock lui doivent ?
Femmes (Épouse de. Hugo Adèle) : (1er septembre) 1868. Victor Hugo [1802-1885] fit graver sur la tombe de son épouse Adèle [1803-1868] (à l’enterrement de laquelle, il ne put, exilé, assister) :
« Adèle, Femme de Victor Hugo ». 420 (Cf. Êtres humains. Soi. Hugo Victor, Femmes. Mères, Hommes. « Modestes », Famille. Mariage)
Femmes (Épouse de. Janin Adèle) : 1973. Adèle Janin [1820-1976], épouse de Jules Janin [1804-1874] reçut de son mari 735 lettres pendant leur trente-trois ans de mariage. Dans la présentation de la publication intégrale des lettres de Jules Janin par monsieur et madame Mergier-Bourdeix (2500 pages. 3 tomes), il est écrit :
« On pourrait également regretter de n’avoir pas les réponses de Mme Janin, mais les quelques lettres d’elle que nous possédons ne présentent aucun intérêt, d’autant plus qu’elles ne sont jamais datées et qu’aucun fait saillant ne permet de le faire. »
Adèle Janin, « légataire universelle » de son mari, dans son testament de 1874, légua « à l’Académie française tous les ouvrages composant la bibliothèque de Monsieur Jules Janin, mon bien aimé mari et comprenant ses autographes. […] » 421 (Cf. Langage. Académie française, Femmes. Comment faire disparaître les femmes ? Violences. Violences à l’encontre des femmes. « Droit de cuissage »)
Par ordre chronologique. Femmes. Épouse de. Isabelle Juppé :
Femmes (Épouse de. Juppé Isabelle) (1) : 1994. Isabelle Juppé, auteure du livre À bicyclette, dont le sous-titre est : … « Et si vous épousiez un ministre ? » et dont la conclusion est :
« Ces quelques mois au Quai d’Orsay et surtout mes voyages à l’étranger mont démontré, si je ne le savais déjà, à quel point les Françaises n’ont pas trop à se plaindre. » (Cf. Politique. Nationalisme) 422
L’aisance - peu glorieuse - du jugement de ceux et celles qui n’ont pas trop à se plaindre concernant tous-toutes les autres…
Femmes (Épouse de. Juppé Isabelle) (2) : (1er décembre) 2010. Bruno Le Maire, dans Jours de pouvoir, écrit :
« Déjeuner avec Alain Juppé à l’hôtel de Brienne. Le jugement de sa femme Isabelle le conforte dans son choix de retourner au gouvernement : ‘Isabelle trouve que je n’ai jamais été si détendu, donc, c’est que ça doit être bien’. » 423 (Cf. Famille. Couple)
-------------
Femmes (Épouse de. Kristeva Julia) : 1997. Lu cette réponse de Julia Kristeva, en réaction à la question :
« Est-il facile d’être une femme et d’être l’épouse de Philippe Sollers [1936-2023] ? » :
« Mon mari m’a aidée, il est sensible à ces problèmes. Il a su aider d’autres femmes qui lui doivent beaucoup. » 424 (Cf. Hommes. « Intellectuels ». Sollers Philippe, Relations entre êtres humains. Dépendance, Féminismes, Patriarcat)
Par ordre chronologique. Femmes. Épouse de. Nadejda Kroupskaïa :
Femmes (Épouse de. Kroupskaïa Nadejda) (1) : (18 octobre) 1898. Nadejda Kroupskaïa [1869-1939], dans une lettre adressée à la mère de Lénine [1870-1924], Maria Alexandrovna Oulianova [1835-1905], lui écrit :
« Volodia (Lénine) se demande toujours où je trouve la matière pour d’aussi longues lettres ; mais lui, dans ses lettres, ne parle que de choses ayant un intérêt pour toute l’humanité, tandis que moi je raconte toutes choses sans importance. » 425
Femmes (Épouse de. Kroupskaïa Nadejda) (2) : 1929. Léon Trotsky [1879-1940], dans Ma vie, écrit :
« (avant 1905) La liaison avec la Russie était toute entre les mains de Lénine [1870-1924]. C’était sa femme Nadejda Konstantinova Kroupskaïa qui avait assumé le secrétariat de la rédaction [de L’Iskra]. Elle était le centre de tout le travail d’organisation, recevait les camarades venus de loin, instruisait et accompagnait les partants, fixait les moyens de communication, les lieux de rendez-vous, écrivait les lettres, les chiffrait et les déchiffrait. » 426 (Cf. Femmes. « Politiques »)
Femmes (Épouse de. Kroupskaïa Nadejda) (3) : 1930. Dans Souvenirs sur Lénine de Nadejda Kroupskaïa [1869-1939] épouse de Lénine [1870-1924], la nature de leurs relations est à peine évoquée. 427
Femmes (Épouse de. Kroupskaïa Nadejda) (4) : Concernant Nadejda Kroupskaïa [1869-1939], épouse de Lénine [1870-1924], je lis sur Wikipédia :
« Ses cendres reposent à Moscou, au pied du Kremlin, sur la place Rouge, à côté du mausolée de Lénine. » 428
Selon que vous serez mari ou épouse du mari…
-------------
Femmes (Épouse de. Labori Marguerite) : 1993. Lu dans la Correspondance d’Émile Zola [1840-1902] :
« Marguerite Labori [1864-1952], née Okey, était originaire de Sydney en Australie. Elle épousa en premières noces un grand virtuose du piano, Vladimir de Pachmann, dont elle avait été l’élève. Pianiste remarquable elle-même, elle donna des récitals dans la plupart des capitales européennes, ainsi qu’à New York. Compositeur d’une drame lyrique, Yato [1913], elle a laissé un livre de souvenirs de son mari, Labori. Ses notes manuscrites. Sa vie [1947].
- Séverine [1855-1929] l’évoque ainsi le 23 février [1898], dans le prétoire de la cour d’assises, au moment de la condamnation d’Émile Zola :
« L’exquise femme de Labori [avocat d’Émile Zola. 1860-1917] toute jeune et si jolie, avait amené, cette fois ses deux garçonnets : ‘Comme ça, on sera tous ensemble’, disait-elle pâlotte, mais brave, avec un semblant de sourire.’ [1900. p.201] » 429 (Cf. Femmes. Remarquables. Séverine, Justice. Avocat-es. Labori Fernand)
Femmes (Épouse de. Laclos Marie-Soulange Duppéé ) : Lu, concernant Marie-Soulange de Duperré [1759-1932], épouse de Pierre Choderlos de Laclos [1741-1803] :
« Laclos n’épousa ni une marquise de Merteuil, ni une Cécile de Volanges [Les liaisons dangereuses], mais Marie-Soulange Duperré, fille d’un fonctionnaire, receveur des tailles à La Rochelle. Ils vécurent fort pauvrement, eurent trois enfants et ne cessèrent jamais de s’aimer tendrement. » 430
De nombreuses lettres sont publiées dans le livre d’Émile Dard, consacré au général Choderlos de Laclos 431, ainsi que dans le volume de La Pléiade [1979] des Œuvres complètes de pierre Choderlos de Laclos. (Cf. Hommes. Féminisme. Laclos Choderlos de)
Femmes (Épouse de. Lang Monique) : (9 janvier) 1983. Lu dans le Journal de Matthieu Galey [1934-1986] :
« Un soir de confidence, Monique [Lang, épouse de Jack Lang] lui dit [à Bernard Raffalli. 1941-2002], avec son habituelle spontanéité gavroche, assez attendrissante, au fond :
‘Nous sommes ravis d’être ministres’. » 432 (Cf. Famille. Couple, Langage. Possessif)
Femmes (Épouse. Latour Chantal) : (30 janvier) 2023. Bruno Latour [1947-2022] considérait que son épouse était son « fil à plomb moral ». 433
Femmes (Épouse. Lessing Doris) : 1958. Doris Lessing [1919-2013], dans La cité promise. Les enfants de la colère (3), auteure de :
« En découvrant que son troisième mari - et le dernier, avait-elle espéré - était, tout au moins, en partie homosexuel, elle avait éprouvé de l’angoisse, mais à l’exception d’un ou deux mots brefs à Patty, sa grande amie, elle n’avait pas dit grand-chose d’autre que : ‘à mon âge, c’est le compagnonnage qui compte’. » 434
Femmes (Épouse. Levasseur Thérèse) : Jean-Jacques Rousseau [1712-1778], dans Testament de Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Genève :
« […] J’institue et nomme mon unique héritière et légataire universelle Thérèse Levasseur [1721-1801] ma Gouvernante : Voulant que tout ce qui m’appartient et qui peut se transmettre de quelque nature et en quelque lieu qu’il soit mêmes les Livres et Papiers et le produit de mes ouvrages lui appartienne comme à moi-même, bien fâché de ne pouvoir mieux payer vingt ans de services, de soins et d’attachements qu’elle m’a consacrés et durant lesquels elle n’a même reçu de moi aucuns gages. 435 (Cf. Enfants. « Bâtards », Famille. Héritage, Femmes. Mères. Remarquables. Veuves. Thérèse Levasseur)
Par ordre chronologique. Femmes. Épouse de. Dina Lévi-Strauss :
Femmes (Épouse de. Lévi-Strauss Dina) (1) : 2016. Dina Lévi-Strauss [1911-1999]. Dans le documentaire d’Arte, consacré à Claude Lévi-Strauss [1908-2009], le film de 1935-1936 réalisé dans l’État de Matogrosso (son intitulé) était présenté comme ayant comme auteur-es les « Professeurs Dina et Claude Lévi-Strauss ». Les photos qui en furent ultérieurement montrées n’étaient pourtant plus formellement signées - chacune pour leur part - qu’étant celles de « Claude Lévi-Strauss ». 436 Cf. « Sciences » sociales. Ethnologie. Lévi-Strauss Claude)
Femmes (Épouse de. Lévi-Strauss Dina) (2) : (28 juillet) 2019. Jean Malaurie [1922-2024], parlant de Claude Lévi-Strauss [1908-2009], évoque « sa thèse complémentaire qui, je crois, a été en partie écrite par sa femme Dina Dreyfus, [1911-1999] une très forte personnalité ». 437
Femmes (Épouse de. Lévi-Strauss Dina) (3) : Je lis sur Wikipédia : « En 1937, des objets collectionnés auprès des Bororo sont montrés à Paris dans une exposition dont le titre ‘Indiens du Mato-Grosso (Mission Claude et Dina Lévi-Strauss)’ reconnaissait la contribution scientifique des époux. Pourtant, après leur séparation, Dina ne publiera plus rien en ethnologie, et sa contribution aux recherches de terrain, les seules que Claude ait jamais entreprises, sera largement oubliée. Dans Tristes Tropiques, Claude Lévi-Strauss ne mentionne son ex-compagne qu'une seule fois, pour son départ de l'expédition ; dans son album Saudades do Bresil il exclut toutes les photographies qui la représentent. Ce n'est qu'en 2001 que paraissent enfin des documents photographiques de l'expédition attestant le travail de terrain de Dina. » (Cf. Hommes. « Intellectuels », Langage. Académie française, Patriarcat, « Sciences » sociales. Ethnologie. Lévi-Strauss Claude)
-------------
Femmes (Épouse de. Linder Ninette) : Je lis sur Wikipédia concernant l’épouse de Max Linder, Ninette Linder [1883-1925] :
« […] En 1921, il rencontre une jeune fille mineure de 16 ans, Ninette Peters, dans un palace de Chamonix où il se repose. Sa mère refusant la demande en mariage, il enlève la jeune femme et l'emmène à Monte-Carlo. La mère cède à sa demande à la suite du scandale médiatique qu'il a soulevé : le 23 août 1923, il l'épouse à l’église Saint Honoré d’Eylau à Paris. Le 23 février 1924, rongé par la jalousie envers sa femme, il s'empoisonne au Gardénal mais est sauvé à temps. En juillet 1924 naît leur fille Maud, dite Josette, qui sera recueillie par ses grands-parents maternels. […] Il abandonne brusquement tous ses projets, en proie à des crises de jalousie de plus en plus fréquentes. À l'âge de 41 ans, le 31 octobre 1925, il se suicide dans sa chambre d'hôtel (le Baltimore, avenue Kléber à Paris). On le retrouve aux côtés de son épouse, âgée de 20 ans, morte elle aussi, leurs artères du poignet gauche sectionnées. Tous deux meurent plus tard dans la soirée de la suite de leurs blessures. »
Je lis ensuite : « Mathilde Peters, la belle-mère de Max, par la menace d’un procès envers Maurice [frère de Max Linder] obtient la garde de Maud mais la famille Leuville [nom de famille de Max Linder] se dispute pendant des années, par procès interposé, la garde de l'orpheline légataire pour s'emparer de la fortune de son père. » 438 (Cf. Femmes. Jeunes filles. Remarquables. Linder Maud, Hommes. Remarquables. Zweig Stefan)
Femmes (Épouse de. Littré Pauline) : (juillet) 1854. Sait-on que l’immense travail effectué par Émile Littré [1801-1881] concernant son magistral Dictionnaire, Le Littré le fut aussi avec l’aide de son épouse Pauline [?-?] et de sa fille Sophie [?-?] ? 439
Voici, après que M. Hachette lui ai proposé d’ « accepter un ou plusieurs associés qui soulagerait le poids d’une aussi lourde tâche », la lettre qu’ Émile Littré lui écrit :
« Mon cher Hachette, J’ai, comme tu le penses bien, beaucoup réfléchi à ce dont nous avons parlé à Plessis-Piquet […] Or, le résultat de toutes mes réflexions a été que le secours que tu mets à ma disposition ne peut pas m’être fort utile tel qu’il se présente d’après notre conversation avec M. Beaujon. Il n’a peut-être pas tout le temps nécessaire à me donner ; mais surtout j’ai besoin de quelqu’un qui soit perpétuellement à ma disposition et dont je puisse user sans aucun scrupule pour toute sorte de menus détails. Or, avec la personne que j’ai vue chez toi, je n’aurais ni ces facilités, ni cette liberté. Si ce travail lui offrait de l’intérêt en quelques parties, en d’autres, ce ne serait qu’affaire de manœuvre.
Je reviens donc à la proposition dont je t’ai parlé.
Ma femme et ma fille sont disposées à m’aider dans ce travail qui ne leur déplait pas. Elles pourront me donner chacune deux heures et demi à trois heures, ce qui fera six heures par jour. Cela, je crois est suffisant.
Tu mettrais un millier de francs à ma disposition par an pour le temps que durera l’impression ; et je t’en rendrai compte. Dans tous les cas, si, après essai, la chose n’allait pas, nous serons toujours à temps de recourir à une aide extérieure. […]
Ton vieil ami. E. Littré »
« Finalement Littré dû céder (à l’insistance de Hachette). Hachette accepta de payer 1.220 francs pour l’aide de madame et mademoiselle Littré. Mais trois collaborateurs, Beaujon, Jullien et Sommers furent engagés. »
Le dernier paragraphe dans lequel j’ai puisé ces informations s’intitule :
« La passion du travail solitaire ».
Par ordre chronologique. Femmes. Épouse de. Brigitte Macron :
Femmes (Épouse de. Macron Brigitte) (1) : 2013. Laurence Masurel, journaliste à Paris Match, auteure d’un livre intitulé La France est ingouvernable, l’adresse à Brigitte Macron qui lui réponds en ces termes :
« Je vous remercie infiniment pour votre message d’encouragement [non reproduit] et pour votre livre ‘la France est ingouvernable’ mais, vous le savez, nous sommes prêts à relever tous les défis. » 440
Le Canard enchaîné évoque un « ‘nous’ royal qui vaut son pesant de modestie. »
Un « nous » du couple formé par Brigitte et Emmanuel Macron eut été plus approprié ?
À moins d’évoquer un exécutif bicéphale ? (Cf. Culture. Macron Brigitte, Femmes. « Politiques ». Macron Brigitte, Famille. Couple)
Femmes (Épouse de. Macron Brigitte) (2) : (28 mai) 2025. Sa gifle à son mari, qui a réjoui tant de monde, restera un moment qui ne sera pas oublié, de l’histoire.
Femmes (Épouse de. Macron Brigitte) (3) : (19 septembre) 2025. Lu sur Franceinfo : « Emmanuel et Brigitte vont fournir des preuves que la Première dame est née femme, confirme le cabinet américain de Tom Clare, leur avocat, auprès de franceinfo. » Comment un chef d’État (et son épouse) peut-il s’abaisser à, s’avilir en se justifier ainsi, et par là même cautionner comme légitimes de telles accusations ? (Cf. Justice, Hommes. « Politiques ». Macron Emmanuel)
-------------
Femmes (Épouse de. Maitron Marcelle) : 1997. Dans une présentation de la carrière de Françoise Maitron-Davydoff, fille de Jean Maitron [1910-1987] et de Marcelle Maitron [1911-2003], je lis que Marcelle Maitron « a toujours secondé son mari dans ses travaux. ‘Ils donnaient l’image d’un couple très uni, qui partageait toutes les tâches’. » Y compris celles concernant la rédaction du Maitron ? Qu’en disent les rédacteurs du Maitron ? 441
La réponse : Dans la présentation, rédigée par Claude Pennetier, de Jean Maitron, dans le Dictionnaire biographique Mouvement ouvrier, mouvement social, je lis :
« Son épouse, Marcelle Maitron, resta attachée à l’œuvre de Jean Maitron et en facilita les prolongements. Elle mourut le 2 décembre 2003 à Fresnes, chez sa fille Françoise. » 442
C’est tout. (Cf. Famille. Couple)
Par ordre chronologique. Femmes. Épouse de. Clara Malraux :
Femmes (Épouse de. Malraux Clara) (1) : 1996. Clara Malraux [1897-1982], se remémorant ses Vingt ans et sa vie d’alors avec André Malraux [1901-1976], auteure de :
« […] Un jour, ce sera pire, pour moi, du moins. Un jour, je ne le sais pas encore, je serais juive, un jour, je serai l’ex-épouse d’un homme puissant, et ce sera une autre façon d’être solidement embêtée. » 443 (Cf. Famille. Couple)
Femmes (Épouse de. Malraux Clara) (2) : 2016. Dans la longue présentation faite sur Wikipédia d’André Malraux [1901-1976], aucun écrit de Clara Malraux n’est cité. La concernant, il n’est fait référence qu’à un livre de Dominique Bona intitulé : Clara Malraux. Nous avons été deux. [2010] (Cf. Culture. Patriarcale)
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Épouse de. Katia Mann :
Femmes (Épouse de. Mann Katia) (1) : (13 mars) 1933. Thomas Mann [1875-1955] écrit à Lavinia Mazzuchetti [1889-1965], après avoir évoqué son « cœur très lourd et l’horreur et le dégoût [qui l’] éprouvent beaucoup - les accusations des nazis allemands :
« Tant que j’aurais ma courageuse femme à mes côtés, je ne crains rien. »
- Et, le 18 juin 1935, il évoque « ma femme, vaillante et secourable à mon côté, comme toujours ». 444 (Cf. Hommes. « Intellectuels ». Mann Thomas)
Femmes (Épouse de. Mann Katia) (2) : (21 janvier) 1936. Katia Mann [1883-1980], écrit à sa fille Erika [1905-1969], en évoquant son mari, nommé le « magicien » :
« Moi qui ne suis que son accessoire ». 445 (Cf. Famille. Couple)
Femmes (Épouse de. Mann Katia) (3) : (1er juillet) 1936. Thomas Mann [1875-1955], dans une lettre écrite à Mr. Koltzow, président de l’association des écrivains soviétiques, pour plaider la cause de Mme Mühsam, veuve de Erich Mühsam [1978-1934] écrivain anarchiste allemand « assassiné [le 10 juillet 1934] dans un camp de concentration allemand » et emprisonnée en Russie, auteur de :
« Son épouse vivait dans la sphère intellectuelle de son mari et parlait le même langage politique, cela va presque sans dire. » 446 (Cf. Femmes. Veuves, Hommes. « Intellectuels ». Mann Thomas, Penser)
Femmes (Épouse de. Mann Katia) (4) : Postface d’Erika Mann [1905-1969] concernant la publication du tome 2 des Lettres de Thomas Mann :
« Nous n’avons pas trouvé de lettres à Katia Mann. Depuis le jour où elle quitta l’Allemagne avec son mari, il n’y eu plus aucune correspondance entre eux deux - ils étaient inséparables. » Elle précise cependant dans les « Remerciements » :
« Mme Katia Mann a pris une part décisive à la sélection de ces lettres. » 447 (Cf. Relations entre êtres humains. Remerciements)
Femmes (Épouse de. Mann Katia) (5) : 1974. Katia Mann [1883-1980], dans Souvenirs à bâtons rompus, auteure de :
« Peut-être aurais-je terminé mes études, et aussi passé des examens, mais je n’avais étudié que pendant quatre ou six semestres, quand je me suis mariée, et après le mariage, le premier bébé est vite arrivé, puis tout de suite après, le second, et à un très bref intervalle le troisième et le quatrième. C’en était fait de mes études. » 448 (Cf. Femmes. Mères, Hommes. « Intellectuels ». Mann Thomas)
-------------
Femmes (Épouse de. Mauriac Jeanne) : 1990. Françoise Verny [1928-2004], écrit concernant l’épouse de François Mauriac [1885-1970] :
« J’apprends à aimer Jeanne Mauriac [1894-1983] après la mort de son mari. Auparavant, elle se tenait, discrète, dans l’ombre de son époux. Et je l’admirais juste pour sa beauté. Avec l’âge, le modelé du visage, l’élégance de la silhouette ressortent encore mieux. On ne discerne la beauté dans son essence que chez les vieilles personnes, quand elles sont dépouillées des artifices et des charmes de la jeunesse.
Je suis également sensible à une éducation exquise, à une courtoisie mesurée, jamais encombrante, à une réserve qui ne ressemble pas à de l’effacement. […]
Elle vit dans le passé, pour sa famille. » 449 (Cf. Femmes. Âgées, Beauté. Veuves, Famille, Relations entre êtres humains. Courtoisie)
Femmes (Épouse de. Mauvillon Madame) : (1er mai) 1794. Benjamin Constant [1767-1830] écrit à Isabelle de Charrière (1740-1805] concernant madame Mauvillon [?-?] :
« Marié à 27 ans [Jakob Mauvillon. 1743-1794], avec une fortune de 1200 Fr [?] [« forts petits moyens »] à une femme qui n’avait rien, il parvint, grâce à son travail et à l’économie de cette femme, à subsister, non seulement sans embarras, mais avec agrément. Non seulement, il la trouva toujours gaie, bonne et tendre, mais il n’eut jamais le chagrin d’être mal compris (sic). Elle concevait, discutait, rectifiait ses idées, ménageait ses faiblesses, supportait et adoucissait ses moments d’humeurs, aimait son caractère, partageait ses opinions. » 450
Femmes. Épouse de. Jenny Marx :
Femmes (Épouse de. Marx Jenny) (1) : (10 août) 1841. Jenny von Westphalen [1814-1881], alors ‘fiancée’ - depuis 1836 - à Karl Marx [1818-1883], lui écrit :
« Petit sanglier, comme je me réjouis de savoir que tu es heureux, que ma lettre t’a fait plaisir, que tu te languis de moi, que tu loges dans des pièces tapissées, que tu as bu du champagne à Cologne et qu’il y a là-bas des clubs Hegel [1770-1831], que tu as rêvé, que tu…- mais malgré tout il y a une chose que me manque : tu aurais quand même pu me faire un petit compliment pour mon grec et consacrer à mon érudition un petit article élogieux : mais vous êtes ainsi faits, messieurs des hégelomanes [Hégeliens], vous n’avez de reconnaissance pour rien, quand bien même ce serait tout ce qu’il y a de plus excellent, si ce n'est exactement dans votre façon de voir, et il faut donc que je m’en contente et que je me repose sur les propres lauriers à moi. » Encore une femme qui avait tout compris… 451 (Cf. Êtres humains. Soi. Hegel Friedrich, Hommes. Égoïstes. « Intellectuels », Famille. Hegel Friedrich, Patriarcat)
Femmes (Épouse de. Marx Jenny) (2) : (mars) 1843. Jenny von Westphalen [1814-1881] écrit à Karl Marx [1818-1883] :
« […] Que ne puis-je aplanir et égaliser tous les chemins devant toi, et en ôter tout ce qui pourrait constituer un obstacle pour toi ! Mais ce n’est pas notre lot. Nous ne devons pas intervenir de toute notre énergie quand la roue du destin tourne. À cause du péché originel, par la faute de madame Ève, nous sommes condamnées à la passivité, notre lot est d’attendre, d’espérer, de supporter, de souffrir. On nous confie tout au plus l’aiguille à tricoter, l’aiguille à coudre, la clé de la maison et ce qui va au-delà de ces attributions est le fait du mal. […] » 452 (Cf. Femmes. Aiguilles, Tricot, Féminismes)
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Épouse de. Athénaïs Michelet :
Femmes (Épouse de. Michelet Athénaïs) (1) : (13 juillet) 1857. Jules Michelet [1798-1874] dans son Journal, auteur de :
« Aujourd’hui, exceptionnellement souffrante, elle [Athénaïs Michelet. 1826-1899] m’appela d’une voix douce et basse qui m’alla au cœur : ‘Mon fils !’ »
Femmes (Épouse de. Michelet Athénaïs) (2) : 1867. Les Mémoires d’une enfant d’Athénaïs Michelet - livre auquel Jules Michelet n’accorde que très peu d’attention dans son Journal - expriment « l’itinéraire d’une enfant mal aimée [est] un témoignage rare [et bouleversant] - sur la solitude et les angoisses de l’enfance. » 453 (Cf. Enfants, Femmes. Écrivaines)
Femmes (Épouse de. Michelet Athénaïs) (3) : Athénaïs Michelet [1826-1899], auteure de :
« Je ne suis que par lui, je ne vis que pour lui, rien de ce qui n’est Lui ne me touche. » 454 (Cf. Femmes. Pleurs, Hommes. « Grands », Famille. Couple)
Femmes (Épouse de. Michelet Athénaïs) (4) : 1898. 1899. Athénaïs Michelet [1826-1899], concernant son grand homme de mari, Jules Michelet [1798-1874], auteure de :
« […] J’étais tout pour lui, et lui, tout pour moi, oh, nous nous sommes bien aimés, mais il y avait dans mon amour beaucoup de maternité. L’homme a besoin de retrouver dans l’épouse les soins de la mère qui a ouaté de tendresses douces l’enfance, endormi les douleurs sous ses baisers, séché ses pleurs sous ses caresses. Que de fois, je me suis surprise appelant Michelet : ‘mon fils, mon enfant’, et dans ces moments-là, il me semblait vraiment qu’il était l’être de ma chair, le petit sorti de mes entrailles. Les étrangers étaient étonnés, et des yeux cherchaient le fils, l’enfant à qui je m’adressais. » 455 (Cf. Femmes. Mères, Relations entre êtres humains. Caresses)
-------------
Femmes (Épouse de. Mitterrand Danielle) : 1979. Jean Daniel [1920-2020], dans L’ère des ruptures, auteur de :
« (En 1978, à Latche) La solidarité qu’elle [Danielle Mitterrand. 1924-2011] étale avec les humeurs de son mari [François Mitterrand. 1916-1996] est un spectacle si vrai, si chaud qu’il me détourne du soin de la convaincre qu’elle s’égare. » 456 (Cf. Famille. Couple, Patriarcat)
Femmes (Épouse de. Montaigne. Charlotte) : L’épouse de Montaigne [1533-1592], Françoise de la Chassaigne [1545-1602], mariée à 20 ans, donna naissance à six filles, dont cinq moururent en bas âge [à deux mois, sept semaines, trois mois, un mois, quelques jours]. Seule Lénor survécut.
Philippe Ariès [1914-1984] pour sa part, écrit (sans source. Dans Les essais ?) que :
« Montaigne était incapable d’établir le compte exact de ses enfants et de toutes les couches de sa femme. » 457 (Cf. Patriarcat. Hommes. Pères)
Femmes (Épouse. Nietzsche Friedrich) : 1878. Friedrich Nietzsche [1844-1900], dans Humain, trop humaine, auteur de :
« Une bonne épouse qui doit être une amie, une coadjutrice, une procréatrice, une mère, un chef de famille, une gouvernante, qui peut être, même doit, indépendamment de l’homme, s’occuper de son affaire et de sa fonction propre, ne peut pas être en même temps une concubine : ce serait, d’une façon générale, trop lui demander. » 458 (Cf. Hommes. « Intellectuels », Féminismes. Humour, Patriarcat)
Femmes (Épouse de. Orwell George) : 2008. Bernard Crick [1929-2008], dans son autobiographie de George Orwell [1903-1950], auteur de :
« […] Ce qu’il souhaitait à l’évidence, c’était une mère pour Richard, et pour lui-même une maîtresse, une femme de ménage, une nourrice et un exécuteur testamentaire, avec en guise de compensation pour sa femme, dans l’hypothèse où il vivrait plus longtemps que ce qui avait été prévu, le fait qu’elle hériterait d’un revenu confortable, puisque La ferme des animaux était en librairie et montrait déjà les signes évidents d’un futur best-seller. » 459 (lire la suite)
Femmes (Épouse de. Pasteur Louis) (Prénom inconnu de moi) [?-?] Pour le biographe de Louis Pasteur, René Vallery-Radot :
« Madame Pasteur sut, dès les premiers jours, non seulement admettre, mais approuver que le laboratoire passât avant tout. » 460
Par ordre chronologique. Épouse de. Charlotte-Françoise Péguy :
Femmes (Épouse de. Péguy Charles) (1) : (28 octobre) 1914. Isabelle Rivière [1889-1971] écrit à Jacques Rivière [1886-1925], prisonnier en Allemagne :
« Le pauvre Péguy [1873-1914] a été tué [le 5 septembre 1914], sa femme [Charlotte-Françoise Baudoin] attend un quatrième enfant, elle est dans la misère. » 461
Femmes (Épouse de. Péguy Charles) (2) : (19 mai) 1916. L’abbé Mugnier [1953-1944] rapporte dans son Journal les propos de Suarès [André. 1868-1948] concernant Charles Péguy [1873-1914] :
« Sa femme et sa belle-mère qui sont du peuple, du faubourg, qui avaient leur origine parmi les gens de la Commune ne pardonnent à pas à Péguy d’avoir évolué vers le catholicisme. » 462 (Cf. Femmes. Mères. Péguy Charles, Relations entre êtres humains. Pardon, Politique. Démocratie. Peuple)
Femmes (Épouse de. Péguy Charles) (3) : (25 février) 1919. Dans le livre de textes de Charles Péguy [1873-1914] de Romain Vaissermann, intitulé L’écrivain et le politique, je lis :
« Par jugement du tribunal civil de la Seine, la Nation adopte les enfants mineurs de Charles Péguy, à savoir Germaine, Pierre et Charles-Pierre. »
Préalablement, la seule information, concernant l’épouse de Charles Péguy, à la date du 28 octobre 1897, est la suivante :
« Mariage civil avec Charlotte Françoise Baudoin, âgée de 18 ans, mairie du Vème arrondissement (Témoins : Paul Collier, Georges Weulersse ; Charles Abel Baudoin, Albert Lévy). » 463 (Cf. Enfants, Famille)
-------------
Femmes (Épouses de policiers) : (20 décembre) 2018. Perrine Salé, porte-parole des Femmes des forces de l'ordre en colère [FFOC], a déclaré à l'AFP lors de la manifestation des Gyros bleus :
« On nous parle de salaires. Nous, on vous parle d'humains. Il y en a marre que nos enfants ne soient plus respectés parce qu'ils sont fils de policiers. » 464 (Cf. Femmes. Colère, Patriarcat. Pères, Politique. État. « Gilets jaunes ». Répression)
Femmes (Épouses de prisonniers politiques) : 1955-1964. Alexandre Soljenitsyne [1918-2008], dans Le premier cercle, auteur de :
« Sur elle, planait le triste sort de toutes les épouses de prisonniers politiques, c’est-à-dire d’épouses d’ennemis du peuple : quelque fût celui à qui elles s’adressaient, quelque fut l’endroit où elles allaient, partout où l’on était au courant de leur malheureux mariage, c’était comme si elles traînaient derrière elles l’ineffaçable honte de leur mari. Aux yeux de tous, c’était comme si elles partageaient le fardeau de la culpabilité avec l’affreux traître à qui elles avaient un jour, sans y penser, confié leur sort. » 465 (Cf. Famille. Couple. Mariage, Justice. Soviétique, Politique. Prison)
Femmes (Épouse de. Pompidou Claude) : 1997. Claude Pompidou [1912-2007], auteure de :
« […] Pour moi, je m’adaptais. J’ai toujours fait une confiance absolue à mon mari et je n’ai jamais discuté ses choix, ni ses décisions même si je n’étais pas toujours emballée. » Et de :
« De toutes manières, il s’agissait de son choix et il ne m’appartenait pas de m’en mêler. Je peux être aussi soumise qu’indépendante, disons… une indépendante soumise ! Et en cette circonstance [nomination de son mari à la banque Rothschild], et comme toujours, je lui fis confiance. » 466
Femmes (Épouse de. Poutine Lioudmila) : (7 mai) 2004. Anna Politkovskaïa [1956-2006], dans Douloureuse Russie. Journal d’une femme en colère, auteure de :
« Aujourd’hui démarre le deuxième (et en principe dernier) mandat de Poutine au Kremlin. La cérémonie d’investiture est une nouvelle démonstration de l’autoritarisme, de l’arrogance et de l’inaccessibilité de notre chef. Il s’est même aliéné sa propre famille ! Lors de la retransmission de l’évènement, les présentateurs ont indiqué avec déférence : ‘Parmi les invités à la cérémonie solennelle de l’investiture de M. Poutine, se trouve l’épouse du président, Lioudmila Poutine.’ Ce serait drôle si ce n’était si triste. Comment est-il possible que lors de l’investiture de son mari, la femme du président se trouve parmi les invités, derrière une barrière, à regarder le grand homme marcher seul sur un tapis rouge ? » 467
N.B. Depuis lors, Vladimir Poutine a divorcé en 2013.
Et, grâce à une réforme de la constitution, il peut se maintenir au pouvoir jusqu’en 2036. (Cf. Droit. Constitutionnel, Femmes. Colère, Hommes. « Politiques », Famille. Couple, Politique)
Femmes (Épouse de. Quinet Hermione) : 1869. Hermione Quinet [1821-1900], auteure de :
« Heureuse de me rendre utile aux travaux de mon mari [Edgar Quinet. 1803-1875] écrivant pour lui toute la journée dans une petite chambre au-dessus de la sienne, vers deux heures, j’entendais le bruit de ses pas ; c’était le signal de la réunion. Puis, après la visite des amis, la promenade, on se retrouvait seuls, au coin du feu. […]
Maint disciple fidèle enviait celle qui entendait chaque soir dans l’intimité ces paroles qui ne retentissaient plus devant l’auditoire du Collège de France, ni à la tribune. Ah ! du moins, elle les conservait religieusement. Comme l’abeille qui dépose le miel des fleurs dans l’alvéole, chaque jour, la compagne de l’exil renfermait dans une page intime les pensées recueillies dans les entretiens du maître chéri. Depuis 17 ans, j’amasse pieusement ces pensées, pour les restituer un jour aux amis lointains, surtout pour en nourrir éternellement mon âme. Si je n’ai pu conserver à ces entretiens leur forme, les mots textuels, du moins suis-je sûre d’en avoir gardé le véritable esprit, l’inspiration. […]
Renfermant mon horizon dans la pensée et les travaux de mon mari, l’exil ne me paraissait nullement comme une épreuve ; la vie n’était pas une science, mais une félicité. […]
Je n’étais nullement pressée de voir terminer une œuvre à qui nous devions tant de nobles illusions à défaut de bonheur public. Assez de luttes et d’âpres pensées venaient arracher l’auteur à cet abri de paix. Mon humble tâche consistait à mettre au net les chapitres achevés, et quand j’avais rempli chaque matin de mon écriture une vingtaine de pages, mon esprit et mon cœur étaient pleins de délices ; je me réjouissais en songeant que le lendemain serait un jour semblable. […]
Cette vie active et idéale était mon bonheur. Marchant sur les traces du guide, le disciple glanait les épis qu’on lui abandonnait. Une tâche chérie lui était réservée. Le maître lui demandait son appréciation sur chacun des livres dans des notes critiques. […]
Aux fonctions de critique et de secrétaire, se joignent celle de copiste. Vivant si loin de l’imprimerie, ne recevant qu’une seule épreuve ou deux tout au plus, l’auteur est tenu d’envoyer un manuscrit irréprochable. [...]
En prévision de la perte d’un manuscrit envoyé à Paris, il faut, le plus souvent, double copie. Si on s’amusait à additionner les milliers de pages recopiées depuis seize ans pour chacun des vingt ouvrages publiés en exil, on arriverait à consommation formidable de bouteilles d’encre et de rames de papier, ou plutôt de ballots. […]
Je reçus une lettre où l’on me demandait une biographie d’Edgar Quinet, des notes sur ses ouvrages ; on préférait s’adresser à moi, sachant qu’il éprouvait une grande répugnance à parler de lui-même. Dans la situation faite aux proscrits, j’ai cru qu’il m’était permis de résumer les livres et la vie de mon mari. Vraiment, il est trop dur de brimer toujours son cœur et sa pensée. Voilà pourquoi aujourd’hui encore j’écris ces pages, comme si elles ne paraissaient pas de mon vivant. L’exil n’est-il pas frère de la mort ? […]
Les œuvres complètes de mon mari étaient enfin réimprimées. Je les avais maintenant sous les yeux, rangés sur ma petite table ; c’était ma bibliothèque à moi, mes auteurs favoris, le trésor et l’ornement de mon sanctuaire. Aujourd’hui encore, en les regardant, une pensée m’attriste ; la dirais-je à haute voix ? (même nos bienveillants amis vont sourire) ‘O mes livres chéris ! que ne puis-je vous emporter avec moi au-delà de cette vie !’ » 468 (Culture. Livres, Femmes. Utiles)
Femmes (Épouse de. Reagan Nancy) : 1990. Nancy Reagan [1921-1989], auteure de :
« Ronnie est un homme affable et sociable qui a plaisir à se trouver avec des gens mais, contrairement à la plupart d’entre nous, leur compagnie ou leur approbation ne lui sont pas indispensables. Comme il me l’a dit lui-même, il semble n’avoir besoin que d’une personne : moi. » 469
Femmes (Épouse de. Régnier de Marie) : (janvier) 2003. Je lis dans le Journal en public de Maurice Nadeau concernant l’épouse de Henri de Régnier [1864-1936], que celle-ci, Marie de Régnier [1875-1963] avait, après sa mort, déposé à la Bibliothèque Nationale sept Carnets de son mari « qu’il n’avait jamais eu l’intention de publier. » La suite :
« Mais la veuve, les avait même un peu caviardés, obligée qu’elle était de céder au chantage du secrétaire de Pierre Louÿs [1870-1925], détenteur après la mort de son patron d’une correspondance […] révélée il y a quelques mois. Marie de Régnier ne tenait pas à ce qu’on sache comment, à peine mariée, vendue en somme par son père, le poète et joueur malheureux José Maria de Heredia, au plus offrant, elle devint la maîtresse, photos à l’appui, dudit Pierre Louÿs et comment elle s’était fait faire par lui en enfant [grossièreté respectée] dont Henri de Régnier assurait la paternité. » 470 (Cf. Femmes. Veuves)
Femmes (Épouse de. Rocard Michèle) : 1987. Michèle Rocard [1941-2010] écrit dans un livre où, à 45 ans, elle raconte sa vie en ce qu’elle est notamment liée à celle de son mari Michel Rocard [1930-2016] et de leurs deux enfants, auteure de :
« Mes opinions politiques ne sont pas un mystère ; elles sont ce que me dicte ma totale solidarité avec Michel. »
Elle intitule aussi l’un chapitre de son livre :
« Le plus important des deux est bien celui qu’on pense ». 471
Pour justifier qui ? Pour justifier quoi ? Pour [se] protéger [de] qui ? Pour [se] protéger [de] quoi ?
Femmes (Épouse de. Roland Jeanne-Marie) : 1793. Concernant Jeanne-Marie Roland [1754-1793], le comte Beugnot [1761-1835] écrivit dans ses Mémoires :
« Elle me disait, en me parlant de l’union des cœurs vertueux, en vantant l’énergie qu’elle inspire : ‘La froideur des Français m’étonne. Si j’avais été libre et qu’on eût conduit mon mari au supplice, je me serais poignardée aux pieds de l’échafaud ; et je suis persuadée que, quand Roland apprendre ma mort, il se percera le cœur’. Elle ne se trompait pas. »
N.B. Jeanne-Marie Roland fut guillotinée le 8 novembre 1793 ; son mari, alors en liberté près de Rouen, se suicida le 10 novembre. 472 (Cf. Famille. Couple, Histoire. Révolution française. Roland Jeanne-Marie)
Femmes (Épouse de. Rolland Maria) : Maria Koudatcheva [1895-1985], seconde épouse de Romain Rolland [1866-1944] - le mariage eut lieu en 1934 - fut, selon Victor Serge [1890-1947], une agente du Guépéou. 473
* Ajout. 1er septembre 2016. On peut lire, la concernant, une notice biographique circonstanciée dans l’édition établie par Jean Lacoste du Journal de Vézelay. 1938-1944 de Romain Rolland. 474
Femmes (Épouse de. Roosevelt Eleanor) : 2014. Eleanor Roosevelt [1884-1962], au terme de sa vie, auteure de :
« Tous les êtres humains ont des failles, tous les êtres humains ont des besoins, des tentations, des émotions. Les hommes et les femmes qui vivent de longues années côte à côte apprennent à connaître leurs faiblesses respectives, mais aussi ce qui les rend dignes de respect et d’admiration. […]
Il [Franklin Delano Roosevelt] aurait pu être plus heureux avec une épouse dépourvue de sens critique. Ce que je n’ai jamais été capable d’être, il lui fallut le trouver chez d’autres… »
Terrible critique de l’homme Roosevelt. 475 (Cf. Femmes. Mères. Remarquables. Roosevelt Eleanor, Hommes. Heureux. « Politiques »)
Par ordre chronologique. Femmes. Épouse de. Tatiana Roy :
Femmes (Épouse de. Roy Tatiana) (1) : 1990. Françoise Verny [1928-2004], dans Le plus beau métier du monde, concernant Tatiana Roy [?-2012], épouse de Jules Roy [1907-2000], écrit :
« Tania, d’origine russe [née en Bulgarie de parents émigrés russes] mère de deux enfants, quitte son métier et sa famille pour se vouer à l’écrivain. […]
Devenue son épouse et sa collaboratrice, elle accepte de mener une vie quasi conventuelle en sa compagnie pendant les deux années, de 1966 à 1975, qu’il sacrifie à la saga algérienne, Les chevaux du soleil.
Elle lui offre sa présence, sa compétence… et son sourire… indispensable à ce mélancolique. […] »
N.B. Je découvre qu’elle-même a écrit des poèmes, un roman, un récit et traduit plusieurs romanciers et poètes russes (dont Ossip Mandelstam [1891-1938]). (Cf. Femmes. Écrivaines, Patriarcat)
Femmes (Épouse de. Roy Tatiana) (2) : 2000. Présentation de Tatania Roy [?- 2012], par « les éditeurs » de son livre Bonheurs quotidiens [2000. Éditions Tirésias] :
« Être l'épouse d'un grand écrivain est une situation à la fois terrible et merveilleuse, tel devrait être notre avis, certes sommaire, mais Tatiana Roy, toute en finesse, avec malice et un immense talent, nous livre, jour après jour, ses relations jamais atones avec Jules Roy et nous irradie cette drôle d'aventure. Elle nous narre ses émois, ses peurs à rassurer, ses allégresses à partager l'ombre et la lumière de ‘son’ Julius ; alors l'écriture devient comme une empreinte à cette vie si peu commune. Elle nous dit sans fard, avec une vraie nudité, cruelle et pourtant si belle, non exhibitionniste, ses regrets de femme de lettres, parfois son calvaire de femme sensible, sensuelle, se sentant abandonnée, mais toujours chantant son amour pour celui qu'elle nomme ‘son grand écrivain de mari’. Avec elle, nous traversons sa première rencontre, un peu rude, et avec elle, nous sommes désarçonnés de l'accueil qui lui est fait, à la limite de la maniaquerie, elle si nonchalante. De page en page, elle va nous apprendre à aimer cet homme, à prendre conscience de son œuvre, de sa sensibilité et de sa place dans l'histoire de la littérature française, de cette fin du XXe siècle. » (Cf. Femmes. Écrivaines, Patriarcat)
-------------
Femmes (Épouse de. Ruiz Raoul. Valeria Sarmiento) : Valeria Sarmiento [1941-2011], auteure de :
« J’ai monté autour de 70 films de Raoul (sur 120), plus de la moitié. Pour Raoul, c’était beaucoup plus facile de faire le montage avec moi, parce que, le soir, dès fois, il se rappelait des choses : il me disait : ‘Fais ça, ça, ça, ça, ça…’. Je pouvais arriver tôt dans la table de montage et changer beaucoup de choses. Donc c’était très commode pour lui de m’avoir à côté (rires) pour faire le montage. Mais c’est comme ça… c’était notre échange. Il écrivait le scénario pour moi ou on écrivait ensemble le scénario et je faisais le montage de ce film.…
Je suis réalisatrice et monteuse. J’essayais toujours de faire mes films aussi à côté. Donc, c’était me laisser une espèce de parcelle de liberté. Si j’avais un tournage, je partais. S’il avait un tournage, il partait. Mais toujours, c’était des contacts par téléphone, tous, tous, tous les jours. Et on essayait toujours de se voir, même pendant un tournage, s’échapper un week-end…Nous avons passé ensemble plus de 40 années, 42… » 476
* Ajout. 4 mai 2016. (mai) 2016. Dans Le Monde Diplomatique une quasi pleine page est consacrée à Raoul Ruiz : aucune référence n’est faite à Valeria Sarmiento. Et on l’on peut même lire :
« […] Ruiz restera celui qui s’est débrouillé, pendant toute son existence, pour parvenir à faire du cinéma tout le temps. » 477 (Cf. Culture. Cinéma)
Femmes (Épouse de. Sarraute Nathalie) : 1987. Nathalie Sarraute [1900-1999], dans Nathalie Sarraute, qui êtes-vous ? auteure de :
« Raymond [1902-1985, son mari, avocat] […] « a joué un rôle immense dans ma formation littéraire. […]
L’entente était complète dans ce domaine-là [artistique, littéraire] qui pour moi est essentiel. » 478 (Cf. Famille. Couple)
Femmes (Épouse de. Sinatra Barbara) : 2015. Gloria Steinem, dans Ma vie sur la route. Mémoires d’une icône féministe, écrit :
« […] Enfin paraît Barbara Sinatra, une ancienne show-girl de Las Vegas, qui a été l’épouse de l’un des Marx Brothers. C’est une présence calme et royale. […] Sinatra vient d’arriver, un verre à la main. Et il a l’air très … Franck Sinatra [1915-1998].
Sous mes yeux, cette femme altière se transforme en geisha pour lui servir de la dinde. » 479 (Cf. Proxénétisme. Las Vegas. Proxénètes. Sinatra Franck)
Femmes (Épouse de. Soljenitsyne Natalia) : 1940. 1956. Mariage d’Alexandre Soljenitsyne [1918-2008] et de Natalia Alexeïevna Rechetovskaïa [1919-?], le 27 avril 1940. Le 7 juillet 1945, son mari ayant été condamné à huit ans de prison pour activités ‘contre-révolutionnaires’, elle est renvoyée en 1948 de l’Université de Moscou, et doit divorcer en 1952 en tant qu’épouse d’un ‘ennemi du peuple’ afin de retrouver un emploi. Alexandre Soljenitsyne, ayant été officiellement ‘réhabilité’ en 1956, il et elle se remarieront le 2 février 1957. En 1972, ils divorceront à nouveau.
Je lis dans Rue du prolétaire rouge [1978] de Nina et Jean Kéhayan, qui vivaient alors à Moscou lors de la dénonciation de Soljenitsyne :
« Pendant des semaines, tout ce que l’Union soviétique comptait de journaux, de stations de radio et de télévision s’est mobilisé pour faire la preuve de la malfaisance d’un homme. […] L’agence de presse Novosti retrouva même sa première femme et lui tint la plume pour la rédaction de ses mémoires. […] La mobilisation était totale. […] » 480 (Cf. Justice. Témoins, Politique. Répression)
Femmes (Épouse. Stendhal) : (19 novembre) 1805. Stendhal [1783-1842] écrit à sa sœur Pauline [Beyle. 1786-1857] :
« […] Dans ce siècle-ci, où toutes les distinctions sont tombées, l’argent fait tout. Toute femme unie à un mari qui a 15.000 francs de rentes est une femme agréable ; si le mari en a vingt, elle est charmante ; elle devient vraiment intéressante si 25.000 francs de rente lui donnent les moyens de donner des thés et des dîners fréquents. » (Cf. Famille. Couple)
Femmes (Épouse de. Tirole Nathalie) : (mars) 2017. Nathalie Tirole déclara en Suède à un journaliste après l’attribution à son mari, Jean Tirole, en 2914, du prix Nobel de sciences économiques :
« J’ai beaucoup investi dans mon mari. Là, c’est le retour sur investissement. »
Et Bernard Cassen du Monde Diplomatique, qui cite cette phrase, poursuit :
« On a connu des visions plus poétiques des relations de couple. Madame donnait ainsi raison à Karl Marx [1818-1883] : l’auteur, avec Friedrich Engels [1820-1895], du Manifeste communiste [1848] disait de la bourgeoisie qu’elle avait noyé toute sentimentalité dans ‘les eaux glacées du calcul égoïste’. » 481 (Cf. Hommes. « Modestes », Famille. Couple, Économie. Capitalisme. Calcul)
Par ordre chronologique. Femmes. Épouse de. Marie de Tocqueville :
Femmes (Épouse de. Tocqueville Marie de) (1) : (27 septembre) 1843. Alexis de Tocqueville [1805-1859] écrit à Louis de Kergorlay [1804-1880], l’un de ses meilleurs amis, concernant son épouse, Marie, [1799-1864] [née sous le nom de Marie Mottley]
qu’il « a trouvé dans un état d’exaspération véritablement désespérant » :
« […] Écris nous souvent à moi et à Marie à laquelle tes lettres font du bien. Tu es le seul homme qui ait quelque influence sur elle. Encore, est-ce limité. Car elle a un de ces esprits qui ne cèdent que par l’effet de leur propre volonté et qui ne puisent guère qu’en eux seuls les principes et les motifs de cette volonté. » 482
Quel hommage !
Femmes (Épouse de. Tocqueville Marie de) (2) : 1843. Marie de Tocqueville [1799-1864], souvent ‘trompée’ par son mari, bouleversée de ses infidélités [« Le moindre écart de ma part lui parait le dernier et le plus affreux des malheurs », écrit-il], Louis de Kergorlay [1804-1880] accepta de jouer le rôle d’intermédiaire entre eux deux. Il avait tenté, le 30 août 1843, de lui prêcher l’indulgence, sur le fondement de cet argument :
« Je vous dirais sans hésitation que vous confondez toujours deux choses, l’infidélité des mauvaises habitudes et l’infidélité du cœur. Vous raisonnez sur les mœurs des hommes avec les sensations d’une femme. » 483 (Cf. Êtres humains. Vies. Vies-dites-privées, Femmes. « Trompées », Relations entre êtres humains. Indulgence, Politique. État, Lois. Mœurs. Morale, Patriarcat, Tocqueville Alexis de)
Femmes (Épouse de. Tocqueville Marie de) (3) : (18 septembre) 2023. Je lis concernant Marie de Tocqueville [1799-1864], sur Wikipédia :
« Elle est tout au long de sa vie un soutien fidèle d'Alexis de Tocqueville [1805-1859], avec lequel elle partage une grande complicité. Au moment de la Révolution de 1848, il lui rend ainsi hommage : ‘Je trouvais dans ma maison l'appui, si rare et si précieux en temps de révolution, d'une femme dévouée, qu'un esprit pénétrant et ferme, et une âme naturellement haute devaient tenir sans effort au courant de toutes les situations, et au-dessus de tous les revers.’ » (Cf. Femmes. Dévouement. Maison)
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Épouse de. Sophie Tolstoï :
Femmes (Épouse de. Tolstoï Sophie) (1) : 1980. Il aura fallu, en France, attendre 1980 pour la publication du Journal intime de Sophie Tolstoï [1844-1919], pour enfin connaître cette femme et détruire les mensongères accusations dont elle a été, toute sa vie et bien après sa mort, l’objet. Soit environ un siècle. Le prix à payer pour que soient connues les femmes dont la vie détruit le mythe des « grands hommes » ? 484 (Cf. Hommes. « Grands », Penser. Mythe)
Femmes (Épouse de. Tolstoï Sophie) (2) : 1994. Je lis dans Les passions d’Henri Guillemin [1903-1992] :
« Le 28 octobre 1910, Tolstoï [1828-1910] accomplit l’acte qui lui a posé problème depuis près de trente ans [quitter après 48 ans de vie conjugale, son épouse, avoir abandonné sa résidence d’Iasnaïa Poliona, et mourir dans une petite gare de la ligne Moscou-Rostov]. Non seulement sa femme Sophie ne l’a pas suivi dans son évolution morale, mais […], »
Mais, pourquoi eut-il fallu qu’elle le « suive », elle qu’il rejetait ? 485 (Cf. Histoire. Historiographie. Patriarcale)
-------------
Femmes (Épouse de. Triolet Elsa) : (autour de 1960) Elsa Triolet [1896-1970] écrit à Louis Aragon [1897-1982] :
« Il n’est pas facile de te parler. Tu sembles oublier que nous vivons l’épilogue de notre vie, qu’ensuite il n’y aura plus rien à dire et que l’index lui-même d’autres le liront - pas nous.
Je te reproche de vivre depuis trente-cinq ans comme si tu avais à courir pour éteindre un feu. Dans ta course, il ne faut surtout pas te déranger, ni te devancer, ni t’emboîter le pas, ni te suivre - quel que soit l’ouvrage - aussi bien couper des branches sèches, il ne faut surtout pas s’aviser de faire quoi que ce soit avec toi, ensemble. Cette dernière entreprise est bien ce que j’avais vécu de plus affreusement triste. Tu es là à trembler devant mes initiatives, jamais tu ne discutes, tu ne fais que crier ou tu ‘prends sur toi’. Le plaisir normal de faire quelque chose ensemble, tu ne le connais pas. Un mot anodin à ce sujet et tu te mets à m’expliquer la montagne de choses que tu as à faire. Comme au téléphone, tu racontes toutes tes activités, à n’importe qui, pour expliquer que tu ne peux pas voir ce quelqu’un justement maintenant. En somme, rien de changé depuis l’exposition anticoloniale.
Pourtant, il serait peut-être aussi urgent de parfois nous rencontrer. Il nous reste extrêmement peu de temps, et tu le sais mieux que quiconque. Mon Dieu, ce que la sérénité me manque, toute une vie comme dans la voiture où je ne peux jamais te dire ‘regarde ! ’ puisque toujours tu lis ou tu écris, et qu’il ne faut pas te déranger.
J’étouffe de toutes les choses pas dites, sans importance, mais qui auraient rendu la vie simple, sans interdits. Avoir constamment à tourner la langue sept fois avant d’oser dire quelque chose, de peur de provoquer un cyclone - et lorsque cela m’échappe, cela ne rate jamais ! J’y ai droit.
Pourquoi je te le dis ? Pour rien. Comme on crie, bien que cela ne soulage pas. La solitude n’est pas le grand thème de mes livres, elle l’est - de ma vie. J’y suis habituée, je m’y plais après tout. À l’heure qu’il est, le contraire me dérangerait. Ce que je veux ? Rien. Le dire. Que tu t’en rendes compte. Mais j’ai déjà essayé, je sais que c’est impossible. Et si tu me dis encore une fois combien juste maintenant tu tiens tout à bout de bras - je casse tout dans la maison ! Je ne mendie pas, rien, ni ton temps, ni ton assistance, ce que je ne supporte pas c’est la manière dont tu te tiens sur la défensive, les barbelés et les fossés. Ma peine te dérange, il ne faut pas que j’aie mal, juste quand tu as tant à faire. Moi aussi je prends sur moi, et même je ne fais que cela. À en éclater, à sauter au plafond. Même ma mort, c’est à toi que cela arriverait.
Et puis - zut ! Je suppose que quand on n’a pas de larmes, il vous faut une autre soupape. Allons mettons que ce que je ressens soit pathologique, et consolons-nous avec ça. Autrement tu vas encore me sortir que ‘tu as encore commis un péché…’ Et si c’était vrai ? Un péché contre un semblant de bonheur. Je te rappelle seulement l’heure : nous en sommes à moins cinq. Ne me dis pas à moi six et demi, parce que c’est la même chose.
Donc il ne s'agit pas de faire un énième petit pas et c'est bien pour ça que je pense que nous pouvons le faire et le réussir. Il s'agit de construire une transformation en profondeur qui va nous amener les uns et les autres à changer les réflexes, les habitudes et je crois que c'est ce que vous attendez de nous et au fond de vous-mêmes. […] Ceci pour vous donner les jalons et les précisions mais au-delà de ce sujet, pour vous dire que ce défi, et je sais que vous n’êtes pas ici à convaincre, est un des défis essentiels pour notre nation. D’abord, parce que c’est ce qu’attendent nos concitoyens de nous. » 486 (Cf. Femmes. « Féminin », Hommes. « Intellectuels ». Aragon Louis, Penser. Expliquer)
Par ordre chronologique. Femmes. Épouse de. Natalia Ivanova Trotsky :
Femmes (Épouse de. Trotsky. Natalia Ivanova) (1) : (janvier) 1942. Deux ans après l’assassinat de Léon Trotsky, le 21 août 1940, Victor Serge [1890-1947] rencontre Natalia Ivanovna [1882-1962], son épouse, dorénavant veuve :
« Pauvre femme, toute menue, vêtue de laine grise dont la souffrance a ravagé le visage. Elle semble tout le temps sur le point d’éclater en sanglots, mais les sanglots même de sont éteints, elle vit ainsi - ombre. Elle a un très bon regard, on la sent très droite et très bonne. »
Puis, il évoque des désaccords politiques entre eux et écrit :
« Nous aurions trop à répondre et il est évident que, fidèle à la mémoire du Vieux (Trotsky) jusque dans l’erreur, cela ne servirait qu’à la peiner. […] » Il conclut enfin :
« Nous nous quittons amicalement, sans pouvoir conclure. Nous avons passé une triste heure de crépuscule à discuter avec l’ombre inquiétante du Vieux. » 487 (Cf. Corps. Visage, Femmes. Veuves)
Femmes (Épouse de. Trotsky Natalia Ivanova) (2) : 1942. Dans les mêmes Carnets de Victor Serge [1890-1947], je lis plus loin l’appréciation qu’Alice Rühle [1894-1943], épouse d‘Otto Rühle [1874-1943], psychanalyste Adlérienne, écrivaine et militante féministe porte sur Natalia Ivanovna, l’épouse de Trotsky [1882-1962 : à savoir qu’elle lui « trouve meilleure mine maintenant que du vivant de Vieux » mais aussi « qu’elle était totalement inhibée par la puissante personnalité du Vieux. Silencieuse, effacée, n’intervenant jamais en rien… Elle est beaucoup plus vivante aujourd’hui. […] » 488 (Cf. Femmes. Veuves)
Femmes (Épouse de. Trotsky Natalia Ivanova) (3) : (18 mai) 1949. Une lettre de Cornelius Castoriadis [1922-1997] que celui-ci adressa à Natalia Ivanovna [1882-1962] dévoile son rôle politique et / ou la déférence qui serait due à la-veuve-du-grand-homme :
« Le courage moral et la clairvoyance avec lesquels vous avez pris plusieurs fois position contre l’opportunisme et la direction actuelle de la IVème internationale (Trotskyste) nous font attribuer une importance exceptionnelle à vos appréciations et nous permettent d’espérer que nous aurons votre soutien dans notre lutte (celle de Socialisme ou Barbarie). » 489
-------------
Femmes (Épouse de. Trump Melania) : (16 décembre) 2018. Donald Trump, à la Maison Blanche, félicité Melania « notre formidable première dame » pour avoir « travaillé si dur » à l’installation des décorations de Noël. […]. »
« Bienvenue à la Maison-Blanche, passez une bonne soirée. Joyeux Noël, bonne année et bonne santé », a-t-elle, à sa ensuite, pour sa part, déclaré. 490 (Cf. Femmes. Silence, Hommes. « Politiques »)
Femmes (Épouse de. Vaux Clotilde de) : Lu sur Wikipédia :
« […] Clotilde de Vaux [1815-1848] rencontre chez ses parents Amédée de Vaux, un jeune homme désargenté de la région qui a été recommandé à son père pour l'aider à la perception. La jeune femme répond favorablement aux avances du jeune homme, entre autres pour échapper au foyer paternel. Celui-ci fait alors sa demande en mariage, qui est acceptée à contrecœur par les parents de Clotilde. Après le mariage qui aura lieu le 28 septembre 1835, Amédée de Vaux récupère l’emploi de son beau-père à la perception, et les parents de Clotilde vont habiter Paris. Clotilde demeure alors à la perception dont son mari a maintenant la charge. Quatre ans plus tard, en 1839, on découvre que son mari est un voleur et un faussaire, qui a trafiqué les livres de comptes, pour payer des dettes de jeu. Ce dernier tente de mettre le feu à la perception et s'enfuit en Belgique. La vie de Clotilde est brisée : elle ne peut divorcer, elle n’a pas de ressources, pas de métier... Elle revient vivre chez ses parents à Paris, et envisage d’écrire pour gagner sa vie. Mais en attendant, elle dépend de la maigre pension et de l'avarice de son père. […] » (Cf. « Sciences » sociales. Sociologie. Comte Auguste)
Femmes (Épouse de. Verlaine Mathilde) : 1951. Paul Léautaud [1872-1956], dans ses Entretiens avec Robert Mallet [1915-2002], concernant Mathilde Verlaine [sous le nom de Mathilde Meauté. [1853-?], épouse de Paul Verlaine. 1844-1896], auteur de :
« C’est très joli d’être la femme d’un grand poète, mais d’être celle d’un ivrogne qui pourrait vous donner un coup de couteau, tout de même, c’est à considérer ! Il y a des gens qui sont portés à dire que, quand on est l’épouse d’un grand homme, il faut tout supporter avec lui. Ce sont ceux qui ne vivent pas avec lui ! » 491
Les Mémoires de ma vie présentés comme signés par Ex-Madame Paul Verlaine ont été réédités en 2014. [Éditions Champ Vallon. 256p.] (Cf. Famille. Couple, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
Femmes (Épouse de. Wilde Constance) : 1985. Lire la concernant, le livre d’Anne Clark Amor, Madame Oscar Wilde. 492
Un livre documenté, respectueux de ce que fut la vie de Constance Mary Llyod [1858-1898], épouse d’Oscar Wilde [1854-1900], mais dont malheureusement, quelques (rares) références masquent mal des partis-pris non justifiés. Trois exemples de phrases qui m’ont mises mal à l’aise :
- (Concernant la sortie de la prison d’Oscar Wilde) :
« Le jour suivant, peu après 6 heures du matin, il fut remis en liberté, tandis qu’à ce moment précis Constance commettait une erreur très grave. Ce qu’elle aurait dû faire de toute évidence, c’était d’attendre son mari à la porte de la prison pour le suivre dans son exil. […] » (p.269)
- « Vis à vis de ses deux fils, elle a joué un rôle capital. Toutefois, elle n’a jamais égalé son remarquable époux [...] » (p.293)
- (Dernière phrase du livre) :
« Certes, elle aurait souhaité éviter, dans la mesure du possible, ses innombrables motifs de chagrin, mais jamais au détriment de sa vive et durable passion (comprendre : son mari) ; son rôle essentiel tout au long de l’existence, ne fut-il pas tout simplement d’être madame Oscar Wilde ? » (p.299)
Femmes (Épouse de. Woolf Virginia) : (28 mars) 1941. Lettre de Virginia Woolf [1882-1941] à son mari, Leonard Woolf [1880-1969], écrite avant sa décision de se suicider :
« Mon chéri, J’ai la certitude que je vais devenir folle à nouveau : je sens que nous ne pourrons pas supporter une nouvelle fois l’une de ces horribles périodes. Et je sens que je ne m’en remettrai pas cette fois-ci. Je commence à entendre des voix et je ne peux pas me concentrer.
Alors, je fais ce qui semble être la meilleure chose à faire. Tu m’as donné le plus grand bonheur possible. Tu as été pour moi ce que personne d’autre n’aurait pu être. Je ne crois pas que deux êtres eussent pu être plus heureux que nous jusqu’à l’arrivée de cette affreuse maladie. Je ne peux plus lutter davantage, je sais que je gâche ta vie, que sans moi tu pourrais travailler. Et tu travailleras, je le sais.
Vois-tu, je ne peux même pas écrire cette lettre correctement. Je ne peux pas lire. Ce que je veux dire, c’est que je te dois tout le bonheur de ma vie. Tu t’es montré d’une patience absolue avec moi et d’une incroyable bonté. Je tiens à dire cela - tout le monde le sait. Si quelqu'un avait pu me sauver, cela aurait été toi. Je ne sais plus rien si ce n'est la certitude de ta bonté. Je ne peux pas continuer à gâcher ta vie plus longtemps. Je ne pense pas que deux personnes auraient pu être plus heureuses que nous l'avons été.
Si quelqu’un avait pu me sauver, cela aurait été toi. Je ne sais plus rien si ce n’est la certitude de ta bonté. Je ne peux pas continuer à gâcher ta vie plus longtemps. » 493
* Ajout. 25 octobre 2017. (avril) 1941. Lu cette analyse d’Anaïs Nin [1903-1977], après qu’elle eut, dans son Journal, reproduit une partie de cette lettre de Virginia Woolf :
« Étonnamment direct et simple de la part d’un écrivain qui a exploré toutes les ambiguïtés de la langue anglaise, dont l’écriture était si abstraite et labyrinthique. Simple, direct, comme toute vraie souffrance. C’était la première fois qu’elle s’exprimait comme un être humain. » 494
Femmes (Épouse de. Zay Madeleine) : (15 août) 1942. Jean Zay [1905-assassiné le 20 juin 1944], en prison, dans une lettre à son épouse, Madeleine [1906-1991], lui écrit :
« Le temps ne me pèse plus et me devient à peine sensible. J’attends désormais sans aucune fièvre. Et cet extraordinaire miracle, c’est toi qui l’as réalisé, mon petit amour bienaimé. C’est à toi que je le dois tout entier, à toi et aux filles, c’est à dire deux fois à toi. C’est à toi, à ton amour, à ton sourire, à l’apaisement que tu me donnes de mille manières, à toutes les minutes, même quand tu es éloignée, que je dois tout mon courage, toute ma certitude. C’est à toi que je dois d’avoir gagné - et définitivement - la rude bataille que je livre depuis deux ans. Sans toi, que serais-je devenu ? Avec toi, que pourrais-je craindre ? Tu es toute ma force, toute ma vie. Je le pense à chaque instant et particulièrement ce soir. Et je m’en aperçois sans cesse, bien que je ne te le dise pas souvent. […] » 495 (Cf. Êtres humains. Soi, Famille. Couple, Justice. Grâce. Zay Jean, Politique. Prison)
Par ordre chronologique. Femmes. Épouse de. Alexandrine Zola :
Femmes (Épouse de. Zola Alexandrine) (1) : (8 mars) 1894. Lu dans l’introduction biographique du Tome VIII [1893-1897] de la correspondance d’Émile Zola :
« Le 9 mars 1894, Zola [Émile. 1840-1902] écrit à son correspondant Hollandais Jacques van Santen Kolff [1848-1896] : ‘Je viens de traverser une longue crise de souffrances physiques et morales’. Il n’ajoute bien sûr aucune précision, mais il est permis de penser qu’à ce moment-là les choses (sic) se sont apaisées rue de Bruxelles et qu’Alexandrine a fini par accepter la liaison de son mari. L’atmosphère (sic) demeure instable sans doute, mais à force d’usure, l’épouse légitime a cédé. » 496 (Cf. Famille. Polygamie, Patriarcat. Pères. Zola Émile)
N.B. Si l’épouse est « légitime », la mère de ses deux enfants ne peut être qu’illégitime.
Du danger de reprendre des termes sans en peser la signification…
Femmes (Épouse de. Zola Alexandrine) (2) : (17 mars) 1899. Alexandrine Zola [1839-1925], écrit à son mari Émile Zola [1840-1902] qui lui avait fait envoyer des fleurs à l’occasion de son anniversaire :
« Ce 17, jour de fête, et malgré ta tendre attention, est un véritable jour de deuil ; je puis le mettre parmi ceux qui m’ont été les plus douloureux, dans ces dernières années, car, sur ces dernières années de vie commune, l’on doit en retrancher une dizaine d’un calvaire affreux qui ne cessera qu’avec moi. Aujourd’hui, tout ce flot de chagrin passé, devant la solitude de ma vie, me remonter, et c’est dans une souffrance des plus amères que je passe cette journée, au milieu des fleurs qui ne m’ont pas été aménagées […] J’étais près de toi, lorsque la 34ème année s’est achevée, le 28 décembre, et ni l’un ni l’autre, nous n’en avons parlé, et j’ai rentré encore une fois mes larmes et mes soupirs désespérés, n’ayant pas encore compris, comment ce bonheur que je rêvais pour nos vieux jours avaient pu ainsi m’échapper comme dans un coup de foudre. » 497 Une terrible vérité, une douleur, un drame, des illusions… ; une dignité ? (Cf. Femmes. Fleurs. Pleurs. « Trompées »)
Femmes (Épouse de. Zola Alexandrine) (3) : (14 novembre) 1899. Alexandrine Zola [1839-1925], écrivant à son mari Émile Zola [1840-1902] le dénomme « le génie du siècle et le brave entre tous. » 498
Femmes (Épouse de. Zola Alexandrine) (4) : 1980. Je lis dans les notes du Tome II de la Correspondance d’Émile Zola :
« Eleonore-Alexandrine Meley, [1839-1925] qui se faisait appeler Gabrielle et qui reprendra son prénom d’Alexandrine. Elle épousera Zola [1840-1902] le 31 mai 1870. Dans l’édition qu’elle préparera pour Fasquelle, madame Zola fit subir aux textes des lettres de son mari à Roux des corrections révélatrices de sa psychologie. Elle remplaça toutes les mentions de Gabrielle (ici, par exemple : ‘Tu as le bonjour de ma mère et de Gabrielle’) par « ma femme ». Par ailleurs, elle supprima toutes les allusions que faisait son époux à Marie, la jeune femme avec laquelle vivait Roux [Marius. 1870-1936]. Dans son travail d‘‘éditrice’, Mme Zola se montre aussi très soucieuse du ‘cant’ [Qu’en dira-t-on ?] ; elle rejette le prénom qu’elle portait au temps de sa jeunesse bohème, lorsqu’elle fréquentait des peintres et connut Zola ; elle fait disparaître toute allusion à une union illégitime (sic). Elle eut très tôt, dès qu’elle eut épousé le romancier, ce souci de respectabilité. C’est ce qui lui inspire probablement les remarques, parfois acrimonieuses, qu’elle fait dans ses lettres sur Marie et aussi pour les mêmes raisons, sur la maîtresse de Cézanne. »
L’absence ici de toute référence à son mari bigame - et non pas « infidèle » comme je l’ai lu - que Zola longtemps lui cacha et à ses deux enfants, relève telle aussi de la « psychologie » ? 499 (Cf. Femmes. Prénoms, Patriarcat. Pères. Zola Émile)
Femmes (Épouse de. Zola Alexandrine) (5) : 1997. Je ne peux que renvoyer au livre passionnant, précis, rigoureux, juste d‘Évelyne Bloch-Dano, Madame Zola. [1839-1925]
Trois remarques critiques … importantes… : l’emploi des termes d’ « inquisitrice », de « victime agressive » (p.244) et de « veuve abusive » (p.302). » 500 (Cf. Hommes. Égoïstes)
-------------
V. Femmes (Journalistes) :
Femmes. Journalistes :
Femmes (Journalistes) (1) : Une journaliste de retour d’enquête :
« Encore une fois, j'ai rencontré des femmes remarquables. »
Femmes (Journalistes) (2) : 1994. Françoise Basch [1930-2023], dans Victor Basch [1863. 10 janvier 1944]. De l’affaire Dreyfus au crime de la milice, concernant le procès de Rennes, auteure de :
« Ce lundi matin 7 août [1898], la salle est plein comme le constate Victor Basch. L’évènement avait attiré une foule de journalistes de la presse locale, nationale et étrangère. […] On remarque les ‘reporteresses’ du quotidien féministe La Fronde. Leurs confères naturellement, ne les prennent guère au séreux et commentent les attraites de leurs « charmantes consoeurs’, ces ‘caillettes dreyfusistes’. [In : Colette Cosnier [1936-1016], Rennes [?]. p.60] » (Cf. Hommes. Journalistes, Justice. Procès Dreyfus Alfred, Langage. Féminisation du langage, Féminismes. Antiféminisme) 501
N.B. On ne dira assez l’importance de La Fronde. (Cf. Femmes. Journalistes. La Fronde)
Femmes (Journalistes) (3) : 2018. Entendu une ex-journaliste déclarer :
« J’ai douté de l’utilité du journalisme quand j’ai découvert que l’on ne pouvait pas s’exprimer librement. » (Penser. Liberté de la presse)
Par ordre alphabétique. Femmes. Journalistes :
Femmes (Journalistes. Adler Laure) : (26 septembre) 2017. Laure Adler, s’adressant à Anne Sylvestre [1934-2020], auteure de :
« Vous savez que c'est ringard de se dire féministe ? » 502 (Cf. Femmes. Remarquables. Sylvestre Anne)
Par ordre chronologique. Femmes. Journalistes. Caroline Broué :
Femmes (Journalistes. Broué Caroline) (1) : (4 août) 2019. Caroline Broué, responsable d’une émission de France Culture, consacrée à - et d’un grossier parti-pris négatif à l’encontre de Françoise Giroud [1916-2003] -, a été reprise par l’une de ses invitées, Sonia Mabrouk :
« Je n’aime pas qu’on déboulonne les statues » lui a-t-elle dit. 503 (Cf. Culture. Patriarcale, Femmes. Journalistes. Giroud Françoise. Saint-André Alix de)
Femmes (Journalistes. Broué Caroline) (2) : (1er février) 2020. Reprenant la présentation de « la Parisienne » telle que présentée par France Culture, Caroline Broué se l’approprie et déclare :
« ‘Timide, effrontée, coquette, ça me va. » 504 (Cf. Femmes. « Coquettes »)
-------------
Femmes (Journalistes. Caster Sylvie) : (1er avril) 1985. Sylvie Caster, venue de Charlie Hebdo, première femme permanente embauchée en 1985 au Canard Enchaîné (créé à la Libération) était en charge d’une rubrique intitulée : Calamity Caster (dont l’intitulé lui fut imposé). Elle témoigne :
« Il y a une femme qui écrit dans le Canard, et c’est une calamité. […] C’est évidemment intéressant, parce que c’est signaler ouvertement, et s’en rendre compte, qu’on a un problème avec les femmes. » 505
Il faut savoir qu’avant elle, les articles antérieurs signés Jeanne-la-Cane et Valentine de Coincoin étaient écrits par des journalistes hommes du Canard.
Pour une analyse critique, lire le chapitre 28 intitulé :
« Une citadelle sans les femmes » du livre de Karl Laske et Laurent Valdiguié, Le vrai Canard. 506
Femmes (Journalistes. Fronde La) : Lire Wikipédia. En attendant…
Il faudrait publier tous (ou presque) les articles de La Fronde, par auteure et par thème.
Je pourrais, pour ma part, donner les photocopies des articles consacrés au travail (au sens très large du terme)
Femmes (Journalistes. Gesbert Patricia) : (27 juin) 2018. Sur France Culture, la si prudente, si consensuelle, Patricia Gesbert concernant les conséquences de « l’affaire Weinstein » pose à Annie Ernaux la question suivante :
« Est-ce qu’il n’y a pas un risque d’obsolescences des hommes » ?
Puis évoquant l’avortement vécu par Annie Ernaux, elle le qualifie d’ « évènement intime ». 507 (Cf. Femmes. Avortements, Féminismes, Langage. Critique de mot : « Évènement », Patriarcat. Weinstein Harvey)
Par ordre chronologique. Femmes. Journalistes. Françoise Giroud :
Femmes (Journalistes. Giroud Françoise) (1) : 1980. Lu sous la plume de Michèle Manceaux [1933-2015] l’une des journalistes qui a travaillé avec Françoise Giroud [1916-2003] à L’Express [qu’elle quitte en tant que directrice de rédaction en 1974] :
« Les femmes que Françoise Giroud avait réunies n’étaient pas des féministes militantes mais d’instinct, elles visaient à se créer, à créer. On peut se demander si elle agissait ainsi dans l’intérêt des femmes ou dans l’intérêt du journal, mais les femmes du journal y trouvaient leur compte. Elles étaient propulsées plutôt que barrées. Comme on leur faisaient confiance, elles ne se méfiaient pas les unes des autres. Elles ne se jalousaient pas. Elles se racontaient leurs aventures et leurs soucis. Pas un mois où nous n’avions à résoudre collectivement un problème posé par un avortement (la pilule n’existait pas), par un divorce, un chèque sans provision, un déménagement à la cloche de bois, un enfant malade. Nous ne comptions pas sur les hommes. » 508 (Cf. Femmes. « Politiques ». Giroud Françoise. Solidarité. Sororité)
Femmes (Journalistes. Giroud Françoise) (2) : 1997. Lu dans La mémoire du cœur de Christine Ockrent, elle-même journaliste :
« […] On se préoccupe toujours moins de ce que pensent les femmes. À l’exception des vraies professionnelles, de celles qui sont passées entre les mains habiles de madame Giroud [1916-2003], ravissantes et malignes péronnelles lâchées dans le milieu journaliste pour y butiner à loisir. Elles y ont toutes fait carrière, continuant à briller de leurs feux et faisant des émules. » 509 (Cf. Femmes. « Politiques ». Giroud Françoise. Solidarité. Sororité)
Femmes (Journalistes. Giroud Françoise) (3) : 2003. Selon Françoise Giroud [1916-2003] concernant Pierre Mendès-France [1907-1982], « il n’existait pas de traces de misogynie chez cet homme. Il respectait les femmes et cela ne l’étonnait nullement de me voir m’intéresser à la politique. Le contraire lui aurait apparu anormal. » 510
« Moi-je-en-politique » : la norme sur laquelle fonder un jugement ? (Cf. Femmes. « Politiques ». Giroud Françoise, Hommes. « Politiques ». Mendès-France Pierre)
-------------
Femmes (Journalistes. Manceaux Michèle) : 1980. Michèle Manceaux [1933-2015], auteure, en 1980, concernant le traitement par les hommes des femmes journalistes en France :
« Sauf quelques cas isolés, promus au rang d’exception, c’est à dire d’alibis qui permettent d’autant mieux de refuser les autres, on se méfie des femmes. Leurs idées ne sont pas considérées comme politiques, surtout quand elles choquent, c’est à dire quand elles le sont. » 511 (Cf. Femmes. D’exception, Penser. Idées, Patriarcat)
Par ordre chronologique. Femmes. Journalistes. Christine Ockrent :
Femmes (Journalistes. Ockrent Christine) (1) : 1991. En conclusion d’une présentation de Clarence Thomas [juge à la Cour Suprême des États-Unis], accusé de harcèlement sexuel par Anita Hill, Christine Ockrent écrivit :
« On ne saura jamais si Anita Hill a menti, ni pourquoi Clarence Thomas a été confirmé à deux voix près. Le poids du vote noir [pour rappel : Anita Hill avait, elle aussi, la peau noire] et le calcul politique l’ont emporté. Mais l’Amérique a honte d’avoir tant appris sur elle-même (sic), et d’avoir dans la confusion des genres et des valeurs, tant fouillé sa conscience. La télévision jusqu’à la caricature a rempli sa fonction de montrer au plus grand nombre les jeux du cirque politique.
Nos chaînes ont beau jouer à l’Amérique [?], nos mœurs ne sont pas encore les siennes ; en matière de sexe, de politique et de mensonges, nos scénarios sont différents. Au moment où ici on s’interroge avec beaucoup de raison et un peu d’hypocrisie, sur les dérapages de l’information-spectacle, en voici un qu’il vaut mieux s’épargner, tant pis sur l’audimat. » 512 (Cf. Corps. Peau, Relations entre êtres humains. Hypocrisie, Langage. Critique de Mots : « Dérapage », Patriarcat. ‘Affaire’ Weinstein, Politique. Nationalisme. Racisme, Violences. Violences à l’encontre des femmes. Harcèlement sexuel)
Femmes (Journalistes. Ockrent Christine) (2) : (11 avril) 2018. À l’occasion de la visite en France en avril 2018 du nouveau dirigeant d’Arabie Saoudite, Mohammed ben Salmane [MBS], Christine Ockrent, auteure du Livre noir de la condition des femmes (XO Éditions. 2006] animait une rencontre au musée des Arts et métiers, le 9 avril, avec deux « députées » de la monarchie islamique sur le thème : « L’évolution du rôle des femmes dans la société Saoudienne. » 513
Il est probable qu’elle n’y ait vu aucune contradiction. Pas même une dissonance ? (Cf. Droit. Santé, Politique. Islam)
* Ajout. 9 juillet 2022. Christine Ockrent, sur France Culture, concernant Mohammed ben Salmane, auteure de : « Au-delà des excès du personnage… »
-------------
Femmes (Journalistes. Saint-André Alix de) : (4 août) 2019. Alix de Saint-André, interviewée concernant Françoise Giroud [1916-2003], parle d’Alma Malher [1879-1964], en ces termes : « une bonne femme épouvantable, une horreur », « très antipathique », « cette horreur ».
Quant à Françoise Giroud, on ne sait pourquoi, « elle jouait les idiotes dans les diners », et elle n’avait pas été choisi par Valéry Giscard d’Estaing au lieu et place de Simone Veil - pourquoi aurait-elle dû l’être ? mystère - parce qu’elle « n’était pas un parangon de vertu ». 514
Femmes (Journalistes. Salamé Léa) : (23 juillet) 2025. Lu dans Le canard enchaîné. Léa Salamé, future présentatrice du Journal télévisé de 20 heures de France 2, auteure de :
« Je me fatigue moi-même […] Tout le monde me veut. » (Cf. Hommes. « Modestes »)
Femmes (Journalistes. Sarraute Claude) : 1996. Claude Sarraute [1927-2023], dans Des hommes en général et des femmes en particulier, auteure de :
« (alors, journaliste au Monde) Invitée à New York, à l’époque (sans date), je me rappelle être allée demander au chef du service étranger du Monde s’il n’aurait pas un reportage à me confier. Il a fouillé dans sa corbeille à papier :’Attends voir, je viens de balancer une petite dépêche de l’AFP, une connerie… Des mal baisées qui ne veulent plus qu’on les prenne pour des objets sexuels ! Ah, la voilà ! Paraît qu’elles ont manifesté en jetant leurs soutien-gorge, leurs porte-jarretelles, leur cire à épiler et leurs boucles d’oreilles, ces folles. Tu devrais aller y mettre le nez. C’est tout à fait pour toi ! » 515 (Femmes. Mépris. Le Monde, Politique. Médias, Histoire. Patriarcale)
Par ordre chronologique. Femmes. Journalistes. Gerda Taro :
Femmes (Journalistes. Taro Gerda) (1) : Gerda Taro [Gerta Pohorylle. 1910-1937], première femme reporter de guerre, « tuée dans l’exercice de ses fonctions », en soutien à la République espagnole et aux brigades internationales. Elle meurt à 27 ans, dans la guerre d’Espagne, écrasée par un char dans d’« affreuses souffrances ».
« Quand je pense à tous les gens extraordinaires qui sont morts dans cette guerre, j’ai l’impression qu’il n’est pas juste que je sois encore en vie » avait-elle écrit avant sa mort. 516
Femmes (Journalistes. Taro Gerda) (2) : (28 juillet) 1937. Je lis dans les Carnets de Louis Guilloux [1899-1980] :
« Ce soir annonce la mort de Taro [Gerta Pohorylle. 1910-1937], tuée en Espagne devant Brunete. L’article nécrologique, qui doit être d’Aragon [1897-1982] s’achève ainsi : ‘Elle était de celles qui donnent leur vie sans rien y trouver d’étonnant.’ » 517 (Cf. Femmes. Comment meurent les femmes ? Patriarcat)
Femmes (Journalistes. Taro Gerda) (3) : 2006. Concernant les relations de Gerda Taro [Gerta Pohorylle. 1910-1937], avec l’agence de presse CAPA, je lis dans le Monde 518 la critique de la biographie allemande [2006] qui lui a été consacrée :
« […] Mais pourquoi son travail a-t-il été occulté ? C'est là que le livre d'Irme Schaber devient passionnant. Cette femme libre a d'abord été transformée, dès sa mort, en icône antifasciste par le parti communiste français. Sa disparition fait les gros titres de la presse du PCF. Pas moins de 10 000 personnes accompagnent sa dépouille au Père-Lachaise sur fond de Marche funèbre de Chopin. Paul Nizan et Louis Aragon font son éloge alors que sa tombe est sculptée par Giacometti. De plus, Capa [Robert Capa.1913-1959], écrit Schaber était ‘habitué à considérer comme siennes les images de Gerda’. Elle montre comment, en onze mois d'Espagne, les photos de Taro ont été publiées sous la signature ‘Capa’, puis ‘Capa/Taro’, et enfin ‘Taro’ seule. Mais sa disparition brutale et la notoriété du photographe hongrois ont fait que des ‘photos Taro’ sont devenues des ‘photos Capa’ et que ce dernier a ‘favorisé ces transformations’. [...] » 519 (Cf. Femmes. Comment faire disparaître les femmes ? Noms)
-------------
VI. Femme (Mères) :
Femmes. Mères :
Femmes (Mères) (1) : Aux mères mortes sur l’autel de la famille, la patrie amnésique…
Mères (2) : Il y a tant de mères qui n’aiment pas leurs enfants, ou l’un-e ou l’autre plus particulièrement ; tant de mères dont les enfants ne comblement pas leur vie et/ou ont brisé leurs espoirs de vie ; tant de mères qui sont d’abord et avant tout épouses, amantes ; tant de mères qui transfèrent sur leurs enfants, l’image détestée du père ; tant de mères, qui, plus largement, ne peuvent construire la place d’un-e autre dans leur vie ; tant de mères enfin qui le sont devenues sans même comprendre ni comment, ni pourquoi, et - la norme - qui n’avaient aucune conscience des conséquences ; tant de mères qui ne peuvent l’être « n’ayant jamais été enfant » 520 …
Constat, dont les effets ravageurs seraient sans aucun doute moindres si l’imposition de la norme jamais définie (et pour cause) : « être une bonne mère » - qui libérerait l’inconscient, la parole, le vécu si souvent insupportables - était moins écrasante, moins étouffante, moins invivable.
Mères (3) : L’une voulait avoir un enfant, et ne savait rien de la maternité ; l’une voulait être mère et ne savait rien des enfants. La plupart ne savent ni ce que c’est d’être mère, ni d’avoir un, des enfants.
Mères (4) : (juin) 2022. Selon la revue Population et Sociétés, « chaque année, environ 400.000 jeunes femmes de moins de 15 ans, mettent au monde un enfant. » (Cf. Femmes. Jeunes filles)
Mères (5) : - Le mari : « Si tu pars, ce sera sans les enfants. »
- Les services sociaux : « Si vous le rejoignez, ce sera sans les enfants. » (Cf. Patriarcat. Pères, Patriarcat, Politique. État, Histoire. « Longue »)
Mères (6) : 1978. Lu, dans Entrer dans la vie. Naissances et enfances dans la France traditionnelle, :
« Jusqu’à l’aube du XXème siècle [en France], la vie d’une femme mariée se passe en grossesses, allaitements et enterrements d’enfants. » 521
Par ordre alphabétique. Femmes. Mères :
Mères (Abderrhaim Souad) : (9 novembre) 2011. Souad Abderrhaim, responsable du parti tunisien Ennahdha, alors parlementaire, auteure de :
- « Les mères célibataires ne devaient pas aspirer à un cadre légal qui protège leurs droits. »
- « La famille ne doit pas être formée en dehors des liens du mariage. » 522 (Cf. Droit. Patriarcal, Femmes. « Politiques », Famille. Mariage)
Mères (Aboulker Isabelle) : (21, 22 février) 2022. Isabelle Aboulker, compositrice, évoquant sa vie parle de sa mère qui, ayant aimé un autre homme que son mari, dont elle attendait un enfant, « a dû renoncer à ses deux filles », dont elle. Elle dira aussi, que dans son « testament », son père avait interdit qu’elle en ait la garde. Après la mort de son père en 1952, Isabelle Aboulker ne vécut donc pas avec sa mère. 523 (Cf. Culture. Aboulker Isabelle, Droit. Patriarcal, Famille. Divorce, Patriarcat)
Mères (Admirables) : 2018. Une femme peut, de son vivant, être qualifiée publiquement de « mère admirable ». Elle devra attendre sa mort et / ou d’être veuve, pour être qualifié - rarement - d’épouse admirable. Mais alors qu’est-ce à dire ?
Mères (Akerman Chantal) : (7 février) 2013. Chantal Akerman [1950-2015], après évoqué son père, gantier qui, ayant commencé à travailler à 15 ans, avait (lui aussi) des ambitions qu’il n’a pu réaliser, poursuit :
« Ma mère voulait, avec sa mère qui, elle, peignait, faire une maison de haute couture. Et puis… Rien... » (Un jour elle m’a dit :
« Tu sais j’ai travaillé avec ton père, mais je n’en avais pas envie. Si j’ai fait ça, c’est pour aider. Mais ce n’était pas ce dont j’avais envie. » 524
N.B. Cette citation ne révèle en rien la complexité des rapports entre Chantal Akerman et sa mère, déportée à l’âge de 15 ans et demi, abordés dans leur complexité, notamment dans l’interview sus évoqué. (Cf. Femmes. Mères. Travail, Féminismes)
Mères (Agoult Marie d’) : 1833. Marie d’Agoult [Daniel Stern. 1805-1876], auteure dans Mes souvenirs de :
« Je ne voulais pas éloigner de moi les enfants qui m’étaient nés (hors mariage) dans des conditions où, selon la loi française, je ne pouvais rien être pour eux. Ni mon nom n’avait pu leur être donnés, ni ma fortune ne devait leur appartenir ; d’autant plus tenais-je à leur garder toute ma tendresse et à ne jamais paraître désavouer une maternité contre la quelle conjuraient ensemble toutes les sévérités de la loi et de l’opinion. »
Ses trois enfants, qui lui furent « ôtés brutalement », s’appelaient Blandine Liszt, Cosima Liszt et Daniel Liszt.
Il importe aussi de noter que lorsqu’elle a quitté son mari (avec lequel elle avait eu deux enfants dont l’une était décédée) pour vivre avec Liszt, ipso facto, elle « perdait tous ses droits maternels » et donc la garde de Claire Christine d’Agoult. 525 (Cf. Droit. Patriarcal, Enfants, Famille. « Droits Maternels », Patriarcat. Pères)
Mères (Agrippine) : (4 novembre) 16-(29 mars) 59. Agrippine auteure de :
« Qu’il [son fils, Néron] me tue, pourvu qu’il règne. » 526
Ce qu’il fit.
Mères (Aron Raymond) : 1983. Raymond Aron [1905-1983] consacre dans ses Mémoires [778 pages], 22 lignes dans deux paragraphes, à sa mère [Suzanne Lévy. 1877-1940].
Il écrit aussi : « C’est au début de juin [1940] que ma mère mourut à Vannes […] » 527
Mères (« Assistance publique ») : 2015. Un enfant « placé » entendit de sa mère déclarer avant sa décision (pour la justifier) :
«L’assistance publique n’est pas faite pour les chiens. » 528 (Cf. Êtres humains, Enfants, Politique. Animalisation du monde)
Par ordre chronologique. Mères. Honoré de Balzac :
Mères (Balzac Honoré de) (1) : 1835. Honoré de Balzac [1799-1850], dans Le père Goriot, auteur de :
« Nous sommes heureuses, nous autres femmes, de n’être pas sujettes au duel ; mais nous avons d’autres maladies que n’ont pas les hommes. Nous faisons les enfants, et le mal de mère dure longtemps. » 529 (Cf. Femmes. Heureuses, Relations entre êtres humains. Duel)
Mères (Balzac Honoré de) (2) : 1828. 1844. Honoré de Balzac [1799-1850], dans La femme de trente ans, auteur de :
« Qu’une femme perde un nouveau-né, l’amour conjugal lui a bientôt donné un successeur. Cette affliction est passagère, aussi. » 530
Mères (Balzac Honoré de) (3) : 1828. 1844. Honoré de Balzac [1799-1850], dans La femme de trente ans, auteur de :
« - Je ne vous parlerai pas de sentiments religieux qui engendrent la résignation, dit le curé ; mais la maternité, madame, n’est-elle donc pas… ?
- Arrêtez, monsieur ! dit la marquise. Avec vous, je suis vraie. Hélas ! je ne puis l’être avec personne ; je suis condamnée à la fausseté ; le monde exige de continuelles grimaces, et sous peine d’opprobre, nous ordonne d’obéir à ses conventions. […] Jai un enfant, cela suffit ; je suis mère, ainsi le veut la loi. […] Ma pauvre petite Hélène est l’enfant de son père, l’enfant du devoir et du hasard ; elle ne rencontre en moi que l’instinct de la femme, la loi qui nous pousse irrésistiblement à protéger la créature née dans nos flancs. [...] Mais elle n’est pas dans mon cœur. […]. Mais je le sais, ce monde est implacable ; pour lui, mes paroles sont des blasphèmes, j’insulte à toutes ses lois. Ha ! je voudrais faire la guerre à ce monde pour en renouveler les lois et les usages, pour les briser. Ne m’a-t-il pas brisé dans toutes mes idées, dans toutes mes fibres, dans tous mes sentiments, dans tous mes désirs, dans toutes mes espérances, dans l’avenir, dans le présent, dans le passé ? […] » 531 (Cf. Patriarcat, Politique. Lois)
Mères (Balzac Honoré de) (4) : 1846. Honoré de Balzac [1799-1850], dans La cousine Bette, auteur de :
« L’œil d’Hortense étincelait : il coulait dans ses veines un sang chaud, chargé de fer impétueux : elle déplorait d’employer son énergie à tenir son enfant. » 532
-------------
Mères (Beaunez Catherine) : (20 juin) 2024. Je reçois ce texte de Catherine Beaunez intitulé « Le chant des partisans » publié sur Facebook, le 14 juin 2024, accompagné d’un dessin d’elle :
« Vendredi dernier, je suis allée chercher mes neveux à la sortie de l’école. Sur le chemin du retour, ma nièce, 10 ans, a chanté les premiers mots du Chant des partisans que sa maîtresse lui apprend en ce moment.
Sa grand-mère, maman, le chantait souvent à la maison, avec force et émotion. Comme un chant de toujours.
Elle qui s’était inscrite en 1942 à La Croix rouge, à 15 ans. Elle qui avait ramassé et transporté dans une brouette le corps d’un jeune soldat tué dans un bombardement sur le pont de Bezons. [Elle aussi qui s’étonnait de ne pas revoir une copine d’école à la rentrée. Elle et sa mère avaient les cheveux tout blancs en sortant de la cave où elles s’étaient cachées pendant la guerre].
Maman aussi qui, a 18 ans, toujours avec La Croix rouge, avait accueilli les juifs de retour des camps, à l’hôtel Lutetia. Elle était chargée de les peser et de les mesurer. Elle qui avait les joues rondes. Eux, la peau sur les os, le regard creux. Leur gêne d’être nu-es devant elle.
Maman encore qui avait bravement résisté aux avances d’un officier allemand. Il l’avait repérée depuis son bureau au-dessus de la Gare du Nord. Il l’avait faite venir entre deux allemands, lui avait parlé de sa famille et l’avait faite asseoir sur un lit. Elle, sans se démonter : ‘Vous penseriez quoi si quelqu’un en faisait autant avec votre fille ?’. Il s’est excusé et l’a faite raccompagner. Elle avait du cran, maman.
Son Chant des partisans, elle l’a continué avec papa pendant la guerre d’Algérie. À Colombes, ils luttaient tous les deux pour l’indépendance de l’Algérie avec des amis algériens, qu’ils n’ont pas revus après le 17 octobre 1962. Tués et jetés dans la Seine.
Et lorsque la DST est venue à la maison chercher la liste des responsables politiques Algériens, maman a glissé cette liste dans du beurre, en me demandant de le mettre au frigo. J’avais cinq ans, j’ai déposé le beurrier dans le frigo devant les flics. Ils ont mis à sac la maison, n’ont jamais trouvé la liste.
Elle avait du cran et du courage, maman. Et toute sa vie, elle s’est engagée à gauche avec papa pour défendre les droits humains.
Son Chant des partisans, on lui a chanté à ses 80 ans. On ne le connaissait pas par cœur. Elle, oui.
Quand j’ai raconté tout ça à ma nièce au retour de l’école, elle m’a dit : ‘Elle était super, Mamie !’. Et on a fredonné ensemble le Chant des partisans. C’était le vendredi qui précédait les Européennes du 9 juin 2024. » (Cf. Femmes. Résistantes)
Mères (Bellil Samira) : 2002. Samira Bellil [1072-2004], dans Dans l’enfer des tournantes, auteure de :
« […] En fait, ma mère aurait voulu m’élever comme elle avait été élevée au bled, à la dure. Chez nous, c’est comme ça, les filles s’en prennent plein la gueule sans broncher. Je sais que ma mère avait eu la vie dure, qu’elle avait été victime d’une culture où la femme est traitée comme un chien. Je sais qu’elle n’a eu ni amour, ni considération, ni la moindre affection. Je lui en veux tout de même de son silence. Je lui en veux d’avoir laissé mon père nous faire subir sa violence. Je lui en veux de n’avoir rien dite quand il me battait ou me faisait passer des nuits dehors. Aujourd’hui, elle ne s’en souvient pas, c’est pratique ! Je lui en veux de ne pas s’être battue pour moi, d’avoir laissé se faire ma dégradation psychologique. Je lui en veux de n’avoir pas été pour elle la prunelle de ses yeux.
Mon père avait toutes les excuses, je n’en avais aucune. Elle me demandait de le comprendre, parce qu’il n’avait pas appris à faire autrement. Ce n’est pas aux enfants de comprendre les adultes, et j’étais bien trop dans ma souffrance. » 533 (Cf. Enfants, Femmes. Animalisation des femmes. Responsables. Silence, Famille, Relations entre êtres humains. Aimer, Patriarcat. Pères, Penser. Comprendre, Violences)
Mères (Berr Hélène) : (19 octobre) 1943. Hélène Berr [1921-1945], dans son Journal, auteure de :
« Je comprends le tourment de Maman, sa souffrance est décuplée, elle est multipliée par le nombre de vies qui dépendent d’elle. » 534
Mères (Blanqui Auguste) : 1887-1900. Lu dans Choses vues de Victor Hugo [1802-1885] concernant Auguste Blanqui [1805-1881] :
« En 1848, quand Blanqui sortit de prison (hôpital de Tours) [où il est enfermé depuis 1840], il vint sur le champ à Paris. Sa vieille mère qui l’adorait se mit à sa recherche, allant chez lui cinq ou six fois par jour sans le trouver. Le troisième jour de son arrivée, il alla à La Réforme et dit à Ribeyrolles ‘J’ouvre un club. Annonce-le’.
- J’annonce tous les clubs, dit Ribeyrolles. J’annoncerai le tien. As-tu vu ta mère ?
- Il s’agit bien de ma mère, dit Blanqui, il s’agit de mon club.’ (Conté par Ribeyrolles, hier 18 mars 1857 à Guernesey). » 535 (Cf. Femmes. Épouse de. Blanqui, Hommes. « Politiques », Famille, Langage. Possessif, Politique. Lutte de femmes. Blanqui Auguste)
Mères (Blum Léon) : 2003. Jean Lacouture [1921-2015] présente Adèle Marie Alice Picart [1841-?] comme la « mère courageuse [de Léon Blum. 1852-1950] qui coupe les pommes en tranches strictement égales pour que personne n’ait une meilleure part que l’autre […]. » 536 (Cf. Politique. Égalité)
Mères (Brigitte) : 2007. Brigitte [nom réel non dévoilé], auteure de :
« Je suis née près de Blois, en août 1961. Pour ma mère, ce fut bien trop tôt. Ma naissance est son drame. […] Je serai donc à vie l’enfant de trop. » 537 (Cf. Enfants)
Mères (Burkhart Christina) : 1817. Dans l’Index des noms de personnes citées et présentées dans le tome II de la Correspondance de Friedrich Hegel [1770-1831], je lis :
« Burkhart, Christina, Charlotte, Johanna, née Fischer (née en 1778), mère du fils naturel de Hegel, Ludwig Fischer. »
La concernant, voici ce que révèle la Correspondance de Hegel, par une lettre qui lui fut adressée, le 19 avril 1817 :
« Voss a depuis amené ici Ludwig [Hegel]. Je lui ai fait connaître la mort de sa mère. Elle l’a plus affecté que moi. Il y a longtemps que mon cœur en a fini avec elle ; je ne pouvais plus encore que craindre des contacts désagréables entre elle et Ludwig - et aussi indirectement avec ma femme - et, pour moi, des choses extrêmement désagréables. Ludwig est pour moi et ma femme (Marie von Trucher) un sujet de joie. » 538 (à reprendre)
Je lis aussi sur Wikipédia concernant Friedrich Hegel :
« En 1811, il (Hegel) épouse Marie von Trucher qui appartient à une famille patricienne de la ville. Ils ont deux fils : Karl Hegel [1813-1901] qui deviendra historien, et Immanuel Hegel [1814-1891]. » (Cf. Êtres humains, Enfants, Femmes. Épouse de. Hegel Maria)
Mères (Calamity Jane) : 1997. Dommage que les Lettres à sa fille de Calamity Jane [1856-1803] [Martha Jane Cannary] se soit avérées un faux (elle ne savait ni lire ni écrire) : elles sont en effet crédibles et touchantes et attachantes. La fin :
« Pardonne-moi et songe que j’étais solitaire. » 539 (Cf. Femmes. « Seules »)
Mères (Kapek Carel) : 1934. Karel Capek [1890-1938], dans Une vie ordinaire, auteur de :
« […] Oui, comme maman. Ça fait du bien, même à une jeune femme, de se comporter comme une maman et d’entourer un être de ses soins, de se désoler et de se préoccuper de lui ; elle songe, les yeux remplis de larmes : ‘S’il tombait malade, je prendre soin de lui’. Elle ne se rend même pas compte comment de ce fait, elle est en train de se l’approprier, comment elle s‘efforce de s’en emparer ; elle veut qu’il lui appartienne, qu’il ne puisse pas résister et qu’il se soumette à la terrible abnégation de son amour. » 540 (Cf. Relations entre êtres humains. Aimer)
Mères (Catherine II) : L’époux de la future Catherine II [1729-1789], le futur éphémère Pierre III, informé, en septembre 1758, qu’elle était enceinte (après 13 ans de mariage, plusieurs fausses couches et deux enfants) déclara :
« Dieu sait où ma femme prend ses grossesses ; je ne sais trop si cet enfant est à moi et s’il faut que je le prenne sur mon compte. »
Informée par son amant, Léon Narychkine [1760-1826] auquel, avec d’autres, ce « propos tout chaud » venait d’être adressé, et, bien qu’ « effrayée » elle-même, l’impératrice écrit dans ses Mémoires avoir dit :
« Vous êtes tous des étourdis ; exigez de lui un serment comme quoi il n’a pas couché avec sa femme, et dites-lui que, s’il prête ce serment, tout de suite vous irez en faire part à Alexandre Chouvalov [homme ‘fort’ du régime de l’impératrice comme au grand inquisiteur de l’empire. »]
La réaction du père putatif fut :
« Allez-vous en au diable et ne me parlez plus de cela. » 541 [à reprendre] (Cf. Femmes. Enceintes. Remarquables. Catherine II, Patriarcat. Pères)
Par ordre chronologique. Mères. Louis-Ferdinand Céline :
Mères (Céline Louis-Ferdinand) (1) : 1932. Louis-Ferdinand Céline [1894-1961], dans Voyage au bout de la nuit, auteur de :
« Ma mère, de France, m’encourageait à veiller sur ma santé, comme à la guerre. Sous le couperet, ma mère m’aurait grondé pour avoir oublié mon foulard. Elle n’en ratait jamais une, ma mère pour essayer de me faire croire que le monde était bénin et qu’elle avait bien fait de me concevoir. C’est le grand subterfuge de l’incurie maternelle, cette Providence supposée. » 542
Mères (Céline Louis-Ferdinand) (2) : 1932. Louis-Ferdinand Céline [1894-1961], dans Voyage au bout de la nuit, auteur de :
« Ma mère aussi, à moi, elle faisait du commerce ; ça nous avait jamais rapporté que des misères, son commerce, un peu de pain et beaucoup d’ennuis. » 543 (Cf. Économie. Commerce. « Pauvres Les »)
Mères (Céline Louis-Ferdinand) (3) : 1932. Louis-Ferdinand Céline [1894-1961], dans Voyage au bout de la nuit, auteur de :
« […] Parce que, comme ma mère, je n’arrivais jamais à me sentir entièrement innocent des malheurs qui arrivaient. » 544
Mères (Céline Louis-Ferdinand) (4) : 1932. Louis-Ferdinand Céline [1894-1961], dans Voyage au bout de la nuit, auteur de :
« Ma mère, à propos, j’avais pas été la voir depuis longtemps… Et ces visites-là ne me réussissait guère sur le système nerveux… Elle était pire que moi, pour la tristesse, ma mère… Toujours, dans sa petite boutique, elle avait l’air d’en accumuler tant qu’elle pouvait autour d’elle des déceptions après tant et tant d’années… » 545
Mères (Céline Louis-Ferdinand) (5) : 1944. Louis-Ferdinand Céline [1894-1961] s’enfuit, en 1944, pour l’Allemagne, puis, part avec un visa d’Allemagne pour le Danemark : il écrit alors à Marie Canavaggia [1896-1976], qui avait été sa secrétaire à Paris avant pour lui demander des nouvelles de sa mère qu’il a quittée à la mi-juin 1944. Marie Canavaggia lui ayant appris que sa mère est morte, il lui répond :
« Chère amie, vous pensez si vos deux lettres, reçues ce jour, m’ont bouleversé. Ma pauvre mère. Elle me hante. Je ne pense guère à autre chose. C’était elle la plus faible, la plus innocente. Elle a payé pour tout le monde… Je me repens effroyablement de mes duretés envers elle… Je ne pense plus qu’au Père Lachaise et à me retrouver avec elle… Je la vois encore, nous quittant comme un pauvre chien congédié, au coin de l’avenue Junot […]. » 546 (Cf. Femmes. Animalisation des femmes. « Faibles »)
-------------
Mères (Chaperons) : Edith Wharton [1862-1937], autorisée à assister à un cours d’art dramatique du « vieil acteur » Delaunay [Louis. Arsène. 1826-2013] au Conservatoire, se souvient :
« Il n’y avait personne dans la salle que ses jeunes élèves, garçons et filles, avec les mères (apparemment authentiques) de ces dernières, car à cette époque, même les actrices en herbe ne suivaient jamais de cours sans être chaperonnées ! » 547
N.B. La référence à « l’authenticité apparente » des mères s’explique par le fait que là, comme à l’Opéra, l’on accusait de « fausses mères » de jouer le rôle d’entremetteuses entre les jeunes filles et les vieux messieurs, présents aux répétitions, aux aguets. Ce qui n’était pas toujours faux. (Cf. Femmes. Artistes. Jeunes filles. « Entremetteuses », Violences. Violences à l’encontre des femmes. « Droit de cuissage »)
Mères (Charlotte de Prusse) : 1839. Astolphe de Custine [1790-1857], dans ses Lettres de Russie, écrit concernant Charlotte de Prusse Alexandra Feodorovna, [1798-1860], épouse de Nicolas 1er, empereur de Russie [1796-1855], mère de dix enfants :
« Elle n’appartient plus à la terre : c’est une ombre. Elle n’a jamais pu se remettre des angoisses qu’elle a ressenties le jour de son avènement au trône [tentative de coup d’État le 14 décembre 1825 qui fut réprimée par l’armée] : le devoir conjugal a consumé le reste de sa vie. Elle a donné trop d’idoles à la Russie, trop d’enfants à l’Empereur. ‘S’épuiser en grands ducs, quelle destinée’, disait [d’elle] une grande dame polonaise... » 548
N.B. Pour une toute autre perception de cette femme, on peut se reporter aux Mémoires de la baronne d’Oberkirch dont elle fut la grande amie. 549
Mères (Claudel Louise-Athanaïse) : 1913-1929. Lu sous la plume d’Henri Guillemin [1903-192], que la mère de Camille Claudel [1864-1943] « n’ira pas la voir une seule fois de 1913 [date de l’internement de Camille] à 1929 [date de sa mort]. » 550
Information importante mais bien courte… (Cf. Femmes. Artistes. Claudel Camille, Hommes. Claudel Paul)
Mères (Collin Françoise) : 1977. Françoise Collin [1928-2012], dans Les Cahiers du Grif, auteure de :
« Le dégagement [des femmes] par rapport à la maternité biologique ou même pédagogique ne nous paraît pas suffisant.
La maternité n’est pas qu’un fait pour les femmes, elle est une attitude profondément ancrée en elles par l’éducation.
Il est temps que les femmes cessent de jouer seules les mères universelles, en particulier les mères des hommes, celles qui les alimentent physiquement et moralement toute leur vie sans que jamais soit même reconnue cette origine.
Car les femmes ne mettent pas une fois les hommes au monde, elles les y mettent et les remettent tout le temps.
C’est auprès d’elles et en elles qu’ils viennent constamment refaire leurs forces pour aller ‘construire’ leur monde et produire, chacun à ses manières, leurs œuvres.
C’est auprès d’elles et en elles qu’ils viennent s’abriter et se consoler de la violence et de l’horreur de ce monde même : ils vident les femmes de leur propre substance, de leur vie. […] »
Lire tout le texte, important. 551 (Cf. Hommes, Famille. Féminismes. Penser le féminimes, Patriarcat)
N.B. Le Journal de Jules Michelet [1798-1874] explicite, revendique, à de nombreuses reprises, ce (dernier) rôle joué par sa jeune épouse sur et pour lui. (Cf. Femmes. Épouse de. Michelet Athénaïs)
Par ordre chronologique. Mères. Ivy Compton-Burnett :
Mères (Compton-Burnett Ivy) (1) : 1929. Ivy-Compton-Burnett [1884-1969], dans Frères et sœurs, auteure de :
« Elle caressa les cheveux de ses enfants et ils levèrent les yeux sur elle, en souriant. Il ne leur venait même pas à l’esprit qu’ils ne puissent pas adapter leur humeur à la sienne. » 552 (Cf. Enfants)
Mères (Compton-Burnett Ivy) (2) : 1967. Ivy-Compton-Burnett [1884-1969], dans La chute des puissants, auteure de :
« Le père de Ninian avait adopté, peu après sa naissance cet enfant orphelin, fils d’un ami, qui avait fini de prendre son nom. Les racontars n’avaient pas manqué à l’époque, mais on n’en parlait plus depuis longtemps. Selina, qui n’en savait pas plus long, avait accepté l’inévitable. Par grandeur d’âme, elle s’était interdit les doutes, et entre elle et l’enfant étaient nés des rapports presque filiaux. Son père adoptif lui avait légué une petite rente et il vivait sous le toit familial. » 553 (Cf. Enfants. « Légitimes »)
Mères (Compton-Burnett Ivy) (3) : 1967. Ivy-Compton-Burnett [1884-1969], dans La chute des puissants, auteure de :
« Et maintenant, je veux m’entretenir avec ma mère. Il nous reste en commun un avenir mesuré et nous avons partagé si peu du passé. » 554
-------------
Mères (Darlan Eva) : 2016. Eva Darlan, dans Grâce ! Mes combats pour Jacqueline Sauvage, concernant sa mère, écrit :
« […] Partout, j’entendais d’elle : ta mère est une sainte. Je ne comprenais pas pourquoi. Je soupçonnais qu’il était question de mon père. Comme une imbécile qui ne connaît rien à la vie, je pensais qu’elle était maso. Je l’entendais soupirer à longueur de temps et chantonner d’une drôle de façon, mezza voce, comme pour se bercer elle-même. Je sais maintenant qu’elle a vécu un enfer, chaque jour, et que ses seules consolations ont été ses enfants petits et la religion. Maigre consolation pour une vie de cauchemar. Mais peut être que d’autres n’ont pas eu ça. […] » 555
Mères (D’Eaubonne Françoise) : (20 novembre) 2021. Vincent d’Eaubonne, fils de Françoise d’Eaubonne [1920-2005], auteur de :
« Elle ne m’a pas élevé, mais elle a contribué à élever la pensée humaine. Ceci vaut bien pour cela. J’ai l’immense chance d’avoir un matrimoine à défendre et une fierté de le faire. » 556 (Cf. Enfants, Hommes. Féminisme, Patriarcat, Penser)
Mères (De Gaulle Charles) : 1940. Charles de Gaulle [1890-1970] parmi les témoignages qui « afflu[ent] » à Londres de soutien à la France Libre, évoque « l’image d’une tombe, couverte des fleurs innombrables que des passants y avaient jetées ; cette tombe était celle de ma mère [Jeanne Maillot. 1860-1940], morte à Paimpont, le 16 juillet [1940], en offrant à Dieu ses souffrances pour le salut de sa patrie et la mission de son fils. » 557 (Cf. Politique. Religion)
Mères (Degenfeld Louise de) : Lu sur Wikipédia : Marie-Suzanne-Louise, dite Louise de Degenfeld [1634-1677] :
« Dame de compagnie de Charlotte de Hesse-Cassel [1627-1686]. Elle est l’épouse de l’électeur palatin Charles 1er, de manière morganatique, après que celui-ci a répudié puis divorcé unilatéralement de Charlotte de Hesse-Cassel. Elle est la mère de quatorze de ses dix-sept enfants, pour lesquels il a ressuscité le titre de raugrave et elle fut nommé raugravine en 1667. Étant des enfants illégitimes, ils ne pouvaient pas accéder au titre comte palatin, et ils n'avaient aucune terre. » (Cf. Enfants. « Bâtards ». « Illégitimes », Famille)
Mères (Dhavernas Odile) : 1981. Odile Dhavernas, dans Petite soeur née… prépare suicide, concernant sa mère auteure de :
« Femme merveilleuse, habitée d’une force, d’une foi intarissable. Femme pressurée, vampirisée, esclave de l’intendance jamais finie, elle prend une revanche terrible. Dans le seul domaine où elle ait un pouvoir, elle l’exerce avec tyrannie, époux et fille, époux et filles pareillement soumis à sa férule. Elle est sûre de ses privilèges, contrepartie misérable de sa réclusion et de ses travaux forcés. […] Elle pourvoit à tout, elle se répand, rayonnante, prodigieuse, excessive, imprévisible, écrasante. Son despotisme domestique est à la mesure des contraintes dans lesquelles s’inscrit sa vie. […] » 558 (Cf. Droit. Dhavernas Odile, Êtres humains. Privilégiés)
Mères (Duc d’Enghien) : (12 juillet) 1808. Germaine de Staël [1766-1817] écrit à Maurice O’Donnell [1780-1843] :
« Savez-vous que la duchesse de Bourbon [1750-1822] (exilée alors en Espagne), la mère du duc d’Enghien [1772-1804], a écrit à Napoléon [1769-1821] pour lui demander de revenir en France : quelle bassesse ! »
- Le 8 juillet 1808, Germaine de Staël avait, déjà, dans une lettre au prince de Ligne, évoqué cette lettre de la mère du duc d’Enghien « à l’Empereur pour lui dire que la providence le conduit et la lettre se finit par : ‘Votre très humble servante et sujette’ » 559
Pour rappel, le duc d’Enghien fut enlevé, « jugé » et fusillé par [la police de] Napoléon.
Les lettres de la mère du duc d’Enghien à Napoléon resteront sans réponse et elle ne pourra regagner la France qu’après sa chute. (Cf. Femmes. Humbles)
Mères (Duncan Isadora) : 1927. Isadora Duncan [1877-1927], dans Ma vie, auteure de :
« Comme nous payons cher la gloire d’être mères ! » 560 (Cf. Femmes. Écrivaines. Servantes, Famille. Mariage)
Mères (Eichmann Adolf) : (avril) 1961. Joseph Kessel [1898-1979], à son retour de Jérusalem du procès Eichmann [Adolf. 1906-1962], à qui l’on demandait ce qu’il avait pensé du « monstre », répondit :
« Je pense qu’il n’a pas été suffisamment aimé par sa mère. » 561
* Ajout. 14 juillet 2021. Des - extrêmes - limites d’une explication uni-causale. (Cf. Êtres Humains, Enfants. Miller Alice, Femmes. Nazisme, Hommes. Remarquables. Eichmann Adolf)
Mères (Emmanuelle. Sœur) : 2008. Concernant les « chiffonnières » des bidonvilles du Caire, avec lesquelles Sœur Emmanuelle [1908-2008] a vécu et pour lesquelles elle a mis en œuvre de nombreuses actions, celle-ci écrivit :
« À mes yeux de Française, mes sœurs chiffonnières sont de misérables esclaves.
J’essaie de toutes mes forces de hâter leur libération.
Il me paraît essentiel qu’elles ne soient pas enceintes tous les dix ou douze mois.
Ces grossesses répétées les vieillissent en effet prématurément.
À quarante ans ce sont de vieilles grands-mères.
Cependant j’ai dû reconnaître au fil des jours que la plupart sont loin d’être malheureuses.
Elles rayonnent même d’une plus grande joie que leurs sœurs d’Europe ou d’Outre-Atlantique.
La maternité ininterrompue coule comme une source de nature qui les épanouit au plus secret de l’être.
Elles sont comblées par cela qui représente à leurs yeux le sens de la vie.
Heureusement qu’elles ont cela, car elles n’ont rien d’autre. […]
La racine de leur bien-être se cacherait-elle au creux de leurs entrailles ?
Chercherais-je alors à tarir leur principale cause de joie ?
Attention, il y a la mère, mais il y a l’enfant. Ils sont, eux, les victimes des familles trop nombreuses. […] » 562
Terrifiant de penser qu’elle fut encensée pendant des dizaines d’années ; et sans doute, l’est-elle encore. (Cf. Corps, Enfants, Femmes. Enceintes, Famille, Patriarcat, Politique. Esclavage)
Mères (Ferrante Elena) : 2012. Elena Ferrante, dans Le nouveau nom, évoque les femmes Napolitaines de son quartier pauvre dans la première moitié du XXème siècle :
« […] Ce jour-là, en revanche, je vis très clairement les mères de famille de mon quartier.
Elles étaient nerveuses et résignées. Elle se taisaient, lèvres serrées et dos courbé, ou bien hurlaient de terribles insultes à leurs enfants qui les tourmentaient. Très maigres, joues creuses et yeux cernés, ou au contraire dotées de larges fessiers, de chevilles enflées et de lourdes poitrines, elles traînaient sacs à commission et enfants en bas âge, qui s’accrochaient à leurs jupes et voulaient être portés.
Et, mon Dieu, elles avaient dix, au maximum vingt ans de plus que moi.
Toutefois, elles semblaient avoir perdu les traits féminins auxquels, nous les jeunes filles, nous tenions tant, et que nous mettions en valeur avec vêtements et maquillages.
Elles avaient été dévorées par les corps de leurs maris, de leurs pères et de leurs frères, auxquels elles finissaient toujours par ressembler – c’était l’effet de la fatigue, de l’arrivée de la vieillesse ou de la maladie. Quand cette transformation commençait-elle ? Avec les tâches domestiques ? Les grossesses ? Les coups ? […] » 563 (Cf. Corps. Femmes, Femmes. « Féminin ». Maquillage, Famille. Mariage, Patriarcat, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
Mères (Fillon Penelope) : (mai) 2017. Lors de l’interview que Penelope Fillon avait accordé au Sunday Telegraph, celle-ci dit à la journaliste :
« J’ai réalisé que mes enfants ne me connaissaient que comme une mère. Je leur dis pourtant que je suis diplômée de français, que je suis juriste, que je ne suis pas stupide ! »
Quel terrible aveu - qui n’a rien à voir avec « la discrétion » qu’évoque Le Monde ! - quelle tristesse, et sans doute, quels regrets… 564 (Cf. Femmes. Épouse de, Relations entre êtres humains. Discrétion, Politique. Médias)
Mères (Gandhi Indira) : 2017. Arundhati Roy, dans Le Ministère du Bonheur Suprême, auteure de :
« En 1976, l’état d’urgence décrété par Indira Gandhi [1917-1984] avait duré vingt et un mois. Sanjay Gandhi [1946-1980], son fils cadet, enfant gâté, était alors le chef du Youth Congress [l’aile jeunesse du parti au pouvoir] et gouvernait pour ainsi dire le pays qu’il traitait comme son jouet. » 565 (Cf. Femmes. « Politiques »)
Mères (Garde des enfants) : Cf. Enfants. Garde des enfants
Mères (Giroud Françoise) : 2003. Christine Ockrent, dans Françoise Giroud. Une ambition française [1916-2003], débute le chapitre 9 intitulé La mère ainsi :
« Le plus grand malheur de Françoise s’appelle Alain. C’est son fils. Cet enfant, elle n’en voulait pas, et il le sait. Quoi qu’il fasse, quoi qu’il dise, il lui rappelle la honte, la tache indélébile d’avoir été fille-mère. » 566 (Cf. Enfants, Femmes. « Filles-mères », Violences. Violences à l’encontre les femmes)
Mères (Goldoni Carlo) : 1787. Carlo Goldoni [1707-1793], dans ses Mémoires, auteur de :
« Nous arrivâmes à Chiozza, et nous fûmes reçus comme une mère reçoit son cher fils, comme une femme reçoit son cher époux après une longue absence ; j’étais très content de revoir cette vertueuse mère qui m’était tendrement attachée ; après avoir été séduit et trompé, j’avais besoin d’être aimé. C’était une autre espèce d’amour que celui-ci, mais en attendant que je pusse goûter les délices d’une passion honnête et agréable, l’amour maternel faisait ma consolation. » 567 (Cf. Femmes. « Attachées ». Femmes. Épouse de, Hommes. « Trompés », Relations entre êtres humains. Amour)
Mères (Goncourt Edmond et Jules de) : (2 juillet) 1868. Edmond [1822-1896] et Jules [1830-1870] de Goncourt écrivent dans leur Journal :
« Les mères, sublimes aveugles ! » 568
Mères (« Gestation pour autrui ») : Cf. Corps. Gestation pour autrui. [G.PA]
Mères (Halimi Gisèle) : (12 juillet) 2021. Gisèle Halimi [1927-2020], auteure de :
« On ne peut pas condamner une femme d’avoir un enfant, si elle a décidé de ne pas en avoir. […] C’est l’acte le plus important de notre vie. […] Par conséquent, ça peut être qu’un acte de liberté. » 569 (Cf. Féminismes, Langage. Mots, Patriarcat, Politique. Liberté)
Par ordre chronologique. Mères. Victor Hugo :
Mères (Hugo Victor) (1) : (24 septembre) 1821. Victor Hugo [1802-1885], écrit à Adèle Foucher [1803-1868] qui n’est pas encore son épouse, concernant sa mère [Sophie Trébuchet. 1772-1821] décédée le 27 juin 1821 :
- « Elle m’a rendu bien malheureux parce qu’elle poussait trop loin le désir de me voir heureux. »
- Les (8 et 10 janvier) 1822, il lui écrit aussi, concernant « le consentement de [son] père » à leur futur mariage :
« […] J’espère que mon père, après avoir fait le malheur de ma mère, ne voudra pas le mien. » 570 (Cf. Êtres humains. Heureux, Famille. Couple. Mariage, Patriarcat. Pères, Penser. Consentement)
Mères (Hugo Victor) (2) : (18 décembre) 1850. Victor Hugo [1802-1885], dans Choses vues, auteur de :
« Je veux remédier à un ensemble de faits sociaux qui font fatalement du malheureux un misérable, et sous le poids desquels tant d’infortunées mères mettent au jour des filles pour le lupanar et des fils pour le bagne. » 571 (Cf. Êtres humains. Heureux, Famille, Patriarcat, Politique. État. Répression. Prison, Proxénétisme. Bordels)
-------------
Mères (Kautsky Karl) : 1927. Léon Trotsky [1879-1940] écrit, dans Ma vie, concernant Karl Kautsky [1854-1938] qu’il « vit pour la première fois en 1907 » :
« Ses adversaires l’appelaient ‘le pape de l’Internationale’. Fréquemment des amis lui donnaient le même titre, mais dans un sens affectueux. La mère de Kautsky [Minna Jaich. 1837-1912] auteur[e] de romans à tendances sociales qu’elle dédicaçait ‘à son fils et maître’, reçut, le jour où elle atteignit son soixante-dixième anniversaire, des félicitions des socialistes italiens, adressées alla Mamma del Papa. » 572 (Cf. Femmes. Écrivaines)
Mères (Kazan Elia) : 1985. Elia Kazan [1909-2003], auteur de :
« […] Si j’ai une si grande dette à l’égard de ma mère, c’est qu’elle a tout fait pour que je sois meilleur que la société d’où j’étais issu. C’est elle aussi qui m’a donné des livres et m’a fait lire. […]
Ma mère venant d’une famille plus instruite [que celle de son mari] a tenté de faire de moi le genre de personne que n’était pas son mari. » 573 Combien… (Cf. Culture. Livres. Kazan Elia)
Mères (Khalo Frida) : Frida Khalo [1907-1957], dans une lettre à Diego Rivera [1886-1957], après un avortement :
« Diego, je n’ai pas été capable de faire un trésor de ta graine.
Cette épave de femme n’a même pas été capable de te donner un fils. » 574 (Cf. Corps. Sperme, Femmes. Artistes. « Épave humaine », Famille. Couple)
Mères (Klein Mélanie) : (22 mai) 2023. Élisabeth Roudinesco, sur France Culture, concernant Mélanie Klein [1882-1960], auteure de :
« C’est une mère épouvantable » (Cf. « Sciences » sociales. Psychanalyse)
Mères (Lacordaire Jean-Baptiste Henri) : Jean-Baptiste Henri Lacordaire, en religion Père Henri-Dominique Lacordaire [1802-1861], auteur, lors de ses Conférences à Notre Dame, en chaire donc, de :
« Le jeune homme, quand il regarde le monde, peut douter de la femme.
Il ne le peut plus quand il regarde sa mère. » 575 (Cf. Famille, Patriarcat, Penser. Douter)
Mères (Léautaud Paul) : 1951. Paul Léautaud [1872-1956], dans ses Entretiens avec Robert Mallet [1915-2002] concernant sa mère qui l’avait « abandonné trois jours après sa naissance » et qu’elle est venue voir « une huitaine de fois », auteur, à 78 ans, de :
« Quand elle partait, j’étais enchanté. Quand ma bonne m’annonçait : ‘Ta maman va venir...’Ah ! Non ! Ça ne me réjouissait pas ! Et quand elle était là, je lui disais : ‘oui, madame, non, madame…’ Elle était une étrangère, pour moi, cette femme. […] » Et de : « Je n’ai souffert à aucun moment (de ce ‘manque’). » 576
Du même (relevé par Robert Mallet) :
« Je n’ai jamais eu de chance avec les femmes. J’étais à peine né que ma mère me plantait là. » (Cf. Femmes. Bonnes-à-tout-faire, Hommes. Remarquables. Léautaud Paul, Patriarcat. Pères. Léautaud Paul)
Mères (Lefebvre Catherine) : 1992. Lu dans un Dictionnaire des femmes célèbres concernant Catherine Lefebvre [duchesse de Dantzig. 1760-1830] :
« Elle eut quatorze enfants dont pas un ne survécut ». 577 (Cf. Enfants)
Mères (Le Goff Jacques) : 1992. Jacques Le Goff [1924-2014], historien, auteur de :
« […] J’aimais passionnément ma mère, mais je m’aperçus plus tard que je n’avais jamais opéré de transfert affectif entre la mère du Christ et ma propre mère. » 578
Un vague souvenir de famille me laisse penser qu’il ne fut pas le seul à vivre ce transfert, ouvrant la voie à de probables projections.
Mères (Le Pen Marine) : Marine Le Pen, présidente du Front national, lors du divorce de ses parents et des échanges publics qui s’en suivirent, dit, concernant sa mère, Pierrette Lalanne :
« Une mère, ça fait partie d’un jardin secret, pas d’une décharge publique. » 579 (Cf. Femmes. « Politiques », Famille. Divorce, Politique. Front national)
* Ajout. 26 mars 2017. Je lis, quelques jours après, des Bonnes feuilles issues du livre intitulé : Les politiques ont aussi une mère 580 présentant une analyse, resituée dans leur histoire, de leurs relations. J’en cite la réconciliation, telle que présentée - et publiée - par sa mère :
« Donc, nous n’arrivions pas à reprendre pied. Ni l’une ni l’autre. Jusqu’au jour où elle a décidé que ça avait trop duré. Au détour d’une conversation, elle s’est approchée et m’a dit, comme une chose qu’on avait oubliée et qui vient de vous revenir : ‘Écoute, mamoune, on va oublier tout ça, je t’aime comme avant‘. C’est tout. Deux secondes et c’était fini. Le malaise avait disparu pour toujours. » 581
Mères (Lessing Doris) : 1952. Doris Lessing [1919-2013], dans Les enfants de la violence, auteure de :
« […] Elle se sentait irrémédiablement ratée ; elle n’était bonne à rien, pas même à cette fonction simple et naturelle que toute femelle devrait accomplir comme elle respire : être mère. » 582 (Cf. Femmes. « Femelles »)
Mères (Levasseur Thérèse) : Thérèse Levasseur [1721-1801], épouse de Jean-Jacques Rousseau (mariage civil le 11 septembre 1768 à Bourgoin) ; ils vécurent ensemble pendant 22 ans et demi.
De tous ceux et celles qui ont débattu de l’abandon par Jean-Jacques Rousseau [1712-1778] de ses cinq enfants aux enfants-trouvés, la seule qui n’eut jamais la parole, ou plus exactement dont l’histoire n’a pas retenu ni ses sentiments, ni ses propres dires, fut leur mère…
* Ajout. 1er mai 2024. Ce que j’ai écrit n’est pas juste. Voici ce que Jean-Jacques Rousseau [1712-1778] écrit la concernant :
« Le seul [scrupule] que j’eus à vaincre fut celui de Thérèse à qui j’eu toutes les peines du monde de faire adopter cet unique moyen de sauver son honneur [celui d’être enceinte]. »
Et concernant leur deuxième enfant né, Rousseau écrit :
« Pas plus de réflexion de ma part, pas plus d’approbation de celle de la mère ; elle obéit en gémissant. » 583 (Cf. Enfants, Femmes. Épouse de. Remarquables. Levasseur Thérèse, Patriarcat. Pères. Rousseau Jean-Jacques)
Mères (Marie-Antoinette) : 1822. Les Mémoires de Madame Campan [première femme de chambre de la reine Marie-Antoinette. 1752-1822] nous transmettent les pensées - véridiques, vraisemblables ?) Marie Antoinette [1755-16 octobre 1793], à la naissance de son premier enfant, une fille :
« On présenta la jeune princesse à la reine. Elle le pressa sur son cœur vraiment maternel : ‘Pauvre petite, lui dit-elle, vous n’étiez pas désirée mais vous ne m’en serez pas moins chère. Un fils eût plus particulièrement appartenu à l’État. Vous serez à moi ; vous aurez tous mes soins ; vous partagerez mon bonheur et vous adoucirez mes peines’. » 584 (Cf. Patriarcat)
Mères. Marivaux :
Mères (Marivaux) (1) : 1727. Marivaux [1688-1763], dans La vie de Marianne, auteur de :
« […] Vous avez raison, mademoiselle, reprit ma mère ; il ne serait pas excusable, et je l’avertirai. Ce n’est que dans la conjoncture présente que je ne fusse la première à souhaiter une alliance comme la vôtre, elle nous honorerait beaucoup assurément ; mais mon fils ne la mérite pas, son caractère m’épouvanterait ; et quand il serait assez heureux pour vous plaire, en vérité, j’aurais peur, en vous le donnant de vous faire un très mauvais présent. » 585
Mères (Marivaux) (2) : 1727. Marivaux [1688-1763], dans La vie de Marianne, auteur de :
« C’était de ces mères de famille qui n’ont de plaisir et d’occupation que leurs devoirs, qui les respectent, qui mettent leur propre dignité à les remplir, qui en aiment la fatigue et l’austérité, et qui, dans leur maison, ne se délassent d’un soin que par un autre. » 586
Mères (Marivaux) (3) : 1727. Marivaux [1688-1763], dans La vie de Marianne, auteur de :
« Mais cette mère, toute ingrate qu’elle était, avait un ascendant prodigieux sur lui ; il n’osait lui parler avec autant de force qu’il aurait dû ; il n’en avait pas le courage. Pour le faire taire, elle n’avait qu’à lui dire : ‘Vous me chagrinez’ ; et c’en était fait, il n’allait pas plus loin. » 587 (Cf. Hommes)
-------------
Mères (Mountbatten Edwina) : 2005. Bertrand Meyer-Stabley, dans Edwina Mountbatten [1901-1960], auteur de :
« Edwina est une femme qui, si elle se montre fière de ses enfants et même vaguement possessive […] est avant tout une femme qui les aura négligés. Et dont le plus grand domaine d’expertise est de donner des conseils à la gouvernant et à la nurse. » 588
Mères (« Martyres ») : 1986. Extrait d’une Correspondance anonyme, signée Maman, publiée par Les Cahiers du Grif, :
« L’autre visage de l’ange est celui du martyre. Et au cours de mon adolescence, j’en suis venue à voir ma mère comme le Martyre en personne, pleine de ressentiment souterrain à cause de la ‘récompense‘ [le mariage ? la maternité ?] qui n’est jamais venue.
Comment pourrait-il y avoir une récompense pour l’abdication infinie de soi dans l’intérêt présumé de sa famille, pour l’étranglement de ses propres émotions et désirs jusqu’à ce qu’on ne sache plus ce qu’on veut, ni ce qu’on espère, ni ce qu’on aime vraiment ?
Je ne voulais pas lui ressembler : je ne voulais pas être celle qui prend toujours la plus petite tranche de gâteau, celle qui reste seule au salon chaque matin, embrassant les autres tandis qu’ils se dépêchent pour rejoindre le monde extérieur, celle qui était coincée dans la soumission aux humeurs imprévisibles - et à la retraite léthargique de plus en plus fréquente - d’un homme profondément malheureux. » 589 (Cf. Relations entre êtres humains. Récompense, Patriarcat)
Par ordre chronologique. Mères. François Mauriac :
Mères (Mauriac François) (1) : 1932. François Mauriac [1885-1970], dans Le nœud de vipères, auteur de :
« […] Au fond, sans qu’elle se l’avouât, c’était la maternité, plus que le mariage, qui lui faisait envie. » 590 (Cf. Famille. Mariage)
Mères (Mauriac François) (2) : 1962. François Mauriac [1885-1970], dans Ce que je crois, auteur de :
« J’étais le dernier fils d’un mère devenue veuve très jeune, entrée dans le veuvage comme on entre en religion, très scrupuleuse, et qui se considérait comme chargée à la lettre de mon destin éternel. » Suivi de :
« Et si ma pieuse mère m’a marqué à jamais du signe chrétien, sa religion formaliste, vétilleuse, a très tôt alerté les refus de ma raison. » 591 (Cf. Enfants. Mauriac François, Femmes. Veuves)
-------------
Mères (Monde Le) : 2016. Début de la présentation par Le Monde - quasi pleine page - du livre de Fawzia Zouari, Le corps de ma mère [Joëlle Losfeld. 240p. 2016], sous le chapeau suivant :
« Les mères sont des dictateurs comme les autres », phrase suivie de : « Ou presque ». L’amalgame, pas même insinué, posé, affirmé comme relevant de l’évidence, le coup contre toutes les femmes est porté.
Le billet qui l’accompagne s’intitule : « La langue française en partage ». 592 (Cf. Corps, Langage. Langue. Française, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
Mères (Monica) : Monica [331-387], pour les chrétien-nes, sainte Monique, mère d’Augustin d’Hippone [354-430], pour les chrétien-nes, saint Augustin, à son fils :
« Mon fils, pour moi, plus rien n’a de charme dans cette vie. Que pourrais-je encore faire ici-bas ? Pourquoi y suis-je encore ? Je n’ai plus rien à attendre de ce siècle. Une seule chose me fait désirer m’attarder encore dans cette vie : te voir chrétien catholique avant ma mort. Dieu me l’a accordé avec surabondance : tu es allé jusqu’à mépriser les félicités de la terre, et je te vois devenu son serviteur. Que fais-je donc ici ? » 593
Deux semaines plus tard, à 65 ans, elle mourut. (Cf. Femmes. Remarquables. Monica, Famille. Mariage)
Par ordre chronologique. Mères. Napoléon :
Mères (Napoléon) (1) : Maria Letizia Ramolino [1750-1836], épouse de Charles Bonaparte [1746-1785], fut mariée à 14 ans, (son mari avait 18 ans), veuve à 35 ans, mère de 14 enfants, dont deux moururent à la naissance et trois en bas âge. Mère de Napoléon [1769-1821].
Mères (Napoléon) (2) : 1865-1869. Tolstoï [1828-1910], dans La guerre et la paix, concernant les agissements de Napoléon [1769-1821] ayant pénétré avec son armée dans Moscou [1812] écrit :
« Napoléon faisait tout ce qui dépendant de lui pour la bienfaisance [...]. Il donna l’ordre d’inscrire au fronton des établissements hospitaliers : ‘Maison de ma mère’, afin d’unir par cet acte sa tendre piété filiale à sa magnanimité de monarque. » 594 (Cf. Relations entre êtres humains. Bienfaisance)
* Ajout. 30 mars 2023. (octobre-décembre) 1865. Léon Tolstoï [1828-1910] écrit dans ses Carnets :
« Napoléon fait écrire à Moscou sur les établissements de bienfaisance : ‘Maison de ma mère’. Il pensait flatter ainsi les Russes : ‘Je suis bon - ma mère va s’occuper de vous’ - et comme c’est répugnant, choquant. Mêler sa famille. » 595 (Cf. Femmes. Maison)
Mères (Napoléon) (3) : 1876. Lu, concernant sa mère, cette citation de Napoléon (sans date, sans source) dans Les origines de la France contemporaine d’Hippolyte Taine [1828-1893] :
« Les pertes, les privations, les fatigues, dit Napoléon, elle supportait tout, bravait tout ; c’était une tête d’homme sur un corps de femme. » 596 (Cf. Corps, Patriarcat. Pères. Napoléon)
-------------
Mères (Oldenbourg Zoe) : 1988. Zoe Oldenbourg [1916-2002], auteure de :
« Que l’on ne croit pas qu’une femme, fût-elle la meilleure des mères, peut se consoler de son échec personnel en se réjouissant des succès de ses enfants. [Mais un enfant qui réussit, c’est tout de même mieux que rien.] » 597
Mères (Péguy Charles) : 1974. Je lis dans le « témoignage » de Robert Debré [1882-1978], L’honneur de vivre ce témoignage / souvenir, concernant Cécile Quéré [1846-1933] la mère de Charles Péguy [1873-1914] :
« Madame Péguy était une paysanne qui était habillée avec un caraco, un petit bonnet frisé sur la tête, un tablier à carreaux noirs et blancs ; mais rien ne l’intimidait : qu’elle soit dans le grand monde ou qu’elle soit dans le petit monde, madame Péguy était à son aise partout. C’était même extraordinaire qu’une femme de cette époque-là eût un aisance aussi parfaite’. Telle était, vue par Thérèse Bonnard [cuisinière de madame Péguy ?], la rempailleuse de chaise orléanaise qui, veuve de bonne heure, avait élevé et formé son enfant. » 598
De Charles Péguy lui-même :
« J’ai vu toute mon enfance rempailler les chaises exactement du même esprit et du même cœur et de la même main, que ce même peuple avait taillé ses cathédrales. » 599 (Cf. Femmes. Épouse de, Politique. Démocratie. Peuple)
Mères (Rilke Rainer Maria) : (15 avril) 1904. Lou Andréas Salomé [1861-1937] publie dans Ma vie, un extrait d’une lettre qui lui fut adressée par Rainer Maria Rilke [1875-1926] concernant sa propre mère :
« Ma mère est venue à Rome et est encore ici. Je ne la vois que rarement, mais - tu le sais - chaque rencontre avec elle est une sorte de rechute. Quand il me faut voir cette femme égarée, irréelle, qui n’est rattachée à rien et ne peut vieillir, je sens combien j’ai souhaité dès mon enfance m’éloigner d’elle, et je crains au fond de moi de ne pas être encore assez loin d’elle après ces années d’allées et venues, d’avoir encore quelque part en moi des mouvements qui sont l’autre moitié de ses gestes rabougris, des bribes des souvenirs brisés qu’elle promène partout avec elle ; alors sa pitié distraite me fait horreur, sa foi têtue, toutes ces caricatures et ces déformations auxquelles elle s’est accrochée, vide d’elle-même comme un vêtement, fantomatique et effrayante. Et dire que je suis son enfant ; et que dans ce mur délavé qui ne fait partie de rien, une porte dérobée, à peine visible, a permis mon entrée dans ce monde ! - (à supposer que cette entrée puisse vraiment ouvrir sur le monde…) » Et Lou Andréas Salomé poursuit :
«[…] Après que nous nous fûmes trouvés un jour réunis tous trois à Paris, quelques années plus tard, il faut vraiment stupéfait (revérifier le texte) que sa mère ne me fasse pas horreur d’emblée et qu’elle m’ait seulement parue extrêmement sentimentale. Sa répulsion tournait au désespoir car il ne pouvait s’empêcher de voir dans sa mère un reflet ridiculement déformé de lui-même. […] » 600 (Cf. Corps. Vagins, Êtres humains, Femmes, Relations entre êtres humains. Pitié. Haine des hommes à l’encontre des femmes)
Mères (Rocancourt Christophe) : 2003. « Quelqu’un s’est chargé de lui expliquer que sa mère se prostituait » écrit, en parlant de lui-même, Christophe Rocancourt, « orphelin, playboy, taulard » :
« Ma mère… Une prostituée… Mon cauchemar. Le jour où on me l’a révélé, on ne m’a pas seulement humilié, on m’a privé de l’indispensable naïveté de l’enfance et du droit de croire en l’honnêteté, en la pureté. […] J’ai eu la conviction qu’il ne me serait plus possible d’accorder ma confiance. Ce jour-là, on m’a violé, au sens plein du terme. »
Christophe Rocancourt rapporte aussi les propos du directeur d’un orphelinat « qui a [selon lui] le mieux résumé la situation. Il l’a fait sans précaution de langage, mais la réalité est celle-là. Il a dit : ‘Pour nos garçons, toutes les femmes sont des putes, sauf leur mère. Alors imaginez ce qu’il peut y avoir dans la tête d’un enfant dont la mère se prostitue’. […] » 601 (Cf. Êtres Humains. Naïveté, Enfants, Penser. Expliquer, Proxénétisme, Violences)
Mères (Roosevelt Eleanor) : 2014. Lu dans un livre consacré à Eleanor Roosevelt [1884-1962] :
« ’Mes enfants seraient plus heureux sans moi’ confia un jour Eleanor à Joseph Lash [Joseph Lash, A world of love. p.387]. Contrairement à Franklin, père complaisant et ludique, guère empressé à leur inculquer la discipline, Eleanor s’est toujours reprochée d’avoir été trop peu tendre, trop sévère avec ses enfants, élevés par des gouvernantes depuis leur plus jeune âge. Trop lointaine aussi à partir du moment où elle est entrée en politique. Avec le temps, devenue une grand-mère très attentive qui emmène ses petits enfants en Europe, elle a compris combien il avait pu être difficile pour des adolescents d’avoir des parents plus préoccupés du monde que de leur destinée. Ainsi, les divergences, les incompréhensions et même les conflits n’ont pas manqué. Eleanor s’est souvent sentie responsable des échecs de leur vie privée. » 602 (Cf. Êtres humains. Heureux. Vies. Vies-dites-privées, Femmes. Grands-mères. Épouse de. Remarquables. Roosevelt Eleanor)
Mères (Rougeot André) : 2008. André Rougeot, journaliste au Canard enchaîné, raconte :
« Ma famille était communiste. Chez moi on avait fait de la Résistance dans la SNCF, et le jour de la mort de Staline, j’ai pleuré avec mon père, en lisant L’Huma.
Ma mère nous a ramené sur terre en disant : ‘Regardez-moi ces deux imbéciles’. » 603 (Cf. Femmes. « Politiques ». Piat Yann, Famille, Politique)
Pa ordre chronologique. Mères. Jean-Jacques Rousseau :
Mères (Rousseau Jean-Jacques) (1) : 1765. Jean-Jacques Rousseau [1712-1778], dans les Ébauches des Confessions, auteur de :
« Je coûtai la vie à la meilleure des mères [Bernard Suzanne. 1673-1712]. Ma naissance fut ma première infortune. » Transformé dans Les confessions par :
« Je coûtais la vie à ma mère, et ma naissance fut le premier de mes malheurs. » (Livre 1) 604
Mères (Rousseau Jean-Jacques) (2) : 1782. Jean-Jacques Rousseau [1712-1778], dans Les Confessions, concernant la mère de Thérèse Levasseur, auteur de :
« Une mère est toujours bien forte sur une fille d’un bon naturel. » 605
Mères (Rousseau Jean-Jacques) (3) : Lu dans les Mémoires de Jean-François Marmontel [1723-1799] :
« Ma femme avait du faible pour Rousseau [Jean-Jacques. 1712-1778] : elle lui savait un gré infini d’avoir persuadé aux femmes de nourrir leurs enfants et d’avoir pris soin de rendre heureux ce premier âge de la vie. ‘Il faut, disait-elle, pardonner quelque chose à celui qui nous a appris à être mères’. » 606 (Cf. Êtres Humains. Heureux, Femmes. Mères. Levasseur Thérèse, Relations entre êtres humains. Pardon)
-------------
Mères (Roussel Nelly) : 1903. (mars) 1917. Nelly Roussel [1878-1922], auteure de :
- en 1903 : « La maternité n’est noble que consciente ; elle n’est douce que désirée. Accomplie par instinct ou subie par nécessité, elle n’est qu’une fonction animale ou une épreuve douloureuse. »
- en (mars) 1917 (In : Le Néo-Malthusien) : « Il faut nous lever toutes pour le proclamer, ô mes sœurs […]
Il faut proclamer que si l’on veut des enfants, c’est à nous qu’on doit s’adresser désormais ; et que nous n’en ferons, en nombre raisonnable, bien entendu, qu’à certaines conditions. À la condition d’abord que nous ayons la certitude de ne plus travailler pour l’engraissement des champs de bataille, à la condition qu’on nous donne des garanties sérieuses de paix - ou, mieux encore qu’on nous laisse nous-mêmes assurer la paix, par une participation directe aux affaires publiques. À la condition, ensuite, que soit reconnu notre ‘droit de mères’, droit naturel basé sur nos devoirs et sur nos peines, et que trop longtemps a primé le droit artificiel et injustifiable du père. À la condition aussi que la maternité ne soit plus pour nous une cause d’esclavage, d’humiliation et de misère, mais devienne au contraire - par son assimilation à une fonction sociale, la plus honorée et la mieux rétribuée de toutes - une source de bien être, d’indépendance et de sécurité.
Oui, mesdames ! Posons nos conditions. Et si elles ne sont point acceptées, faisons ce que font tous les travailleurs conscients et dignes, lorsqu’on les exploite, les maltraite et le bafoue : faisons la grève ! » 607 (Cf. Êtres humains, Corps, Droit. « Naturel », Femmes. Animalisation des femmes. « Politiques », Patriarcat. Pères, Politique. Esclavage. Guerre)
Mères (Sackville-West Lady) : Lady Sackville-West [1862-1936], mère de Victoria Sackville-West [1882-1962] inscrivit au dos d’une photo de Virginia Wolf [1882-1941] dont sa fille fut l’amante :
« Le terrible visage d’une femme dont le vœu insensé, qui malheureusement a abouti, est de séparer les gens qui s’aiment. Je hais cette femme qui a transformé ma Vita [Victoria] et l’a éloignée de moi. » 608
Mères (Sacrifiées) : (novembre) 1966. Lu dans L’Écho de notre temps [mensuel de l’Action catholique générale féminine] dans un reportage mené dans la banlieue de News Orleans, dans une famille ‘noire’ composée des parents et de neuf enfants :
« […] Alors, j’ai regardé Mme Kennedy. Ses yeux, immobiles, fixaient son fils (sic). Elle avait les mâchoires un peu serrées, contractées. Son regard s’était fait plus aigu, plus volontaire. Ces enfants, pour elle, c’était sa revanche, une revanche gagnée. C’est en eux qu’elle était fière d’elle-même, fière d’être noire, de s’être sacrifiée. Ils la payaient de toute sa résignation douloureuse. » 609 (Cf. Enfants, Femmes. Fières. Revanche. Résignées, Politique. Racisme)
Par ordre chronologique. Femmes. Mères. George Sand :
Mères (Sand George) (1) : (18-26 juillet) 1847. George Sand [1804-1876], auteure, notamment de :
« […] Ce qui m’a fait vouloir et accomplir cette immolation anticipée à ma vie de femme, c’est l’amour maternel. […] »
Pour comprendre partiellement ce qu’elle entendait par ce constat, mais aussi afin de savoir comment ne pas élever une fille, lire la longue lettre de George Sand à Emmanuel Arago le 26 juillet 1847, véritable scalpel acéré dans sa ‘vie de famille’…
- La réponse que lui a faite Arago ne manque ni de justesse, ni de courage :
« Tu manquerais à tes devoirs si tu te laissais être mère quand tu dois être juge. » 610 (Cf. Droit. Droits / Devoirs, Hommes, Famille. Sand George, Patriarcat. Pères, Penser. Juger)
Mères (Sand George) (2) : (30 octobre) 1858. George Sand [1804-1876], dans une lettre à Émile Aucante [1822-1908], auteure de :
« Mon pire ennemi en ce monde est ma fille. » 611 (Cf. Famille. Sand George)
N.B. Je vois citer les références du livre de M. Samuel Rocheblave, Georges Sand et sa fille. Calmann-Lévy. (Lisible sur Gallica)
Mères (Sand George) (3) : (21 juin) 1861. George Sand [1804-1876], dans une lettre à Maurice Dudevant-Sand [1823-1889], auteure de :
« […] Aie soin de l’enfant de ta mère […] » 612
Mères (Sand George) (4) : (20 octobre) 1864. George Sand [1804-1876], dans une lettre à Ludre Gabillaud [1812-1903], concernant son fils, auteure de :
« Il est temps pour lui de se charger de sa propre existence, et le devoir de sa femme est d’avoir de la tête et de me remplacer. » 613
Mères (Sand George) (5) : (7 avril) 1869. George Sand [1804-1876], dans une lettre à Sophie Dreyfus (qui vient de perdre sa fille) [?-?], auteure de :
« La mère de famille est vraiment sainte. Elle vit et marche avec des poignards plantés au cœur. » 614 (Cf. Famille. Sand George)
Mères (Sand George) (6) : (9 juillet) 1871. George Sand [1804-1876], dans une lettre à Charles Edmond [1822-1899], auteure de :
« Cher ami, nous ne demanderions qu’à vous complaire, Maurice [1823-1889] et moi ne faisons qu’un et ce n’est pas de lui que viendrait l’obstacle. » 615
-------------
Mères (Sarraute Nathalie) : 1983. Dans Enfance, le livre très largement autobiographique de Nathalie Sarraute [1900-1999], je lis que « la bonne » de sa nouvelle « petite sœur », la regarde « d’un air de grande pitié » et lui dit :
« Quel malheur quand même de ne pas avoir de mère. »
- La concernant, elle écrira plus tard :
« Je n’avais sur terre qu’une seule mère, et elle n’était pas encore morte. » 616
(Cf. Êtres humains. Soi, Relations entre êtres humains. Pitié, Femmes. Écrivaines. Bonnes-à-tout-faire)
Mère (Schumann Clara) : Clara Schumann [1819-1896] a eu, en treize ans de mariage, huit enfants et a eu à vivre deux fausses couches.
Mères (Servan-Schreiber Denise) : 2003. Lu dans le livre de Christine Ockrent intitulé Françoise Giroud. Une ambition française :
« La créature (sic) qui, au journal [L’Express], en impose le plus, c’est Denise [Servan-Schreiber 1900-1987] la mère de Jean-Jacques [Servan-Schreiber. 1924-2006]. ‘Personne ne pouvait ignorer l’amour-fou, exclusif que se portaient ces deux êtres, raconte Danièle Heymann [1933-2019]. Denise appelait son fils ainé son ‘édition de luxe’ ; ses autres enfants n’étaient que des livres de poche ! » 617 (Cf. Culture. Livres, Enfants, Femmes. « Créatures »)
Mères (Sévigné Madame de) : (21 octobre) 1671. Madame de Sévigné [1626-1696], écrit à sa fille, madame de Grignan [1646-1705] :
« Mon Dieu, ma bonne, que votre ventre me pèse, et que vous n’êtes pas seule qu’il fait étouffer » 618 et, le 29 décembre 1688 :
« La bise [le mistral] de Grignan, qui vous fait avaler la poudre de tous les bâtiments de vos prélats, me fait mal à votre poitrine. » 619 (Cf. Êtres humains. Soi, Corps, Enfants. Sévigné Madame de, Famille)
Par ordre chronologique. Mères. Germaine de Staël :
Mères (Staël Germaine de) (1) : 1795. Germaine de Staël [1766-1817], dans Histoire de Pauline, auteure de :
« […] Dès l’instant que Pauline s’aperçut de sa grossesse, ses incertitudes cessèrent, sa résolution fut prise, elle vit son époux dans l’impossibilité de l’abandonner ; elle sentit le besoin de l’attacher chaque jour davantage à la mère par l’enfant, et à l’enfant par la mère, et calmée par l’idée d’un devoir, elle fut moins tourmentée par son secret. » 620
Mères (Staël Germaine de) (2) : 1980. Lu, concernant Germaine de Staël [1766-1817] :
« Il est certain que Germaine [de Staël] cherchait un gendre qui puisse à la fois faire le bonheur de sa fille, consolider sa propre situation sociale, partager ses idées et prolonger son action politique. » 621
Elle le trouva (ainsi que l’argent ‘nécessaire’ au mariage et dont il était dépourvu) en la personne de Victor de Broglie [1785-1870].
Et le futur mari convint à sa fille Albertine [1797-1838]. (Cf. Êtres humains, Enfants, Famille)
-------------
Mères (Simenon Georges) : 1974. Georges Simenon [1903-1989], dans sa Lettre à ma mère, Henriette Brüll [1880-1970] (écrite trois ans après sa mort), auteur de :
« [...] Je me souviens qu’un jour tu m’as regardé longuement, avec une attention soutenue et tu as prononcé cette phrase que je n’ai pas pu oublier : ‘Comme c’est dommage, Georges, que c’est Christian (son frère cadet, mort à 41 ans) qui soit mort.’ Cela ne voulait-il pas dire que dans ton esprit, selon ton cœur, c’est moi qui aurais dû partir le premier ? Tu as d’ailleurs ajouté : ‘Il était si tendre, si affectueux’. Sans doute ne l’étais-je pas, Mère, ou évitais-je de le montrer. » 622
Mères (Staline Joseph) : 1967. Lu dans Vingt lettres à un ami de Svetlana Alliluyeva [1926-2011], la fille de Staline [1878-1953] :
[Staline] « aimait et vénéra sa mère [Ekaterina Gueorguievna Gueladzé 1858-1937]. C’était, disait-il, une femme très intelligente. Il voulait désigner par-là ses qualités spirituelles et non sa culture, car elle savait à peine griffonner son propre nom.
Il nous racontait parfois comment elle le rossait, quand il était enfant, sans parler des corrections que lui infligeait son père qui aimait bien boire (mon grand-père paternel mourut au cours d’une rixe de soulards, frappé d’un coup de couteau).
Sa mère était d’un caractère sévère et décidé ce qui enthousiasmait mon père. Bientôt veuve, elle devint plus dure encore.
Elle avait eu beaucoup d’enfants, tous morts en bas âge ; seul mon père avait survécu.
Très croyante, elle rêvait de voir son fils devenir prêtre. Elle resta profondément religieuse jusqu’à ces derniers jours, et lorsque mon père alla lui rendre visite peu de temps avant sa mort, elle lui dit : ‘C‘est quand même dommage, que tu ne sois pas devenu prêtre ! ...’.
Il répétait ces paroles avec enthousiasme : le mépris de sa mère pour sa réussite immédiate, pour sa gloire sur terre, pour toutes ces vanités, le ravissait. » 623
N.B. Staline ne se rendra pas à son enterrement. (Cf. Relations entre êtres humains. Vanité, Femmes. Intelligentes. Veuves)
Mères (Tchékhov Anton) : 1897. Anton Tchékhov [1860-1904], dans Les moujiks, auteur de :
« Quant à Maria, loin de craindre la mort, elle regrettait même qu’elle tardât tant à venir et elle était heureuse quand elle perdait un enfant [« Elle avait eu 13 enfants mais il ne lui en restait que six - rien que des filles, pas un garçon et l’aînée avait huit ans. »] » 624 (Cf. Femmes. Heureuses, Hommes. Moujiks)
Mères (Thatcher Margaret) : (22 novembre) 2022. Entendu sur France Culture concernant Margaret Thatcher [1925-2013] :
« Sa fille Carole a été journaliste, a travaillé à la télévision puis a glissé vers une téléréalité plutôt trash. En 2009, hors antenne, lors d’une simple conversation elle parle du joueur de tennis Jo Wilfried Tsonga comme une ‘poupée nègre de chiffon’. Elle est licenciée par la BBC. Le fils Marc s’est éloigné de son pays, s’est fait discret. Il a été obligé de s’exiler aux États-Unis, puis en Afrique du sud, après avoir trempé dans des affaires secrètes et mystérieuses de contrats d’armement au Proche-Orient sur lequel il aurait touché des commissions illicites. En 2005, il est condamné 4 ans de prison avec sursis par la justice Sud-Africaine pour avoir participé au financement d’un coup d’état manqué par des mercenaires en Guinée équatoriale.
Les enfants de Margaret et Denis Thatcher sont aussi ceux de l’ère Thatcher. » 625 (Cf. Femmes. « Politiques »)
Par ordre chronologique. Mères. Léon Tolstoï :
Mères (Tolstoï Léon) (1) : 1877. Léon Tolstoï [1828-1910], dans Anna Karénine, évoque le comte Vronski :
« Sans qu’il s’en rendit compte, il n’avait pour [sa mère] ni respect, ni affection, véritables ; mais son éducation et son usage du monde ne lui permettait pas d’admettre qu’il pût lui témoigner d’autres sentiments que ceux d’un fils respectueux et soumis. » 626
Mères (Tolstoï Léon) (2) : (10 juin) 1908. Léon Tolstoï [1828-1910] écrit dans son Journal :
« Ce matin, je parcours le jardin et, comme toujours je me rappelle ma mère, ‘maman’, de qui je n’ai aucun souvenir mais qui est restée en moi un idéal sacré. Jamais je n’ai entendu dire d’elle rien de mal. Et en marchant dans l’allée des bouleaux, en approchant de celle des noisetiers, j’ai vu la trace dans la boue d’un pied de femme, pensé à elle, à son corps. Et la représentation de son corps n’entrait pas en moi. Tout ce qui est corporel l’aurait souillée. Qu’il était beau mon sentiment pour elle ! […] » 627 (Cf. Corps)
-------------
Mères (Tristan Flora) : Flora Tristan [1803-1844], écrivit, concernant sa mère (sans source) :
« Ma mère m’obligea à épouser un homme que je ne pouvais ni aimer, ni estimer. Comme elle n’a cessé de me montrer le plus vif chagrin, je lui ai pardonné. » 628 (Cf. Famille. Mariage, Relations entre êtres humains. Estime. Pardon)
Mères (Vernes Jules) : Jules Vernes [1828-1955] dit de sa mère Sophie Allote de la Fuÿe [1807-1881] que « sa puissance d’imagination était plus forte que les machines à vapeur les plus puissantes de l’époque. »
Ce qui fut présenté, le 17 décembre 2020, par Olivier Sauzereau - historien des sciences - simplement - comme un « compliment ». 629
Mères (Voltaire) : (18 mai) 1768. Voltaire [1694-1778], dans une lettre à Michel-Paul-Guy de Chabanon [1730-1792], rapporte cette « histoire » :
« Je ne me souviens plus quelle était la femme qui défendait sa ville contre les assiégeants qui étaient déjà sur la brèche, et qui lui montrait son fils prisonnier, prêt à périr si elle ne se rendait pas ; elle troussa bravement sa cotte [jupe] : ‘Voilà, dit-elle, qui en fera d’autres.’ » 630 (Cf. Corps. Femmes, Hommes. Grossiers. Voltaire, Patriarcat. Voltaire)
Par ordre chronologique. Mères. Émile Zola :
Mères (Zola Émile) (1) : (20 février) 1861. Émile Zola [1840-1902] écrit à son ami Jean-Baptistin Baille [1841-1918] :
« Pour te mettre au courant de tout, je n’ai que deux mots à dire : j’ai vingt ans, et je suis encore à la charge de ma mère, qui peut à peine se suffire à elle-même. » 631
Mères (Zola Émile) (2) : 1877. Émile Zola [1840-1902], dans L’assommoir, auteur de :
« Il s’agissait de maman Coupeau, qui avait alors soixante-sept ans. Les yeux de maman Coupeau étaient complètement perdus. Ses jambes non plus n’allaient pas du tout. Elle venait de renoncer à son dernier ménage par force, et menaçait de crever de faim, si on ne la secourait pas. Gervaise trouvait honteux qu’une femme de cet âge, ayant trois enfants, fût ainsi abandonnée du ciel et de la terre. » 632
-------------
VII. Femme (Noms) :
Femmes. Noms :
Femmes (Noms) (1) : Perdre son nom (à son mariage) - élément majeur définissant l’identité d’une personne - c’est perdre une partie de soi-même. 633
C’est aussi se recomposer une identité sur le sacrifice de la sienne.
* Ajout. 3 septembre 2019. En contrepoint :
« Tout Mirabeau [1749-1791] qu’il est, il partage les mêmes ambitions que les jeunes roturiers ardents à son âge : se faire un nom ! » 634
Femmes (Noms) (2) : Pour être honnête, lorsque je me suis mariée, j’avais hâte de changer de nom. Pour changer de statut ? Pour conforter l’hypothèse d’un nouveau départ ? Pour affirmer une décision ? En tant que rite de passage ? Par conservatisme ? par aliénation ? Ou, plutôt, pour tout cela à la fois.
Femmes (Noms) (3) : Il était « connu ». Il était marié. Il n’éprouva ni le besoin, ni la nécessité de divorcer. Il déclara, généreux : « Je lui laisse [le droit de conserver] mon nom. »
Femmes (Noms) (4) : Elle s’appelait Jeanne ; une demi-heure après, elle était « le coup du siècle ».
Femmes (Noms) (5) : Les hommes [publics] ont une fâcheuse tendance à ne nommer que les femmes qu’ils peuvent citer en tant que faire-valoir d’eux-mêmes.
* Ajout. 9 mai 2025…. sans avoir à s’auto-dévaluer.
Femmes (Noms) (6) : Je lis dans une note de 2021 de l’édition du livre de poche. Classique ; de La curée [1871] d’Émile Zola [1840-1902] concernant Laure d’Aurigny :
« Une femme dont on donne le nom et la prénom (qu’elle s’est généralement choisi) est à l’époque une demi-mondaine [!] actrice ou prostituée de haut rang [!] entretenu par ses amants, et non une femme de la bonne société [qui, elle, ne peut qu’avoir le nom de son mari, ou de son père]. 635
Par ordre chronologique. Femmes. Noms :
Femmes (Noms. Voltaire) (1) : (11 janvier) 1760. Voltaire [1694-1778], dans une lettre au comte d’Argental [1700-1788], écrit :
« Je ne croyais pas qu’avec de l’argent, vous eussiez besoin d’un pouvoir. Votre nom seul est pouvoir », tandis qu’il écrit, le 29 mars 1760 à Jean-Robert Tronchin [1710-1793] que « l’on s’en reportera bien à [sa] signature, car [son] nom vaut une cérémonie. » 636
Femmes (Noms. Sade) (2) : 1785. Dans Les 120 journées de Sodome, concernant une femme, nommée « La Duclos » ou « Duclos », laquelle raconte sa vie dans un bordel, Sade [1740-1814], auteur de :
« […] Telle est l’origine, Messieurs, qui me valut le nom de Duclos : il était d’usage que chaque fille adoptait le nom du premier avec qui elle avait eu affaire, et je me soumis à leur mode. » 637 (Cf. Proxénétisme. Bordels. Personnes-dites-prostituées)
Femmes (Noms. Girardin Delphine de) (3) : Delphine de Girardin [1804-1855] a écrit sous les pseudonymes suivants : Vicomte Charles Delaunay, Charles de Launay, Vicomte de Launay, Léo Lespès, Léa Sepsel. [Wikipédia]
Femmes (Noms. Genlis Madame de) (4) : 1824-1825. Je lis dans les Mémoires de Madame de Genlis [1746-1830] qu’elle « compose un petit ouvrage intitulé L’Ami des talents et des arts ». Elle poursuit :
« Le nom d’une femme n’aurait pu que diminuer le poids de mes réflexions ; je cachais mon nom. » 638 (Cf. Femmes. Écrivaines, Penser. Penseuses)
Par ordre chronologique. Femmes. Noms. Honoré de Balzac :
Femmes (Noms. Balzac Honoré de) (5) : 1833. Honoré de Balzac [1799-1850], dans Le médecin de campagne, auteur de :
« En vertu d’une coutume romaine encore en usage ici [en 1813, dans le Dauphiné] comme dans quelques autres pays de la France, et qui consiste à donner aux femmes le nom de leur mari, en y ajoutant une terminaison féminine, cette fille a été appelée la Fosseuse du nom de son père [« Le Fosseur »] ». 639 (Cf. Famille. Mariage, Langage. Féminisation du langage. Patriarcal)
Femmes (Noms. Balzac Honoré de) (6) : 1839. Honoré de Balzac [1799-1850], dans Le curé de village, présente la fille de M. Champagnac, « la Champagnac », puis, même page, épousée par M. Sauviat : « la Sauviat », puis, M. Champagnac décédé, page suivante, il nomme : « les Sauviat », puis, à nouveau, page suivante : « la Sauviat », ce qui fut suivi de : « la mère Sauviat ». 640
-------------
Femmes (Noms. Hugo Victor) (7) : 1862. Victor Hugo [1802-1885], dans Les misérables, évoque Cosette, le jour de son mariage avec Marius :
« Cosette se penchant tout contre Marius, lui caressa l’oreille de ce chuchotement angélique : - C’est donc vrai. Je m’appelle Marius. Je suis madame Toi. »
Tandis que Jean Valjean, confessant son passé à Marius, expliquant pourquoi il se refusait dorénavant à se « servir » du nom de Fauchelevent :
« Fauchelevent a eu beau me prêter son nom, je n’ai pas le droit de m’en servir ; il a pu me le donner, je n’ai pas pu le prendre » - conclut en ces termes, terribles de vérité, pour les femmes :
- « Un nom, c’est un moi. » 641 (Cf. Êtres humains. Soi, Famille. Mariage, Patriarcat)
Femmes (Noms. Agoult Marie d’) (8) : 1880. Je lis dans les Mémoires de Marie d’Agoult [1805-1876] comment celle-ci en vint à prendre le pseudonyme de Daniel Stern.
Émile de Girardin [1802-1881], directeur de La Presse, souhaitait publier ses écrits. Un jour, l’un d’entre eux lui plut, il le prend et lui dit :
« Vous n’avez pas signé me dit Monsieur de Girardin. – Mais non – Il faut signer – Je ne peux pas - Pourquoi ? - Je ne peux pas disposer d’un nom qui ne m’appartient pas à moi seule ; je ne veux pas demander d’autorisation. Si je dois être critiquée dans les journaux, je veux que personne ne soit engagé d’honneur à me défendre - C’est juste, s’écria Monsieur de Girardin. Eh bien alors prenez un pseudonyme. - Lequel ? - Essayez un nom. […] »
Et puis, elle raconte comment elle en vint à choisir celui de Daniel Stern. 642
Femmes (Noms. David-Neel Alexandra) (9) : 1904. 1919. Alexandra David-Neel [1868-1969], née sous le nom de Alexandra David, écrit à son mari [le mariage ayant eu lieu le 4 août 1904] :
- Le 11 novembre 1904 : « […] Je ne t’ai forcé à me donner aucun nom. Celui que je porte dans mes relations littéraires est un pseudonyme. Tu le sais aussi bien que moi. Mon cher ami, je quitterais mon pseudonyme si tu peux y trouver un grand plaisir.
Je crois seulement que cela peut m’être préjudiciable au moment où je commence à peine à être connue d’un petit noyau.
D’autre part, j’estime que, pour toi-même, ta position, tes relations, il est mieux que ton nom ne figure pas au bas des articles que je peux être amenée à écrire dans des journaux et même dans des revues. Tout le monde n’a pas les mêmes idées politiques et religieuses.
Il vaut mieux que je garde une personnalité absolument et très ouvertement distincte de la tienne. Que l’on sache que tu n’es pour rien dans ce que je dis ou écris et que, même, la grande masse de ceux qui t’entourent n’établissent aucun rapport entre Alexandra Myrdal [sous le nom duquel elle a publié ses premiers textes féministes], journaliste et femmes de lettres, et Philippe Néel, ingénieur des Chemins de Fer. »
- Le 12 janvier 1919 : « À propos d’articles que je vais publier, je tiens à te demander si tu préfères que je fasse suivre mon nom du tien dans ma signature. Je dois à ton amitié dévouée le séjour en Asie qui me permet d’écrire ces articles et si tu peux y trouver l’ombre d’un plaisir quelconque, il n’est que trop juste que ton nom figure au bas de ceux-ci. » 643
Femmes (Noms. Colette) (10) : (9 janvier) 1907. Paul Léautaud [1872-1956], dans son Journal littéraire note que Colette [1873-1954] va publier « la dernière Claudine », « signée de son nom ». 644
Elle en avait déjà publié six. (Cf. Culture. Livres, Femmes. Écrivaines. Colette)
Femmes (Noms. Renard Jules) (11) : (13 octobre) 1908. Jules Renard [1864-1910], dans son Journal, auteur de :
« Il dit à sa femme : ‘Je veux bien quitter cette maison, mais alors, nous divorcerons. Je ne veux pas te laisser mon nom, dont tu continuerais à te servir.’
Son nom, c’est celui d’un couturier, et c’est sa femme qui l’a fait. » 645
Par ordre chronologique. Femmes. Noms. Marcel Proust :
Femmes (Noms. Proust Marcel) (12) : 1921. Marcel Proust [1871-1922] dans Sodome et Gomorrhe, auteur de :
« […] Elle [madame de Cambremer] pensa que j’avais dit cela pour humilier non pas moi, mais elle. Était-elle rongée par le désespoir d’être née Legrandin. C’est du moins ce que prétendait les soeurs et les belles-soeurs de son mari, dames notables de province […].
[Mais] celle-ci souffraient d’autant moins d’être née Legrandin qu’elle en avait perdu le souvenir. » 646
Femmes (Noms. Proust Marcel) (13) : 1922. Marcel Proust [1871-1922] dans La prisonnière, auteur de :
« J’avais été frappé en apprenant que le nom Villeparisis étai faux, mais il est d’autres exemples de grandes dames ayant fait un mariage inégal (sic) et ayant gardé une situation prépondérante. » (Cf. Famille. Mariage)
-------------
Femmes (Noms. Personnes-dites-prostituées) (14) : 1930. Noms affectés, imposés aux femmes - dites - prostituées dans les bordels de Fort de France (Martinique) relevés dans les années trente :
« Emilienne chic, Blanche Cupamal, Génisse Cupidon, Ginette Goingoincoin, Siara Exana Rosella, Chérubin Saint Ange, Solitude Auvat, Modestine Modeste, Laurencia Soupir, Ange Batard. »
Ces appellations ne sont, pour reprendre les termes de l’auteur du livre dans lequel je les ai relevées, ni « fantaisistes », ni « prétentieuses », ni « poétiques », ni « amères » 647 : elles sont humiliantes, dégradantes, infamantes parce qu’elles leur dénient leurs propres noms et donc les dépossèdent de toute identité singulière qui leur soit propre. (Cf. Femmes. Noms. Sade. Crazy Horse, Proxénétisme. Bordels. Personnes-dites-prostituées)
Femmes (Noms. Orwell Georges) (15) : Georges Orwell [1903-1950] tente de dissuader un ami avant la naissance de sa fille d’ « d’infliger à la pauvre petite môme un nom de type celtique que personne n’est capable d’épeler. Elle deviendra psychotique en grandissant ou quelque chose de ce genre. ». Et il poursuit :
« Les gens finissent toujours par devenir leur nom en grandissant. » 648 Non.
Femmes (Noms. Goebbels Maria) (16) : Magda Goebbels [1901-1945] s’est successivement appelée [ou plutôt aurait pu s’appeler] Magda Behrend (nom de son grand-père paternel et donc celui de sa mère, celle-ci ayant été mère sans être mariée), puis Magda Friedländer (nom du mari de sa mère) puis Magda Ritschel (nom de son père ‘biologique’ qui l’avait ultérieurement « reconnue »), puis Magda Quandt (nom de son premier mari), puis Maria Goebbels (son second mari). 649
Femmes (Noms. Malher Alma) (17) : Alma Malher [1879-1964] est née sous le nom d’Alma Schindler, puis épousa Gustave Malher et après sa mort, Walter Gropius et Franz Werfel.
Et, pourquoi, en l’occurrence, ne pas évoquer le nom de celui de ses amants ? (Cf. Femmes. Amants. Veuves, Famille. Mariage)
Femmes (Noms. Malraux Clara) (18) : André Malraux [1901-1976] dira de son épouse, Clara Malraux [1897-1982], dont elle a gardé le nom :
« C’est un nom qu’elle n’a pas volé. » 650
En tout généreux égocentrisme altruisme…
Femmes (Noms. Stein Édith) (19) : Édith Stein [1891-1942], devenue carmélite en 1933, fut renommée du fait de son entrée en religion Sœur Thérèse-Bénédicte de la Croix. Tout en prenant en compte la diversité de ses interlocuteurs / trices (religieux, laïcs, personnels, intellectuels, familiaux, institutionnels, hommes et femmes), du fait des précautions à prendre par rapport aux persécutions antisémites nazis, j’ai ressenti un certain malaise à la lecture de sa signature depuis son entrée au Carmel. Je lis : (le plus fréquent) Votre sœur Thérèse-Bénédicte de la Croix. Ocd (ocd signifiant : ordre des carmes déchaux)
Mais, aussi : Votre Sœur T[hérèse] Bénédicte de la Croix ocd ; Votre Sœur Bénédicte ; Votre Sœur T[hérèse] Bénédicte ; Votre T[hérèse] B[énédicte de la C[roix] ; Votre très petite sœur T[hérèse] Bénédicte ; Votre Sœur T[hérèse] Bénédicte de la Croix ; Votre sœur Bénédicte de la Croix. Ocd ; Votre sœur T[hérèse] Bénédicte ; Votre très petite sœur B[énédicte] ; Votre très petite sœur Thérèse-Bénédicte de la Croix. Ocd ; Votre très petite sœur reconnaissante T[hérèse] B[énédicte de la] C[croix] ; Votre Édith ; Votre B[énédicte] ; Votre sœur Bénédicte ; Votre cousine sœur Thérèse-Bénédicte ; Votre tante sœur T[hérèse] Bénédicte ; Ta sœur T[hérèse] ; Ta tante sœur Bénédicte ; Ta sœur T[hérèse] B[énédicte de la] C[roix] ; Ta tante Édith ; Ta sœur T[hérèse] Bénédicte de la Croix. ocd ; Votre très petite sœur B[énédicte] ; Ton Édith, alias sœur Bénédicte ; Ta B[énédicte] ; Sœur Bénédicte ; Sœur Bénédicte de la Croix. Ocd ; Sœur Thérèse Bénédicte de la Croix ocd ; Sœur T[hérèse] Bénédicte de la Croix ocd ; Sœur T[hérèse] Bénédicte ; Sœur T[hérèse] B[énédicte] de la C[roix] ; Ind[igne] Sœur Thérèse-Bénédicte de la Croix. Ocd ; Votre B[énédicte] reconnaissante ; B[énédicte] ; Bénédicte de la Croix. Ocd ; Thérèse-Bénédicte de la Croix ; Sœur Thérèse-Bénédicte de la Croix ocd ; Sœur Thérèse-Bénédicte de la Croix ; Ind[igne] sœur Thérèse-Bénédicte de la Croix. Ocd… 651 (Cf. Femmes. Remarquables. Stein Édith)
Femmes. Noms. Louis Aragon :
Femmes (Noms. Aragon Louis) (20) : 1948. Louis Aragon [1897-1982], dans Les voyageurs de l’impériale, auteur de :
« Elle s’était mariée pour ne pas déchoir ; il est pire encore de rester vieille fille que de ne pas avoir de nom. » 652 (Cf. Femmes. « Vieilles filles »)
Femmes (Noms. Aragon Louis) (21) : 1948. Louis Aragon [1897-1982], dans Les voyageurs de l’impériale, auteur de :
« […] Que va penser le portier qui sait que vous êtes chez moi ? […] Je ne tiens pas à ce que le portier croit que nous couchons ensemble… J’ai beau être séparée de lui, je porte le nom de mon mari … » 653
-------------
Femmes (Noms. Gide Madeleine) (22) : 1948. Dans l’édition de 1948 de La Pléiade du Journal. 1889-1939 d’André Gide [1869-1951], il n’est fait, dans l’Index, aucune référence à Madeleine Gide [1867-1938]. Elle n’existe pas. (Vérifier l’évolution des publications ultérieures) (Cf. Femmes. Épouse de) Les voici :
* Ajout. juillet 2018. Je lis, à la fin de cette édition, à la date du 26 janvier 1939 :
« Avant de quitter Paris, j’ai pu achever de revoir les épreuves de mon Journal. À le relire, il me paraît que les suppressions systématiques (du moins jusqu’à mon deuil) [en d’autres termes, le décès de son épouse] de tous les passages relatifs à EM, l’ont pour ainsi dire, aveuglé. Les quelques allusions au drame secret de ma vie y deviennent incompréhensibles, par l’absence de ce qui les éclairaient ; incompréhensibles ou inadmissible, l’image de ce moi mutilé que j’y livre, qui n’offre plus, à la place ardente du cœur, qu’un trou. » 654
Le Journal, aveuglé ; lui, seul « mutilé », seul « incompris » …
Et l’édition de La Pléiade sort en l’état.
- Dans l’édition suivante de 1954 de La Pléiade du Journal. 1939-1949 [celle donc qui poursuit la précédente, mais qui ne s’y substitue pas], suivie de Souvenirs d’André Gide, madame Gide (« née Madeleine Rondeaux, alias Emmanuelle ») a été réintégrée (p.1259), mais ces pages citées ne concernent que ces dernières années.
- Dans l’édition de 1996 de La Pléiade du Journal de Gide. 1887-1925, il n’existe pas d’Index.
- Dans l’édition de 1997 de La Pléiade du Journal de Gide. 1926-1950, madame Gide (Madeleine Rondeaux, Madame André, [1867-1938] cousine et épouse de Gide) est citée dans l’Index qui concerne les deux tomes réédités. (p.1568, 1569).
Il aura fallu 49 ans pour que le nom de l’épouse d’André Gide soit, concernant son Journal, rigoureusement indexé par La Pléiade, 59 ans après sa mort.
Femmes (Noms. P.U.F) (23) : 1948. Les Presses Universitaires de France [PUF] publient une série de petits livres insérés dans une « Collection du Centenaire de la révolution de 1848. »
Sur la quatrième de couverture de celui publié par Édith Thomas, Les femmes en 1948, seule femme auteure, elle est la seule dont le nom est précédé par celui de son statut civil marital ; lui-même distinguant Madame de Mademoiselle : « Les femmes en 1848 par Melle Édith Thomas. » 655 (Cf. Femmes. Écrivaines)
Femmes (Noms. Lessing Doris) (24) : 1958. Doris Lessing [1919-2013], dans La cité promise, Les enfants de la violence (3), auteure de :
« […] Quant à ‘Hesse’, c’était un nom reçu comme un bracelet d’un homme qui le possédait pour le donner à une femme devant les représentants de la loi au moment de signer le contrat de mariage. » 656 (Cf. Êtres humains, Famille. Mariage, Patriarcat)
Femmes (Noms. Sarrazin Albertine) (25) : (15 février) 1959. Albertine Sarazin [1937-1967], qui vient de se marier « entre deux gendarmes », écrit à Julien, son mari :
« Ah, un détail important : Madame Sarrazin étant mon nom, que tu le veuilles ou non, il faut désormais te résigner à m’appeler ainsi. Non en raison des règlements [de la prison], puisque je suis toujours Damien pour le personnel. Mais pour le plaisir que j’en tire, et le sentiment que j’ai de l’avoir gagné. Si tu as ‘l’impression de me voler’, moi j’ai celle de ne pas l’avoir volé. […] » 657
Femmes (Noms. Béchet Louise) (26) : 1981. Lu dans le Tome XII de la publication par La Pléiade de La comédie humaine d’Honoré de Balzac [1799-1850] à l’Index des personnes réelles citées dans son [immense] œuvre :
« Béchet (Louise-Marie-Julienne Béchet, devenue la femme de Pierre-Adam Charlot qui prit le nom de Pierre Béchet, et dite Mme), puis Mme Jacquillat [1880-1880], libraire-éditeur quai des Augustins, 59. » 658
N.B. Elle est présentée par Wikipédia comme étant « une femme d’affaires, une femme de lettres et éditrice française. »
Femmes (Noms. Roudy Yvette) (27) : 1983. Je lis dans le Guide des droits des femmes publié par le Ministère des droits de la femme, (p.81) préfacé par Yvette Roudy :
- Question : Pouvez-vous garder votre nom après votre mariage ?
- Réponse : « Absolument, lors du mariage vous ne perdez pas votre nom. Ce n’est qu’un usage qui veut que la femme prenne le nom de son mari. De toutes façons, votre seul nom légal, c’est celui de votre naissance. » [… qui est celui de votre père…] (Cf. Langage. Verbe. Perdre, Prendre)
* Ajout. 11 novembre 2022. Et je lis page suivante :
- Question : Nom de l’enfant. Quel nom porte votre enfant ?
- Réponse : « Si vous êtes mariée, il porte le nom de votre mari. Si vous n’êtes pas mariée, votre enfant porte le nom de celui qui le reconnait en premier (sic). Si vous le reconnaissez ensemble, votre enfant porte le nom de son père. » (Cf. Dialogues, Enfants, Patriarcat. Filiation. Filliation)
Femmes (Noms. Suza Linda de) (28) : 1984. Linda de Suza, dans La valise en carton, évoquant la naissance de son fils dont le père était en prison, écrit :
« Il fallait que nous nous mettions d’accord pour lui donner un nom. Je ne voulais pas que mon fils soit déclaré ‘de père inconnu’. Au Portugal, il n’y a que les prostituées qui ne peuvent pas donner le nom du père et je ne tenais pas à passer pour l’une d’elles. » 659 (Cf. Famille, Patriarcat. Pères, Proxénétisme. Personnes-dites-prostituées)
Femmes (Noms. Fleutiaux Pierrette) (29) : (31 octobre) 1990. Roger Vrigny [1920-1997], dans l’émission Lettres ouvertes, après la publication du troisième roman de Pierrette Fleutiaux [1941-2019], Nous sommes éternels, auteur de :
« Elle s’est faite déjà un nom. » 660
À son écoute, pourrait dévaluer toute critique, dont, ici, la dimension masculiniste, méprisante, dévalorisante, paternaliste met particulièrement en valeur la bêtise du jugement. (Cf. Culture, Patriarcat)
Femmes (Noms) (30) : 1995-2001. Mo Yan, dans Beaux seins, belles fesses, auteur de :
« (ces noms) ne respectent pas les enseignements de Confucius, car le maître a dit : ‘Si l’appellation n’est pas correcte, la parole ne suit pas.’ » 661
Femmes (Noms. Mendès France Marie-Claire) (31) : 1996. Marie-Claire Mendès-France [1921-2004], dans Sarah au bout de l’enfer, consacré à la défense et à la libération de Sarah Balabagan, écrit :
« Activiste, je le suis sans doute, non sans une bonne dose de prudence car je porte un nom qui m’empêche d’agir à légère et de m’engager pour des causes douteuses. » 662
Du poids, pour une épouse qui a perdu son nom, de celui du mari… (Cf. Femmes. Épouse de, Hommes. « Politiques ». Mendès-France Pierre)
Femmes (Noms. Morawska Irena) (32) : 1997. Irena Morawska, dans Comment j’ai enlevé Emilia de Calabre à sa vilaine maîtresse, auteure de :
« Chez Regina Drzazga, on ne prononçait jamais de noms ou de prénoms. Elle n’utilisait que des sobriquets : « Sorcière », « Barbouillée », « Phtisique », « Tête de hibou », « Manche à balai. » Quant à Emilia, elle était un « balai-brosse de remplacement ». 663
Femmes (Noms. Mitterrand Danielle) (33) : 1998. Danielle Mitterrand [1924-2011] qui, du fait de son mariage, avait perdu son propre nom : Danielle Gouze, décide de créer, après que son mari ait été son élu président de la République, une fondation qu’elle veut intituler : Frances-Libertés, Fondation Danielle Mitterrand.
Raphaël Doueb, secrétaire de l’association, qu’elle considère comme son ‘conseiller’ lui répond : « Encore faut-il que le président soit d’accord pour que vous utilisiez son nom. »
François Mitterrand, après avoir laissé planer le doute, répond :
« C’est convenu, cette fondation portera notre nom [et je contribuerai personnellement à la constitution du capital]. »
Il importe par ailleurs de noter que c’est bien à François Mitterrand [1916-1996], dans une lettre qui lui fut transmise par Danielle Mitterrand, que Raphaël Doueb [?-1998], après un « incident » (fin 1989) adressa sa démission [que le Président refusa]. 664
En résumé, en se mariant, elle a perdu son nom, s’y est substitué celui de son mari, censé être le sien, mais qui ne le fut jamais en bien propre.
Il est vrai aussi que cette Fondation n’eut sans doute pas existé si elle n’avait pas épousé son mari… et prit son nom… (Cf. Femmes. Épouse de, Hommes. « Politiques ». Mitterrand François)
Femmes (Noms. Girod Marie-Louise) (34) : 2003. Dans un livre consacré à Marie-Louise Girod [1915-2014], organiste, concernant son mariage en 1960, je lis :
« Les voilà mariés, mais André Parrot [1901-1981] tient à ce qu’elle garde son nom d’organiste, elle reste donc Marie-Louise Girod : ’Quand je ne serai plus là, tu joindras mon nom au tien, comme ça je ne te quitterai jamais’. Ce qu’elle a fait. » 665 (Cf. Femmes. Épouse de)
Femmes (Noms. Crazy Horse) (35) : 2016. Crazy Horse. France. Les danseuses - dénudées - du cabaret Crazy Horse, lesquelles gagnent royalement 2000 euros par mois (mars 2016) - se voient attribuer un nom « qui leur colle à la peau » dixit la directrice générale, Andrée Dissenberg 666. Elles ont le droit d’en refuser un seul, le second leur est obligatoirement attribué. En voici un florilège, dont on notera le raffinement :
Lova Moor ; Psykko Tico ; Rosa Fumetto ; Polly Underground ; Diva Terminus ; Misse bisou ; Fifi Standby ; La magazineuse ; Loulou de Paris ; Lulla Ultimatum, Azy Nenuphar ; Loa Vahina...
Et l’on apprend sur le site du Crazy Horse que « le baptême de leur nom de scène s’effectue le soir de leur première apparition sur scène. (Cf. Corps. Peau, Femmes. Noms. Sade, Proxénétisme. Personnes-dites-prostituées)
Femmes (Noms. Le Figaro) (36) : (11 avril) 2017. Lu dans Le Figaro :
« Madame Alain Duplessis-Fourcaud, née Jeanne de Passemar de Saint André » ; « Madame Henri Potez, née Jeanine Delarue » ; « Madame Yann de Givré, née Françoise Paulange » ; « Mireille Castellani, née Coutellier » ; « Madame Bauchet, née Chantal Delalande » ; « Madame Jean Ravel, née Myriam Neyret » ; « Odile Rouyer, née Delacourt » ; « Professeur Véronique Gournay, née Toulemonde ». 667 (Cf. Femmes. Épouse de)
Femmes (Noms. Mères séparées du père) (37) : (2 février) 2017. Dans le Carnet du Monde annonçant la mort de l’avocat Thierry Lévy [1945-2017], le nom des « mères » de ses trois enfants ne sont pas cités, tandis que l’est celui de sa compagne.
Qu’en penser, sans connaître leurs vies respectives ? (Cf. Patriarcat. Pères)
Femmes (Noms. Loridan-Ivens Marceline) (38) : (20 septembre) 2018. Dans l’article du Monde consacré à la nécrologie de Marceline Loridan-Ivens [1928-2018], je lis :
« Il y a dans sa chambre, rue des Saint-Père, le portrait et le fantôme de son père, Shloïme Rozenberg, dont elle regrettait souvent d’avoir relégué le patronyme pour celui de ses maris. » 668 (Cf. Femmes. Épouse de, Patriarcat. Pères)
Femmes (Noms. Sotinel Claire) (39) : (10 août) 2019. Claire Sotinel, constate sur France Culture que :
« Dans la vie d’Augustin [Augustin d’Hippone. 354-430], on ne connait pas le nom des femmes, sauf celles qu’il élève socialement. » 669
Une riche grille d’analyse.
(Cf. Culture. Patriarcale, Féminismes, Histoire. Sotinel Claire)
Femmes (Noms. Halimi Gisèle) (40) : (22-23 septembre) 2019. Gisèle Halimi [1927-2020], dans Le Monde, se souvient, alors avocate, d’une rencontre avec Charles de Gaulle [1890-1970], le 12 mai 1959 :
« Quand il m’est apparu, il m’a semblé gigantesque. Il m’a tendu la main en me toisant. Et, de sa voix rocailleuse, il a lancé : ‘Bonjour madame’. Il a marqué un temps. ’Madame, ou mademoiselle ? ‘ Je n’ai pas aimé. Mais alors pas du tout ! Ma vie personnelle ne le regardait pas. J’ai répondu en le regardant bien droit : ‘Appelez-moi maître, monsieur le président ! Il a senti que j’étais froissée et il a accentué sa courtoisie : ‘Veuillez entrer, je vous prie, maître. Asseyez-vous je vous prie, maître. Je vous écoute, maître.’ » 670 (Cf. Relations entre êtres humains. Courtoisie)
Femmes (Noms. Sen Amartya) (41) : 2022. Amartya Sen, dans Citoyen du monde. Mémoires, auteur de :
« Il est désolant de voir que l’un des problèmes - du moins à mes yeux - auquel les femmes doivent faire face se trouvait illustrée par la vie personnelle de Dorothy. Par convenance sociale, elle a changé son nom à chaque fois qu’elle s’est mariée et ses publications les plus connues ont été signée de son second nom d’épouse [Weddeburn], même après son divorce d’avec Bill. La radicale Dorothy [Swaine] Barnard [1899-1977] a donc publié tous ses livres et ses articles sous les patronymes de ses différents maris. […] » 671 (Cf. Femmes. Épouse de)
Femmes. Prénoms :
Femmes (Prénoms) (1) : Il la citait dans son Journal par son prénom. Elle disparut des Index (des noms), et par suite, de l’histoire.
Par ordre chronologique. Femmes. Prénoms :
Femmes (Prénoms) (1) : (9 novembre) 1942. Je découvre dans le Cahier VIII de Paul Claudel, [1868-1955], ce quatrain rédigé par lui pour la naissance de sa petite fille Marie-Victoire :
Pour marie-Victoire
Ce petit poisson dodu
Appelé Marie-Victoire
Sans dents comme il a mordu
À l’hameçon de l’histoire. »
Il s’avère que mes parents qui m’avaient autrefois récité cette présentation - depuis si longtemps oubliée - m’avaient toujours dit qu’ils m’avaient prénommée ainsi, après avoir lu dans Le Figaro, l’annonce de cette naissance, et en manifestation de leurs engagements résistants.
Je lis en note de La Pléiade, que ce quatrain avait été ultérieurement publiée dans Le Figaro Littéraire le 23 mars 1946.
N.B. Marie-Victoire Nantet est la mandataire de l’œuvre de Paul Claudel, ainsi que l’auteure d’un livre intitulé Camille et Paul Claudel [Lignes de partage. Gallimard. 2021]. 672
Femmes (Prénoms) (2) : 1951. Dans les ateliers du couturier Jean Dessès [1904-1970], deux couturières étaient prénommées Germaine. Dès lors, pour les distinguer, l’une fut appelée Germaine « Flou » et la seconde : Germaine « Tailleur ». 673
Femmes (Prénoms) (3) : 1965. Pierre Citron [1919-2010], dans sa préface à La femme de trente ans [1842] d’Honoré de Balzac [1799-1850], écrit que « Balzac aimait donner aux femmes qu’il aimait un prénom qui n’était pas le leur, et dont il fut seul à se servir. » 674
Femmes (Prénoms) (4) : 1973. Raymonde Courrière, dans Génération MLF, témoignant de ses premiers engagements au MLF :
« La première partie de la réunion [sur le Nomadic, bateau amarré sur la Seine en 1973 qui « fait partie des plus belles heures de ma vie »] était animé par Sylvana et Florence. Longtemps, je n’ai connu que les prénoms : il nous fallut des années pour que notre identité ne soit plus un prénom associé à une ville, Irène de Marseille, Maryse de Tarbes, Françoise de Lille…). » 675 (Cf. Femmes. Solidarité entre femmes. Féminismes)
Femmes (Prénoms) (5) : 1995. Lu dans Jean Tulard, Guide des films. 1895-1995. LZ, concernant Sept amoureuses (Les). 1942. [Frank Borzage] :
« L’humour n’est pas oublié dans la scène finale où le pasteur se met à bafouiller car les sept filles portent des prénoms masculins (les parents ayant choisi les prénoms avant les naissances et espéraient à chaque fois avoir un garçon). » 676 (Cf. Culture. Cinéma)
Femmes (Prénoms) (6) : (21 octobre) 2012. Annie Stora, dans un texte intitulé : « Femmes juives d’Algérie : émancipation et transmission » évoque la question de la transmission par le prénom :
« À ma naissance, ma mère a imposé à son mari le prénom d’Annie qui lui semblait plus moderne que celui de sa belle-mère prénommée Julie. J’imagine que c’était, à certains égards, une façon pour elle de prendre son autonomie en choisissant le prénom de sa fille aînée ; ce qui ouvrait une brèche de modernité en opérant une coupure dans la lignée de sa belle-mère même si ce n’était qu’une forme modeste de contestation. Julie est mon second prénom. » 677
Femmes (Prénoms) (7) : 2012. Elena Ferrante, dans Le nouveau nom, écrit :
« Pendant que nous travaillons, elle se mit à me parler du moment où elle avait commencé à se rendre compte qu’elle était désormais Mme Carraci [le nom de son mari]. Au début, je ne comprenais pas grand-chose à ce qu’elle voulait vraiment dire, et ses observations me semblèrent banales. Nous, les filles, c’est bien connu, quand nous tombons amoureuses, la première chose que nous faisons, c’est voir si notre prénom sonne bien, associé au nom de l’être aimé […]. » 678
Femmes (Prénoms) (8) : (2 octobre) 2016. À l’écoute ce jour d’un débat sur France Culture : Quand on nomme un homme par son nom et son prénom, il n’est pas acceptable de nommer une femme par son prénom, fut-elle sa meilleure amie (ce qui en l’occurrence n’était pas le cas).
Femmes (Prénoms) (9) : (décembre) 2018. À la lecture dans Le Monde Diplomatique d’une critique du livre de Chantal Mouffe Pour un populisme de gauche 679 par Serge Halimi, je découvre que l’absence de prénom peut être aisément perçue comme une marque de mépris et / ou de disqualification. Pour moi, en tout cas.
Après avoir lu une référence à « Chantal Mouffe », je lis : « Mouffe postule… », « Mouffe propose… », « Mouffe imagine… » ; « Mouffe ne rêve pas… », « Mouffe adosse sa réflexion sur… » 680
Nous avons tous et toutes droit à un nom et un prénom. (Cf. Politique. « Populisme »)
* Ajout. 13 juillet 2019. Il est des familles qui décident du fait de la notoriété accordée à un ancêtre - toujours mâle ? - que leur nom de famille intégrera le nom et le prénom du dit ancêtre. Exemple : Casimir-Périer, Vallery-Radot.
Femmes (Prénoms) (10) : (10 octobre) 2024. J’entends dans l’émission consacrée à Harry Braveman [1920-1976] sur France Culture - pour la première fois ? - un homme, Juan Sebastian Carbonell - se reprenant après avoir appelé une femme, invitée avec lui, Lucie Rondeau du Noyer, par son seul prénom et expliquant discrètement cela par le fait qu’ils travaillaient souvent ensemble.
Femmes (Prénoms) (11) : (3 juin) 2025. Lu sur Wikipédia concernant Émile-Étienne Baulieu [1926-2025] :
« Vie privée Après un premier mariage avec une prénommée Yolande, Il épouse la productrice Simone Hariri Baulieu. Il est le père de trois enfants. » (Cf. Patriarcat. Pères)
-------------
VIII. Femmes (« Politiques ») :
Femmes. « Politiques » :
Femmes (« Politiques ») (1) : Et si les femmes dites « politiques », auxquelles on peut ajouter les femmes dites « de pouvoir », n’étaient que les villages Potemkine du patriarcat ?
En tout état de cause, le fait que certaines femmes, de plus en plus nombreuses, accèdent, de plus en plus, aux pouvoirs politiques, économiques… et sont, de plus en plus, utilisées comme justificatifs du patriarcat, est-il un changement de paradigme politique ?
Dans la majorité des critiques féministes de la démocratie, leur progression est peu ou prou considérée comme un progrès, une avancée… Vers ?
S’il faut reconnaître que leur nombre grandissant modifie la vision du rôle que les femmes jouent dans le monde, à s’y focaliser, le risque majeur que le féminisme soit perçu - et c’est déjà largement la situation prévalant - comme synonyme d’une caution (bourgeoise ? élitiste ? « occidentale » ?) donnée au monde actuel qui lui confèrerait un surplus de légitimité.
N.B. L'expression « villages Potemkine » désigne un trompe-l’œil à des fins de cache du réel. Selon une légende, de luxueuses façades en carton-pâte avaient été érigées à la demande du ministre russe Potemkine afin de masquer la pauvreté des villages lors de la visite de Catherine II [1729-1789] en Crimée en 1787.
Femmes (« Politiques ») (2) : 1878. Le cardinal de Bernis [1715-1794], auteur dans ses Mémoires de :
« Les femmes, qui ont toujours eu l’ambition de gouverner les États […]. » 681
Quelle que soit la signification qu’il en donne, je n’ai jamais lu une assertion aussi sujette à caution affirmée avec une telle évidence ; et ce, de la part d’un homme qui avait eu à connaître l’État dans toutes ses composantes et à en vivre tous ses aléas.
Suite : Faute de quoi, dans l’attente, des femmes se limitèrent à, se contentèrent de, s’habituèrent à tenter de « gouverner » les hommes qui avaient les rênes du pouvoir.
Et, ce que l’on a appelé « la corruption des mœurs » fut sans doute l’un des ressorts et l’une des majeures conséquences de ce processus - interdisant toute référence à toute morale - de critique de la perversion - … non de la logique… - du pouvoir politique. (La fin, pas clair) (Cf. Politique. Lois. Mœurs)
Par ordre alphabétique. Femmes. « Politiques » :
Femmes (« Politiques ». États-Unis. Addams Jane) : 1915. Jane Addams, [1860-1935], participa au Congrès international des femmes à La Haye dont le mot d’ordre était :
« Nous, femmes […] nous protestons contre la folie et les horreurs de la guerre qui mènent à un sacrifice inconsidéré de vies humaines. »
La Ligue internationale pour la paix et la liberté [WILPF] naquit de ce Congrès et obtint le prix Nobel de la paix en 1931. 682
N.B. Sur Wikipédia, elle est présentée sous l’item : « militante ».
Par ordre chronologique. Femmes. « Politiques ». Michèle Alliot-Marie :
Femmes (« Politiques ». Alliot-Marie Michèle) (1) : 2002. De Michèle Alliot-Marie, nommée ministre de la défense, Jean Marie Le Pen a déclaré :
« J'ai toujours aimé les cantinières », 683 tandis que Jacques Chirac aurait dit à Nicolas Sarkozy :
« Le ministre de la défense, c’est moi. » 684
Femmes (« Politiques ». Alliot-Marie Michèle) (2) : (12 janvier) 2011. Michèle Alliot-Marie restera sans doute dans l’histoire du fait de sa proposition à l’assemblée nationale, que « le savoir-faire, reconnu dans le monde entier, de nos forces de sécurité, permette de régler des situations sécuritaires de ce type », afin d’éteindre la révolution tunisienne commençante, ledit « savoir-faire » s’adressant aussi à l’Algérie. 685
* Ajout. 7 mars 2015. Quatre ans après : la presse évoque la livraison d’« armes françaises pour la Tunisie ». 686
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. « Politiques ». Martine Aubry :
Femmes (« Politiques ». Aubry Martine) (1) : 2008. Martine Aubry s’est adressée à Adeline Hazan, ex-présidente du Syndicat de la magistrature, maire de Reims, ville invitante, en découvrant une araignée sur son pupitre, devant les milliers de participant-es socialistes en ces termes :
« Franchement, Adeline, le ménage aurait pu être fait depuis hier ! » 687 (Cf. Hommes. « Politiques ». Fabius Laurent, Féminismes. Antiféminisme. Fabius Laurent)
Femmes (« Politiques ». Aubry Martine) (2) : 2011. Compte tenu de la gravité des prises de position de l’ensemble des responsables socialistes lorsqu’ils/elles ont été au courant des agressions sexuelles dont Dominique Strauss-Kahn est l’auteur, Martine Aubry est responsable d’un parti [poste quitté en septembre 2012] qui doit s’interdire d’invoquer la morale à l’encontre de quiconque. Que reste-t-il alors de la politique ? L’accès au pouvoir ? … pouvoir alternatif d’autant moins crédible que Martine Aubry a, notamment, pu se prononcer le 21 mai 2011 en faveur d’une candidature de Christine Lagarde (ministre de Nicolas Sarkozy) à la direction générale du Fonds Monétaire International. 688
Femmes (« Politiques ». Aubry Martine) (3) : (24 mai) 2017. Martine Aubry, après l’échec du PS aux élections présidentielles de mai 2017 et l’élection d’Emmanuel Macron, auteure de :
« J’ai 66 ans, aujourd’hui j’ai l’impression que tout ce que j’ai fait est abîmé et cassé. » 689 Courageux ? Lucide ? Mais n’est-ce pas toute une génération de politiques qui pourraient se retrouver, au moins partiellement, dans ce diagnostic, encore politiquement bien flou cependant ?
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. « Politiques ». Autain Clémentine :
Femmes (« Politiques ». Autain Clémentine) (1) : (10 juillet) 2016. Clémentine Autain, interrogée sur la difficulté de gouverner, évoqua « la difficulté de la tâche ». 690
De la « tâche » ?
Femmes (« Politiques ». Autain Clémentine) (2) : (14 juin) 2024. Clémentine Autain, auteure de :
« Bien sûr que j’accepterai d’être première ministre. »
On comprend peut-être mieux, pour qu’une telle question puisse être posée, l’avantage d’être membre d’un parti politique et l’assurance qu’il confère. (Cf. Politique. Parti politique)
-------------
Femmes (« Politiques ». Barèges Brigitte) : (18 janvier) 2019. Brigitte Barèges, maire de Montauban, lors du débat des maires, à Souillac, avec Emmanuel Macron, entre autres analyses peu respectables assimilant notamment « terrorisme » et « émigration », auteure, concernant les « Gilets jaunes », ceux qu’elle avait par ailleurs reçus, de :
« Ce sont de pauvres gens ». (Cf. Politique. « Terrorisme ». « Gilets jaunes », Économie « Gilets jaunes ». « Pauvres Les ») 691
Par ordre chronologique. Femmes. « Politique ». Delphine Batho :
Femmes (« Politiques ». Batho Delphine) (1) : (2 juillet) 2013. Delphine Batho, ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie du gouvernement Jean-Marc Ayrault, a été « relevée de ses fonctions » - traduction : licenciée - du gouvernement, pour avoir qualifié de « mauvais » le budget de son ministère, pour avoir déclaré qu’il y avait une « déception à l'égard du gouvernement » et avoir posé la question : l’écologie « est-elle bien une priorité ? » 692
- « Ni une erreur, ni une faute », déclara-t-elle plus tard justement ; une affirmation d’autorité, le choix d’un fusible, jugé alors nécessaire, au sein d’un gouvernement qui ne fut jamais écolo… 693 (Cf. Politique. Écologie, Économie. Budget)
Femmes (« Politiques ». Batho Delphine) (2) : (15 janvier) 2018. Delphine Batho, qui souhaitait se présenter au poste de premier/ère secrétaire du parti socialiste déclara :
« Je conteste de A à Z les modalités d'organisation de ce congrès de confiscation, dans ce qui n'est plus un parti mais une petite mafia politique avec ses parrains, ses lieutenants, ses exécutants. J'ai découvert qu'il y avait eu un traficotage des statuts au dernier moment pour changer les règles du jeu, dans l'objectif de reconduire la même aristocratie politique. Je ne peux pas être complice d'un congrès illégitime. » 694 Après ce constat, quatre hommes décidèrent néanmoins de rester en lice.
-------------
Femmes (« Politiques ». Algérie. Benghabrit Nouria) : 2016. Nouria Benghabrit, ministre de l’éducation nationale Algérienne, si l’on en croit, faute d’autres sources, ce qu’en dit Jeune Afrique, réhabiliterait l’idée même de Politique. 695
* Ajout. 18 mai 2017. Mais peut-on réhabiliter le politique, en cautionnant un régime militaire, dictatorial, ayant étouffé un pays, ayant justifié tous les enfermements ? Non. On ne peut que le cautionner. D’où sans doute l’article de Jeune Afrique…
* Ajout. 1er avril 2019. Lu : « Nouria Benghabrit, qui ne figure plus dans le nouveau gouvernement, remercie Bouteflika. ‘Aujourd’hui s’achève ma mission à la tête du ministère de l’Éducation nationale. Je remercie le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, pour la confiance accordée depuis le 5 mai 2014. […] L’engagement vers une école de qualité est un processus long et difficile, mais qui peut être gagné avec les efforts de tous. Je remercie l’ensemble des cadres et des enseignants du secteur. », a-t-elle écrit sur sa page Facebook. » 696
Femmes (« Politiques ». Pakistan. Bhutto Benazir) : (2 décembre) 2022. Ne pouvant privilégier tel ou telle expression particulièrement signifiante de la vie de Benazir Bhutto [1953-2007], ni en reproduire la totalité, je ne peux que renvoyer à l’émission de France Culture : Une vie, une oeuvre, Benazir Bhutto. 697
Deux souvenirs néanmoins : elle a dit avoir été violée durant son emprisonnement, après l’assassinat de son père ; l’évocation des pouvoirs - sur elle - de son mari [« monsieur 10 % »].
Femmes (« Politiques ». Bouchardeau Huguette) : 1981. La découverte du livre d’Huguette Bouchardeau, Tout le possible rappelle qu’il fut un temps où la gauche pensait gouverner tout en ayant une vision politique alternative. 698 (Cf. Politique. « Gauche La », Historiographie. Patriarcale)
Femmes (« Politiques ». Colette) : (9 mars) 1914. Colette [1873-1954], à la Chambre des députés, auteure de :
« […] La plupart des celles (les femmes) qui sont ici (dans les tribunes) n’ont pas besoin de feindre l’intérêt pour les débats parlementaires. Même si elles ne suivent pas passionnément le mari, l’amant, l’ami ou le parent jeté sous leurs yeux dans la cuve (l’hémicycle), elles obéissent à un goût sincère et tortueux pour les choses de la politique, où on les voit si vite informées, lucides, familières, prêtes d’avance à tous les mandats, à toutes les responsabilités - et à toutes les inconséquences. » 699 (Cf. Femmes. Écrivaines. Colette, Politique, Histoire)
Femmes (« Politiques ». Coutelle Catherine) : (12 juin) 2017. Catherine Coutelle, ex-députée socialiste, ancienne présidente de la Délégation de l'assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances, auteure de :
« Les députées sont des femmes et des mères avant tout. » 700 (Cf. Politique. Égalité. Égalité des chances)
Femmes (« Politiques ». Cox Jo) : 2016. Jo Cox [1974-2016], députée travailliste britannique partisane du maintien du Royaume Uni dans l’Union européenne, assassinée le 16 juin 2016.
- Sa mort rappela aux Suédois l’assassinat d’Anna Lindh [1957-2003], ministre des affaires étrangères social-démocrate, qui, elle aussi, défendait une position pro-européenne assassinée le 10 septembre 2003, à quatre jours d’un référendum sur la monnaie unique dans le pays.
Par ordre chronologique. Femmes. « Politiques ». Édith Cresson :
Femmes (« Politiques ». Cresson Édith) (1) : (15 mai) 1991. Le lendemain de la nomination d’Édith Cresson au poste de première ministre, le 15 mai 1991, le titre de Libération fut :
« Et dieu [surnom donné à F. Mitterrand] crée la femme ». (Cf. Politique. Médias)
Femmes (« Politiques ». Cresson Édith) (2) : 1993. Édith Cresson, première ministre [15 mai 1991-2 avril 1992] : une tragédie politique.
Lire le livre d’Élisabeth Schemla, Édith Cresson. La femme piégée. 701
Femmes (« Politiques ». Cresson Édith) (3) : 1993. Édith Cresson, interrogée par Élisabeth Schemla, pour la rédaction de son livre : Édith Cresson, la femme piégée, après avoir évoqué « le trouble » qui l’avait saisie après l’alliance, en 1972, de François Mitterrand [1916-1996] avec George Marchais [PCF] explique les raisons de sa « dissimulation » [de son silence] :
« Je ne pouvais pas contester un seul instant le fondement même de sa stratégie [celle de Mitterrand] sur laquelle la victoire [de la gauche] reposait. J’ai toujours été très certaine, en observant les autres qui ne lui arrivaient pas à la cheville, que lui seul sait comment agir. Pour m’en sortir, je me demandais ce que mon père, s’il était toujours vivant, en penserait. […] » 702 (Cf. Patriarcat. Pères)
Femmes (« Politiques ». Cresson Édith) (4) : 2006. Édith Cresson, auteure de :
« Les hommes politiques français sont persuadés qu’ils ont un irrésistible pouvoir de séduction - ce qui, malheureusement pour eux - est loin d’être toujours le cas et que l’élection leur donne le droit de régner sur une sorte de troupeau dont font partie les femmes, lesquelles, comme sous un tchador virtuel, pourraient accomplir certaines tâches, subalternes, cela va de soi. […]
Être femme en politique n’est pas simple. Les obscénités sur elles ne trouvent leur place que dans un système de concurrence, en vue d’éliminer l’adversaire. […]
En France, la classe politique se demandera toujours si une femme est comme ils disent ‘compétente’. Pour un homme, jamais. » 703 (Cf. Hommes. « Politiques ». Mitterrand François)
-------------
Femmes. « Politiques ». Rachida Dati :
Femmes (« Politiques ». Dati Rachida) (1) : (28 juillet) 2019. Rachida Dati, candidate aux élections municipales à Paris, s’en prend aux « barons » de la droite parisienne :
« Je me suis déclarée juste parce qu’ils sont contre moi. » 704
Réaction bravache, mais sans doute pas uniquement… (Cf. Justice. Avocat-es. Dati Rachida, Penser. Pensées. Binaires, Politique)
Femmes (« Politiques ». Dati Rachida) (2) : (16 janvier) 2024. Lu dans Le Canard enchaîné, concernant Rachida Dati, nommée ministre de la culture, ce portait d’elle, par « un socialiste qui l’a maintes fois croisée » :
« Elle arrive quelque part, balance une vanne qui fait marrer les gens, fait son cirque, joue de sa différence, minaude, copine, prends des numéros de téléphone, arrange des coups, voit les failles des uns et des autres, qu’elle saura utiliser ultérieurement, ment effrontément et repars, laissant ses interlocuteurs sous le charme. Ça fait trente ans quelle fait ça. » Puis suit : « elle n’hésita pas non plus à utiliser les menaces, la demande au fonds souverain qatari d’un « modeste virement de 400.000 euros », son « double jeu permanent sur le radicalisme », ses nombreux rapports avec « le clan Aliyev d‘Azerbaïdjan », et enfin, son contrat avec Carlos Ghosn de 900.000 euros « alors qu’elle n’est pas même encore membre du Barreau », et pour lequel elle est « mise en examen pour corruption passive » (sic). 705
En écrivant de portait, je repense à ce compliment émanant d’une féministe selon laquelle « c’est une femme politique qui n’a pas peur des hommes ».
Un peu court, bien que cela me pose un problème - non résolu - d’analyse politique féministe.
* Ajout. 4 juin 2025. Après avoir vu le Complément d’enquête [France 2. Le Nouvel Observateur] la concernant, mes deux dernières phrases / jugements sont inacceptables. Rachida Dati est une femme sans foi ni loi, faisant du mensonge sa ligne de conduite et de la corruption son mode normal de fonctionnement.
Quant au jugement politique sur le fonctionnement de notre société politique, je ne peux que constater l’évidence, à savoir que les prisons sont pleines de personnes qui ont été condamnées pour avoir X fois moins qu’elle enfreint la loi. (Cf. Droit, Justice, Politique. État. Répression. Lois)
Femmes (« Politiques ». Dati Rachida) (3) : (4 septembre) 2024. Lu sur Franceinfo : « La ministre de la Culture démissionnaire, Rachida Dati, s'en prend à Jean-Michel Blanquer et Édouard Philippe sur X. ‘L’élégance comme la reconnaissance devraient amener à plus de respect de l’institution présidentielle et de l’homme qui vous a permis d’agir et même d’exister sur le plan politique’, écrit-elle, alors que l'ancien Premier ministre a annoncé hier être candidat à la prochaine élection présidentielle et que l'ancien ministre de l'Éducation nationale règle ses comptes dans un livre très critique envers Emmanuel Macron. »
Une répartie bien envoyée…
* Ajout. 4 juin 2025. Cf. plus haut.
-------------
Femmes (« Politiques ». Duflot Cécile) : (5 juin) 2017. Cécile Duflot, députée Europe Écologie-Les Verts, ex-ministre du logement de François Hollande, auteure de :
« Je porte le flambeau féministe pour les futures générations. » 706
* Ajout. 8 août 2017. (31 mars) 2014. Cécile Duflot avait déclaré en quittant le gouvernement Ayrault :
« Je me met à la disposition de la gauche, de la France », déclaration jugée, néanmoins, ultérieurement par elle, « un peu trop grandiloquente ». 707 (Cf. Hommes. Grossiers. Sarkozy Nicolas, Féminismes, Langage. Possessif, Politique. Écologie)
Femmes (« Politiques ». Fraisse Geneviève) : 1999. Geneviève Fraisse, nommée par Lionel Jospin, six mois après qu’il ait été lui-même nommé premier ministre, Déléguée interministérielle aux droits des femmes [1997-1998], auteure de :
« De toutes façons, on m’avait mise dans un piège. Entre deux ministres. Entre Martine Aubry et le premier ministre. […] Le droit des femmes n’était pas un enjeu suffisant pour que Matignon en fasse un cheval de bataille contre Martine Aubry. »
Je lis plus loin : « J’ai passé mon année de déléguée à rappeler au gouvernement ce problème de l’égalité professionnelle. Ce fut l’objet de ma bagarre avec Martine Aubry. Elle m’avait demandé de faire des propositions, je lui avais répondu que je n’étais pas une experte. (sic) Elle m’avait répliqué, moi non plus. (sic) Bon ! Sauf qu’elle avait des moyens que je n’avais pas. »
La Délégation ne disposait d’aucune administration propre, d’aucun budget et de très peu de moyens. 708 (Cf. Femmes. « Politiques ». Aubry Martine)
Femmes (« Politiques ». Garaud Marie-France) : 2006. Marie-France Garaud [1934-2024], alors conseillère avec Pierre Juillet [1921-1999] à l’Élysée [Georges Pompidou, Président], raconte la nomination de Jacques Chirac comme ministre de l’agriculture du gouvernement Pierre Messmer [1907-2007] :
« […] Les députés venaient dans ces temps-là se plaindre à l’Élysée autant de lui que du premier ministre. Pompidou [Georges. 1911-1974] se taisait, mais n’était pas content, et, en 1972, le nom de Chirac [Jacques. 1932-2019] ne figurait pas sur la liste du gouvernement Messmer [Pierre. 1916-2007] tel qu’il était formé. On le vit alors rôder dans les couloirs, inquiet de ce silence. Juillet, qui avait pour lui toutes les indulgences, eut pitié. ‘Bon, si vous y tenez, trouvez-lui quelque chose’ lâcha le Président. Et c’est ainsi que Jacques Chirac, après avoir tordu le nez sur le portefeuille de l’industrie, devint ministre de l’agriculture. […] » 709 (Cf. Relations entre êtres humains. Indulgence. Pitié, Hommes. « Politiques ». Chirac Jacques, Politique. « Élites »)
Par ordre chronologique. Femmes. « Politiques ». Françoise Giroud :
Femmes (« Politiques ». Giroud Françoise) (1) : Françoise Giroud [1916-2003], auteure de :
- « Quoi qu’on fasse, y compris la putain, il faut le faire bien. » Et de :
- « Je me suis heurtée à des salopards, j’ai travaillé avec des caractériels, j’ai supporté des imbéciles. Mais dans l’ensemble, leur présence m’a plutôt été épargnée, aucun des représentants des dites catégories ne m’a laissé plus de trace qu’une brûlure d’ortie. En revanche, par le hasard de métiers mirobolants, j’ai été fabriquée, formée, instruite, construite par des hommes qui n’étaient pas indifférents. »
Elle évoque ensuite sa mère […], puis, elle écrit :
« Donc, j’ai été pour une large part faite par des hommes. Comme sur de la cire, ils ont laissé leur empreinte, leur trace, le plus souvent à leur insu. » 710 (Cf. Femmes. « Cire ». Journalistes. Giroud Françoise, Proxénétisme. Personnes-dites-prostituées)
Femmes (« Politiques ». Giroud Françoise) (2) : 1974. Françoise Giroud [1916-2003], dans Les Françaises face au chômage, auteure de :
- Concernant la possibilité légale de se constituer parties civiles qui auraient été rendues possibles aux associations de femmes/féministes) :
« Françoise Giroud (secrétaire d’état à la condition féminine) s’est toujours opposée à formuler cette demande, me confie M. Jean-Jacques Dupeyroux [1929-2020], professeur de droit à Paris Assas, ces associations, disait-elle, se mettraient aussitôt à attaquer les hommes…» [Reconnu depuis : Cf. article 2,2 du Code de procédure pénale)
- Concernant le chômage :
« Que les femmes sont donc contrariantes ! Le chômage menace ? Qu’elles restent donc à la maison et en un trait de plume, le nombre des demandeurs d’emploi diminuerait de moitié. Qu’elles cèdent la place aux hommes et les offres d’emplois se multiplieraient. » (F. Giroud. L’Express. 16 décembre 1974) Considéré comme de l’humour ? 711
Que pèse dès lors la question, en 1974, de la nomination d’une femme-de-gauche dans un gouvernement-de-droite, par rapport à l’adéquation de Françoise Giroud aux normes patriarcales dominantes ? Pas grand’ chose… 712 (Cf. Femmes. « Féminin ». Journalistes. Giroud Françoise. Maison, Hommes. Féminisme. Dupeyroux Jean-Jacques, Politique. « Gauche La », Économie. Chômage)
Femmes (« Politiques ». Giroud Françoise) (3) : (juin) 1975. Françoise Giroud [1916-2003], alors secrétaire d’état à la condition féminine, refusa de recevoir les femmes prostituées, lors de leur révolte et de l’occupation de l’église Saint-Nizier, à Lyon. Sa réaction :
« Je trouve que les prostituées doivent être considérées comme tout être humain et qu’il n’y a aucune raison d’exprimer à leur égard d’autre (s ?) sentiments (s ?). Cela dit, les prostituées s’insurgent contre la répression et la répression, comme je l’ai déjà dit, est du ressort du ministre de l’intérieur. »
Question : « Si les prostituées se sont adressées à vous, ce n’est pas un hasard. »
Réponse : « Quand je leur ai dit que je ne pouvais rien faire pour elles, et que cela ne me concernait pas, elles se sont adressées ailleurs. » 713 (Cf. Femmes. « Féminin ». Journalistes. Giroud Françoise, Proxénétisme. Personnes-dites-prostituées, Histoire)
-------------
Femmes (« Politiques ». Guigou Élisabeth) : 1997. Élisabeth Guigou, ancienne ministre, concernant les femmes politiques (ou : en Politique) auteure de :
« […] Leur langage, concret, vient du cœur, ce qui ne les empêche pas de théoriser, d’être capables de vues plus abstraites ou plus idéologiques. » 714
Essentialiste, maternalisme, régressif, méprisant, absurde. Sans doute, renierait-elle aujourd’hui cette ‘analyse’, mais dans l’attente, elle reste cautionnée.
Femmes (« Politiques ». Kosciusco-Morizet Nathalie) : (6 juin) 2017. Nathalie Kosciusco-Morizet, candidate aux élections législatives, auteure de :
« […] dans dix jours ma voix peut s'éteindre. » 715
A-t-elle pensé à toutes les voix qui ne se sont jamais ‘allumées’ ? (Cf. Êtres humains)
Femmes (« Politiques ». Kustener Brigitte) : (30 novembre) 2016. Lu, dans Le Monde :
« Brigitte Kustener, ancienne collaboratrice de l’ex-députée et adjointe à la mairie de Paris Françoise de Panafieu, a dû attendre cette année pour obtenir enfin une investiture dans la capitale. En 2012, elle était partie en dissidence contre Bernard Debré. Elle voulait être candidate, le médecin lui proposait d’être sa numéro deux. ‘Est-ce que le féminin de député, c’est suppléante ?‘ avait-elle alors ironisé. Pour 2017, Bernard Debré a enfin accepté de lui laisser son siège. À 57 ans, elle s’estime heureuse : ‘J’ai sa bénédiction cette fois, c’est très élégant de sa part.’ » 716 (Cf. Femmes. « Féminin ». « Politiques ». De Panafieu Françoise)
Femmes (« Politiques ». Joly Eva) : (1er avril) 2012. Eva Joly, candidate écologiste à l’élection présidentielle de 2012, auteure de :
« On a le droit de m'écraser moi, de m'injurier, mais on n’a pas le droit d'injurier l'écologie. » 717
À désespérer : Les Chiennes de garde défendaient les femmes politiques victimes d’injures, lesquelles souvent faisaient effectivement appel à elles ; aujourd’hui l’une d’entre elles en exclue même l’éventualité et confère en outre un permis d’injure. (Cf. Culture. Cinéma. L’ivresse du pouvoir, Êtres humains, Relations entre êtres humains. Injures, Politique. Écologie)
Par ordre chronologique. Femmes. « Politiques ». Christine Lagarde :
Femmes (« Politiques ». Lagarde Christine) (1) : (28 juin) 2011. Christine Lagarde [ex-ministre des finances de Nicolas Sarkozy], nouvelle présidente du Fond Monétaire International - institution garant de toutes les dominations impérialistes - a qualifié sa nomination de « victoire pour les femmes ». 718
Son salaire annuel (en 2011) : 551.700 dollars, soit environ 31.700 euros par mois, net d’impôts. 719 (Cf. Femmes. Conscience de classe. Bourgeoises, Économie)
Femmes (« Politiques ». Lagarde Christine) (2) : (24 janvier) 2015. Concernant le roi Abdallah d’Arabie Saoudite, décédé le 23 janvier 2015, Christine Lagarde, présidente du F.M.I, auteure de :
« De manière très discrète, il était un vrai défenseur des femmes. » 720 Elle poursuit :
« C'était très progressif. Mais j'ai abordé cette question avec lui à plusieurs reprises et il y croyait fermement. » De plus, « il avait mis en place beaucoup de réformes ». 721
Traduction : Peu importe [entre autres charmantes pratiques politiques de ce pays] la charia, le roi Abdallah était un fidèle soutien des États-Unis et de l’ « occident » et cela suffit. Rarement, le mépris des femmes, le cynisme libéral n’a été si clairement affirmé. Le plus grave : que cette déclaration n’ait pas eu pour conséquence son départ du F.M.I Pas même son éventualité. (Cf. Politique. Cynisme. Réformes, Économie. F.M.I)
Femmes (« Politiques ». Lagarde Christine) (3) : (2 mars) 2015. Christine Lagarde, toujours au F.M.I, déclare :
« Il ne faut jamais lâcher la cause des femmes. » 722 (Cf. Économie. F.M.I)
Femmes (« Politiques ». Lagarde Christine) (4) : (17 avril) 2015. Christine Lagarde a refusé la demande du gouvernement Grec concernant un « report de paiement » assurant que les précédents n'avaient pas été suivis de « résultats productifs ». Elle a déclaré qu’Athènes devait donc payer un milliard d'euros à ses créanciers à partir du 6 mai et que le F.M.I n’accorderait aucun délai de paiement. Vue et entendue, lors de sa déclaration à la télé : terrible sentiment d’inhumanité. 723 (Cf. Économie. F.M.I. Grèce. Résultats)
Femmes (« Politiques ». Lagarde Christine) (5) : (2 juillet) 2019. Christine Lagarde est nommée présidente de la Banque Centrale Européenne. (Cf. Relations entre êtres humains. Flagornerie, Économie)
-------------
Femmes (« Politiques ». Corinne Lepage) : 2017. Corinne Lepage faisant, le soir même de l’élection d’Emmanuel Macron à la présidence de la République, ses offres de services pour un poste de ministre : quelle tristesse de gâcher ainsi un itinéraire écologique de valeur…
- À sa décharge (?) elle n’est pas la seule « politique » à chercher à se faire valoir ainsi publiquement.
Femmes (« Politiques ». Le Pen Marine) : (4 avril) 2017. Marine Le Pen, quatre jours avant le second tour de l’élection présidentielle, et au lendemain du débat où elle s’était (notamment) montrée grossière, s’affirme sans apparente gêne comme « la représentante du peuple » et explique « qu’elle fait exactement ce que le peuple attendait d’elle ». 724 Comme Jeanne d’Arc [1412-1431] ? Ses propos, à l’approche de la présidentielle, deviennent absurdes… (Cf. Politique. Front national. Démocratie. Peuple)
* Ajout. 8 mai 2017. Pour nuancer ma critique : Emmanuel Macron, le soir de son élection, auteur de : « La France l’a emporté » … (Cf. Hommes. « Politiques ». Macron Emmanuel, Politique. Démocratie. Élections. 7 mai 2017. Peuple)
* Ajout. 21 juin 2024. Avec du recul, « la France » dans la bouche d’Emmanuel Macron, prend une signification plus particulièrement inquiétante.
Femmes (« Politiques ». Lienemann Marie-Noëlle) : 2002. Dans Ma part d’inventaire de Marie-Noëlle Lienemann (sénatrice, ancienne députée européenne, ministre, conseillère générale, secrétaire nationale du parti socialiste…), - qui, selon son éditeur, « n’a pas peur de regarder la réalité en face pour mieux préparer l’avenir » (quatrième de couverture) - réussit l’exploit de ne pas écrire une seule fois le mot : « femme ». 725
Par ordre chronologique. Femmes. « Politiques ». Brigitte Macron :
Femmes (« Politiques ». Macron Brigitte) (1) : (4 octobre) 2018. Valeurs actuelles publie 726, selon une « top source » qui semble crédible, la réalité d’une « véritable engueulade » de Brigitte Macron à l’Élysée, entendue par les officiers de sécurité, au cours de laquelle elle lui aurait notamment dit : « Les conneries, ça suffit maintenant ! ».
Il est certes plus que dommage de citer sur cette seule source l’évident rôle politique joué par Brigitte Macron, évacuant ainsi l’importance de son influence sur son mari ; mais cette citation, outre qu’elle est, en soi, une analyse politique, a en sus l’avantage de relativiser, pour le moins, le qualificatif de « politique » accolé à un homme et / ou à une femme dite « politique ».
Le 11 octobre 2018, des photos - officielles - nous montrent Brigitte et Emmanuel Macron en Arménie « très fusionnels », « plus complices que jamais », « échangeant des gestes tendres », « se tenant la main à de nombreuses reprises ». 727
Dans quel royaume d’apparences, de mensonges, ces gens-là vivent-ils… (Cf. Femmes. Épouse de. Apparence, Relations entre êtres humains. Influence, Penser. Vérité, Politique)
Femmes (« Politiques ». Macron Brigitte) (2) : (22 décembre) 2018. Selon Le Monde, Brigitte Macron aurait évoqué « la violence et la vulgarité des Gilets jaunes ». 728
Femmes (« Politiques ». Macron Brigitte) (3) : (9 mai) 2019. Gérard Collomb [1947-2023], ancien ministre de l’intérieur, évoquant certaines raisons de son départ du gouvernement et les « difficultés » actuelles d’Emmanuel Macron, déclare que Brigitte Macron soutenait régulièrement, à l’époque, ses positions parce qu’elle « sortait plus souvent et voyait plus la réalité de la France ». 729 (Cf. Famille. Couple, Justice. Collomb Gérard)
Femmes (« Politiques ». Macron Brigitte) (4) : (21 août) 2019. Lu dans Le Canard enchaîné :
« Parlant de l’influence de Brigitte Macron, un participant aux dîners politiques raconte [Le JDD. 18 août] : ‘Elle a un mot gentil pour tout le monde quand on arrive, mais ensuite plus un mot. C’est étonnant une personne aussi effacée et aussi présente politiquement…’ Au contraire cela dénote un indéniable sens politique… » 730
-------------
Femmes. « Politiques ». Marion Maréchal :
Femmes (« Politiques ». Maréchal Marion) (1) : (12 juin) 2024. Entendu hier sur Radio courtoisie (radio d'extrême-droite) concernant Marion Maréchal (peu importe le contexte) :
« Elle a été une véritable Blanche de Castille [1188-1252]. »
Et ce, suivi d’une chronique en l’honneur de Geneviève de Galard [1925-2024] « l’ange de Diên Biên Phu », laquelle, devrait, entends-je, « être Panthéonisée ». (Cf. Politique. Extrême-droite. Religion, Histoire)
* Ajout. 19 juin 2024. En utile contrepoint, lire l’article du Canard enchaîné (p.3) :
« Marion Maréchal a dilapidé l’argent de Zemmour. Avant de rejoindre sa tante au RN, l’ex-tête de liste de Reconquête a grassement rémunéré collaborateurs et sociétés amies ».
Femmes (« Politiques ». Maréchal Marion) (2) : (12 juin) 2024. Éric Zemmour, après avoir dénoncé « la trahison », « le mensonge » de Marion Maréchal qu’il a exclue de ‘son’ parti Reconquête, a eu ce trait d’humour qui ne lui est pas familier :
« Elle est pour le regroupement familial » [avec la famille Le Pen]. (Cf. Famille)
-------------
Femmes (« Politiques ». Mégret Catherine) : 1997. La première phrase de Catherine Mégret, épouse de Bruno Mégret, nouvellement élue Front national à la Mairie de Vitrolles, fut :
« Je voudrais souligner combien notre victoire est d’abord celle de mon mari. » Ce qui en l’occurrence est vrai : Bruno Mégret frappé d’inéligibilité, a, en son lieu et place « fait élire sa femme ».
Il est inintéressant de se remémorer que, deux ans après, en 1999, pour barrer la voie au dit Bruno Mégret, n°2 du parti, Jean-Marie Le Pen avait déclaré, à son tour, que s’il était déclaré inéligible, il ferait conduire la liste Front national aux élections européennes par sa nouvelle épouse Jany Le Pen, laquelle, incidemment, avait déclaré qu’elle était « parfaitement ignare en politique ». (Cf. Femmes. Épouse de, Politique. Front national)
Femmes (« Politiques ». Ministres) : 1975. Maria de Lourdes Pintasilgo [1930-2004], ministre Portugaise des affaires sociales en 1974-1975, raconte :
« En 1975, Françoise Giroud [1916-2003] avait organisé à Paris des Journées internationales de la femme. Elle y avait invité tout ce que le monde européen compte de femmes ministres ainsi que d’autres femmes exerçant des fonctions élevées dans l’administration, l’Université, etc.,…Quelques-unes des femmes ministres s’étaient déjà rencontrées ; on se voyait, on se passait des nouvelles rapidement : comment vas-tu ? que fais-tu ? etc.,
Soudain, la femme qui était à l’époque ministre de la santé et de l’environnement en Yougoslavie demande à une femme hollandaise, socialiste, elle aussi ministre de la santé : ‘Et toi, que fais-tu ?’. Elle lui répond : ‘A lot of nonsense and a few nice things‘ (‘Une quantité de bêtises et quelques choses intéressantes.’) »
Démystifiant, donc utile. 731 (Cf. Politique. État)
Femmes (« Politiques ». Panafieu Françoise de) : (juin) 2012. Françoise de Panafieu [UMP] raconte :
« Bien des hommes m'avaient dit à voix basse qu'ils militeraient pour elle [pour Brigitte Kuster, élue, remplacée par les instances de l’UMP par Bernard Debré]. Mais à la commission d'investiture, il n'y avait plus personne... Quand je suis sortie de là, je me suis dit : Waouh ! S'ils se planquent sous la table ici, en temps de guerre, dans la cave de qui j'irais me réfugier si j'étais poursuivie ? »
- De la même :
« Nous ne respectons pas la loi que nous avons nous-mêmes élaborée et votée (concernant la « parité ») et on s'étonne que les citoyens ne nous respectent pas ! » Sur 577 candidatures présentées par l'UMP aux élections législatives de juin 2012, 72 % sont des hommes. 732
- Françoise de Panafieu avait par ailleurs justifié, en 2002, la réouverture des bordels.
Il existe des termes, celui de « respect » par exemple, que sa première déclaration avait légitimés mais, qui, à la lumière de cette dernière prise de position, doivent être employés avec circonspection. (Cf. Femmes. « Politiques ». Kustener Brigitte, Politique. Parité, Proxénétisme)
Femmes (« Politiques ». Panot Mathilde) : (6 février) 2023. Remarquable discours politique de Mathilde Panot [L.F.I] à l’assemblée nationale, à l’occasion du projet de la réforme des retraites.
* Ajout. 24 novembre 2024. Remarquable, aussi sur BFM. TV. (Cf. Politique. Parti politique)
Femmes (« Politiques ». Pau-Langevin George) : (13 octobre) 1987. George Pau Langevin, alors avocate, présidente du MRAP [Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples], auteure de :
« […] Nous, hommes d’outremer » […] » 733
Elle sera, en 2014, nommée « ministre des outremers ».
Quelle injure colonialiste, par ailleurs, dans le terme d’ « outremer »…. (Cf. Justice. Avocat-es, Politique. Colonialisme. Racisme. Démocratie. Peuple)
Par ordre chronologique. Femmes. « Politique ». Valérie Pécresse :
Femmes (« Politiques ». Pécresse Valérie) (1) : (7 juin) 2019. Valérie Pécresse, auteure de :
« Je veux sauver la droite. » 734 (Cf. Femmes. Humbles, Justice. Pécresse Valérie, Politique. État)
Femmes (« Politiques ». Pécresse Valérie) (2) : (10 août) 2020. Valérie Pécresse, toujours présidente de la région Ile de France, auteure de :
« Bonne fête de l’Assomption, une fête à l’image de Marie, qui incarne de don de soi, l’amour et l’espérance. Des valeurs qui devraient tous nous inspirer, croyant et non croyants, tant elles sont nécessaires dans le monde d’aujourd’hui ! »
Le Canard enchaîné ne relève que l’atteinte à la laïcité… 735 (Cf. Patriarcat, Politique. Religion)
Femmes (« Politiques ». Pécresse Valérie) (3) : (4 décembre) 2021. Valérie Pécresse - une droite confuse assumée - a devancé quatre hommes dans la primaire des Républicains. Dans son discours, elle déclare :
« Pour la première fois de son histoire, le parti du général de Gaulle [1890-1970] […], notre famille, va se doter d’une candidate. Alors je pense à toutes les femmes de France aujourd’hui et je dis merci aux adhérents. » Au moins, ses engagements féministes sont d’emblée clairs : pas même une phrase terminée.
Je note aussi qu’après l’avoir entendue évoquer en toute humilité, en toute modernité, « Jeanne d’Arc » [1412-1431] comme sa personnalité politique de référence, c’est, fait-elle savoir, Nicolas Sarkozy, son « mentor » qu’elle a appelé en premier après sa victoire. À ce niveau d’incohérence, on est dans la réalité de l’absurde. (Cf. Politique. Religion)
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. « Politiques ». Monique Pelletier :
Femmes (« Politiques ». Pelletier Monique) (1) : 1995. Monique Pelletier [1926-2025], dans La ligne brisée, évoquant - alors qu’elle était, en 1978, « ministre déléguée à la condition féminine » - un jeune et brillant médecin, nommé par elle - qui soignait son mari devenu hémiplégique et aphasique - écrit :
« Je le soupçonne de faire des ravages parmi le personnel féminin du service. » 736
Cette femme n’aurait pas écrit cela si elle n’eut pas considéré que ce fut peu ou prou un compliment qu’elle lui adressait ; et encore moins qu’il put, comme « le personnel féminin », en prendre ombrage…
Mais, serait-ce, parce qu’elle a écrit cela, qu’elle put dépasser ce jugement ? (Cf. Femmes. « Féminin », Violences. Violences à l’encontre des femmes. « Droit de cuissage »)
Femmes (« Politiques ». Pelletier Monique) (2) : (10 mai) 2016. Monique Pelletier [1926-2025] écrivit :
« ministre des femmes (sic) en 1979, j’ai été agressée par un sénateur. Honte à moi de mon silence. » 737 (Cf. Violences. Violences à l’encontre des femmes. « Droit de cuissage »)
-------------
Femmes (« Politiques ». Pénicaud Muriel) : (20 mai) 2020. Lu dans le portrait effectué par Le Canard enchaîné de Muriel Pénicaud, ministre du travail d’Édouard Philippe :
« Maitrise en sciences de l’éducation, diplômée de psychologie ; administratrice territoriale, membre du cabinet de Martine Aubry, puis intègre de grandes entreprises : Danone, puis Dassault Systèmes, puis Danone à nouveau dont elle devient DRH ; présidente de l’école des inspecteurs du travail, membre du haut conseil du dialogue social nommée par Gérard Larcher, chargée d’une mission sur le stress au travail avec Henri Lachmann [Schneider Electric], présidente du conseil national éducation économie ; membre des conseils d’administration : SNCF, Aéroport de Paris, Fondation Bettencourt, Orange ; nommée par Manuel Valls à la tête de Business France où elle est mise en cause pour favoritisme au profit d’Havas, lors de l’organisation au profit d’Emmanuel Macron, alors ministre des Finances du French Tech Night. …». 738
* Ajout. 27 août 2020. Nommée ambassadrice de France à l’OCDE. (Cf. Politique, Économie)
Femmes (« Politiques ». Piat Yann) : (25 février) 1994. Yann Piat [1949-1994], femme « politique » française, filleule de Jean Marie le Pen, députée du Var Front national, en 1986, puis en 1988, date à laquelle elle est exclue du Front national ; elle sera alors réélue sous l’étiquette UDF, en 1993. À l’assemblée nationale, elle fut membre de la commission d’enquête sur les tentatives de pénétration de la mafia en France. Assassinée le 25 février 1994, en raison de ses dénonciations des liens entre les milieux maffieux et politiques. Première députée assassinée en France. (Cf. Politique. Mafias, Violences, Économie)
Femmes (« Politiques ». Pompadour Madame de) : 1782. Jean-Jacques Rousseau [1712-1778] écrit dans Les confessions [Livre XI] qu’il « regardait Madame de Pompadour [1721-1764] comme une façon de premier ministre. » Plus loin, il évoque :
« l’entêtement d’une femme obstinée qui, sacrifiant toujours à ses goûts ses lumières, si tant est qu’elle en eut, écartait presque toujours des emplois les plus capables pour placer ceux qui lui plaisait le plus. […] » 739
N.B. Ce jugement, qui peut être partiellement juste, ne saurait être le portait de l’action de madame de Pompadour.
Femmes (« Politiques ». Radjavi Maryam) : (19 mars) 2025. Je lis dans Le Canard enchaîné (p.3) que Maryam Radjavi, la cheffe de l’Organisation des moudjahidin du peuple iranien [OMPI] - « mouvement islamo-marxiste, para-militaire, en lutte contre le régime iranien » - […] utilise l’argent de la cause - celui des militants-es - en thalasso de luxe : Ainsi : au moins, 14 séjours à l’Hôtel royal d’Évian, puis au Sofitel de Biarritz, soit environ 130.000 euros pour ses « soins du corps » en 2024.
Femmes (« Politiques ». Roudy Yvette) : 1995. Yvette Roudy, dans De quoi ont-ils peur ? auteure de :
« […] Faut-il s’étonner que les hommes politiques français puissent si facilement se débarrasser des rares féministes françaises qui s’obstinent à rester dans les partis ? Ils préfèrent traiter, au moment des élections, avec des personnalités extérieures, plus faciles à écarter quand elles ne servent plus. Seules sont retenues les femmes qui ne dérangent ni leurs règles, ni leurs jeux, ni les mœurs. […] » 740
Oui, il faut le dire : les critères par les hommes de choix (des femmes) en politique sont encore si souvent la dépendance, la malléabilité, les faibles exigences… tempérées par l’ambition ? Certes, elles n’en ont pas le monopole. Mais taire cela est faire injure aux femmes qui décident de faire « de la politique » : elles devront, comme les hommes, avaler les couleuvres et vivre avec leur impuissance. (Cf. Femmes. Peur, Politique. Parité. Sénatrice. Comment devenir sénatrice)
Par ordre chronologique. Femmes. « Politiques ». Ségolène Royal :
Femmes (« Politiques ». Royal Ségolène) (1) : Avoir enduré avec hauteur la somme d’injures et d’ignominies dont Ségolène Royal a été l’objet impose le respect. L’analyse politique féministe est toujours manquante. 741
- Plus récemment, ses prises de position concernant le fait qu’elle souhaite, sans autre forme de procès, « tourner la page » (le 20 mai 2011), avant même toute décision judiciaire concernant Dominique Strauss-Kahn, l’a rangée de facto dans le camp des cautions d’un agresseur sexuel. De plus récentes déclarations n’effacent pas la faute.
N.B. Deux ‘leçons‘ de son échec aux élections législatives de juin 2012 : nul-le n’est au-dessus des lois (du P.S) et : la présomption est un vilain défaut.
* Ajout. 16 janvier 2013. Concernant la première assertion, une question me vient à l’esprit : pourquoi aurait-elle dû ‘endurer’ toutes ces injures ? Pourquoi n’a-t-elle pas d’emblée affirmé qu’elle ne les accepterait plus et ne s’en est-elle pas donnée les moyens ? Si tel avait été sa décision, elle aurait certes dû affronter l’ensemble de la classe politique et prendre un risque politique réel (pas perdu pour autant). Mais elle aurait fait faire aux femmes et donc à la société française un immense pas en avant. Plus important que son (éventuelle) élection… (Cf. Êtres humains, Relations entre êtres humains. Injures, Hommes. « Politiques ». Strauss-Kahn Dominique)
Femmes (« Politiques ». Royal Ségolène) (2) : 2018. Ségolène Royal publie un livre intitulé Ce que je peux enfin vous dire [Fayard. 2018. 289p.] dans lequel elle rapporte les « réactions sexistes » entendues, vécues par elle - certaines nominatives, d’autres non - depuis 30 ans.
Que n’eût-elle écrit ce livre plus tôt…
Elle y écrit aussi :
« L’imagination [en la matière] a culminé en 2006 et 2007, dans une totale impunité » et ce suivi de :
« Jamais un candidat à une élection n’avait encaissé une telle avalanche de mépris sans qu’aucune réaction ne vienne l’endiguer. »
Pas même des féministes ? (Cf. Femmes. Mépris, Justice. Impunité, Sexes […])
Femmes (« Politiques ». Royal Ségolène) (3) : (1er juillet) 2018. Sylvie Kauffmann, journaliste, directrice éditoriale du Monde, se souvient de la candidature de Ségolène Royal en 2007 à la présidence de la République « dont on rigolait beaucoup dans les milieux politiques. »
Elle, incluse ? 742 (Cf. Femmes. Journalistes, Penser. Raison)
-------------
Femmes (« Politiques ». Rudd Amber) : (30 avril) 2018. Amber Rudd, ministre de l’intérieur britannique, avait déclaré, concernant son collègue Boris Johnson, ministre des affaires étrangères, qu’il n’était pas « le genre d’homme qu’on choisirait pour se faire raccompagner en voiture à la fin d’une soirée. » 743 (Cf. Hommes. Grossiers. Johnson Boris)
Femmes (« Politiques ». Saunier-Seïté Alice) : 1974. Échange de mots, retranscrits et publiés par Françoise Giroud [1916-2003], entre elle et Alice Saunier-Seïté [1925-2003] qui assistait à son premier conseil des ministres [présidence de Valéry Giscard d’Estaing] :
« Chère Alice, vous doutiez-vous qu’un Conseil des ministres peut être aussi ennuyeux ? »
Réponse : « Chère Françoise, oui, car j’ai toujours constaté l’insondable puérilité du sexe masculin. »
Si Alice Saunier-Seïté n’avait pas été si souvent définie par son statut de [supputée] ‘maîtresse de’…, aurais-je moi-même retranscrit cet échange ? 744 (Cf. Hommes. Sexes. Hommes, Histoire. Archives)
Par ordre chronologique. Femmes. « Politiques ». Marlène Schiappa :
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (1) : 2010. Marlène Schiappa, dans Osez l’amour des rondes, écrit notamment :
- « Soyez drôles, mais pas trop. La femme grosse a l’obligation d’être marrante, mais ne doit pas oublier que sa priorité doit toujours rester sa soumission totale à l’homme. Elle préférera donc rire aux blagues pourries de son compagnon plutôt que de se lancer dans un récital de vannes. »
- « La levrette : Il s’agit ici de mettre en avant le meilleur visage de la grosse : son cul ».
- « Sodomie mensongère : il s’agit ici de faire croire à votre amant qu’il vous sodomise alors qu’il s’introduit seulement entre vos deux miches. Technique usitée par la plus vieille profession du monde depuis des siècles. Merci pour cet aimable rappel de notre condition, Marlène. » etc. 745 (Cf. Corps. Visage, Pornographie, Proxénétisme, Sexes […])
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (2) : (24 mai) 2014. Le site Atlantico publie les « dix suggestions pour vous faire prescrire un arrêt de travail pathologique » - proposées par Marlène Schiappa, avant sa nomination au gouvernement sur son blog Maman Travaille - fondées sur la simulation, le mensonge, la manipulation, la séduction, l’abêtissement, les modalités de détournement de la loi.
Commentaire d’Atlantico :
« À coup sûr, les employeurs apprécieront les prochaines sorties de la ministre sur la discrimination hommes-femmes dans les entreprises… et les prochaines sorties du Président et de son équipe sur l’exemplarité des élus. » 746 (Cf. Femmes. Abêtissement)
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (3) : (28 avril) 2017. Marlène Schiappa, responsable d’un réseau intitulé « Maman travaille », « référente égalité femmes-hommes d’Emmanuel Macron » présente, dans l’entre deux tours de l’élection Présidentielle de mai 2017, les projets d’Emmanuel Macron s’il est élu. J’ai relevé :
- « Son programme, qui est très caricaturé, est de libérer l’économie en ouvrant plus de droits » et :
- « Il est convaincu que l’émancipation, c’est permettre à chacune de faire les choix qu’elle veut, comme si elle était un homme, ni plus ni moins. C’est à dire pouvoir sortir dans la rue à 3h du matin, si elle en a envie, avoir accès à l’IVG ou se rendre à la fac avec son voile. » 747
Effectivement, avec de telles ambitions, on ne peut que la croire :
« Avec Emmanuel Macron, la vie des femmes va changer. » (Cf. Hommes. « Politiques ». Macron Emmanuel, Politique. Démocratie. Élections présidentielles. 7 mai 2017)
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (4) : (24 mars) 2017. Lors d’un débat au cours duquel Emmanuel Macron et Marlène Schiappa s’étaient engagés publiquement à la création d’un Ministère des droits des femmes, Marlène Schiappa a déclaré :
« Le féminisme est aussi un courant économiste. » 748 Cette petite phrase, ouvre un boulevard aux thèses et politiques économiques libérales, proxénètes nécessairement incluses. (Cf. Féminismes, Économie)
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (5) : (18 mai) 2017. Marlène Schiappa est nommée non pas ministre, mais « secrétaire d'état en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes » du gouvernement Édouard Philippe.
J’apprends qu’elle avait « travaillé aux côtés de Laurence Rossignol au ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes » et qu’elle a collaboré quelques mois aux Nouvelles News, fort peu critique, par ailleurs, la concernant… (Cf. Droit, Enfants, Famille, Politique. Égalité)
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (6) : (22 mai) 2017. Marlène Schiappa est interrogée par les Nouvelles News :
- Question : « Un mot d’abord sur la déception qu’a pu causer la dénomination de votre rôle. Vous n’êtes pas à la tête d’un ministère, mais d’un secrétariat d’état, certes rattaché au Premier ministre. N’est-ce pas un mauvais signal ?», Marlène Schiappa répond :
- Réponse : « Au contraire. Avoir un secrétariat d’état rattaché à Matignon, c’est le pilotage politique que j’avais proposé à Emmanuel Macron. Car lors de mes discussions durant la campagne présidentielle avec des expertes, des associations… toutes me disaient qu’elles étaient globalement satisfaites des actions menées ces dernières années par le ministère des Droits des femmes, mais s’il fallait un point d’amélioration à leurs yeux, c’était un besoin de transversalité. […] » 749 (Cf. Langage. Mots)
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (7) : (22 mai) 2017. Marlène Schiappa s’estime en droit de conférer des labels de véracité « féministe » à ses collègues :
« […] Mais je peux déjà dire que dans ce gouvernement, il y a beaucoup de vraies féministes. La ministre du travail, de la culture, des transports, des sports, des armées… sont des femmes très engagées sur ces questions. »
Marlène Schiappa, du fait de sa fonction ministérielle, délivrant des brevets de « vraies féministes » : un bel exemple d’enfermement institutionnel. 750 (Cf. Politique. État)
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (8) : (24 mai) 2017. Marlène Schiappa, nommée par Emmanuel Macron « secrétaire d'état en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes » du gouvernement Édouard Philippe, invitée par Radio Alpa, affirme :
« Je me situe plutôt dans un mouvement féministe qu'on appelle pro-sex aux États-Unis, et qui demande un statut du travailleur sexuel, que ce soit pour les animateurs de sites X, les performers érotiques, les assistants sexuels pour personnes handicapées...
Le mouvement pro-sex pense qu'on ne peut pas partir du point de départ que toutes les prostituées sont contraintes. »
Et ce, suivi de la, non moins, fulgurante analyse :
« Néanmoins, je ne crois pas non plus qu'on puisse partir du point de départ que toutes les personnes prostituées seraient consentantes. Il est bon parfois de s'éloigner des dogmes pour entrer dans le concret, de voir comment ça se passe pour les principales concernées. […] » 751 (Cf. Êtres humains. Handicapés, Hommes. « Politiques ». Macron Emmanuel, Penser. Pensées. Binaires, Pornographie, Sexes. « Objet sexuel », Proxénétisme)
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (9) : (3 août) 2017. Marlène Schiappa déclare que « le corps n’est pas un bien public ». 752
Si l’on accepte la grille de lecture de la dénégation selon laquelle il s’agit du procédé par lequel, tout en formulant une pensée, un désir - ici une réalité - jusqu'ici refoulée, une personne s'en défend, en niant qu'il lui appartienne, et de fait l’exprime, alors de riches conclusions politiques doivent en être tirées.
Mais, plus précisément, à quoi donc engage - et que peut bien signifier l’emploi du terme de « bien public » ? Qui, dans le monde, pourrait affirmer :
« Le corps est un bien public » ?
Cette assertion, en sus, est indigne, car elle a pour moyen le leurre et pour finalité la tromperie. (Cf. Êtres humains, Corps, Penser. Grille de lecture, Proxénétisme)
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (10) : (3 août) 2017. Marlène Schiappa évoque, devant la Délégation aux droits des femmes du sénat, incidemment, qu’elle est « aussi en charge » des « L.G.B.T ». 753
Ainsi dorénavant l’égalité femmes-hommes (un concept) est comparable ? équivalente ? aux « L.G.B.T » - des êtres humains, qualifié sans que l’on sache sur quels fondements, arbitrairement donc, comme tels. (Cf. Êtres Humains. « L.G.B.T », Sexes. « L.G.B.T »)
* Ajout. 22 novembre 2017. Cf. article 1 du décret 2017-N°1066 du 24 mai 2017 relatif à ses attributions :
« Par délégation du Premier ministre, Mme Marlène Schiappa, secrétaire d'état chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, prépare, anime et coordonne le travail gouvernemental en matière de parité et d'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu'en matière de lutte contre la haine envers les personnes lesbiennes, gays, bi et trans. » […]
Lire la suite… (Cf. Relations entre êtres humains. Haine, Politique. Parité)
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (11) : (12 septembre) 2017. Marlène Schiappa revendique la PMA [Procréation médicalement assistée] pour toutes les femmes, afin qu’elles puissent toutes devenir mères 754, sans que les enfants n’aient de pères. Les hommes, ou plutôt, certains rares d’entre eux, réduits à leur sperme, lui-même devenu un objet du marché. Désavouée par le ministre de l’intérieur, elle devra retirer son projet. Un temps… (Cf. Êtres humains. Corps. Sperme, Hommes, Politique. Égalité, Sexes [...], Économie. Marché)
N.B. Ce commentaire n’est pas une position contre la PMA.
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (12) : (16 octobre) 2017. Marlène Schiappa, en sus d’une nouvelle loi sur le harcèlement sexuel [de rue], qu’elle annonce, c’est, selon elle, de la critique des précédentes qui ne sont pas, ou mal, ou si difficilement mises en œuvre, que les femmes ont besoin.
Et si l’on veut vraiment que les choses changent, si l’on veut vraiment que des siècles d’injustice soient dénoncées et que ces violences cessent, ce dont les femmes - celles qui ont parlé et toutes celles les plus nombreuses qui n’ont pas parlé - ont besoin, c’est d’abord et avant tout - d’une nouvelle police, mais surtout d’une nouvelle justice.
La parole, là aussi, de toutes les injustices, de tous les scandales de la justice, de toutes les hontes commises à l’encontre des femmes par la « Justice », doit se libérer. (Cf. Droit, Justice, Langage. Mots. Critique de : « Scandale », Patriarcat. Weinstein Harvey, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (13) : (18 octobre) 2017. Je lis dans l’organigramme de la composition du cabinet de la secrétaire d'état auprès du premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, que celui-ci est composé de 5 personnes. L’une d’entre elles est « conseillère en charge des droits des femmes. »
Ainsi, si l’on pense que le terme de « droits des femmes » a un sens, il faut savoir qu’une seule personne est officiellement en France, chargée de « gérer », de suivre, de critiquer, d’innover, les dits droits de la moitié de la population française. 755
* Ajout. 27 juin 2018. « Par arrêté du 13 juin 2018 portant cessation de fonction au cabinet de la secrétaire d’état auprès du premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes publié au Journal Officiel du 21 juin, il est mis fin aux fonctions de Floriane Volt, conseillère en charge des droits des femmes. »
Aussi simple que cela… : zéro serait-il moins gênant que : 1 ?
* Ajout. 8 août 2018. À titre de comparaison, je lis que 61 personnes sont en charge de « la communication de l’Élysée ». 756 (Cf. Politique. État. « Gilets jaunes »)
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (14) : (22 octobre) 2017. Marlène Schiappa affirme, dans le JDD :
« Je suis très proche de Brigitte [Macron]. Elle me demande des conseils. »
Commentaire du Canard enchaîné :
« Et le génie Schiappa consent à lui en donner ? » 757
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (15) : (22 novembre) 2017. Je lis dans Le Canard enchaîné :
« La plupart des orateurs au Congrès de Lyon [1er conseil national de LaREM [La république en marche] où fut adoubé Christophe Castaner, après qu’il ait été nommé par Emmanuel Macron] ont vanté les immenses efforts (sic) du président Macron et de son mouvement au service de l’égalité femmes-hommes : parité au gouvernement, 43 % des députées, etc., (sic).
Mais, à l’exception notable de Marlène Schiappa, tous les orateurs principaux étaient des hommes […]
Il y avait bien des femmes sur la tribune et au micro, mais c’était pour assurer l’ambiance. […] Dans le jargon du métier, cela s’appelle ‘faire des ménages’. Mais, là, ce n’était même pas payé. » 758 (Cf. Hommes. « Politiques ». Castaner Christophe, Langage. Jargon, Politique. Parité)
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (16) : (25 novembre) 2017. Après le discours lamentable d’Emmanuel Macron à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et du lancement de la grande cause du quinquennat : « words, words, words » ; « despise, despise, despise » - à quelle politique Marlène Schiappa peut-elle dès lors se référer ? (Cf. Hommes. « Politiques ». Macron Emmanuel, Patriarcat. Weinstein Harvey)
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (17) : (27 novembre) 2017. Un document intitulé : Décryptage du budget dédié à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles du secrétariat d’état montre qu’ « aucun budget supplémentaire » n’a été programmé pour lutter contre les violences. Le terme de mépris est insuffisant, c’est d’une attaque frontale contre les femmes de ce pays qu’il s’agit. Les femmes, je le pense, n’oublieront pas. Et Emmanuel Macron devra - et sera - personnellement jugé responsable des violences à l’encontre des femmes qui dorénavant seront perpétrés contre les femmes. Et ce sera juste. 759 (Cf. Économie. Budget, Sexes […], Violences. Violences à l'encontre des femmes)
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (18) : 2018. Faute de crédits, dans le cadre institutionnel, politique, économique français, Marlène Schiappa a [pris] le pouvoir que la valeur de sa parole singulière lui confère, ou non.
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (19) : (7 février) 2018. Lu dans Le Canard enchaîné, le jugement d’Emmanuel Macron concernant Marlène Schiappa :
« Elle a créé son fonds de commerce. Elle s’installe dans le rôle de la passionaria du combat de l’égalité entre les femmes et les hommes. Je la laisse faire parce que j’en ai fait la grande cause de mon quinquennat. Il faut bien qu’en dépit de quelques excès une figure qui l’incarne. » Et Le Canard conclue :
« Sans oublier que Schiappa est intouchable en raison de sa proximité avec Brigitte. Existe-t-il meilleur soutien en Macronie ? » 760
Les femmes - car c’est bien d’elles, de nous qu’il s’agit - mises en position d’être qualifiés de « fonds de commerce » - de Marlène Schiappa, apprécieront la valeur que leur accorde le président de la République… (Cf. Hommes. « Politiques ». Macron Emmanuel)
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (20) : (10 février) 2018. La reprise en mains institutionnelle est dorénavant effective : après les révélations de réalités de violences commises à l’encontre des femmes par Nicolas Hulot, n°2 du gouvernement, Marlène Schiappa écrit :
« Le Premier ministre a parlé au nom de tout le gouvernement en étant très clair : le gouvernement fait confiance à Nicolas Hulot. Qu'ajouter ? Je pourrais répéter cela. Je pourrais ajouter que c'est ‘un homme charmant’ (c'est le cas), ‘respectueux’ (c'est le cas), que je pense à son épouse et ses enfants (c'est le cas), qu'il porte un combat majeur pour l'avenir de la planète (c'est le cas) ; mais en quoi cela apporterait-il quoi que ce soit, dans un sens ou dans un autre ? » 761
La messe est dite… pour ceux et celles qui y croyaient…
Le danger était trop important, la reprise en mains peut commencer.
* Ajout. 6 mars 2018. Nicolas Hulot a, le 2 mars, déposé plainte en diffamation contre le magazine Ebdo « qui avait fait état d’une plainte pour viol et d’une rumeur de harcèlement sexuel. » 762 (Cf. Hommes. « Politiques ». Hulot Nicolas, Justice. Diffamation. Rumeur, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (21) : (8 mars) 2018. Marlène Schiappa déclara sur TPMP [Touche pas à mon poste] :
« Il est très beau, Cyril Hanouna, on ne peut pas dire le contraire. Il est très bienveillant. Je trouve que c’est un gentleman. C’est quelqu’un qui se comporte très bien avec les femmes. » 763
Eh, oui, cela fut dit…
Mais cela ne fut pas relevé, pas cité dans la revue de presse du Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Officiellement donc, Marlène Schiappa n’a pas « félicité » Cyril Hanouna, ni ne l’a complimenté pour le « respect » dont il fait - c’est évident - quotidiennement preuve auprès de près de trois millions de téléspectateur/trices…764 (Cf. Hommes. « Gentleman »)
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (22) : (8 mai) 2018. Je découvre sur internet que Marlène Schiappa, alors déjà secrétaire d’état, a reçu le 8 décembre dernier le prix spécial laïcité du Grand Orient de France. Dans un tweet daté du 8 décembre 2017, elle s’affirme « honorée de recevoir le prix spécial Laïcité du GODF [Grand Orient de France] » qu’elle « prend pour un encouragement. »
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (23) : (9 mai) 2018. Lu sur Le Canard enchaîné :
« La secrétaire d’état chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes publie : Si souvent éloignée de vous’, ainsi présenté en quatrième de couverture : ‘Telle une Madame de Sévigné moderne, Marlène Schiappa écrit à ses filles […] Aux confins de l’intime et du politique, ce récit à la fois exceptionnel et universel nous dévoile le cœur d’une mère au service du gouvernement. »
Pour son prochain ouvrage, un autre sujet vendeur : Madame de Sévigné féministe ? » 765
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (24) : (9 mai) 2018. Muriel Pénicaud, ministre du travail et Marlène Schiappa, secrétaire d’état chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, conclurent les réunions de concertation sur l’égalité salariale au ministère du Travail, en présence de tous les syndicats. 766
Le soutien à l'AVFT, publiquement exprimé, fut porté par la CGT, mais avait fait l'objet d'un consensus trans-syndicats, CGT, la CFDT, la CGC, la CFTC, FO, FSU, SOLIDAIRES et l'UNSA.
Marlène Schiappa, à nouveau donc interpellée, a répondu que l'AVFT avait arrêté son activité, que l'État n'avait pas à faire de mécénat avec les associations et qu'il faisait déjà preuve de mansuétude en ne supprimant pas entièrement la subvention de l'AVFT, maintenue intégralement [Pour 2018 en tout cas].
Les deux termes de mécénat et de mansuétude méritent une analyse politique.
N.B. Marlène Schiappa peut-elle expliquer pourquoi elle menace si clairement l’AVFT et affiche si clairement son soutien, y compris financier, au Collectif féministe contre le Viol ? Qu’en pense le CFCV ?
* Ajout. 31 mai 2018. 48.000 femmes victimes de violences au travail en 2016.
En février 2018, 32 % des femmes déclaraient avoir été victimes d’une forme de harcèlement sexuel au cours de leur carrière. 767 (Cf. Penser. Expliquer)
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (25) : (11 mai) 2018. Marlène Schiappa, secrétaire d’état chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes a une telle confiance en la justice de la justice française qu’en matière de harcèlement sexuel au travail, qu’elle a décidé - de concert avec le président de la République, le premier ministre, sa consœur, ministre de la justice - de n’en rien changer.
Alors que le monde entier est encore si profondément bouleversé par les conséquences de « l’affaire Harvey Weinstein », l’efficacité de la justice française, pour la permanence du patriarcat et la domination masculine était-elle par trop probante ? 768
N.B. Pour rappel : Non seulement les « ordonnances Macron » ont, en droit du travail, restreint les droits des femmes la matière ; non seulement, les femmes pâtiront, comme tous les justiciables, de la réforme actuelle de la justice initiée par Emmanuel Macron ; mais, en sus, la lutte contre le harcèlement sexuel ne fait pas partie des réformes présentées avec la ministre du travail, comme relevant de l’égalité professionnelle hommes-femmes. [Repris dans : Justice. Schiappa Marlène] (Cf. Justice. Macron Emmanuel, Patriarcat. Weinstein Harvey, Politique. État, Violences. Violences à l’encontre des femmes. Harcèlement sexuel)
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (26) : (11 mai) 2018. Marlène Schiappa, secrétaire d’état chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes a une telle confiance en la justice de la justice française qu’en matière de harcèlement sexuel au travail, qu’elle a décidé - de concert avec le président de la République, le premier ministre, ses consœurs, ministre de la justice et du travail - de former ceux et celles qu’elle nomme avec dignité, respect et élégance, « les personnels de standard » et ce, « en quelques semaines », qui seront chargé-es de répondre savamment aux personnes qui appelleront ledit standard. 769
En faisant fi, elle qui ne s’affirme féministe que depuis un an, des 33 ans d’initiatives législatives, d’avancées jurisprudentielles, de compétences juridiques, d’innombrables procès préparés, défendus, plaidés par l’AVFT ?
« L’État doit reprendre la main » ainsi, a-t-elle justifié sa décision, et ce, après un jugement politique dépourvu de toute ambiguïté. 770
Marlène Schiappa s’est-elle vraiment rendue compte de l’énormité politique, a tant de titres, d’une telle assertion ? [Repris dans Justice. Marlène Schiappa]
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (27) : (11 mai) 2018. Après que Marlène Schiappa ait donc refusé d’augmenter le financement public de l’AVFT [235.000 euros par an] et semble attendre de la reconnaissance qu’elle ne l’ait pas diminué, elle décide d’utiliser, là encore [semble-t-il seule ?], l’argent de l’État et de dépenser : « quatre millions pour un plan de communications » et « un million pour un nouveau dispositif contre les violences au travail. » 771
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (28) : (14 mai) 2018. Questionnée sur le nombre d’inspecteurs[trices] du travail - dont le nombre ne cesse de baisser - chargé-es de contrôler les 7000 entreprises en matière d’égalité salariale, Marlène Schiappa eut cette réponse dont la dernière phrase est fort inquiétante, là encore, à tant de titres, :
«’C’est tout à fait absorbable. En France, on a un nombre d’inspecteurs au-dessus des normes de l’Organisation internationale du travail. Le sujet n’est donc pas le nombre, mais la priorité fixée. » 772
N’y a-t-il donc personne qui relise ses interviews ?
* Ajout. 20 août 2019. Réaction naïve de ma part…
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (29) : (14 mai) 2018. Interrogée sur son absence sur les marches du Festival de Cannes, le 12 mai 2018, alors que 82 femmes affirmaient au nom de « l’égalité » dédier cette manifestation « aux femmes du cinéma » Marlène Schiappa, qui a décidément réponse à tout, affirma qu’elle n’avait pas voulu « s’inviter », suivi de :
« Ce n’est pas ma place, je ne suis pas actrice ». 773
N.B. Dans Le Canard enchaîné, il est écrit que :
« Françoise Nyssen [ministre de la culture] était la seule ministre autorisée par le Château [l’Élysée] à monter les marches du Palais des festivals. » 774 (Cf. Culture, Politique. Égalité)
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (30) : (15 mai) 2018. À l’assemblée nationale, le député LR Fabien Di Filippo avait interpellé Marlène Schiappa, la secrétaire d’état chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes en ces termes :
« […] Ce qui est irresponsable et incompréhensible pour les Français, c’est que vous puissiez manquer à votre parole et faire passer votre conception libertaire des rapports sexuels, y compris entre mineurs et majeurs, avant la protection de nos enfants ». Marlène Schiappa a alors réagi en ces termes :
« Je demande une suspension de séance. Monsieur le député Filippo n’a pas à m’insulter de la sorte ni à faire des suppositions qui sont totalement déplacées dans le cadre d’un débat et qui démontrent encore une fois sa misogynie crasse et son ignorance profonde de ce qu’est la liberté des femmes », puis publié le tweet suivant :
« Propos inqualifiables et hallucinants de M. Di Filippo à mon encontre qui fait référence à ma ‘vie sexuelle’ pour justifier son argumentaire ! »
Je ne lis pour ma part aucune « insulte » personnelle, ni aucune référence à « la vie sexuelle » de Marlène Schiappa. Quant aux « femmes », le terme n’ayant pas été prononcé par M. Fillipo, les termes de « misogynie crasse » et de « liberté des femmes » n’avaient pas lieu d’être. 775
* Ajout. 4 mai 2023. Ma dénégation, à la relecture, est-elle fondée ? (Poursuivre)
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (31) : (30 mai) 2018. Marlène Schiappa publie un livre, intitulé Si souvent éloignée de vous, dans lequel elle croit bon préciser qu’il n’est « ni une communication gouvernementale ni un bilan d’action politique, mais un récit purement personnel, partiel et parfois romancé. »
Il fut pourtant rendu public par un courriel émanant du secrétariat d’état.
Le président d’Anticor ayant saisi la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ainsi que le premier ministre, Marlène Schiappa a évoqué « une maladresse » qui « ne se reproduira plus ».
L’article du Monde, après avoir parlé d’un livre « parfois [d’] un registre de littérature de gare » qui évoque cet épisode en conclue :
« Ce qui pourrait passer chez Marlène Schiappa pour de la naïveté, ou une volonté puérile de se donner en exemple, pourrait bien révéler au contraire une maitrise parfaite des codes de la société du spectacle. » 776
Certes, ce livre était un objet politique, mais Le Monde ne serait-il pas plus crédible, plus honorable, s’il avait pris au sérieux - et l’avoir jugé à cette aune - celle de sa politique, qui, elle, ne relève pas de « la société du spectacle » ? (Cf. Êtres Humains. Naïveté)
* Ajout. 17 juillet 2019. Lu dans Le Canard enchaîné, que François de Rugy, accusé par Mediapart mais encore ministre de l’écologie, « ulcéré » par les réactions de Benjamin Griveaux et de Marlène Schiappa a cru bon, le 14 juillet 2019, dire à un ministre, concernant cette dernière :
« Elle avait mobilisé tout son ministère pour faire la promo de son bouquin, mais je ne l’ai pas critiquée. J’aurais trouvé ça nul de l’attaquer là-dessus. » 777 (Cf. Culture. Livres, Hommes « Politiques »)
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (32) : (11 juin) 2018. Je reçois La Veille de l’actualité du Service du droit des femmes et de l’égalité entre les hommes et les femmes. Il n’est curieusement plus fait état d’aucune initiative de la ministre et « l‘action gouvernementale » est réduite à sa plus simple expression.
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (33) : (12 juin) 2018. Lors d’un énième interview, à Terrafémina, Marlène Schiappa, tentant en vain, une énième fois, de se justifier concernant la politique du gouvernement concernant l’AVFT déclare :
« L'AVFT a décidé de fermer son standard. L'État serait en droit dans n'importe quel contrat commercial ou contrat de partenariat de dire : ‘OK, vous ne remplissez pas la mission pour laquelle vous touchez une subvention, on arrête la subvention’. Or, nous, ce n'est pas ce que l'on a dit. »
Et ce, suivi d’un inénarrable :
« On vous demande de faire moins de choses […]. »
Ce qui mérite bien un prix de l’humour, et / ou de l’inconscience, et / ou du cynisme, et / ou de la menace politique ? (Cf. Féministes. Associations)
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (34) : (13 juin) 2018. À la suite de la honteuse déclaration d’Emmanuel Macron selon lequel « les aides sociales, coûtent un maximum de pognon », Marlène Schiappa croit bon nous expliquer ce que sans doute elle estime que nous ne pourrions comprendre sans son analyse, ou que nous comprendrions peut-être mieux avec son aide :
« Toucher 550€ de RSA/mois ne permet pas de sortir de la pauvreté s’il n’y a pas d’accompagnement efficace vers le travail. Un vrai travail, un vrai salaire : voilà le projet du gouvernement ! « L’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes. » (K. Marx) » (Cf. Penser. Expliquer, Économie. Macron Emmanuel)
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (35) : (15 juin) 2018. Au nom de quoi, sur quels fondements, devrais-je - devrions-nous - supporter que de telles analyses, de telles politiques, de telles incohérences, une telle suffisante liée à une telle médiocrité ? Quelle est la légitimité de Marlène Schiappa ? Jusqu’à quand estimera-t-elle son intelligence suffisamment éclairante pour parler au lieu et place de la moitié de la population vivant en France ? Jusqu’à quand les femmes, les féministes, les associations féministes, supporteront-elles cette situation ? Jusqu’à quand tant de médias poursuivront-ils sans honte leur complaisance ?
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (36) : (30 juin) 2018. Marlène Schiappa participe à l’émission : ‘On n’est pas couché’. Brutalement et vulgairement (après avoir été sifflée - comme un chien - ce qui n’a pas été relevé) interrompue par l’acteur Jean-Claude Vandamme, elle réagit en ces termes :
« Ce que vous venez de faire c'est du mansplaining, c'est à dire qu'un homme interrompt une femme pour lui expliquer qu'il sait mieux qu'elle des choses sur son propre domaine d'expertise. »
De quel « domaine d’expertise », surtout en la matière, peut-il bien s’agir ? Si Marlène Schiappa pensait à toutes les femmes, l’expression n’est pas appropriée. Sinon, pense-t-elle qu’il existerait des « domaines d’expertise » qui - seuls ? - permettraient de s’exprimer, et qui, en l’occurrence, légitimait sa propre - et ici seule - parole ?
La domination des expert-es dont la parole, dont le rôle qui leur est accordé est partout est contestée : Marlène Schiappa l‘a brillamment réhabilitée. 778 (Cf. Penser. Expliquer)
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (37) : (4 juillet) 2018. Lu, dans Le Canard enchaîné concernant la réception du discours d’Emmanuel Macron lors de « l’entrée » (sic) de Simone Veil et de son mari au Panthéon :
« Sur France Inter (2 juillet 2018), c’est la ministre Marlène Schiappa qui s’est confite en dévotion : ‘Il y avait une foule immense tout au long du trajet […] qui applaudissait, à tout rompre, par moments, toutes les phrases du président de la République.’ » 779
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (38) : (15 juillet) 2018. Marlène Schiappa interviewe Claire Chazal [leurs deux derniers livres étant cités] pour Paris Match. Cet « entretien » étant présenté comme « sans tabous », je m’interroge : Quel-le journaliste aurait osé poser des questions… disons… aussi peu dérangeantes [concernant notamment sa vie sentimentale, sa vie amoureuse, la passion, le regard des autres, la séduction, etc.] afin d’obtenir des réponses qui ne le sont pas moins
[« Quand on vieillit on a besoin d’une épaule… Rien n’est plus beau que d’avoir le cœur qui bat, de vibrer, et d’être dans ce rapport exclusif, dans la recherche d’un amour absolu… J’ai conscience d’avoir plus de chances et de moyens que d’autres pour résister au temps qui passe… » etc.]
On peut noter plus spécifiquement deux échanges :
- Question. Marlène Schiappa : « Est-ce que, dans le journalisme, les inégalités homme-femme se font sentir ? »
Réponse. Claire Chazal : « Je n’ai jamais eu le sentiment de travailler dans un secteur machiste ». Et ce suivi, sans transition, de : « Les salaires n’étaient pas tout à fait les mêmes. »
- Question. Marlène Schiappa : « Que sentez-vous de masculin en vous ? »
Réponse. Claire Chazal : « Le désir de la liberté, le désir de l’épanouissement professionnel, le désir de la prise de décision, le désir de prendre en main sa vie. Et une forme de dureté que l’on attribue, peut-être à tort, aux hommes. » 780
Commentaire du Canard enchaîné : « Ah, toutes ces qualités qui manquent aux femmes… » 781 (Cf. Penser. « Tabous », Violences. Violences à l’encontre des femmes. Chazal Claire)
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (39) : (25. 28. 30 juillet) 2018. Marlène Schiappa après avoir affirmé, suite à un séjour chez sa sœur, que « l’affaire Benalla n’est pas un sujet qui intéresse [les gens] », annonce, le 30 juillet que les « premières amendes » suite à la loi [pas encore votée) sur le harcèlement de rue auront lieu « à l’automne ». 782
Un commentaire du Figaro, note qu’elle « a été bien absente, silencieuse en ce qui concerne la violence de Benalla concernant la jeune femme [rappelons-le : qu’il met à terre, à violents coups de pieds].
Il y aurait donc pour Schiappa deux types d’agressions, celles sur lesquelles elle est silencieuse et qu’elle tolère parce que commises par les affidés de son maître, Macron, et les autres, toutes les autres, qu’elle dénonce. » 783 (Cf. Hommes. « Politiques ». Macron Emmanuel, Violences. Harcèlement de rue)
* Ajout. 1er août 2018. Lu dans Le Canard enchaîné :
« Déclaration de la secrétaire d’état Marlène Schiappa [LCI. 28 juillet 2018] : ‘Ce qu’a dit hier Alexandre Benalla converge en tous points avec les déclarations de l’Élysée. On a vu qu’il n’est pas le personnage de petite frappe qu’on a voulu inventer mais quelqu’un qui a travaillé, reconnait une faute énorme et a été sanctionné.’ » 784
Marlène Schiappa : la voix de son maître… Plus encore : elle dit ce que personne (auprès du maître) n’oserait déclarer…
Au-delà des gratifications personnelles qu’elle en reçoit, est-elle vraiment consciente du rôle politique qu’on lui fait jouer, et dont elle est l’objet ?
* Ajout. 9 février 2019. Elle le comprend sans doute lucidement, tout en jouant son propre jeu… Mais, avec quels risques…
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (40) : (29 août. 5 septembre) 2018. Lu dans Le Canard enchaîné, concernant l’éventualité d’un départ de Françoise Nyssen de son poste de ministre de la culture :
« En tout cas, les appétits s’aiguisent : la députée des Yvelines Aurore Bergé et la secrétaire d’état Marlène Schiappa sont sur les rangs pour lui succéder. […] »
Rien ne nous sera épargné… 785
* Ajout. 5 septembre 2018. Le Canard enchaîné publie un carton d’invitation de Marlène Schiappa en date du 27 août 2018 à « un dîner de rentrée littéraire en l’honneur des femmes ». On y lit :
« Dans le cadre de cette rencontre, nous vous invitions à apporter votre dernier ouvrage ». « Vous pouvez venir accompagnée de votre éditeur.trice ». 786
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (41) : (31 août) 2018. Je reçois la Veille de l’actualité́ [datée du 24 août 2018] du Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes. J’y lis que le 11 août 2018, dans La Provence Marlène Schiappa souligna notamment que « les droits de la femme et de l'homme ont deux ennemis, en apparence antagonistes, qui sont les extrémistes nationalistes d'un côté́, et les obscurantistes de l'autre ». « En réalité́, ils s'allient et se retrouvent souvent d'accord sur certains sujets ».
Pour preuve de son analyse :
« Qui me cible en ce moment sur les réseaux sociaux ? Les mêmes, pour promouvoir un idéal de société́ mortifère dans lequel les femmes n'ont plus de liberté́ ». 787
On peut noter qu’en une seule phrase, Marlène Schiappa réussit l’exploit de nier et le patriarcat et la domination masculine. (Cf. Penser. « Réseaux sociaux »)
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (42) : (9 septembre) 2019. Je reçois la Veille de l’actualité́ [datée du 7 septembre 2018] du Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes. J’y lis à la [seule] rubrique : « Revue de presse » :
Prostitution - Invitée de la matinale de la radio France Bleu Provence le 4 septembre, la députée Valérie Gomez-Bassac [dont il n’est pas précisé qu’elle est députée LREM, du parti de Marlène Schiappa donc] a déclaré être favorable à l'ouverture de maisons closes et dénonce « l'hypocrisie générale qui entoure la prostitution ». Signalons que « neuf associations, dont Médecins du Monde et le Syndicat du travail sexuel (Strass), et cinq travailleuses du sexe ont déposé hier au Conseil d’État une Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) contre la loi prostitution d'avril 2016 qui pénalise les clients, a indiqué (le 6 septembre) leur avocat » (Agence France Presse). Enfin, Le Point publie le 7 septembre une ‘ enquête sur les nouveaux visages du proxénétisme en France. »
Comment ne pas penser que cette information telle que présentée est, dans l’attente, une caution politique de Marlène Schiappa à la réouverture officielle des bordels ?
Un démenti ? (Cf. Relations entre êtres humains. Hypocrisie, Proxénétisme, Violences. Harcèlement sexuel)
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (43) : (12 septembre) 2018. Je lis dans Le Canard enchaîné deux articles la concernant :
- le 1er lors de la manifestation du 8 septembre 2018 : Après avoir évoqué le porte-parole du gouvernement qui considère que le départ du gouvernement de Nicolas Hulot est « une bonne nouvelle », la suite […] :
« Tandis que Marlène Schiappa manquait de s’attacher à un arbre pour mieux récupérer le mouvement : ‘Oui, tu vois, tu n’es pas seul, Nicolas’ a-t-elle tweeté en taclant Hulot au passage ([qui s’était plaint d’être (seul)]. Nous sommes des millions (sic) chaque jour à agir pour la transition énergétique au-delà des clivages. » Et donc quasiment prêt-es à suivre la politique « écolo » d’Emmanuel Macron... 788
- le deuxième qui nous procure le chiffre officiel - 3000.000 euros - de la « première université du féminisme » organisée par elle, les 13 et 14 septembre 2018. Et Le Canard poursuit :
« Ce déploiement d’argent, à n’en pas douter, tirera une larme aux associations accueillent les femmes victimes de violences, en proie aux brutalités budgétaires de l’État. » 789
Suivent trois exemples, auxquels entre autres associations sacrifiées, menacées, amputées, peut s’adjoindre l’AVFT. (Cf. Économie. Brutalité)
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (44) : (13 septembre) 2018. Marlène Schiappa affirme :
« Le féminisme, ça ne doit pas être une secte. » 790
Il est des termes - ici : « secte » - qui chez certaines personnes sont d’emblée politiquement inquiétants. Car, qui va le définir : elle ?
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (45) : (13 septembre) 2018. Marlène Schiappa au cours du même interview affirme :
« Je ne veux pas stigmatiser les hommes », suivi peu après - faisant de ces deux verbes sinon des synonymes, du moins des équivalents - :
« Je ne veux pas dénoncer les hommes. » 791
Le rapport que la personne de Marlène Schiappa entretient avec l’État, la loi, à la justice mérite, à tout le moins, une certaine mise au point.
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (46) : (21 septembre) 2018. Marlène Schiappa participe, dans le cadre d’une série d’émissions de France Culture intitulée « Sexualité et société », à l’une des invitées :
« Sexualité, comment légiférer ? »
La secrétaire d’état en débat avec une sociologue.
Avec l’AVFT, ayant une connaissance du droit, elle, compétente ? Hypothèse exclue.
Le choix de l’interlocutrice est aisément compréhensible ; cela marche, comme cela devait, comme sur des roulettes. (Cf. Politique. Médias, « Sciences » sociales. Sociologie, Sexes. Sexualité)
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (47) : (11 octobre) 2018. Dans Challenges, Marlène Schiappa, concernant Emmanuel Macron, auteure de :
« Il est christique […]. Les gens le ressentent comme moi (sic), ils aiment qu’il les touche, les prennent par les épaules, les embrasse. Il faut assumer ce côté-là, et tant pis (sic) pour ceux qui ricanent. » 792 (Cf. Femmes. Aliénées)
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (48) : (14 octobre) 2018. Lors de l’émission C Politique, pour tenter une fois encore de justifier sa position - toujours indéfendable - à l’encontre de l’AVFT, Marlène Schiappa a expliqué qu’elle avait augmenté le budget du Collectif féministe contre le viol ! 793
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (49) : (16 octobre) 2018. Marlène Schiappa s’est vue lors de la nouvelle composition du gouvernement adjoindre à son titre de « chargée de l’égalité […] », « la lutte contre les discriminations ».
Dissolvez, dissolvez… (Cf. Droit. Discriminations)
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (50) : (17 octobre) 2018. Marlène Schiappa « se voit favorite » pour prendre la tête de LaREM [La république en marche].
« L'entourage de cette macroniste de premier plan y va, on ne peut plus cash : ‘Marlène Schiappa est en position de gagner haut la main sans concurrent sérieux si elle y va, car elle a à la fois le fond politique, la proximité du Président, l'expérience de référente, l'ADN d'En marche et la popularité dans le mouvement et en dehors. » N'en jetez plus.
‘A ce stade, elle s'interroge car elle veut bien consulter et associer toutes les strates avant de prendre une décision’ et de candidater (ou non), temporise-t-on toutefois... avant de préciser qu'elle ‘échange tous les jours avec le Président’ et que les deux ‘se sont parlé’ de cette succession. La secrétaire d'état ‘trouve que le mouvement manque de structuration idéologique’, ajoute-t-on pour enfoncer le clou. C'est ce qu'on appelle faire campagne. » 794
* Ajout. 21 octobre 2018. Dans le Journal du Dimanche, après avoir déclaré qu’elle « pense incarner l’ADN du mouvement et une forme de renouvellement », elle évoque aussi « sa capacité à prendre ‘la lumière’. »
Elle explique aussi qu’il « faut soutenir les équipes dans les territoires » et « armer intellectuellement nos militants. »
Elle « évoque aussi la possibilité ‘d’une hotline pour les territoires‘ ou ‘l’élection d’ambassadeurs régionaux’ afin d’ajouter ‘un soupçon de démocratie locale’ à un parti jugé trop vertical. ‘Le rôle du mouvement, c’est protéger le président‘ complète-t-elle enfin. » 795
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (51) : (31 octobre) 2018. Lu dans Le Canard enchaîné :
« Avant d’annoncer, le 25 octobre par tweet, qu’elle renonçait à se présenter à la présidence d’En Marche, Marlène Schiappa avait prévu un grand raout pour ‘dynamiser’ sa candidature, comme on dit chez Macron. La secrétaire d’état chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes avait invité, le 20 octobre dernier à son ministère, l’ensemble des référents départementaux [d’En marche]. Mais voilà : Schiappa a dû annuler sa fiesta après s’être fait rappeler à l’ordre par l’Élysée, au motif que les membres du gouvernement ne devaient pas utiliser au profit de leur parti les moyens de leur ministère. Qui sait, elle aurait peut-être eu droit à une perquise au petit matin ? »
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (52) : (1ernovembre) 2018. Lu le titre d’un article paru dans Match :
« Marlène Schiappa donne des mèches de ses cheveux pour les femmes atteintes d’un cancer. »
Je lis aussi que « l’entourage de Marlène Schiappa a confirmé à l’AFP l’authenticité du message » :
« L’initiative est utile pour les femmes atteintes d’un cancer ‘qui n’ont pas toujours les moyens de s’acheter une perruque’. » 796 (Cf. Corps. Cheveux)
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (53) : (7 novembre) 2018. Tweet de Marlène Schiappa :
« Stop aux contresens ! (sic) Le Maréchal Pétain, traître à la patrie, a été condamné à l’indignité nationale. Le Président de la République ne va PAS le célébrer. Samedi, seuls les Maréchaux aux Invalides recevront un hommage : Foch, Lyautey, Franchet d’Esperey, Maunoury, Fayolle. » 797
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (54) : (14 novembre) 2018. Je lis dans Le Canard enchaîné que Marlène Schiappa a, en un an, « obtenu 10 % de mieux [d’augmentation] pour certains membres de son cabinet », alors que l’augmentation est en moyenne de 2,6 % concernant les autres cabinets et que celui du secrétariat d’état aux armées a lui été abaissé de 19,9 %. 798
Elle a précisé dans le Journal du dimanche du 12 novembre 2018 cependant que plusieurs de ses conseillers ont été augmentés de « 10 ou 15% ».
« Je ne trouve pas ça déraisonnable au bout de 18 mois à travailler sept jours sur sept d'arrache-pied », a-t-elle fait valoir.
N.B. Le montant brut du Smic mensuel 2018 (sur la base de la durée légale du travail soit 35h par semaine ou 151,67 heures par mois) est de 1.498,47 € (contre 1.480,27 euros en 2017, ce qui représente une hausse de 18 euros par mois).
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (55) : (3 décembre) 2018. Marlène Schiappa, après trois semaines de bouleversements de la France, auteure de :
« Notre cap est le bon. Quand vous voulez atteindre le sommet d’une montagne, il faut garder votre objectif. Mais si le chemin est trop difficile à grimper pour les plus fragiles, les premiers de cordées doivent ajuster le chemin pour ne laisser personne sur le bord de la route. » 799
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (56) : (16 décembre) 2018. Marlène Schiappa, concernant « les nouvelles revendications » des « Gilets jaunes » (après la suppression de la hausse de la taxe carbone et une « hausse du pouvoir d'achat », annoncés par Emmanuel Macron) propose son analyse :
« Ça n’est pas sérieux. » 800 (Cf. Économie. « Pouvoir d’achat »)
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (57) : (31 décembre) 2018. Marlène Schiappa, auteure, sur BFM-TV, « en toute finesse » commente Le Canard enchaîné, de :
« Nous avons un grand président qui fait face avec courage et lucidité à la situation. Vérité, dignité et espoir seront les maîtres mots de 2019. » 801
S’il n’en reste qu’une…
Et, effectivement, elle est souvent bien seule à le soutenir encore…
* Ajout. 22 février 2019. Emmanuel Macron, auteur de :
« Qui m’a soutenu pendant la crise des ‘Gilets jaunes’ ? Personne. » 802 (Cf. Êtres humains. Soi, Hommes. « Politiques ». Macron Emmanuel, Politique. « Gilets jaunes »)
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (58) : (8 janvier) 2019. Suite à l’incarcération du manifestant « Gilet jaune » - Christophe Detttinger - qui avait frappé un CRS, une cagnotte avait été ouverte pour financer sa défense. Sur BFM-TV, Marlène Schiappa a jugé nécessaire de poser la question :
« Qui finance, qui soutient, qui est complice de ces violences graves ? Réussir à collecter plus de 120.000 euros en 24 à 48 heures, cela veut dire qu'il y a derrière des gens qui financent et qui sont complices de ces violences. Il ne faut rien laisser passer à ce sujet non plus. »
Marlène Schiappa demande donc l’identification des donneurs et donc la levée de l’anonymat et les rends tous « complices ». Pénalement ? 803
Je ne peux m’empêcher en la lisant, de poser la responsabilité de ceux / celles qui la laissent exprimer les basses pensées de l’exécutif, et les médias de s’en gaver. (Cf. Politique. Médias)
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (59) : (22 janvier) 2019. La co-animation vendredi 26 janvier 2019 de l’émission Balance ton post par Cyril Hanouna et Marlène Schiappa ayant provoqué de nombreuses réactions, celle-ci la justifia, mais elle dut aussi établir un lien avec ses fonctions ministérielles. J’ai alors pu voir, la télévision, à deux reprises une grossière manipulation d’images. Alors qu’elle était interviewée seule pour défendre sa participation à cette émission, furent intercalées, à trois différentes reprises, des images antérieures d’elle-même, mais accompagnée, soutenue - comme si elle était approuvée sur ce point particulièrement litigieux - par Muriel Salmona, présidente de l’association Mémoire traumatique et victimologie, épanouie (dans un tout autre contexte, donc) à ses côtés…
J’ai pu lire furtivement que ces images provenait du ‘Tour de France de l’Égalité entre les femmes et les hommes qui s’était déroulé d’octobre 2017 à mars 2018.
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (60) : (26 janvier) 2019. Marlène Schiappa, lors de l’émission Balance ton post de Cyril Hanouna, laquelle s’inscrivait dans le cadre du « grand débat national » initié par Emmanuel Macron auteure de :
« On est dans un pays où on aime se plaindre. »
Les « Gilets jaunes », notamment ceux et celles qui croulent sous les difficultés auxquelles ils / elles ne peuvent faire fac, apprécieront la conscience politique de Marlène Schiappa et le respect qu’elle leur porte. 804 (Cf. Politique. « Grand débat national »)
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (61) : (21 février) 2019. Selon Marlène Schiappa, - que sa troisième directrice de cabinet a quittée le 15 février 2019 805 - dans un interview à Valeurs Actuelles - il existe une « convergence idéologique » entre La manif pour tous [qui, majoritairement catholiques, était opposé au mariage homosexuel] et « les terroristes islamistes ». Et, elle peut, dans la foulée de sa pensée, lier homophobie et antisémitisme… 806
À moins de considérer que sa parole n’a aucune valeur, ce que dit Marlène Schiappa - qui récuse, pour d’autres, le qualificatif d’ « intellectuel » à un « raisonnement » - juge la pensée, la politique d’Emmanuel Macron [qui l’a choisie] et d’Édouard Philippe [dont elle est membre de son gouvernement].
Mais en deçà et au-delà, les questions que je me pose sont :
Comment et pourquoi Marlène Schiappa a-t-elle pu prendre une telle place dans l’exécutif ?
Comment et pourquoi outrepasse-t-elle sans cesse le périmètre de ses fonctions institutionnelles ?
Comment et pourquoi son incompréhensible liberté d’expression politique est-elle actuellement apparemment incontrôlée ?
N.B.1. L’explication selon laquelle elle est/serait l’amie de Brigitte Macron n’en est pas une. Il s’agit d’un problème - politique, et qui ne se limite pas à la question de l’organisation de l’exécutif. (Cf. Politique. Islam)
N.B.2. Peut-être, simplement, est-elle chargée d’exprimer publiquement ce que l’exécutif n’ose pas, à l‘instant donné, assumer.
* Ajout. 22 février 2019. La Manif pour tous veut porter plainte pour « diffamation publique » contre Marlène Schiappa devant la Cour de Justice de la République. 807
* Ajout. 26 mars 2019. 1790. Edmund Burke [1729-1797], dans ses Réflexions sur la Révolution de France, auteur de :
« Quand vous voyez des gens renoncer à leur qualité pour assumer un rôle qui n’est pas le leur, soyez sûr que dans la plupart des cas, ils connaissent aussi mal ce qu’ils abandonnent que ce qu’ils entreprennent. » 808 (Cf. Êtres humains. Soi, Relations entre êtres humains)
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (62) : (10 mars) 2019. Muriel Robin, sur C’Politique, après l’assassinat de Julie Douib par son ex-compagnon, trente femmes depuis le début de l’année 2019, soit une femme assassinée par un homme tous les deux jours, auteure de :
«[…] J’ai rencontré le premier ministre avec Marlène Schiappa : on m’a fait comprendre que ce qui a été fait était mieux qu’avant. […] » 809 (Cf. Penser. Comprendre, Politique)
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (63) : (25 mars) 2019. Concernant les hommes qui ne paient pas, peu ou qui paient mal la pension alimentaire, le plus souvent insuffisante qu’ils doivent - selon la loi, mais sans oublier toutes les autres…- Marlène Schiappa a déclaré :
« Nous avons des femmes qui paient l’incivisme de leur ex-conjoint ». 810
Au lieu et place de : Des hommes ne font aucun cas de la vie de leurs compagnes et de leurs enfants, les contraignant souvent à la pauvreté, récusent leurs engagements et violent la loi, censée les ‘protéger’. (Cf. Droit, Famille. Divorce. Pensions alimentaires, Justice, Langage. Patriarcal)
* Ajout. 19 septembre 2019. La ministre de la justice emploie ce jour sur BFM-TV (11h 30) l’expression de « débiteur défaillant. » Qu’il est difficile d’affirmer que les hommes violent la loi… (Cf. Droit, Famille. Divorce. Pensions alimentaires, Justice, Langage. Patriarcal)
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (64) : (28 mars) 2019. J’entends incidemment - et sans preuve - qu’il serait question qu’elle se présente à la mairie de Marseille.
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (65) : (25 avril) 2019. Marlène Schiappa, dans un tweet, en date du 25 avril - publiquement critiqué par le syndicat des commissaires de la police nationale - auteure de :
« On qualifie mieux les féminicides désormais. Un meurtre de femme qui avant était comptabilisé comme un accident domestique va désormais plus souvent être qualifié comme meurtre par conjoint. Les choses progressent. Mais la prise en charge doit être + rapide. » 811
Quelle incompétence de la part de quelqu’une qui se permettait de juger l’AVFT…
N.B. Le terme de Feminicide - qui s’est substitué à fémicide - qui mêle toutes les violences dont les femmes sont les victimes - émanant de l’État, des époux, des proxénètes…, ouvrant la voie à toutes les confusions juridiques, politiques, sémantiques est en lui-même très dangereux. (Poursuivre) (Cf. Violences. Violences à l’encontre des femmes. « Féminicides »)
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (66) : (9 juin) 2019. Dans Le Journal du Dimanche, Marlène Schiappa publie une tribune dans laquelle je lis :
« […] Que vous veniez de LR, d’EELV, du PS ou du Parti animaliste, tout ce qui nous intéresse, c’est : êtes-vous prêts à faire passer votre pays avant votre parti ? Êtes-vous prêts à porter et défendre des idées, peu importe leur provenance, au service des Français ? »
J’apprends ainsi que celle-ci - qui ne se soucie pas de la « provenance » des idées - est dorénavant « responsable du débat d’idées à LREM. » 812 (Cf. Penser. Idées, Politique. Nationalisme)
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (67) : (12 juin) 2019. Communiqué de La marche mondiale des femmes :
« Le 7 juin [2019], le Sénat, sur proposition de Laurence Rossignol, a voté l'allongement du délai pour pouvoir avorter légalement de 12 à 14 semaines. D'autres amendements, comme la suppression de la clause de conscience ou l'avortement instrumental par les sage-femmes, ont été rejetés dans la même séance. Mais, ce mardi 11 juin, Agnès Buzyn, ministre de la santé et des solidarités, a fait revoter l'amendement qui a été là rejeté. Juste après, dans un communiqué, Marlène Schiappa a fait savoir qu'elle ‘soutient la mission lancée par la Délégation aux Droits des femmes de l'Assemblée nationale... qui ... débouchera sur le dépôt d'une proposition de loi avec pour objectif d'expertiser l'accès à l'IVG en France et l'allongement du délai d'accès de 12 à 14 semaines.’ » 813 (Cf. Femmes. Avortements, Penser. Expert-es)
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (68) : (6 août) 2019. Dans le JDD, Marlène Schiappa emploie, la concernant, le qualificatif de « sapiosexuelle ».
Elle déclare aussi qu’elle « réfléchit à présenter sa candidature » à la tête de LaREM [la république en marche]. 814
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (69) : (10 novembre) 2019. De quel droit Marlène Schiappa s’autorise-t-elle à considérer que la manifestation de ce jour intitulée Non à l’islamophobie, « est en fait surtout une marche contre la laïcité. » (Tweet, ce jour)
De quel droit s’autorise-t-elle en dénaturer le projet, à en redéfinir la finalité, à en déposséder l’idée à celle de ses initiateurs ? (Cf. Êtres humains. Haine, Langage. Adverbe, Penser. Juger)
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (70) : (12 février) 2020. Lu dans Le Canard enchaîné, repris du Figaro [10 février] : « Je serais celle qui se placera entre la balle et le Président, s’il le faut. » 815
Un beau projet de dévouement politique qu’elle pourrait proposer comme modèle aux femmes violentées… Que de mascarades nous inflige-t-on… (Cf. Êtres humains, Soi)
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (71) : Cf. Coronavirus : 31 mars 2020, 6 avril 2020, 7 juin 2020, 7 juillet 2020, 9 juillet 2020. http://www.marievictoirelouis.net/document.php?id=1193&mode=last
Femme (« Politique » Schiappa Marlène) (72) : Suite et fin : Marlène Schiappa dans le gouvernement Jean Castex est sous les ordres d’un homme dénoncé comme violeur et harceleur. (Cf. Hommes. « Politiques ». Darmanin Gérald, Langage. Possessif. Darmanin Gérald)
* Ajout. 14 avril 2021. Lu, rue du Sommerard (Paris 5ème) Darmanin. Sale violeur. (Cf. Violences. Violences à l’encontre des femmes)
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (73) : (24 septembre) 2020. Marlène Schiappa, sur un tweet, auteure de :
« On a fait la PMA pour toutes les femmes […]. » 816 (Cf. Langage. Critique de mot : « On ». Verbe. Faire)
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (74) : (5 novembre) 2020. Marlène Schiappa, dans Valeurs actuelles, auteure de :
« Je suis corse, j’entends ceux qui demandent pourquoi la police n’a pas abattu tel terroriste qui occupe désormais tel lit d’hôpital. Ceux qui me disent cela sont des gens sensés, pas des fous. » La pensée féministe et celle de la lutte contre les violences faites aux femmes de Marlène Schiappa mène décidément très loin… 817
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (75) : (11 décembre) 2020. Marlène Schiappa concernant son nouveau poste de chargée de la Citoyenneté auprès au ministère de l’intérieur, auteure de :
« Mon quotidien ici n’a rien à voir avec celui de l’égalité. Ici, on s’apprête à rentrer à la maison et on reçoit un texto : un homme a été décapité. On est confrontée à des choses tragiques en permanence. Pardon de le dire comme ça, mais on est davantage dans la gravité, dans des choses graves. »
Commentaire des Effrontées :
« Les féminicides, les viols, des broutilles ? » (Cf. Violences)
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (76) : (24 février) 2020. Lu dans Le Canard enchaîné :
« ‘La France va plonger dans le chaos’. Ces temps-ci, Marlène Schiappa broie du noir. Elle le confie à ses collègues ministres et à des parlementaires : L’après-covid va tourner au cataclysme. La faute aux gens qui vont se lâcher. Et de prédire une multiplication des ‘ comas éthyliques‘, des ‘viols’ et ‘violences en tout genre (sic), des ‘débordements permanents’ et ‘une prolifération des affrontements’. Pire que tout, la ministre déléguée à la citoyenneté craint le retour des gilets jaunes : ‘Avec eux, nous pourrions connaître une version française de l’invasion du Capitole’.
Un seul espoir donc : que le virus reste présent le plus longtemps possible ».
Pour mieux comprendre les liens entre la lutte contre « les violences » et la défense de l’ordre dans, de, par l’État. 818 (Poursuivre)
Femmes (« Politiques ». Schiappa Marlène) (77) : (5 avril, 19 avril) 2023. Le 5 avril 2023 Isabelle Borne, ministre de l’égalité entre les femmes et les hommes accuse :
« Je m'interroge : pourquoi avoir choisi Playboy pour faire avancer le droit des femmes alors que ce magazine est un condensé de tous les stéréotypes sexistes ? Nous sommes en plein dans la culture de la femme-objet. […] Défendre les droits des femmes dans Playboy - revue dans laquelle Marlène Schiappa avait posé - « pas nue » a-t-elle cru bon préciser, en échange de quoi elle avait été interviewée - reviendrait lutter contre l’antisémitisme en accordant un entretien à Rivarol. » Voici, le 19 avril 2023, sa réponse :
« Ne pas avoir de notoriété, ce n’est pas grave en politique. Ne pas avoir d’action concrète, déjà plus. Ne pas avoir de tripes, encore pl. tu nes qu’un sac à main de seconde main. Trouve le courage de me rappeler plutôt que de parler dans mon dos. » Quelle femme charmante… 819
-------------
Femmes. « Politiques ». Sid Cara Nafissa :
Femmes (« Politiques ». Sid Cara Nafissa) (1) : 1959. Nafissa Sid Cara [1910-2002] fut la seule femme ministre lors du premier gouvernement Michel Debré [1912-1996] de la Vème République [1959-1962] ; plus justement, elle fut secrétaire d’état « chargée des questions sociales en Algérie et de l'évolution du statut personnel de droit musulman ». 820 (Cf. Droit. Musulman)
* Ajout. 7 octobre 2020. Plus importants sont les dénis, plus nécessaires sont les symboles.
Femmes (« Politiques ». Sid Cara Nafissa) (2) : (26 avril) 1959. Mouloud Feraoun [1913-1962] écrit dans son Journal :
« Au total les femmes supportent durement le poids de la guerre, on les bat comme les hommes, on les torture, on les tue, on les met en prison. Après tout cela, les décrets de de Gaulle, inspirés ou non par Melle Sid Cara, peuvent toujours proposer des réformes, c’est terminé, il n’y plus rien à réformer. » 821 (Cf. Politique. Colonialisme. Réformes. Guerre. Algérie)
-------------
Femmes (« Politiques ». Suzman Helen) : Helen Suzman [1917-2009], femme politique progressiste Sud-Africaine, députée de 1953 à 1989, fut l’un-e des symboles de la lutte des libéraux blancs contre l’apartheid. Attaquée en tant que femme, juive, blanche, libérale, ses engagements politiques n’ont pas cessé à la fin de l’apartheid ; plus encore, elle fut très critique à l’égard de l’ANC. (Cf. Politique. Apartheid)
Femmes (« Politiques ». Taubira Christiane) : (23 juin) 2015. Christiane Taubira, en réponse, à l’assemblée nationale, à une critique d’un député de droite (extrême), Éric Ciotti, auteure de :
- « Monsieur le député, j'avoue que malgré toutes ces années passées, vous conservez pour moi quelque chose de mystérieux. Je me demande si lorsque vous affirmez certaines choses vous y croyez vraiment. Si c'était du temps de ma fringante jeunesse, j'aurais supposé un sentiment contrarié. Mais cet hémicycle tout entier a déjà constaté à quel point je vous obsède dans toute votre expression publique, avec une constance qui appelle quand même l'admiration. » Et elle poursuivit (concernant l’ordonnance du 2 février 1945 sur la justice des mineurs) :
- « Vous vous livrez à un exercice solitaire lorsque vous prétendez qu'elle était efficace’, suscitant à nouveau les rires de nombreux parlementaires, y compris à droite. » 822
Une sexualisation, sous le mode de l’humour, inappropriée de la politique ? (Cf. Dialogues, Féminismes. Humour)
Par ordre chronologique. Femmes « Politiques ». Margaret Thatcher :
Femmes (« Politiques ». Thatcher Margaret) (1) : (30 juillet) 2020. Un ouvrier métallurgiste anglais concernant Margaret Thatcher [1925-2013] :
« Cette femme a fait plus de mal au pays que la guerre elle-même. » 823 (Cf. Politique. Guerre. Lois, Économie. Utilitarisme)
Femmes (« Politiques ». Thatcher Margaret) (2) : (9 juillet) 2022. Christine Ockrent, interrogée par Émilie Aubry, aux Rendez-vous de l’histoire de Blois, auteure de :
« Le personnage de Margaret Thatcher [1925-2013] retrouve un certain regain, sinon de popularité, du moins de respect. » 824 (Cf. Femmes. Journalistes. Ockrent Christine)
-------------
Femmes (« Politiques ». Vautrin Catherine) : (24 janvier) 2024. Lu, dans l’article qui lui est consacré, Catherine Vautrin. Un jour mon Reims viendra, paru dans Le Canard enchaîné :
« […] Parfois, elle parle d’elle : ‘Je suis basique de chez basique’. Fallait-il le préciser ? ajoute Le Canard. »
Par ordre chronologique. Femmes. « Politiques ». Simone Veil :
Femmes (« Politiques ». Veil Simone) (1) : (26 novembre) 1974. Simone Veil [1927-2017], alors ministre de la santé, débuta son célèbre discours sur l’interruption volontaire de grossesse, à l’assemblée nationale, par ces phrases si souvent citées :
« Je voudrais vous faire partager une conviction de femmes. Je m’excuse de le faire devant une Assemblée constituée quasi exclusivement d’hommes : aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l’avortement. »
Je n’ai jamais compris de quoi devait-elle « s’excuser » ? D’être « une femme » ? De partager sa « conviction » [La sienne ou celle des femmes ?] avec des hommes ? D’aborder la question de l’IVG devant des hommes ? D’avoir à réfuter - à l’avance - leurs arguments ? (Cf. Femmes. Avortements)
Femmes (« Politiques ». Veil Simone) (2) : En lisant le livre d’Élisabeth Guigou, Être femme en politique (p.178), évoquant les « colères mémorables » de Simone Veil [1927-2017] je me suis souvenue de l’épisode suivant :
Trois présidentes d’associations de lutte contre les violences faites aux femmes (je me souviens de la présence de Simone Iff, présidente du Collectif féministe contre le viol, qui la connaissait personnellement, la troisième dont j’ai oublié le nom étant sans doute la présidente de la Fédération Solidarité femmes (Lutte contre les violences ‘conjugales’) avions demandé un RV pour contester je ne sais plus quoi concernant sa politique.
Le RV a été très bref, à peine avions nous abordé le sujet dont nous souhaitions lui parler, la ministre s’est mise très violement en colère, nous a injuriées et mises à la porte, sans autre forme de procès.
Je ne me souviens plus de la teneur exacte de ses propos, mais je me souviens très bien de ma réaction lorsque, ébahies, ahuries, sans avoir bien compris ce qui nous était arrivé, nous nous sommes retrouvées dans un taxi et d’avoir dit [ou simplement pensé ?] :
« Dans un autre pays, ce soir, nous étions en prison. ».
Et lorsque, tout de même très marquée par cet épisode, j’en ai parlé autour de moi parmi des personnes qui travaillaient dans son ministère, il m’a été répondu que ce type d’agissements de sa part était très connu. Le pire, sans doute, c’est que cela était présenté comme relevant d’une donnée, de l’ « acquis ». (Cf. Femmes. Colère)
* Ajout. 31 juin 2018. Ce qui est évoqué ici - n’étant sûrement pas la seule à avoir vécu de telles expériences - est sans doute ce que la si révérencieuse Émilie Aubry, sur France Culture, nomme le « caractère bien trempé » de Simone Veil [1927-2017]. 825
-------------
Femmes (« Politiques ». États-Unis. Warren Elizabeth) : 2016. Elizabeth Warren, sénatrice démocrate du Massachusetts, auteure de :
« Si Trump et le parti Républicain essayent de lâcher la bride des grandes banques afin qu’elles puissent une fois de plus jouer avec notre économie et tout mettre par terre, alors nous allons les combattre à chaque étape du chemin. » 826 (Cf. Hommes. « Politiques ». Trump Donald, Économie. Banques. Capitalisme)
* Ajout. 26 mars 2019. Lu, extrait d’un article de la revue Jacobin [USA] repris par Le Monde Diplomatique : Elizabeth Warren se dit « capitaliste jusqu’au bout des ongles. » 827
Femmes (« Politiques ». Weiss Louise) : La lecture de la vie de Louise Weiss [1893-1983], femme politique, remarquable, mais si critiquable et si peu sympathique devrait dissuader quiconque de toute recherche d’honneur, d’hommage et de reconnaissance officielles, qui apparaissent, la concernant, de manière si flagrante, si dommageables et si tristes. 828
* Ajout. 28 décembre 2020. Des années après ce jugement hâtif, étroitement circonscrit, injuste, et après avoir lu précisément le 3ème tome de ses Mémoires, Combats de femmes - dont nombre de passages sont ici cités - je me rends compte, heureusement pas trop tard, de sa perspicacité politique dans tant de domaines, de son indéniable courage, de sa liberté de parole, de sa capacité d’analyse et de la valeur de ses témoignages. 829
Par ordre chronologique. Femmes. « Politiques ». Leyla Zana :
Femmes (« Politiques ». Turquie. Zana Leyla) (1) : Leyla Zana, députée, femme « politique » kurde, condamnée à 15 ans de prison en 1994 fut libérée le 8 juin 2004, puis condamnée à nouveau à des années de prison. Son immunité parlementaire est levée en juin 2016, comme celle des autres membres du HDP (Parti démocratique des peuples).
Voici un passage d’un interview d’elle [qui fut mariée à 14 ans par son père à un homme de 35 ans] réalisé par Chris Kutschera, en 1994 :
« […] Dans le monde entier, la femme est maltraitée par les hommes. Mais chez les Kurdes, c’est particulier : elle n’est même pas traitée comme une domestique, la femme est un objet, un animal. Dans ma famille, par exemple, mon père, il dormait du matin au soir. Le soir, il se réveillait, et alors il voyait ses amis, il parlait avec eux. Ma mère, c’était le contraire : elle s’occupait des animaux, elle était dehors toute la journée, elle travaillait. Et malgré cela, le soir, quand elle rentrait à la maison, mon père la battait. Il fallait qu’elle fasse tout ce qu’il voulait, comme une esclave.
Ma mère était restée 12 ans après son mariage sans avoir d’enfant : après, elle a eu quatre filles, coup sur coup. Personne ne lui parlait, surtout pas la famille de mon père. Quand une de mes petites sœurs pleurait la nuit, cela dérangeait mon père : il prenait ma mère et la fillette, et il les jetait dehors, quel que soit le temps.
Une fille, ce n’est rien pour un Kurde. Il n’y a pas longtemps, j’ai eu la visite de mon père, qui m’a dit : ‘je veux marier ton frère’. Je lui ai demandé pourquoi. Il m’a dit : ‘Si un jour nous réussissons à faire un Kurdistan, je veux avoir un petit-fils’. Je lui ai dit : ‘Mais tu en as un, mon fils’. Mon père a répondu : ‘Non, celui-là ne m’intéresse pas, il ne porte pas mon nom’.
J’aime beaucoup mon père, mais il a une des originalités des Kurdes : quand il rentre à la maison, il imite la violence qu’il voit à l’extérieur, la violence des gendarmes, des policiers. […] » 830 (Cf. Femmes. « Objets », Politique. Esclavage. Égalité. Zana Leyla)
Femmes (« Politiques ». Turquie. Zana Leyla) (2) : 2015. Juliette Minces [1937-2021], dans De Gurs à Kaboul, qui a assisté au procès de Leyla Zana et de ses trois compagnons en 2014 à Ankara - condamné-es à 15 ans de prison - écrit :
« Je n’ai jamais assisté à quelque chose d’aussi honteux et vulgaire en matière de justice. » 831 (Cf. Justice. Procès. Pinar Selek)
-------------
IX. Femmes (Remarquables) :
Femmes. Remarquables :
Femmes (Remarquables) : Ne jamais oublier : chaque femme « remarquable » ici évoquée repose sur un océan de tombes de femmes non moins remarquables et à jamais oubliées.
Par ordre alphabétique. Femmes. Remarquables :
Par ordre chronologique. Femmes. Remarquables. Céleste Albaret :
Femmes (Remarquables. Albaret Céleste) (1) : 1991. Je lis dans le livre de Céleste Albaret [1891-1984] interviewée par Georges Belmont [1891-1984], intitulé Monsieur Proust, ceci qui m’a particulièrement touchée :
- « Il y a maintenant soixante ans que je l’ai vu pour la première fois, et pourtant, c’était comme si c’était hier. Souvent il me disait : ‘Quand je serai mort, vous penserez toujours au petit Marcel, car vous n’en trouverez jamais d’autre comme lui.’ » […]
- « Quand la vie s’est arrêté pour lui, elle s’est aussi arrêtée pour moi. »
- « Jamais il ne m’a abandonnée. Chaque fois, dans la vie, que j’ai eu à accomplir une démarche, j’ai trouvé un admirateur de Monsieur Proust qui aplanissait pour moi les difficultés, et c’était comme si, dans la mort, il avait continué à me protéger. » 832
Femmes (Remarquables. Albaret Céleste) (2) : (30 juillet) 2019. Céleste Albaret [1891-1984] sur France Culture, concernant ses relations avec Marcel Proust [1871-1929] dit :
« Il m’appelait, alors je venais » ; « Ce qu’il voulait, il fallait qu’il l’ait » ; « Il n’aimait pas qu’on fasse quelque chose qu’il n’aimait pas » ; suivi de : « Je trouvais tout normal ».
Écouter le passionnant interview de Céleste Albaret ]1891-1984] effectué par Georges Belmont [1909-2008], retransmis, via les archives, jusqu’alors enfermées et donc inédites, de la Bibliothèque Nationale, par France Culture. 833
Cette écoute me laissera plus d’émotions, de souvenirs, de vérités (et de réflexions sur la vérité) qu’À la recherche du temps perdu (pas entièrement lu et, peut-être faute d’émotions ressenties, largement oublié). (Cf. Penser. Vérité, Histoire. Archives)
* Ajout. 9 mai 2024. Venant de terminer Sodome et Gomorrhe, je n’ai certes pas ressenti d’émotions, mais un réel intérêt pour les personnages, et même une sorte d’envoûtement.
Femmes (Remarquables. Albaret Céleste) (3) : (2 août) 2019. Céleste Albaret [1891-1984], dans son entretien [près de 50 heures] avec Georges Belmont [1891-1984] : « Je ne peux pas être plus heureuse » disait-elle à Proust. Et aussi :
« Il m’a donné une affection immense » ; « Le destin m’a donné la plus belle vie du monde » ; « Proust m’a fait connaitre ce que je n’aurais jamais soupçonné […] ce qui m’a fait trouver l’autre vie [après sa mort] tellement vulgaire. C’est devenu très dur. » 834 (Cf. Femmes. Heureuses)
Femmes (Remarquables. Albaret Céleste) (4) : (2 août) 2019. Nathalie Mauriac-Dyer, « spécialiste de Proust », auteure de :
« Céleste n’a pas de vie. Elle n’a que la vie de Proust. » 835
Comment peut-on… ?
-------------
Femmes (Remarquables. Ambapali) : Voici la présentation de cette femme, « la belle courtisane propriétaire de ‘bois de manguiers’ », disciple du Bouddha, telle que présentée par Alexandra David-Neel [1868-1969] :
« C’est la Magdeleine de l’Évangile bouddhiste, mais une Magdeleine d’un tout autre caractère, sans passion, sans sentimentalité : Ambapali était une intellectuelle, une lettrée, une Aspasie hautement honorée, ‘la gloire de la ville de Vaiçali. Le Bouddha fut son hôte et c’est à elle qu’on a fait dire : ‘Rares sont les femmes capables de comprendre la profondeur et la subtilité de la doctrine…’ Et il la traite en auditeur valable ; c’est la seule femme avec Vissika la riche matrone qui apparaissent dans les Écritures comme ayant été appréciés par le Bouddha pour leurs capacités intellectuelles et Amballi qui savait tant de langues, tant d’arts et connaissaient les systèmes philosophiques a le pas sur Vissika. Elle devint religieuse sans fracas, sans croire qu’elle n’avait rien à expier, à déplorer, comme une reine qui aurait compris la vanité des choses. On lui attribue des vers délicieux. » 836 (Cf. Relations entre êtres humains. Vanité)
Femmes (Remarquables. Antigone) : 1951. Albert Camus [1913-1960], dans L’homme révolté, auteur de :
« [...] Antigone, elle-même, si elle se révolte, c’est au nom de la tradition, pour que ses frères trouvent le repos dans la tombe et que les rites soient observés. En un certain sens, il s’agit avec elle d’une révolte réactionnaire. » 837 (Cf. Politique. Révoltes)
* Ajout. 1er mars 2023. Présenter Antigone, comme agissant au seul respect de « la tradition », de l’« observ[ance] des rites » peut-il être - même « en un certain sens » - considéré comme […] « réactionnaire » ?
N’est-ce pas nier la révolte, le courage, la force, la pensée d’Antigone ? Si.
Femmes (Remarquables. Arthaud Florence) : Florence Arthaud [1957-2015], interrogée concernant ses craintes à la veille d’un départ en solitaire pour la Route du Rhum, répondit :
« Plus le départ approche, moins je suis angoissée et plus j’ai le moral. »
Yann Queffelec, lui aussi marin, s’exprimait, la concernant, ainsi :
« On disait d’elle qu’elle était ‘la petite fiancée de l’Atlantique’…à moins qu’elle n’ait été le grand amour de tous les océans […], l’épouse unique de tous ces horizons qu’elle avait à cœur de conquérir, l’un après l’autre, de charmer et de ne pas décevoir. […] » 838
Femmes (Remarquables. Aubrac Lucie) : Lucie Aubrac [1912-2007] à ceux et celles qui demandaient ce qu’ils auraient fait pendant la guerre, leur répondait pertinemment :
« Demandez-vous ce que vous faites aujourd’hui. » 839
Femmes. Remarquables. Thérèse d’Avila :
Femmes (Remarquables. Avila Thérèse d’) (1) : Thérèse d’Avila [1515-1582] : quelle femme ! Complexe, subtil et fascinant alliage de masochisme et d’estime de soi, de réalisme et d’extases, de valorisation de l’intelligence et de croyance au diable, de respect (exigé) de l’autorité et de rébellions, de candeur, de lucidité et de sensualité et enfin, d’une immense volonté de puissance (réalisée). Et ce, sous le règne de l’Inquisition. Fine politique ; remarquable force de caractère.
Relativise le mysticisme en l’humanisant, mais, dès lors, le démystifie. 840 (Cf. Êtres humains. Soi. Négation de, Justice. Inquisition, Penser. Croyance)
N.B. Elle fut canonisée en 1622 et reconnue « docteur de l’Église » en 1970.
Femmes (Remarquables. Avila Thérèse d’) (2) : Après lecture, dans le Livre des fondations [1573-1582] de Thérèse d’Avila [1515-1582], des règles, humainement, politiquement terrifiantes, imposées dans les monastères qu’elle créait, l’appréciation précédente est remise en cause. Une véritable pensée totalitaire de la destruction de soi (des autres serait plus juste…), laquelle, comme toute pensée, a fortiori effectivement mise en œuvre, a largement dépassé et pour longtemps les seules communautés religieuses de femmes. (Cf. Êtres humains. Soi. Négation de soi, Femmes. Religieuses)
Femmes (Remarquables. Avila Thérèse d’) (3) : 2001. Pietro Citati [1930-2022], dans Portraits de femmes, concernant Sainte Thérèse [d’Avila] [1515-1582], auteur de :
« Entre le milieu du XVIème siècle et le milieu du XVIIème, époque où apparurent dans la culture européenne les grands organisateurs de la pensée humaine, il n’y eut pas d’intelligence plus limpide, d’architecte spirituel plus robuste et plus délicat que sainte Thérèse. À la lecture de la Vie et du Château intérieur, l’on est séduit par cette prodigieuse aptitude à distinguer les sensations, les sentiments, les inclinations, les causes, les différentes régions et les diverses profondeurs de l’esprit, et à construire l’édifice systématique de la pensée. Comme nous nous sentons grossiers avec notre ‘Ça’, nos ‘complexes’, nos ‘refoulements’, devant la puissance de cette intelligence ! » 841 (Cf. Femmes. Intelligentes, Penser)
Femmes (Remarquables. Avila Thérèse d’) (4) : 2012. Pour Gallimard, dans La Pléiade, Thérèse d’Avila ne se suffisait pas à elle-même : Gallimard l’a ‘mariée’ en esprit et en intelligence avec « Saint Jean de la Croix », dont les écrits ont été conjointement avec les siens publiés en un seul volume. Dès lors « Thérèse » et « Jean » [dépossédé-es de leur nom] ayant été fusionnés, le féminin a disparu, subsumé, englobé dans le masculin :
« Ces deux maîtres spirituels, Thérèse (1515-1582) et Jean (1542-1591), sont aussi deux écrivains de premier plan. Ils furent deux individus engagés dans leur siècle, liés dans la contemplation comme dans l'action, et résolus, pour réformer le Carmel, à affronter le monde auquel ils appartenaient. »
On peut aussi noter l’inanité - ou la banalité ? - de la phrase. 842 (Cf. Culture, Femmes. « Féminin », Patriarcat, Penser. Pensées. Synthèse)
Femmes (Remarquables. Avila Thérèse d’) (5) : 2015. Je lis : « Ce qui ne fait pas de doute, c’est l’importance que Balzac [Honoré de. 1799-1850] attache à la figure de la sainte d’Avila [1515-1582], ‘cette sainte si voluptueusement tendre’, comme il l’écrit dans sa jeunesse dans son Traité de la prière. [?] » 843
-------------
Femmes (Remarquables. Ayoub Mouna) : 2000. Mouna Ayoub, auteure de :
« Je ne suis pas une passionaria de la cause des femmes, le féminisme militant m’intéresse moins que mon féminisme quotidien. Quand je me lève le matin je me regarde, je vois une femme et je me répète : ‘Je ne serai jamais humiliée par un homme’. La plupart des problèmes de ma vie ont été causés par des hommes : mon père, les maris de mes tantes, mon mari plus tard. » […]
Les États, notamment l’Arabie Saoudite et le Liban, qui ont justifiés la manière dont ses « problèmes » sont ‘advenus’, auraient sans doute pu être cités, en sus, par elle.
N. B. (Pour tant que je le sache effectivement) Si elle obtint beaucoup d’argent en conséquence de son divorce, elle « dut » perdre ses cinq enfants. 844 (Cf. Famille. Divorce, Féminismes)
Femmes (Remarquables. Balabanoff Angelica) : 1931. Emma Goldman [1869-1940], dans Vivre ma vie, concernant la Russie révolutionnaire de 1922 compare Angelica Balabanoff [1878-1965] avec Alexandra Kollontaï [1872-1952] :
« Les deux femmes communistes les plus éminentes de la Russie présentaient le plus grand contraste. Angelica Balabanoff manquait de ce que Kollontaï possédait en abondance : belle silhouette, beauté et grâce juvénile ainsi que brillant mondain et sophistication. Mais Angelica possédait une chose qui surpassait de loin les attributs de sa splendide camarade. Dans ses grands yeux tristes brillaient la profondeur, la compassion et la tendresse. Les tribulations de son peuple, les douleurs de l’enfantement de son pays natal, les souffrances endurées par les opprimés qu’elle avait servis toute sa vie étaient profondément gravés sur son visage blafard. » 845 (Femmes. Comparaison entre femmes, Politique. Démocratie. Peuple)
Femmes (Remarquables. Barín Kobané) : 2018. Céline Pina écrit sa page Facebook :
« Elle s’appelait Barín Kobané. Elle était Kurde. Capturée vivante par les Turcs, elle a été torturée, assassinée, ses seins ont été découpés. Et autour de son corps atrocement mutilé, les soldats hurlent de joie et crient Allah Akbar. […]
Voilà ce que font les soldats d’Erdogan et ses alliés. Voilà ce que cautionnent de fait nos dirigeants en faisant semblant d’ignorer les crimes des turcs. […]
Voilà comment on traite celles et ceux qui ont fait rempart de leur corps pour nous protéger de l’état islamique. Voilà comment a été traitée cette jolie femme qui vous regarde. » 846 (Cf. Corps. Seins, Hommes. « Politiques ». Erdogan Recep Tayyip, Politique. État. Répression, Économie. Erdogan Recep Tayyip, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
Par ordre chronologique. Femmes. Remarquables. Joséphine Baker :
Femmes (Remarquables. Baker Joséphine) (1) : 2001. Je lis dans les Mémoires de Jean-Claude Brialy [1933-2007] l’échange qui eut lieu entre Joséphine Baker [1906-1975] et de Gaulle [1890-1970]. Après son expulsion en 1946 des Milandes, petit château dans lequel elle vivait avec son mari et les douze enfants qu’elle avait adoptés, Joséphine Baker, voici ce qu’il écrit :
- « C’est à cette époque [sans date] que le Général de Gaulle l’invita à venir le voir. Il n’oubliait pas que Joséphine avait été une grande résistante dans la Deuxième DB et avait obtenu la croix de guerre et la légion d’honneur à titre militaire. » […]
- « Madame, je sais que vous avez des problèmes d’argent avec votre propriété de Milandes. La France va vous donner la main. Nous pouvons vous soutenir. »
- Mais Joséphine lui répondit d’un sourire :
« Merci beaucoup, mon général, mais j’ai fait des bêtises et la France n’a pas à payer pour mes bêtises. »
- Et Jean-Claude Brialy conclut :
« Je ne connais pas beaucoup de gens qui auraient réagi ainsi. Elle ne s’est d’ailleurs jamais vantée de cette attitude exemplaire, elle était trop pudique, ce n’est que bien plus tard que j’ai appris cette anecdote. » 847 (Cf. Culture. Patriarcale, Femme. Tout court. Femmes. Artistes)
* Ajout. 12 août 2022. André Malraux [1901-1976], dans Les chênes qu’on abat [1971] rapporte ce jugement de Charles de Gaulle la concernant : « cette pauvre brave fille ». 848
Femmes (Remarquables. Baker Joséphine) (2) : (9 août) 2022. Lu sur France Culture concernant Josephine Baker [1906-1975] :
« Recrutée pour ‘jouer’ une africaine dans La Revue Nègre, Joséphine fait sensation en apparaissant nue sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées. En quelques jours, elle devient la femme que le Tout-Paris vient voir. Symbole d’une ouverture vers l’autre - à condition qu’il ne soit ni trop noir ni trop différent - Joséphine devient un objet de désir. Ses seins, ses hanches, son sourire, sa coiffure s’affichent partout. Après une grande tournée en Allemagne, Paul Derval l’engage en avril 1926 aux Folies Bergères où elle mène la revue parée d'une ceinture de bananes. En moins d'un an, elle est devenue une icône. »
Comment la nudité « mais, pas totale » - qui lui fut imposée - d’une femme, d’une femme noire, « mais, pas trop », d’une femme « nègre », transformée en « créature », « sauvage », africanisée, créolisée, colonisée, animalisée, sexualisée, chosifiée - transformée en publicité vivante - sous couvert d’exotisme, de « succès », faute de questionnements critiques est ici réhabilitée. Comme le racisme. Elle est dès lors, ainsi, en 2022, légitimement devenue une « icône », « consacrée ». Plus encore, toutes les contradictions colonialistes, capitalistes, patriarcales de la société française, dont aucune n’est défendable, lui sont transférées. (Cf. Culture, Corps, Femmes. « Créatures », Politique. Colonialisme. Racisme)
* Ajout. 10 août 2022. J’apprends sur France Culture que Josephine Baker a vécu le racisme en Allemagne et en Autriche. Mais, ce n’aurait pas été le cas en France. Fut-elle inoculée ? (Cf. Politique. Nationalisme)
* Ajout. 12 août 2022. France Culture rapporte ses condamnations, ses engagements contre le racisme aux États-Unis, qu’elle avait par ailleurs, américaine, personnellement vécus. Mais que Joséphine Baker n’ait pas dénoncé le racisme en France ne justifie pas que France Culture ne l’évoque pas ; dans la suite, la cohérence politique de l’image qui fut transmise d’elle par Emmanuel Macron lors de sa « Panthéonisation », le 30 novembre 2021.
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Remarquables. Marie Bashkirtseff :
Femmes (Remarquables. Bashkirtseff Marie) (1) : (17 juillet) 1873. Pensant qu’il soit peu probable que soit cité ce que Marie Bashkirtseff [1858-1884] écrivait des hommes dans son célèbre Journal, voici ce que l’on peut notamment lire :
« Je regarde les hommes d’une telle hauteur, je suis charmante pour eux, car il ne sied pas de mépriser ceux qui sont si bas. Je les regarde comme un lièvre regarderait une souris. »
À 15 ans…849 (Cf. Femmes. Orgueil, Hommes, Relations entre êtres humains. Admiration)
Femmes (Remarquables. Bashkirtseff Marie) (2) : (3 juillet) 1876. Marie Bashkirtseff [1858-1884], auteure, concernant son Journal, de :
« Ce pauvre journal qui contient toutes ces aspirations vers la lumière, tous ces élans qui seraient estimés comme des élans d’un génie emprisonné, si la fin était couronnée par le succès, et qui seront regardés comme le délire vaniteux d’une créature banale, si je moisis éternellement !
Me marier et avoir des enfants ! Mais chaque blanchisseuse peut en faire autant. À moins de trouver un homme civilisé et éclairé ou faible et amoureux.
Mais qu’est-ce que je veux ? Oh ! vous le savez bien. Je veux la gloire ! Ce n’est pas ce journal qui me la donnera. Ce journal ne sera publié qu’après ma mort, car j’y suis trop nue pour me montrer de mon vivant. D’ailleurs, il ne serait que le complément d’une vie illustre. » 850 (Cf. Femmes. « Créatures ». Orgueil, Hommes, Relations entre êtres humains. Admiration, Famille. Mariage)
-------------
Femmes (Remarquables. Bellil Samira) : 2002. Samira Bellil [1972-2004] auteure de : Dans l’enfer des tournantes » : un grand, grand, livre (malgré son titre… qui contribua à son succès…). 851 (Cf. Culture. Livres, Violences)
* Ajout. 21 mars 2025. (6 septembre) 2006. Lire, sur son site, Isabelle Alonso, auteure de :
« Hommages à Samira Bellil ».
Femmes (Remarquables. Benziane Sohane) : (4 octobre) 2002. Sohane Benziane fut brulée vive, en France, à 17 ans, dans un local à poubelles à Vitry sur Seine par Djemal Derrar. L’analyse de Kahina, sa sœur ainée, qui la dénomma « la Jeanne d’Arc de banlieue » doit être comprise, écoutée, entendue. 852
Femmes (Remarquables. Bettignies Louise de) : 2013. Lu dans la présentation d’un livre qui fut consacrée à Louise de Bettignies [1880-1918] :
« Louise de Bettignies fait partie de ces ‘inconnues célèbres’. Qui était-elle vraiment ? Pour les Allemands, dangereuse espionne au service des Anglais ; pour les Français, ardente patriote ; pour les Britanniques, femme de tête et organisatrice exceptionnelle du réseau Ramble ; pour les catholiques, mystique et martyre ; pour sa famille, fille aimante et tante adorée ; pour son entourage, femme élégante, subtile, cultivée, complexe et drôle. »
Et si elle était tous ces jugements à la fois ? 853
Femmes (Remarquables. Bidault Suzanne) : 1972. Suzanne Bidault [1904-1955], née sous le nom de Suzanne Borel, elle fut la première femme et seule pendant l’entre-deux-guerres nommée au Quai d’Orsay (attachée d’ambassade, affectée au Service des Œuvres).
D’elle - et cité par elle - M. Fernand Pila, qui fut plus tard ambassadeur au Japon (1935-36), disait :
« Elle n’est pas très intelligente, elle n’est pas belle et elle n’a pas le sou, elle ne présente aucun intérêt. » Le commentaire de Suzanne Bidault fut :
« Je n’ai pas besoin de dire que son attitude changea du tout au tout quand je fus devenue femme de ministre ».
Sa description de la vie au Quai d’Orsay est particulièrement précise.
Elle raconte notamment comment fut pris (en 1929) le décret qui permis à une femme, mais non pas à toutes les femmes, de se présenter au concours pour l’admission dans les carrières diplomatiques et consulaires :
« Il ne faut pas croire que ce décret fut le fait d’un ministre libéral et généreux désireux de frayer une voie nouvelle aux ambitions féminines. Non, comme il arrive souvent en France cette mesure administrative n’était qu’une manifestation de favoritisme. Monsieur Louis Marin [1871-1960] avait une pupille, Mlle Camuzet, jeune fille parfaitement honorable d’ailleurs, qui souhaitait entrer dans la diplomatie. Il demanda à Philippe Berthelot [1866-1934] de combler les vœux de cette aimable personne. Il paraît - ce qui est curieux pour quiconque a connu les deux hommes - que Philippe Berthelot ne pouvait rien refuser à Louis Marin. Mlle Camuzet eut donc son décret. » 854 Suzanne Bidault poursuit :
En 1931, ce décret « était allongé d’une petite phrase bien innocente : ‘Les candidats devront avoir la plénitude des droits politiques. ‘On ne disait pas : ‘Les femmes ne sont pas admises au concours’ mais en fait elles en étaient écartées. »
Pour rappel : Exclues du droit de vote, les femmes n’avaient donc pas - admirable euphémisme - « la plénitude des droits politiques » …
On apprend aussi que « les secrétaires étaient recrutées en grande partie par cooptation : c’était d’une part de veuves de consuls et des nièces d’ambassadeurs, d’autre part de sœurs d’huissiers et des filles de facteurs de la valise (diplomatique). »
On lit enfin en quatrième de couverture de son livre Par une porte entrebâillée ou Comment les françaises entrèrent dans la carrière :
« Par son exemple de force morale et de courage, le livre de Suzanne Bidault se situe parmi les ouvrages les plus authentiques consacrés à la condition féminine contemporaine. »
Non. C’est un « authentique » ouvrage consacré à l’analyse de la vie au Quai d’Orsay avant la guerre et, notamment, à la phallocratie qui y régnait. Certes, Suzanne Bidault ne la dénonce pas, bien au contraire : [comment eut-elle pu le faire ?], elle affirme même haut et fort son antiféminisme.
Mais son témoignage est une dénonciation imparable du patriarcat. (Cf. Droit, Femmes. Ambition. « Féminin ». Jeunes filles. Intelligentes. Secrétaires, Féminismes, Justice, Langage. Euphémisme, Patriarcat, Politique. Diplomatie. Parité, Histoire)
Femmes (Remarquables. Bigillion Victorine) : (29 août) 1804. Stendhal [1783-1842], dans une lettre à sa sœur Pauline [Beyle. 1786-1857], aux fins de la dissuader de quitter ses parents, lui écrit :
« Mademoiselle Victorine Bigillion [?-?] vient de faire exactement ce que tu voudrais. Elle a vécu solitaire à Saint-Ismier : cela a augmenté la force de ses passions et de sa tête. Elle en a une si bonne que son père l’a décidemment prise pour folle. Là-dessus on l’a renfermée presque comme une folle ; la pauvre petite a été poussée à bout ; elle s’est enfuie jusqu’à Moirans ; on l’a rattrapée, et elle est actuellement je crois en prison à la grande Chartreuse où elle restera tant qu’il plaira à ses parents, gens qu’elle a offensé de toutes les manières. Elle ne pourrait s’en tirer que pour se marier, mais qui en voudrait ? » 855 (Cf. Femmes. Enfermées. « Folie », Famille. Frères et sœurs)
Femmes (Remarquables. Binet Sophie) : (12 juillet) 2024. À chaque fois que j’entends Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT [depuis le 31 mars 2023], je suis frappée par l’assurance, la clarté de ses analyses, de ses positions qui tranchent tant avec celles de la classe politique de gauche. Pourquoi ? (Poursuivre) (Cf. Politique. « Gauche La »)
Par ordre chronologique. Femmes. Remarquables. Karen Blixen :
Femmes (Remarquables. Blixen Karen) (1) : 1982. Judith Thurman, dans sa biographie de Karen Blixen, cite (sans date) cette analyse de Karen Blixen [1985-1962] concernant son mariage :
« Si cela n’avait l’air brutal, je pourrais dire, le monde étant ce qu’il est, cela valait la peine d’avoir la syphilis pour devenir baronne [qui lui fut transmise par son mari.] »
Le monde étant ce qu’il est : une analyse coût / avantage.
Mais dans une note, l’auteure cite un conte inachevé de Karen Blixen, Cornelia, dans lequel celle-ci écrit :
« Un même homme qui dissimule ses vices (ses visites à la maison de tolérance) à sa femme et à sa mère pourrait très bien leur confier qu’il a commis un meurtre. » 856 (Cf. Femmes. Comment meurent les femmes ? Syphilis, Famille. Mariage, Proxénétisme, Sexes. Syphilis)
Femmes (Remarquables. Blixen Karen) (2) : 2001. Pietro Citati [1930-2022], dans Portraits de femmes, après avoir présenté son mari comme « volubile et frénétique [qui] pourchassait toutes les femmes blanches, somaliens ou noire, comme il chassait le lion » écrit, plus loin, la concernant :
« Elle était extrêmement maigre. Les innombrables opération qu’elle avait subies à cause de la syphilis - chaque année, on lui enlevait un morceau d’estomac ou de colonne vertébrale […] » 857
À cette seule lecture, on comprend - sans avoir besoin d’une quelconque analyse - comment tant d’hommes, pendant des siècles, ont transmis - sans être interrogés, remis en cause, critiqués, responsabilisés, poursuivis - syphilis, puis sida aux femmes, épouses, dites-prostituées, violées, notamment dans les pays colonisés. (Cf. Corps. Femmes, Femmes. Comment meurent les femmes ? Syphilis, Hommes. Irresponsables, Patriarcat, Politique. Colonialisme, Violences)
-------------
Femmes (Remarquables. Boadicée (Reine) : 1847. Charlotte Brontë [1816-1855], dans Jane Eyre, évoque « l’air de la reine Boadicée ».
Une note précise qu’elle était une « reine britannique qui, en 60 de notre ère, suscita la révolte contre l’occupation romaine. » Et sur Wikipédia (très documenté), je lis :
« Pour les historiens britanniques, elle est considérée comme la Vercingétorix bretonne. Sa révolte est encore de nos jours un symbole de courage ». (Cf. Femmes. Veuves)
Femmes (Remarquables. Bonaparte Marie) : (janvier) 1937. Marie Bonaparte [1882-1962] auteure, dans une lettre adressée à Freud [1856-1939], de :
« Vous-même […] n’avez peut-être pas le sentiment de toute votre grandeur. […] »
N.B. Le contexte : cette phrase fut écrite, après que celle-ci eut acheté la correspondance entre Wilhelm Fliess [1858-1928] et Freud, ce dernier étant fort inquiet de ce qu’elle pourrait publiquement révéler, à juste titre d’ailleurs. 858 (Cf. Relations entre êtres humains. Flagornerie)
Femmes (Remarquables. Bonaparte Mathilde) : 1953. Dans le livre de Marguerite Castillon du Perron La princesse Mathilde. Un règne féminin sous le second empire, je lis concernant la princesse Mathilde Bonaparte [1820-1904] :
« […] Elle crut pouvoir servir la cause de l’Empire tout en épanouissant sa personnalité dans le culte de l’intelligence. Marquée par le destin pour être à la fois la dépositaire la plus distinguée du souvenir Napoléonien et la protectrice de la pensée contemporaine, elle peut se demander si elle a réussi dans des rôles impliquant tant de contradictions. » (Écrit au terme du chapitre concernant ses relations avec Charles-Augustin Sainte-Beuve [1804-1869] et leur rupture) 859 (Cf. Femmes. « Féminin », Famille. Bonaparte Mathilde)
Femmes (Remarquables. Boudicca) : Tacite [58-120 après J.C], concernant Boudicca [entre 59 et 62 après J.C], auteur de :
« Sous la conduite de Boudicca [épouse du roi des Lycéens, Prasutagus] femme de sang royal (les Bretons [de Grande Bretagne] ne font pas de différence entre les sexes dans l’exercice du commandement), ils [Les Brigantes] prirent tous les armes. Ils traquèrent les soldats [romains] disséminés dans les fortins, ils soumirent les garnisons, ils envahirent la colonie [Camulodunum (Colchester)] considérée comme le siège de la tyrannie. Dans leur colère et leurs succès, ils n’omirent aucune des cruautés propres aux natures barbares. » […]
« Si le succès ne les avait pas engourdis, ils auraient pu se débarrasser du joug romain. » 860
On apprend aussi (dans un autre texte de Tacite) qu’elle fut « battue de verges et ses filles déshonorées. »
Tacite [58-120] nous retransmet aussi ses paroles avant le combat :
« Boudicca, montée sur un char, avait devant elle ses deux filles et parcourait le front des nations réunies, en protestant que, si les Bretons avaient l’habitude de combattre sous les ordres de femmes, elle ne venait pas, pour l’instant, en qualité de reine issue de nobles ancêtres, réclamer son royaume et ses richesses ; non, elle voulait comme une simple femme, venger sa liberté perdue, son corps déchiré de verges, l’honneur de ses filles odieusement violé. Les Romains s’étaient vus emportés par leurs passions jusqu’à ne laisser sans souillures ni les corps, ni même la vieillesse ou la virginité. Mais les dieux étaient là prêts à assurer une juste vengeance. […]
Qu’on songeait au nombre de combattants et aux causes de la guerre ; on verrait qu’il fallait vaincre sur ce champ de bataille ou y périr. ‘Femme, c’était son destin arrêté : libre aux hommes de vivre et d’être esclaves.’ »
Qu’advint-il de cette bataille ? : 40.000 mort-es chez les Bretons, 400 chez les Romains. Quant à Boudicca, elle « finit sa vie par le poison. »
Boudicca, ancêtre des luttes féministes contre le viol ? Mais, surtout, grâce à Tacite, la découverte de cette femme, plus de vingt siècles après sa mort, pose une question plus large : ne nous révèle-t-elle pas en sus tous les autres dénis concernant « les femmes » que « l’histoire » nous a cachés ? (Cf. Histoire. Tacite. Patriarcale, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
Femmes (Remarquables. Bourlier Colette) : (18 mars) 2016. Colette Bourlier, née en 1925, a soutenu une thèse de géographie sur les travailleurs immigrés à Besançon dans la seconde moitié du XXe siècle. Elle a notamment déclaré :
« J’ai mis du temps, parce que j’ai fait des pauses […]. » 861
Femmes (Remarquables. Bovy Berthe) : (27 décembre) 1949. Berthe Bovy [1887-1977] est interrogée par quatre hommes, dans l’émission d’André Gillois [1902-2004] de France Culture intitulée : « Qui êtes-vous ? ».
D’emblée elle pose lucidement le rapport de pouvoirs : « Vous allez me demandez ce que je crois être. Et vous allez me dire ce que je suis. » Elle avait raison - cinq hommes jugeaient en toute bonne conscience une femme - et ce fut le cas.
Ces hommes, inquisiteurs, méprisants, grossiers, reprenant ses dires, réécrivant sa vie, jugeant ses souvenirs, « perfides », cherchant sans cesse à la prendre en défaut, en contradictions, en manque, n’abordant jamais sa vie artistique - à son seul crédit et sur laquelle ils n’avaient pas de prise - furent odieux.
Berthe Bovy, qui n’est tombée dans aucun de leurs pièges, s’est révélée une femme, sensible, fine, vraie, et si intelligente, encore plus, comparée à eux. (Cf. Femmes. Artistes, Hommes. Grossiers, Patriarcat)
Femmes (Remarquables. Budde Marianne) : (22 janvier) 2025. Lu dans Les Nouvelles News :
« Rappelant qu’il [Donal Trump] avait affirmé lundi avoir été ‘sauvé par Dieu’ lors d’une tentative d’assassinat en juillet [2024], Mariann Budde - évêque épiscopalienne de Xahington - l’a regardé dans les yeux et s’est lancée :
‘Je vous demande d’avoir pitié des gens de notre pays qui ont peur en ce moment. Il y a des enfants gays, lesbiennes et transgenres dans des familles démocrates, républicaines et indépendantes, certains craignant pour leur vie. Et les gens, qui récoltent nos terres et nettoient nos bureaux, qui travaillent dans les élevages de volailles et les usines de conditionnement de viande, qui font la vaisselle après que nous ayons mangé dans les restaurants et qui travaillent de nuit dans les hôpitaux, ne sont peut-être pas citoyens ou n’ont pas les bons papiers, mais la grande majorité des immigrés ne sont pas des criminels. Ils paient des impôts et sont de bons voisins, ils fréquentent nos églises, mosquées, synagogues, gurdwaras et temples. Que Dieu nous accorde la force et le courage d’honorer la dignité de chaque être humain, de nous dire la vérité les uns aux autres avec amour et de marcher humblement les uns avec les autres et avec notre Dieu pour le bien de tous les peuples de cette nation et du monde ».
Il est dommage qu’elle ait employé le mot : « pitié ». (Cf. Hommes. « Politiques ». Trump Donald)
Femmes (Remarquables. Catherine de Bourbon) : Catherine de Bourbon [1559-1604], aurait répondu [je n’ai pas vérifié…] à son frère Henri IV [1553-1610] qui voulait qu’elle se convertisse pour la marier au duc de Bar, « en guise de réconciliation avec les Lorrains et d’heureux épilogue aux guerres de religion » :
« J’ai reçu de ma mère, la feue reine de Navarre [1528-1572], la foi des Huguenots et point ne m’en déferai. » 862
Femmes (Remarquables. Catherine II) : Catherine II [1729-1795], avant son accession au trône, auteure de :
« J’ai mené pendant dix-huit ans une vie dont dix autres auraient pu devenir folles, et vingt autres à ma place mourir de chagrin. » 863
Plus que crédible… (Cf. Femmes. Mères. Catherine II)
* Ajout. 17 avril 2018. 1951. Dans les Notes et variantes de la publication par La Pléiade en 1951 des Misérables [1862] de Victor Hugo [1802-1885], il est écrit la concernant :
« Catherine II la Grande [1729-1796], femme de Pierre III, impératrice de Russie après le meurtre de son mari et femme des mœurs déréglées. » 864 (Cf. Histoire)
Femmes (Remarquables. Cavell Édith) : (31 mai) 1964. Julien Green [1900-1998] écrit dans son Journal :
« Dans notre monde terrible, une des femmes que j’admire le plus est Édith Cavell. [1865-1915] J’aurais voulu écrire un livre sur elle. Qui connait encore son nom ? » 865
Femmes (Remarquables. Ceausescu Elena) : 1989. Elena Ceausescu [1916-1989] auteure de : « Je vous ai éduqué comme une mère ! »
Ce fut la phrase qu’elle adressa aux militaires du ‘tribunal’ qui venait de la condamner à mort, ainsi que son mari Nicolae [1918-1989], alors qu’elle refusait que l’on leur attache les mains pour les conduire au peloton d’exécution. 866 (Cf. Enfants. Éducation, Femmes. Épouse de. Mères, Patriarcat)
Femmes. Remarquables. Christine de Suède :
Femmes (Remarquables. Christine de Suède) (1) : Christine de Suède [1626-1689] était officiellement « roi de Suède », mais elle fut plus connue sous la dénomination de : « reine de Suède ». Auteure de :
« Je suis née libre, je vis libre et je mourrai libérée. » 867 (Cf. Femmes. « Politiques »)
Femmes (Remarquables. Christine de Suède) (2) : (4 décembre) 1649. Elisabeth de Bohème [1618-1680] écrit à Descartes, concernant la reine de Suède [1626-1689] :
« […] J’admire qu’il est possible à cette Princesse de s’appliquer à l’étude comme elle le fait, et aux affaires du royaume aussi, qui demandent chacune une personne entière. » 868 (Cf. Femmes. « Politiques »)
Femmes (Remarquables. Christine de Suède) (3) : 1989. Je lis dans une note d’Antoine Compagnon au livre de Marcel Proust Sodome et Gomorrhe - 1921 - que « Jean de Monaldeschi [1626-1657], favori de Christine de suède, fut assassiné sur son ordre à Fontainebleau en 1657. » 869
-------------
Femmes (Remarquables. Clerc Thérèse) : 2007. Thérèse Clerc [1927-2006], auteure de :
« J’ai une vie merveilleuse. Je ne fais que ce que j’aime mais j’aime tout ce que je fais […]. » 870 Heureusement qu’elle nous en dévoila les complexités.… (Cf. Femmes. Lesbiennes, Famille. Couple. Clerc Thérèse)
Femmes (Remarquables. Cléopâtre) : Un siècle avant J.C. Lire ce que Plutarque [vers 46-vers 125] écrit de Cléopâtre [-69-30 avant J.C], dans le chapitre passionnant consacré à Antoine.
On découvre la femme de pouvoir, la femme « politique », par ailleurs polyglotte.
On découvre aussi, notamment, Octavie. 871
Femmes. Remarquables. Colliard Lucie :
Femmes (Remarquables. Colliard Lucie) (1) : (1er mars) 2024. Entendu, dans l’émission les Inconnnu[e]s de l’Histoire de France Culture [1ère diffusion. 2 mars 1984] : Lucie Colliard [1877-1961], la concernant :
« Jamais, elle n’employait de termes grossiers et insultants. »
- Elle est aussi notamment l’auteure de :
Douarnenez : une belle grève de femmes. 8 février 1925. (Cf. Politique. Luttes de femmes)
Femmes (Remarquables. Colliard Lucie) (2) : (10 mars) 2024. Entendu, dans l’émission de France Culture, Une histoire particulière. « Les Penn sardines (2) ouvrières en grève. Lucie Colliard, Joséphine Pencalet, deux femmes, deux destins », concernant Lucie Colliard [1877-1961], en vrac :
« Une militante [CGTU] chevronnée », une femme « en chapeau » ; « elle nous a beaucoup appris » ; « elle nous faisait un peu le planning familial» ; « c’était une féministe, même si le mot, on ne le disait pas » ; « elle a un parcours incroyable » ; « institutrice », « pacifiste », « condamnée à deux ans de prison et en effectue deux mois » ; « elle se marie et divorce assez vite », « elle place ses deux enfants » ; « elle est révoquée de l’éducation nationale », « elle est embauchée et salariée par la CGTU » ; « syndicaliste d’action directe », « elle fait des repas, les soupes populaires, des crèches », « elle organise les manifestations » ; « elle est très pragmatique », « elle ne fait pas la morale »; « elle accepte les femmes comme elles sont » ; « elle ne lâche pas l’affaire » [de la grève victorieuse] ; « Il y a très peu de choses sur elle, à part les rapport de police, du préfet » ; « une femme de terrain » ; « elle n’a jamais ramené les choses à elle » ; « son enterrement […] c’était Victor Hugo » ; « Il n’y a pas de rue à son nom à Douarnenez ». (Cf. Langage, Patriarcat, Histoire)
-------------
Femmes (Remarquables. Collombel-Pagnol Joséphine-Marie) : 2016. Joséphine-Marie Collombel-Pagnol [1861-1943, tante paternelle de Marcel Pagnol [1855-1974], directrice de l’École supérieure de jeunes filles de Marseille [1887 à 1918] « mets en place des sections de quartier pour que ‘des ménagères et travailleuses absorbées par de multiples besognes puissent s’éclairer sur l’utilité du bulletin de vote avec le minimum de dérangement. » (sans date)
Je poursuis la lecture :
« En 1928, au premier tour des élections cantonales dans son quartier de l’Estaque, elle se présente, quoique non électrice et encore moins éligible, recueille une cinquantaine de voix, masculine bien sûr. » 872 (Cf. Femmes. Jeunes filles)
Femmes (Remarquables. Colman Lucy) : 1912. Lu dans De l’action directe de Voltairine de Cleyre [1866-1912] :
« Lors d’une réunion du mouvement pour le droit de vote des femmes, face à une motion de Frederick Douglass [auteur de Mémoires d’un esclave. 1817-1885], qui affirmait candidement : ‘Le sacrifice de soi est une valeur positive qui doit être enseignée à toutes les femmes’, Lucy Coleman [1817-1891, elle-même anti-esclavagiste] lui demanda :
‘Pourquoi n’avez-vous pas appliqué vous-même cette vertu quand vous étiez esclave ?’.
Et la résolution de Lucy Coleman qui prônait le droit des femmes à ‘ne plus croire en l’autorité mais à leur seule raison’ fut adoptée. » 873 (Cf. Politique. « Action directe ». Anarchisme. Esclavage. Vote des femmes)
Femmes (Remarquables. Craven Élisabeth) : 1992. Élisabeth Craven [1750-1828], dans ses Mémoires, auteure de :
« On nous oppose des devoirs, on nous prive de l’estime publique, en exigeant de nous des vertus dont on nous impute à crime de nous en faire honneur. » 874 Puissant. Tous ses écrits seraient sans doute à traduire et à rééditer.
Ses Mémoires - malheureusement partiellement gâchés par les partis-pris masculinistes innombrables de l’introduction de ce livre, remplis d’incompréhensions patriarcales et de dénigrements de cette femme remarquable - sont passionnantes.
L’éditeur doit la remplacer. (Cf. Droit. Droits / Devoirs, Histoire. Patriarcale)
Femmes (Remarquables. Curie Marie) : Je lis concernant Marie Curie [1867-1934] ceci :
« [Pendant la première guerre mondiale] Marie Curie crée la première École d’aides-manipulatrices en radiologie. Aucun diplôme n’est requis pour intégrer l’école : ‘Peut devenir manipulatrice toute personne réfléchie, soigneuse, adroite de ses mains et pourvue d’une culture moyenne’ écrit-elle dans son tract appelant au recrutement des femmes’. » Et l’auteure ajoute :
« Après la guerre, elle retrouvera sans doute l’emploi de ses connaissances dans les hôpitaux civils, les dispensaires, les maisons de santé, les sanatoria’. Les demandes affluent des quatre coins de la France : plus de 180 manipulatrices seront formées dans son école. L’organisation de cet enseignement est en relation étroite avec l’École des infirmières militaires ouverte à l’hôpital Édith Cavell sous la direction de Nicole Girard-Mangin [1878-1919], la première [la seule…] femme médecin au front. C’est elle qui se charge de l’enseignement de l’anatomie. » 875
* Ajout. 16 juin 2020. Cf. Femmes. Remarquables. Cavell Édith
Par ordre chronologique. Femmes. Remarquables. Marie D’Agoult :
Femmes (Remarquables. D’Agoult Marie) (1) : (10 juillet) 1836. George Sand [1804-1876], écrit à Marie d’Agoult [Daniel Stern. 1805-1876] :
« Oui, vous êtes une grande âme, un noble caractère et un bon cœur, c’est plus que tout le reste, c’est rare au dernier point, bien que tout le monde y prétende. » 876 (Cf. Êtres humains. Âmes)
Femmes (Remarquables. D’Agoult Marie) (2) : (25 novembre) 1876. George Sand [1804-1876] écrit notamment concernant Marie d’Agoult [Daniel Stern. 1805-1876] :
« […] Je crois pourtant qu’elle triomphera parce qu’elle a une grande aspiration à être plus qu’elle-même. […] Elle a trop cherché un rôle dans le monde, elle n’en avait pas besoin étant par elle-même au-dessus de ce qu’elle rêvait. » 877 (Cf. Êtres Humains. Soi)
-------------
Femmes (Remarquables. Daschkoff Princesse) : La princesse Daschkoff [1729-1810] joua, très jeune, si l’on en croit ses Mémoires, un rôle important quant à l’organisation de la « conspiration » ayant permis l’arrivée de Catherine II [1729-1796] au trône de Russie. Incontestable femme politique, auteure de :
« Tout ardu qu’était le dessein, je n’étais pas femme à me laisser arrêter par des considérations d’obstacles ordinaires. »
Quant à ses arguments pour justifier la nécessité de ladite « conspiration », voici ce qu’elle répond à M. Panine (gouverneur du grand-duc, devenu Pierre III, celui qui devait ‘disparaître’) lequel avait des « scrupules » :
« Agissons d’abord, lui répondis-je, et pas une personne sur cent n’assignera à cet évènement d’autres causes que les abus écrasants dont le redressement n’était possible que par un changement dans le pouvoir. » 878
Puissant… (Cf. Femmes. Comparaison entre femmes. Voltaire)
Femmes (Remarquables. Daubresse Marie) : 1904. Lu dans le livre de Simon-Pierre Perret et Harry Halbreich consacré à et intitulé Albéric Magnard [1865-1914] concernant Marie Daubresse [?-?] :
« - Critique, professeur[e] de musique et sociologue, [elle] fonde au mois de mars 1904 l’Union des femmes professeurs et compositeurs de musique qu’elle présidera jusqu’à sa démission pour raisons de santé au mois de janvier 1907. Son initiative ne doit rien au hasard ; le ministre de l’Instruction publique, Joseph Chaumié, venait en effet de signer un décret limitant à quatre le nombre d’élèves femmes dans les classes de violon, d’alto, de violoncelle et de contrebasse du Conservatoire de Paris. […]
- Le but de l‘U.F.P.C.M est de regrouper les femmes artistes pour mieux défendre leurs intérêts, d’établir entre elles de liens de solidarité et de mettre à leur disposition les appuis matériels et moraux nécessaires à l’exercice de leur profession. [...]
- À la fin de l’année 1911, l’association est forte de 800 adhérentes et compte suffisamment d’éléments qualifiés pour permettre la création d’un orchestre symphonique. Une cinquantaine d’instrumentistes, 52 exactement, sont choisies. […] » [lire la suite] 879
Cf. aussi, Daubresse Michel [Melle], Comment fonder des syndicats de musiciennes [Revue musicale SIM. n° 7. 15 juillet 1911] ainsi que trois articles d’elle cités dans la bibliographie du le site : Les compositrices en France au XIXème siècle. (Cf. Culture, Hommes. Féminisme. Magnard Albéric, « Sciences » sociales. Sociologie)
Femmes (Remarquables. David-Neel Alexandra) : (23 mai) 1912. Alexandra David-Neel [1868-1969], écrit d’Inde à son mari :
« […] Telle qu’elle fut, avec tant d’heures pénibles, tant d’heures de luttes, je ne me plains pas de ma vie. J’aurais pu être une commerçante enrichie, une artiste célèbre. Beni soit ‘cela’ (sa conversion, sans doute, au Bouddhisme et les voyages et les recherches qui s’en sont suivies) qui m’a préservé des routes banales, qui m’a fait gravir les Himalaya et ces invisibles Himalayas de la pensée si infiniment plus élevés que les autres. » 880 (Cf. Femmes. Épouse de, Penser)
Femmes (Remarquables. Davis Angela) : (août) 1971. Jacques Prévert [1900-1977] publia un texte nommé Angela Davis - alors emprisonnée - pour réclamer sa libération. On y lit notamment :
« […] Angela Davis, c’est la générosité, la lucidité, la vie vraie. Il ne faut absolument pas qu’elle puisse être condamnée. Quand on la jugera, des témoins viendront, c’est connu d’avance, des témoins achetés, vendus ou loués comme on en loue pour les mariages à la porte des mairies, et ils jureront sur une bible de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Angela Davis, elle dira - si on la laisse parler - la liberté, toutes les libertés, pour ses frères et sœurs de couleur. […]
Il faut libérer Angela Davis - en attendant le jour où seront condamnées toutes les portes derrière lesquelles la vie noire est enfermée. » 881 (Cf. Femmes. Enfermées, Famille. Frères et sœurs, Justice. Témoins. Procès, Politique. Esclavage. Prison)
Femmes (Remarquables. Decker Marie-Laure de) : 2013. Marie-Laure de Decker, photographe. ‘grand reporter’, auteure de :
« Je me suis toujours dit : ‘au pire, je meurs ! ’ » 882
Libérateur…
Par ordre chronologique. Femmes. Remarquables. Voltairine De Cleyre :
Femmes (Remarquables. De Cleyre Voltairine) (1) : 1914. Voltairine de Cleyre [1866-1912], dans son essai, Comment je devins anarchiste, auteure de :
« J’ai réussi finalement en sortir [du couvent] et j’étais une libre penseuse lorsque j’en suis partie, trois ans plus tard, même si dans ma solitude, je n’avais jamais lu un seul livre ni entendu une seule parole qui m’ait aidée. J’ai traversé la vallée de l’Ombre de la Mort, et mon âme porte encore de blanches cicatrices, là où l’Ignorance et la Superstition m’ont brûlée de leur feu infernal, durant cette sinistre période de ma vie. […]
- À côté de cette bataille de ma jeunesse, tous les autres combats que j’ai dû mener ont été faciles, car, quelles que soient les circonstances extérieures, je n’obéis désormais plus qu’à ma seule volonté intérieure.
- Je ne dois prêter allégeance à personne et ne le ferai jamais plus ; je me dirige lentement vers un seul but : la connaissance, l’affirmation de ma propre liberté, avec toutes les responsabilités qui en découlent.
- Telle est, j’en suis convaincue, la raison essentielle de mon attirance pour l’anarchisme. » 883 (Cf. Êtres humains. Âmes, Enfants, Famille, Féminismes, Penser. Penseuses, Politique. Anarchisme)
Femmes (Remarquables. De Cleyre Voltairine) (2) : 2012. Paul Avrich, biographe de Voltairine de Cleyre [1866-1912] écrit :
« Toute la vie de Voltairine de Cleyre exprime sa révolte contre le système de la domination masculine qui, comme toutes les formes de tyrannie et d’exploitation s’opposait à son esprit anarchiste. » 884 (Cf. Hommes. Tyrans, Patriarcat. Domination masculine, Politique. Anarchisme. Tyrannie)
-------------
Femmes (Remarquables. Djoumbé Fatouma Soundi) : Lu, concernant Djoumbé Fatouma Soundi [vers 1836-1878] :
« En 1841, elle hérita du royaume de Mohéli, la plus petites des Comores. Elle accéda au trône en 1849. Sa gouvernante Française, Mme Droit, placée auprès d’elle par le commandant de Mayotte, avait fait prévaloir les intérêts coloniaux et le catholicisme dans une île très majoritairement musulmane. Sous son influence, la reine refusa de se marier avec Saïd Mohammed Nasser Mkadara, un cousin du sultan de Zanzibar. Elle y fut contrainte en 1851, après que Mme Droit eut été expulsée par une révolte populaire. La France interviendra deux fois, pour défendre les intérêts des planteurs français. Mkadara périt, probablement assassiné. Après avoir semblé de tourner vers la France et permis à Joseph Lambert d’acquérir près de la moitié de l’île, la reine abdiqua, en 1866, sous la pression du Sultanat de Zanzibar, en faveur de son jeune fils, Mohamed. Le contrat passé avec Lambert fut alors dénoncé. En guise de représailles, la France bombarda, en 1867, la petite capitale de l’île, Fomboni. Fatouma se rendit alors en Europe, tenta vainement de rencontrer Napoléon III [1808-1873]. » 885 Lire aussi Wikipédia. (Cf. Politique. Colonialisme)
Femmes (Remarquables. Delange Frédérique) : (8 mai) 1970. Frédérique Delange, étudiante, membre de la Gauche Prolétarienne, par anticapitalisme, avait participé à l’opération de « prise sur le tas » dans les magasins Fauchon (symbole des épiceries de luxe) aux fins de redistribution dans les bidonvilles et foyers de Saint Denis, Nanterre et Ivry.
Présentée comme un « Robin des bois des pauvres », elle fut condamnée, le 19 mai 1970, pour « vol » à 13 mois de prison. 886
Les slogans étaient : « Récupérons sur les patrons le fruit de notre travail », « On a raison de voler les voleurs ».
Commentaire de La Cause du peuple du 23 mai 1970 :
« Et depuis le procès scandaleux, l’action chez Fauchon est un exemple à un autre titre : notre camarade Frédérique a manifesté un courage très simple. Elle a donné une image claire du jeune partisan. »
Bien que condamnée par un tribunal correctionnel, elle ‘bénéficia’ discrétionnairement du « régime spécial favorable aux prisonniers » en prison, que René Pleven [1901-1993], ministre de la justice, avait ‘accordé’ aux condamnées par la Cour de sureté de l’État, en réaction à la grève de la faim que, prisonnier-ères, ils et elles avaient effectuée (durée : 25 jours), reconnaissant par là même de facto la dimension politique de l’action contre Fauchon. 887 (Cf. Justice. Procès, Politique, Économie. « Pauvres Les ». « Prise sur le tas ». Vols)
Femmes (Remarquables. Demuth Hélène) : Hélène Demuth [1820-1890] était employée comme domestique chez le père de Jenny von Westphalen [1814-1881].
Lorsque celle-ci épousera en 1843 Karl Marx [1818-1883], Hélène Demuth la suit, s’installe chez le couple qu’elle ne quittera plus jusqu’à la mort de Marx.
En 1851, elle met au monde un enfant, Frederick Demuth [1851-1929], fils de Karl Marx et d’Hélène Demuth.
Il fut séparé de sa mère - qui jamais ne l’élèvera - et placé dans une famille Londonienne. Plus tard, Engels, décidera d’en reconnaître la paternité, mais ne le mentionna pas dans son héritage.
C’est lui qui, semble-t-il, proposa qu’elle fut enterrée dans le caveau où reposent Karl Marx et son épouse et qu’une inscription la concernant fut, avec l’accord des filles de Marx, ajoutée sur la tombe [Lettre à Laura Lafargue 5 et 10 février 1891, 12 juillet 1891].
Hélène Demuth a joué un rôle indiscutablement important, dans la vie de ‘la famille Marx’, puis, après la mort de Marx, dans celle de ‘la famille Engels’. Après son enterrement, Engels évoque « la pauvre Nimmy ». [Lettre à Laura Lafargue. 14 mars 1892] 888 (Cf. Enfants. « Bâtards », Famille. Couple, Patriarcat. Pères, Politique. Marxisme, Violences. « Droit de cuissage »)
* Ajout. 24 mai 2015. Sur les questions concernant la paternité de cet enfant, les conséquences de sa naissance sur les familles Marx et Engels, et concernant sa vie, le texte cité en note, fait le point. 889
Femmes (Remarquables. Denis Marie-Louise) : Marie-Louise Denis [1712-1790], née Marie-Louise Mignot, nièce, puis amante de Voltaire [1694-1778], fut considérée et nommée par lui :
« Ma chère enfant », « ma maîtresse », « tout mon bien », « ma chère », « ma très chère », « ma chère amie », « la moitié de moi-même et la meilleure moitié », « ma chère muse », « ma chère amie », « ma chère nièce », « mon âme », « mon aimable enfant », « mon cher cœur », [après le décès d’Émilie du Châtelet. 1706-1749] « mon unique consolation et la seule espérance de ma vie », « consolation de ma vie », son « enfant », sa « fille » - « je la regarde comme ma fille » - sa « presque fille », « une femme charmante », sa « nièce », sa « chère nièce », sa « pauvre nièce », une « grande actrice », sa « garde-malade », sa « consolation », son « amie intime », sa « trésorière », « madame Denis » - qu’il qualifiera d’« insatiable », présentera comme « un peu paresseuse », « paresseuse », « bien paresseuse », « plus paresseuse que jamais », « grasse comme une abbesse », « grasse comme un moine » - sa « garde », « une Parisienne », « la compagne de ma retraite », une « dame respectable », « l’Helvétique », « une nièce qui gouverne ma vieillesse », « une nièce qui s’est sacrifiée pour moi », « cette nièce infortunée », « veuve d’un officier au service de la France », sa « compagne » « une veuve d’environ cinquante ans qui voudrait des rentes viagères payées eu denier dix », « une femme qui n’a que moi au pieds des Alpes », « qui le rend trop mondain, mais il faut tout souffrir », « sa chère amie », « maman » ; elle fut aussi celle qui « tint sa maison », son « entrepôt » [14 mars 1744], sa commissionnaire, sa secrétaire, sa gestionnaire, son paravent, son éventail (préciser), sa girouette, son faire-valoir, son souffre-douleur, sa représentante, sa co-rédactrice et/ou co-signataire) de lettres, sa caution, sa protection, son alibi, sa légataire universelle, son exécutrice testamentaire…
N.B. Après l’avoir nommée son « enfant », il termine par « maman », puis « maman et moi ».
- Le (20 février) 1754, celle-ci lui écrira :
« L’avarice vous poignarde », remplacé par « L’amour de l’argent vous tourmente » ; et :
« Ne me forcez pas à vous haïr… vous êtes le dernier des hommes par le cœur, je cacherai autant que je pourrais les vices de votre cœur. » 890
- Le 27 octobre 1754. Voltaire écrit :
« Elle me fait à la fois beaucoup de bien et beaucoup de mal. »
- Le 1er mars 1768, après que Marie-Louise Denis, le laissant seul à Ferney, ait quitté Voltaire pour Paris, il lui écrit pour tenter de la faire revenir ; parmi ses arguments, il écrit :
« Vous adoucirez mes malheurs ; c’est encore là votre destinée. » 891
Mais il lui a écrit tant et tant de choses et tant et tant accablé de monde de ses protestations d’amour…
- Le 22 mars, le 28 mars 1768, il la critique « d’avoir donné des fêtes, des opéras-comiques, des comédies, des soupers de vingt-cinq couvert, entretenu quatre-vingt domestiques » et de lui « avoir laissé pour environ quinze mille livres de dettes criardes à payer. »
- Le 22 mai 1768, il écrit : « Elle me faisait un trop grand sacrifice. » 892 (Poursuivre) (Cf. Langage. Possessif. Voltaire, Relations entre êtres humains. Aimer. Voltaire, Patriarcat. Voltaire)
Par ordre chronologique. Femmes. Remarquables. Christiane Desroches Noblecourt :
Femmes (Remarquables. Desroches-Noblecourt Christiane) (1) : 1976. Ménie Grégoire [1919-2014], dans Telle que je suis, alors étudiante à l’école des hautes études, auteure de :
« Une femme dominait le monde de l’égyptologie. Elle avait trente ans et nous éblouissait : Françoise Desroches-Noblecourt. Une femme avait forcé les portes de l’École du Caire, une femme avait dirigé des fouilles ! J’ai commencé à rêver. » 893
Femmes (Remarquables. Desroches Noblecourt Christiane) (2) : 2009. Christiane Desroches Noblecourt [1913-2011], auteure de :
« Je n’ai pas de rancune, j’ai simplement appris à me battre. On n’arrive à rien sans lutter, vous savez. Si je suis devenue une bagarreuse, c‘est par nécessité. »
Et c’est, concernant cette femme remarquable, que son éditeur, en 2009, écrivit dans la préface de son livre, Sous le regard des dieux, si grossièrement :
« Cette grande égyptologue aura mieux servi la cause des femmes qu’une armée de suffragettes. » 894
Sans doute pensait-il l’honorer… (Cf. Féminismes. Antiféminisme)
* Ajout. 29 décembre 2017. 2011. À l’écoute des émissions À voix nue de France Culture qui lui ont été consacrées en 2011, j’ai été particulièrement d’être frappée par son refus non seulement de rendre quoi que ce soit des trésors Égyptiens qui sont actuellement au Louvre à l’Égypte, mais surtout de son remarquable mutisme quant aux moyens utilisés pour les y faire parvenir, cautionnant dès lors toutes les appropriations - les moins contestables incluses - des « occidentaux » en Égypte. 895
Et, partout ailleurs. (Cf. Culture. « Occidentale », Politique. Colonialisme)
-------------
Femmes (Remarquables. Desrumaux Martha) : Martha Desrumaux [1897-1982] : une femme ouvrière, syndicaliste, socialiste, communiste, féministe, anticolonialiste, antifasciste, antimilitariste, résistante, déportée, politique.
Femmes (Remarquables. Dooh Bunya Lydie) : [1933-2020e] Lydie Dooh Bunya, en 1976, présidente de la Coordination des femmes noires, fondatrice du MODEFEM (Mouvement pour la défense des droits de la femme noire, créé en 1981).
Lire des interviews d’elle dans Hommes et Migrations (septembre-Octobre 2005), La condition des femmes noires en France, 896, dans Amina (juillet 1978), et, enfin une interview réalisée par Toby Susannah Watkins (juin 1995). 897 (Cf. Femmes. Remarquables. Thiam Awa)
Par ordre chronologique. Femmes. Remarquables. Nadedja Dourova :
Femmes (Remarquables. Dourova Nadedja) (1) : 1865-1869. Tolstoï [1828-1910], dans La guerre et la paix, évoque, au cours de la guerre napoléonienne contre la Russie : « la femme d’un staroste [représentant local officiel de la Russie tsariste] Vassilissa, qui tua des centaines de français. »
Une note de La Pléiade [1945] cite A. Rambaud [Alfred Nicolas, 1845-1905], dans son Histoire de la Russie [1878] :
« La paysanne Vassilissa, Melle Nadedja Dourova, donnait aux femmes de Russie de belliqueux exemples. » (p.586) 898
Femmes (Remarquables. Dourova Nadejda) (2) : 1985. Je lis dans La guerre n’a pas un visage de dans femme de Svetlana Alexievitch, que « Pouchkine [1799-1837] avait publié dans sa revue Le Contemporain, des extraits des Mémoires de ‘la demoiselle cavalier’, Nadejda Dourova [1783-1866], célèbre pour avoir pris part à la guerre contre Napoléon. »
Une note précise :
« Première femme officier de l’armée russe, écrivain. En 1806, s’étant travestie en homme, elle incorpora un régiment de cavalerie, participa eux guerres avec la France en 1807, puis en 1812-1814, et fut ordonnance du maréchal Koutouzov [1745-1813]. Auteur de mémoires (La demoiselle cavalier, publiées en français par Viviane Hamy sous le titre La cavalière du tsar, traduction Paul Lequesne) et de récits à caractère romantique. » 899 (à poursuivre, tant les présentations sont différentes……)
Lire sa présentation sur Wikipédia ainsi qu’un article important qui lui fut consacré dans Sputnik : Dourova, L’héroïne russe de Borodino [23 mars 2012].
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Remarquables. Juliette Drouet :
Femmes (Remarquables. Drouet Juliette) (1) : 1851. 1878. Juliette Drouet [1806-1883] fut, on le sait, une femme sans cesse ‘trompée’, à laquelle Victor Hugo - tout en se repaissant de ses incessantes déclarations d’amour, en acceptant une véritable adoration qu’il n’a jamais remise en cause, contestée ou refusée - n’a cessé de lui mentir.
- À la lecture d’un livre publiant certaines lettres inédites (parmi les 22.000 qu’elle lui écrivit), voici trois expressions de la souffrance de la trahison :
- Le 28 juin 1851, après avoir reçu de Léonie Birard, les lettres d’amour que Hugo lui avait adressées, le 13 juillet 1851, elle écrit à Hugo :
« […] Je voudrais absorber tout mon être dans ta contemplation jusqu’à oublier cette vie pour laquelle je ne suis plus faite puisque tu as pu en aimer une autre que moi. »
- Le 12 septembre 1851, elle lui écrit à nouveau :
« J’ai passé une partie de la nuit à relire toutes tes lettres, celles de mai 1844, et j’ai versé plus de larmes sur ces tendresses profanées, sur cet amour souillé, que tu n’as donné de baisers à cette femme, et prodigué d’adorations pendant sept années de trahison que se sont écoulées. »
- Le 6 novembre 1878, alors qu’elle avait découvert en juillet dans un Carnet la liaison de V. Hugo avec une « jeune domestique, Blanche Lanvin », elle lui écrit :
« Je te remercie, mon grand bien-aimé, de m’avoir rassurée encore une fois. Tu ne sauras jamais le faire trop, tu ne sauras jamais le faire assez pour raffermir ma confiance si profondément ébranlée pour effacer tous les cruels souvenirs qui me torturent le cœur depuis quatre mois, pour cicatriser toutes les peines vives de mon âme. » 900 (Cf. Êtres humains. Âmes, Relations entre êtres humains. Baiser. Aimer, Femmes. Adultères. « Trompées », Hommes. Remarquables. Hugo Victor, Famille. Mariage)
Femmes (Remarquables. Drouet Juliette) (2) : 1860. 1862. Voici, après le coup d’État de Louis Napoléon Bonaparte [1808-1873] du 2 décembre 1851, ce que Victor Hugo [1802-1885] écrivit concernant le rôle joué par Juliette Drouet [1806-1883]
- Le 1er janvier 1860 : « L’ordre de me fusiller, si j’étais pris, avait été donné dans les journées de décembre 1851. […] Si je n’ai pas été pris, par conséquence, fusillé, si je suis vivant à cette heure, je le dois à Mme Juliette Drouet qui, au péril de sa propre liberté et de sa propre vie, m’a préservé de tout piège, a veillé sur moi sans relâche, m’a trouvé des asiles sûrs et m’a sauvé, avec quelle admirable intelligence, avec quel zèle, avec quelle héroïque bravoure, Dieu le sait et l’en récompensera !
Elle était sur pied la nuit comme le jour, errait seule à travers les ténèbres dans les rues de Paris, trompait les sentinelles, dépistait les espions, passait intrépidement les boulevards au milieu de la mitraille, devinait toujours où j’étais et, quand il s’agissait de me sauver, me rejoignait toujours. Un mandat d’amener a été lancé contre elle et elle paie aujourd’hui, de l’exil, son dévouement. Elle ne veut pas que l’on parle de toutes ces choses, mais il faut pourtant que cela soit connu. Je la supplie de me permettre de lui rendre ici respectueusement témoignage, du fond de mon cœur et de mon âme et de trouver bon que je dépose ce livre à ses pieds. »
- Puis, à nouveau, en septembre 1862 : « J. J [Juliette Drouet] m’a aimé puis m’a sauvé, au 2 décembre. Elle m’a donné d’abord sa vie, puis la mienne. » 901 (Cf. Relations entre êtres humains. Récompense, Femmes. Dévouement)
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Remarquables. Émilie Du Châtelet :
Femmes (Remarquables. Du Châtelet Émilie) (1) : 1736. 1739. Voici quelques jugements intéressants de Voltaire [1694-1778] concernant ses relations avec Émilie du Châtelet [1706-1749] :
- Le (4 mars) 1736, il écrit à Nicolas-Claude Thieriot [1697-1772] :
« […] Enfin, morbleu, Émilie ordonne, obéissons. »
- (vers le 20 août) 1739, il écrit à madame de Chambonin [?-?], amie d’Émilie du Châtelet :
« Si vous me demandez pourquoi nous allons à Paris, je ne peux répondre que de moi. J’y vais parce que je suis Émilie. Mais pourquoi Émilie y va-t-elle ? Je ne le sais pas trop. Elle prétend que cela est nécessaire, et je suis destinée à la croire, comme à la suivre. […]
Elle est plus savante que jamais, et si sa supériorité lui permet encore de baisser les yeux sur moi, ce sera une belle action à elle, car elle est bien haute. »
- Le (16 décembre) 1739, il écrit à Antoine Ferriol, comte de Pont-de-Veyle [1697-1774] :
« Madame du Châtelet va vous écrire mais je l’ai devancée afin d’avoir un avantage sur elle une fois en ma vie. » 902 (Cf. Femmes. Gloire, Comparaison. Hommes / Femmes, Hommes. « Grands », Patriarcat. Voltaire)
Femmes (Remarquables. Du Châtelet Émilie) (2) : (11 janvier) 1749. Voltaire [1694-1778], concernant Émilie du Châtelet [1706-1749], dans une lettre au comte [1700-1788] et à la comtesse d’Argental [1703-1774], auteur de :
« Elle vient d’achever une préface à son Neuton [Isaac Newton.1643-1727], qui est un chef d’oeuvre. Il n’y a personne à l’académie des sciences qui eut pu faire mieux. Cela fait honneur à son sexe et à la France. En vérité, je suis saisi d’admiration. » 903
Femmes (Remarquables. Du Châtelet Émilie) (3) : 1749. 1752. Voltaire [1694-1778], après la mort d’Émilie du Châtelet [1706-10 septembre 1749], la présente à ses différents interlocuteurs et interlocutrices en ces termes :
- Le 10 septembre 1749, à Marie-Louise Denis [1712-1790] :
« Ma chère enfant, je viens de perdre un ami de vingt ans. Je ne regardais plus il y a longtemps Mme du Châtelet comme une femme, vous le savez [!] […]. »
- Le 23 septembre 1749, au comte d’Argental [1700-1788] : il évoque
« ce grand homme et cette malheureuse femme […] »
- Le 23 septembre 1749, à Marie-Louise Denis [1712-1790] :
« Je ne regrette point une maîtresse, il s’en faut beaucoup. Je regrette un ami et un grand homme. »
- Le 12 octobre 1749, à Anne-Marie Fiquet du Bocage [1710-1802] :
« Il est d’une âme aussi belle que la vôtre de regretter une femme telle que Madame du Châtelet. Elle faisait comme vous la gloire de son sexe et de la France. Elle était en philosophie ce que vous êtes dans les belles-lettres ; et cette même personne qui venait de traduire et d’éclaircir Neuton [Isaac Newton], c’est à dire de faire ce que trois ou quatre hommes au plus, en France, aurait pu entreprendre, cultivait sans cesse, par la lecture des ouvrages de goût, cet esprit sublime que la nature lui avait donné […]. »
- Le 12 octobre 1749, à Jean-Baptiste-François Durey de Meinières [1705-1785] :
« Nous avons perdu un grand homme qui avait des fantaisies de femme, mais son génie et ses vertus faisaient bien disparaître ses petites faiblesses. »
- Le 14 octobre 1749, à François-Thomas-Marie de Baculard d’Arnaud [1718-1805] :
« une femme qui a traduit et éclairci Neuton (Isaac Newton) et qui avait fait une traduction de Virgile, sans laisser soupçonner dans la conversation qu’elle avait fait ces prodiges, une femme qui n’a jamais dit du mal de personne et qui n’a jamais proféré un mensonge, une amie attentive et courageuse dans l’amitié, en un mot un très grand homme que les femmes ordinaires ne connaissaient que par ses diamants et la cavagnole (un jeu) […] »
- Le 15 octobre 1749, à Frédéric II, roi de Prusse [1712-1786] :
« J’ai perdu un ami de vingt-cinq années qui n’avait de défaut que d’être femme. » Puis il évoque : « une femme qui a été capable de traduire Neuton (Newton) et Virgile et qui avait toutes les vertus d’un honnête homme […]. », suivi le 31 décembre 1749 de :
« Je me borne à regretter dans la retraite un grand homme qui portait des jupes, à respecter sa mémoire, et à ne point me soucier du tout de ses faiblesses de femme. »
- en février 1752, à Johann-Heinrich-Samuel Formey [1711-1797] :
« Voici l’éloge d’un grand homme qui portait des jupes. »
- Le 21 mars 1752, à Johann-Heinrich-Samuel Formey [1711-1797] :
« Je vous remercie […] d’avoir donné l’éloge de Mme du Châtelet, femme digne des respects et des regrets de tous ceux qui pensent. »
- Le 17 novembre 1752, à Johann Samuel König [1712-1757] :
« une dame d’un génie étonnant et digne d’être instruite par vous dans les mathématiques. » 904
* Ajout. 18 Février 2018. (5 août) 1736. Voltaire, du vivant d‘Émilie du Châtelet, avait écrit dans une lettre à Pierre-Robert Le Cornier de Cideville [1693-1776] ceci :
« […] Je suis entre Neuton [Newton. 1643-1727] et Émilie ; ce sont deux grands hommes, mais Émilie est bien au-dessus de l’autre. Neuton ne savait pas plaire. » (Femmes. Femme, Hommes. « Grands ») 905
* Ajout. 20 février 2018. (2 mai) 1737. Voltaire, là encore avant son décès, écrit au prince royal de Prusse [futur Frédéric II. roi de Prusse. 1712-1786] :
« […] Madame du Châtelet, qui, je vous assure, a toutes les vertus d’un grand homme, avec les grâces de son sexe […]. » 906 (Cf. Sexes. Femmes)
Femmes (Remarquables. Du Châtelet Émilie) (4) : 1825. Je lis, dans Le Plutarque des jeunes demoiselles. Abrégé des femmes illustres de tous les pays concernant Émilie du Châtelet [1706-1749], ces deux appréciations :
- « Gabrielle-Émile [Et non : Émilie] de Breteuil, marquise du Châtelet fut l’honneur de son sexe et du siècle dernier. »
- « Quelle fut une de ses qualités essentielles ? Celle d’être savante, et de l’ignorer. »
- « N’avança-t-elle pas sa mort par un travail forcé ? Oui […] » 907 (Cf. Dialogues, Langage. Zeugma, Histoire. Patriarcale, Économie. « Travail forcé »)
N.B. Pour appel, Émilie du Châtelet morte à la suite de la naissance d’une fille, à 43 ans, en 1749.
Femmes (Remarquables. Du Châtelet Émilie) (5) : 1845. Un document de 33 pages rédigé par Louise Colet [1810-1876], intitulé Madame du Châtelet [1706-1749], paru dans Le Revue des deux mondes est un document historique de valeur.
Louise Colet écrit :
« Nous avons voulu la faire connaître plutôt que la juger. C’est là, nous le croyons, le premier devoir du biographe. » 908 (Cf. Femmes. Écrivaines. Colet Louise, Penser. Juger, Histoire. Historiographie. Patriarcale)
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Remarquables. Madame [Marie] Du Deffand :
Femmes (Remarquables. Du Deffand Madame) (1) : (3 octobre) 1758. Voltaire [1694-1778], dans une lettre à Jean-Baptiste-Nicolas de Formont [1694-1758], auteur de :
« Mme du Deffant [1697-1780] est plus philosophe que nous deux puisqu’elle supporte si constamment la privation de la vue et qu’elle prend la vie en patience. Je m’intéresse tendrement, non pas à son bonheur, car ce fantôme n’existe pas, mais à toutes les consolations dont elle jouit, à tous les agréments de son esprit, aux charmes de sa société délicieuse. » 909 (Cf. Êtres Humains. Soi. Du Deffand Madame, « Sciences » sociales. Philosophie)
Femmes (Remarquables. Du Deffand Madame) (2) : (20 janvier) 1766. Voltaire [1694-1778] écrit à madame du Deffand [1697-1780] ceci :
« […] Je crois vous entendre quand je vous lis. Jamais personne n’a eu l’esprit plus vrai que vous ; votre âme se peint toute entière dans tout ce qui vous passe par la tête ; c’est la nature elle-même avec un esprit supérieur, point d’art, point de tour, point d’envie de se faire valoir, nul artifice, nul déguisement, nulle contrainte. Tout ce qui n’est pas dans ce caractère me glace et me révolte. Je vous aime, Madame, parce que j’aime le vrai. […]. » 910 (Cf. Êtres humains. Âmes. Soi. Du Deffand Madame, Femmes. Infantilisation. Intelligentes)
N.B. Voltaire dans ce beau compliment ne décrit-il pas, la concernant, en positif ce que ses propres lettres sont si peu ?
-------------
Femmes (Remarquables. Dulac Geneviève) : Concernant Geneviève Dulac [1882-1942], je lis dans Wikipédia :
« Considérée comme sensible, généreuse, indépendante, possédée par la passion de la recherche et du neuf, Germaine Dulac est parmi les premières en France à envisager le cinéma comme un grand art auquel elle va se consacrer dès 1916. »
Geneviève Dulac - qui écrivit notamment dans La Française jusqu’en 1913 - fut la seule à être qualifiée, en 1990, par Georges Sadoul [1904-1967], dans son Dictionnaire des cinéastes de « [d’abord] « journaliste, féministe militante ». La présentation d’elle sus-évoquée fut malheureusement précédé d’un peu rigoureux : « D’abord », qui ne permet pas de savoir dans quelle mesure son engagement féministe perdura ou non dans sa vision du cinéma, ni quelle part il en eut. 911 (Cf. Culture. Cinéma, Femmes. Artistes)
* Ajout. 7 juin 2025. 1984. Lire, concernant Geneviève Dulac, Dominique Desanti [1914-2011], La femme au temps des années folles. J’y lis, cependant, notamment :
- « La condition héréditaire de la femme ne parait pas à première vue freiner Geneviève Dulac » [!] (p.75)
- « Mais l’héritage féminin pourtant dresse pourtant devant elle d’inconscientes barrières [!] […] » 912 (Cf. Féminismes, Patriarcat)
Femmes (Remarquables. Duncan Isadora) : 1827. Isadora Duncan [1877-1927], auteure de :
« Il y a des jours où ma vie me semble une légende dorée parsemée de pierres précieuses, un champs printanier où chatoient une multitude de fleurs à peine écloses, un matin radieux dont les heures sont parsemées d’amour et de joie ; il y a des jours où je ne trouve pas de mots pour exprimer mon extase et ma joie de vivre ; des jours où mon école me semble un rayon de génie, où je crois que son succès, bien qu’impalpable, est immense, où mon art est une résurrection.
Mais il y a des jours au contraire où passant en revue mon existence, je ne suis remplie que d’un dégoût profond, d’une sensation de vide absolu. Le passé ne me semble qu’une série de catastrophes, l’avenir une calamité fatale et mon école une hallucination enfantée par un cerveau de démente. » (Cf. Êtres humains. Cerveaux, Femmes. Artistes. Duncan Isadora)
Lire, pour mieux comprendre ce constat lucide, la vie extraordinaire de cette femme extraordinaire. 913 .
Et quel dommage que sa mort ne lui ait pas permis de rédiger en complément à ses Mémoires, le récit de ses « Deux années en Russie Bolchévique » [1921-1923]. (Cf. Femmes. Artistes, Duncan Isadora, Famille. Mariage. Russie, Féminismes)
Par ordre chronologique. Femmes. Remarquables. Élisabeth de Bohème :
Femmes (Remarquables. Élisabeth de Bohème) (1) : (6 octobre) 1642. René Descartes [1596-1650], dans une lettre à Alphonse Pollot [1602-1668], concernant Élisabeth de Bohème [1618-1680], écrit :
« Je fais bien plus état de son jugement que celui de ces messieurs les Docteurs, qui prennent pour règle de la vérité les opinions d’Aristote plutôt que l’évidence de la raison. » 914 (Cf. Patriarcat, Penser, « Sciences » sociales. Philosophie. Aristote. Descartes René)
Femmes (Remarquables. Élisabeth de Bohème) (2) : (11 décembre) 1648. Henry More [1614-1687] écrit à René Descartes [1596-1650] :
« À peine, ai-je lu vos réflexions philosophiques, que j’ai pensé que votre illustre disciple, la Sérénissime princesse Élisabeth dépassait en sagesse non seulement toutes les femmes d’Europe, mais aussi tous les philosophes. » (Cf. Femmes. Comparaison entre femmes, « Sciences » sociales. Philosophie)
Femmes (Remarquables. Élisabeth de Bohème) (3) : 2019. Blanche Cerquiglini, dans Élisabeth de Bohème [1618-1680], auteure de :
« Pour Élisabeth, la rencontre avec Descartes [René. 1596-1650] est inespérée. Elle trouve là un interlocuteur à sa hauteur intellectuelle, quelqu’un avec qui elle peut enfin philosopher. Car leur correspondance est placée sous l’angle de la philosophie, mais aussi sous l’angle de la confession amicale. Leurs échanges deviendront le jardin secret d’Élisabeth : une activité qui n'est dictée par personne, un espace d’autonomie intellectuelle.
Pourquoi cette si bonne entente ? Les conditions sociologiques l’expliquent : il n’y a aucune rivalité entre eux, aucun enjeu. Élisabeth est une princesse cultivée, non un confrère philosophe. De plus, elle se montre excellemment diplomate : demandant à Descartes des précisions, lui posant des questions, montrant les limites ou les contradictions de certains aspects de son système mais ne lui adressant aucune critique directe. Leur situation est d’abord celle d’une lectrice - une excellente lectrice - face à un auteur. Descartes répond donc d’un ton beaucoup moins virulent qu’il ne le fait avec d’autres correspondants. Peu à peu la lecture d’Élisabeth étant si fine, se ses remarques si pertinente, Descartes en vient à la considérer bien plus qu’une lectrice : une interlocutrice privilégiée. On assiste à la naissance d’une amitié philosophique. Et même, pour finir, à l’inflexion du système cartésien par Élisabeth. […] » 915
Lire tout le texte passionnant concernant cette femme si remarquable.
-------------
Femmes (Remarquables. Eltahawy Mona) : (11 juin) 2015. Mona Eltahawy, auteure de :
« Je suis une femme très en colère et j’en suis fière. » 916 (Cf. Femmes. Colère, Patriarcat. Islam)
Femmes (Remarquables. Eve (celle d’Adam et...)) : 2015. Lu dans le Huffington Post [17 septembre 2015], dans l’article intitulé : Le Pape prend la défense d’Ève contre Adam, ceci :
« ‘La femme tentatrice ? Voilà une idée blessante !’. Il suffit parfois de quelques mots, prononcés par la bonne personne, pour mettre à mal un préjugé vieux de plusieurs millénaires. C’est exactement ce qui s’est produit lors du dernier discours du pape François, consacré à Adam et Ève : ‘La femme tentatrice ? Voilà une idée blessante !’ Une petite phrase qui démolit avec une simplicité désarmante la construction culturelle selon laquelle la femme serait l’instrument du diable, un être dangereux à traiter avec méfiance, voire une franche hostilité. » 917
Mais il manque l’analyse et la dénonciation des conséquences historiques – qui perdurent - de cette image des femmes concernant laquelle l’église catholique porte une très lourde responsabilité. (Cf. Femmes. Remarquables. Jeanne d’Arc, Patriarcat. Église catholique, Penser. Pensées. Préjugés)
Par ordre chronologique. Femmes. Remarquables. Oriana Fallaci :
Femmes (Remarquables. Fallaci Oriana) (1) : 1981. Oriana Fallaci [1929-2006], auteure de ce qui fut, pour moi, un livre inoubliable : Un homme, consacré à la vie mais surtout à la compréhension d’un homme d’une volonté sans concession, Alekos Panagoulis [1939-1976] par une femme qui a vécu avec lui et réfléchi avec, pour, contre, sans lui. Un grand livre politique. 918
Femmes (Remarquables. Fallaci Oriana) (2) : 1997. Concernant Oriana Fallaci [1929-2006], lire le chapitre intitulé La Fallaci, que Christine Ockrent lui a consacré dans La mémoire du cœur. 919 (Cf. Femmes. Journalistes. Ockrent Christine)
-------------
Femmes (Remarquables. Faye Safi) : Safi Faye, première réalisatrice sénégalaise, auteure de nombreux films, dont La Passante (1972), Revanche (1973), Kaddu Beykat (Lettre paysanne) (1975), Fad'jal (Premier arbre), Goob na nu (La récolte est finie) (1979), Man Sa Yay (Moi, ta mère) (1980), Les Âmes au soleil (1981), Selbé (1983), 3 ans 5 mois (1983), Ambassades nourricières (1984), Racines noires (1985), Tesito (1989), Mossane (1996), Regards de femmes (2005) … (Cf. Culture. Cinéma, Femmes. Artistes)
Femmes (Remarquables. Ferrand Élisabeth) : 1754. Condillac [1714-1780], dans son Traité des sensations, écrit concernant Élisabeth Ferrand [1700-1752] :
« Il y a sans doute bien des difficultés à surmonter tout ce système [développé dans son livre]. Et j’ai souvent éprouvé combien une pareille entreprise était au-dessus de mes forces. Mademoiselle Ferrand m’a éclairé sur les principes, sur le plan et sur les moindres détails, et j’en dois être d’autant plus reconnaissant que son projet n’était ni de m’instruire, ni de faire un livre. Elle ne s’apercevait pas qu’elle devenait auteur, et elle n’avait d’autre dessein que de s’entretenir avec moi des choses auxquelles je prenais quelque intérêt. »
Cet écrit ne peut être présenté comme il l’est dans le Journal Parisien. 1797-1799 de Wilhelm von Humboldt comme signifiant « les remerciements [de Condillac] pour ses conseils et ses observations. » 920
…pas plus qu’il ne peut l’être concernant la présentation sur Wikipédia du Traité des Sensations :
« Il [Condillac] raconte comment il a été amené à revoir les postulats de Locke : c’est la critique de Mlle Ferrand qui lui fit remettre en question la doctrine du philosophe anglais, selon laquelle les sens nous donnent une connaissance intuitive des objets. »
En revanche, toujours sur Wikipédia, la présentation d’Élisabeth Ferrand concernant sa « contribution » au Traité des sensations est évoquée, en tant que tel, citations à l’appui. (Cf. Relations entre êtres humains. Remerciements, Penser. Postulat)
Femmes (Remarquables. Galigaï Eleonora) : 1988. Je lis dans une note de l’édition de La Pléiade des Oeuvres de Beaumarchais [1732-1799] :
« Eleonora Galligaï [1568-1619] était la femme de Concini, maréchal d’Ancre [1569-1617] ; la vigueur de son caractère, sa volonté lui assurèrent un grand ascendant sur Marie de Médicis [1575-1642] ; aussi [!], après l’assassinat de son mari en 1617, fit-elle poursuivie pour sorcellerie et décapitée. » 921 (Cf. Femmes. Comment meurent les femmes ? Patriarcat. Permanence)
* Ajout. 11 avril 2025. Deux pages plus loin, je lis dans une autre note concernant la marquise de la Croix [1717-1808] :
« Elle était à Madrid la maîtresse de Beaumarchais (le vous entendez indique assez le sens à donner au mot amie), qui fit d’elle la maîtresse du roi. » (Cf. Langage. Verbe. Faire, Patriarcat. Permanence)
N.B. Je lis ailleurs qu’il « donna » sa maîtresse au roi.
Par ordre chronologique. Femmes. Remarquables. Martha Gellhorn :
Femmes (Remarquables. Gellhorn Martha) (1) : (12 novembre) 2016. Martha Gellhorn [1908-1998], journaliste reporter de guerre, auteure de La guerre en face et Mes saisons en enfer, Cinq Voyages cauchemardesques, publiés en France en 2015, a considéré que sa mère était « la seule personne qui ne [l’]ait jamais possédée. »
France Culture, pour sa part, dans la présentation-chapeau qui est faite d’elle - alors qu’elle a, affrontant tous les dangers, couvert presque toutes les guerres du XXème siècle, la présente ainsi : « Troisième épouse d’Hemingway, elle sera la seule à oser lui demander le divorce. »
Puis, après l’avoir décrite comme « une femme forte, volontaire à qui rien ne résiste » [pas même les guerres ?] France Culture, compassionnel, s’interroge :
« Quelle fêlure cache cette quête d’intensité permanente ? » 922 (Cf. Femmes. Mères, Famille. Divorce, Patriarcat, Politique. Guerre)
Femmes (Remarquables. Gellhorn Martha) (2) : (19 septembre) 2021. Je réécoute, des années après, l’émission de France Culture, Raconter la guerre toute sa vie consacrée à Martha Gellhorn [1908-1998], et je l’entends comme un hommage passionnant permettant d’appréhender l’exceptionnelle vie de cette femme extraordinaire. 923 (Cf. Femmes. Journalistes)
N.B. La différence de perception de ma part est telle que je me demande s’il s’est bien agi de la même émission. Mais « le chapeau » apparaît bien avoir été modifié. (pas clair)
Femmes (Remarquables. Gellhorn Martha) (3) : (5 juin) 2024. À l’écoute toujours de la même émission, je lis sur le site de France Culture :
- « Au 20e siècle, de la Guerre d'Espagne à l'intervention américaine au Panama de 1989, la journaliste Martha Gellhorn a été pendant soixante ans partout dans le monde, sur le terrain, pour rendre compte des guerres. ‘Je ne veux pas être une note de bas de page dans la vie de quelqu’un d’autre’ aurait-elle dit. Malgré son statut de très grande reporter de guerre au 20e siècle, Martha Gellhorn est généralement citée en Europe pour avoir été l'une des quatre épouses de l'écrivain Ernest Hemingway. » Et de :
- « Je veux écrire. J'aime travailler. Le travail et l'écriture sont mes refuges. Finalement, c'est la seule chose qui ne me remplit pas d'ennuis, de consternation ou de doute. C'est la seule chose que je sais être absolument et irrévocablement bonne en elle-même, peu importe le résultat. Je veux voyager partout, tout voir et l'écrire à ma manière. » (Cf. Femmes. Épouse de)
-------------
Femmes (Remarquables. Goldman Emma) : 1931. Emma Goldman [1869-1940], dans Vivre ma vie, se souvenant de ses 23 ans, écrit ceci :
« Ed et moi trouvâmes enfin un endroit à nous. […]
Ed. s’étonnait que j’insiste sur la nécessité d’une pièce à moi. Il trouvait déjà difficile que nous soyons séparés durant les heures de travail et voulait m’avoir avec lui pendant notre temps libre. Mais je tins bon pour garder mon propre espace.
L’obligation de partager ma chambre avait empoisonné mon enfance et ma jeunesse.
Depuis que j’étais devenue un être libre, j’exigeais de pouvoir m’isoler au moins pendant au moins une partie de la journée et de la nuit. » 924 (Cf. Êtres humains. Goldman Emma. Soi, Femmes. Remarquables. Milena Jesenskà, Penser. Soi, Politique. Anarchisme)
Femmes (Remarquables. Gorbanevskaïa Natalia) : (25 août) 1968. Natalia Gorbanevskaïa [1936-2013] fut l’une des sept personnes qui pénétrèrent sur la place Rouge à Moscou déroulant des banderoles telles que ‘Pour notre liberté à tous’ et ‘Honte aux occupants’ pour dénoncer l’invasion de la Tchécoslovaquie par l’armée soviétique.
Arrêtée le 24 décembre 1969, elle sera internée dans un hôpital psychiatrique de 1969 à 1972. 925 (Cf. Politique. Répression, « Sciences » sociales. Psychiatrie)
Femmes (Remarquables. Grouzdieva Olga) : (mars) 2002. Je lis dans Le Journal en public de Maurice Nadeau [1911-2013] :
« Les ‘héros positifs’ d’aujourd’hui, c’est par exemple Olga Grouzdieva qui, tout simplement, a demandé à ne plus être citoyenne russe, tout en gardant les droits de vivre dans son pays. Mère de cinq enfants, ‘je ne suis ni anarchiste, ni révolutionnaire’, dit-elle, mais elle ne veut pas qu’un de ses fils aille se battre en Tchétchénie, et elle en a par-dessus la tête de se heurter à la bureaucratie pour les autres gosses, allocations familiales, cantines scolaires et le reste.
Aux fonctionnaires de Vologda, elle explique : ‘Si je suis mécontente de mon mari, s’il me maltraite, je suis en droit de demander le divorce et de porter plainte. Avec l’État, c’est la même chose.’ Et elle intente un procès à l’État. Les juges sont déboussolés, Olga a toute sa tête. Déboutée, elle remet ça et cela dure des années. À la fin, ‘un oukase du président russe Eltsine autorise Olga Grouzdieva et ses enfants à sortir de la citoyenneté russe.’ » 926 (Cf. Hommes. « Héros », Famille. Divorce, Justice, Politique. Bureaucratie. État. Guerre)
Femmes (Remarquables. Halimi Gisèle) : (16 juillet) 2021. Entendu, concernant Gisèle Halimi [1927-2020] :
« Elle est une figure historique pour les Tunisiennes ».
Comment ce que je ressens comme une limitation (« pour les Tunisiennes ») a-t-elle été pensée et surement vécue comme un ajout, un plus ? Si j’étais Tunisienne, ne penserais-je pas ainsi ? Peut-être pas. (Cf. Féminismes, Penser, Politique. Nationalisme)
Femmes (Remarquables. Hébuterne Jeanne) : 1920. Jeanne Hébuterne [1898-1920], compagne et modèle de Modigliani [1884-1920], le surlendemain de sa mort, enceinte de huit mois de leur deuxième enfant, décide de se tuer en se jetant par la fenêtre de l’appartement de ses parents. Le 27 janvier 1920, Modigliani est enterré, « entouré par des artistes de Montmartre et de Montparnasse ».
Elle, le 28, « au petit jour, dans l’intimité. »
En 1930, les deux tombes seront rejointes. [Wikipédia]
* Ajout. 28 octobre 2018. Je lis dans Jean Tulard, Guide des films. 1895-1995. L-Z, concernant le film Montparnasse 19 [ou : Les amants de Montparnasse. 1957. Jacques Becker] qui retrace la vie de Modigliani :
« Un court passage de sa vie Modigliani est heureux auprès de Jeanne [Hébuterne. « Une jeune bourgeoise qui abandonne sa famille pour le rejoindre. »] Peu de temps après, Modigliani meurt dans un hôpital parisien, alors que Jeanne, ignorant sa fin [Non ! celle de la valeur de ses tableaux], brade toutes les toiles du peintre à un marchand de tableau. » 927
Pour rappel : Elle était enceinte lorsqu’il mourut. (Cf. Culture. Cinéma)
Femmes (Remarquables. Hemmings Sally) : Sally Hemmings [?-?] fut l’esclave noire appartenant au Président Thomas Jefferson [1743-1826] : de leurs relations, sept enfants seraient nés. Lu, le concernant :
« Le grand homme [possesseur de 200 esclaves] en fait n'hésitait pas à faire fouetter ses esclaves, se plaignait de leur ‘puanteur’ et refusait de les émanciper, par crainte d'un ‘métissage qui ouvrirait la voie à la dégénérescence’. » 928 (Cf. Politique. Esclavage)
* Ajout. 30 août 2023. 2009. John Updike [1932-2009], dans Terroriste, auteur de :
« On blâme aujourd’hui Jefferson d’avoir tenu à garder ses esclaves, d’avoir fait des enfants à l’une d’elle, Sally Hemmings, mais on oublie le contexte économique du temps, et la peau très claire de Sally Hemmings. » 929 (Cf. Histoire)
Femmes (Remarquables. Hepburn Katharine) : 2019. Katharine Hepburn [1907-2003] n’est pas « masculine », elle n’est pas « androgyne » : elle est Katharine Hepburn. (Cf. Culture. Cinéma, Êtres humains. Soi, Femmes. Artistes)
Femmes (Remarquables. Herman Liselotte) : 1938. Lu concernant Liselotte Herman [1906-1938] :
« Jeune étudiante communiste et jeune mère, elle proteste ouvertement contre la prise du pouvoir par Hitler, ce qui lui vaut son renvoi de l'université de Berlin. Elle s'installe alors dans le Wurtemberg et participe à différentes actions de résistance. Avec des amis, elle parvient à faire passer à l'étranger des informations sur le réarmement national-socialiste. Elle est arrêtée en décembre 1935 et condamnée à mort avec deux de ses amis en été 1937. Elle est exécutée le 20 juin 1938 à la prison de Berlin-Plötzensee, malgré des protestations du monde extérieur. Elle est la première mère exécutée. » 930 (Cf. Femmes. Mères, Patriarcat, Politique)
Femmes (Remarquables. Hessel Helen) : Helen Hessel [1886-1982], auteure de ces Pensées / anagrammes :
« L’ironie, c’est le mépris dans la grâce »
« L’idée du suicide est le hochet des malchanceux »
« Fidélité est paresse »
« Aucun être moral ne peut tenir parole »
« Femme finie ne pense qu’au passé ». 931
Femmes (Remarquables. Holiday Billie) : 1915-1959. Billie Holiday : une grande dame. Qui, du FBI ou de ‘ses’ hommes (souvent liés entre eux, par ailleurs) lui ont fait le plus de mal ? Concernant son mari, proxénète, John Levy, quelques années après leur séparation, elle aurait déclaré, apprenant sa mort :
« C’est la meilleure nouvelle que j’ai entendue depuis longtemps. » 932
Concernant ses rapports aux hommes, lire et l’entendre chanter les paroles de « Treat me well », injustement dénommé - un détournement de sens - « Fine and mellow » les révèlent, au moins partiellement. (Cf. Femmes. Artistes. Holiday Billie, Proxénétisme)
Femmes (Remarquables. Humbert Thérèse) : 1959. Je lis dans la préface du livre de l’avocat René Floriot [1902-1975] Au banc de la défense la présentation de Thérèse Humbert [1855-1918] dont il fut le défenseur :
« Cette étonnante Thérèse qui réussit avec un brio extraordinaire, à extorquer un peu plus d’un milliard d’anciens francs à de puissants hommes d’affaires aussi importants qu’avertis. Remarquable par son importance, cette escroquerie l’est encore par sa durée. Les victimes de Thérèse ont mis dix-sept ans à comprendre qu’on les avait dupées. Et pendant, dix-sept ans, cette femme charmante, apparemment insouciante et gaie, traitait le Tout-Paris dans son somptueux hôtel de l’avenue de la Grande-Armée, dont le Préfet de police était un familier. » 933 (Cf. Justice. Avocat-es)
Femmes (Remarquables. Jablonowska Maria Anna Louisa, princesse de Talmont) : (4 juin) 1771. Maria Anna Louisa Jablonowska, princesse de Talmont [1728-1800] écrit à Voltaire [1694-1778] cette lettre :
« Il a été envoyé à Monsieur de Voltaire un in-4° des malheurs de l’infortunée Pologne, dans l’espérance qui lui, qui sent ou qui devine si bien la générosité et l’humanité, serait touché de l’état où la noble et généreuse nation est réduite en défendant sa liberté et ses lois.
Et j’apprends, dans le moment, qu’il vient encore d’employer sa plume pour donner aux Polonais des torts sur le respect qu’ils doivent à celle qui les opprime, à qui ils ne doivent que leur haine et pis encore ; quel malheur pour la Pologne d’avoir à craindre et à respecter une puissance qu’elle a dédaigné et refusé de dominer autrefois ! Et ne doit-on pas pardonner ce qui peut échapper à un si juste ressentiment contre leur tyran ?
Je me plains, Monsieur, de votre rigueur et de votre dureté pour une nation où vous êtes estimé. Le feu roi de Pologne Stanislas [1677-1766] vous a témoigné estime et amitié, aussi bien que tous les Polonais qui étaient ou passaient à sa cour. Cela devait vous prévenir un peu pour eux.
Pour moi, Monsieur, aussi fidèle et soumise sujette du Roi [Louis XV], que fière et indomptée Polonaise, je sais combien on peut sentir et penser différemment dans deux nations différentes.
Ne jugez donc pas en Français des Polonais, et n’ajoutez pas à leur malheur l’improbation de tous les ignorants qui confondent les genres de gouvernement et l’état réel des choses, dont le nombre est déjà fort grand.
Et pourquoi en voulez-vous être, vous qui n’avez pas les mêmes raisons ?
La gloire de votre héroïne [Catherine II. 1729-1789],] a-t-elle besoin de ce laurier d’iniquité encore ? Vous me trouverez d’une témérité bien punissable, mais j’avoue que je ne peux ni penser ni parler de votre héroïne sans un frémissement. Devait-elle succéder à Henri IV et à Charles XII [dont Voltaire avait vanté les mérites] ? ».
N.B.1. Il importe de rappeler que le soutien sans faille de Voltaire à Catherine II faisait aisément le sacrifice de la Pologne.
N.B.2. Maria Anna Louisa Jablonowska [?-?]fut l’une des rares personnes [avec notamment Charles de Brosses. 1709-1717] à avoir tenu tête à Voltaire, ici tant de fierté et de hauteur.
La réponse de Voltaire, en date du 15 juin 1771, fut mensongère, lâche, honteuse, lamentable. Il se présenta comme « un vieillard aveugle et mourant », « fort éloigné d’oser se mêler des querelles des nations » et considéra comme nulle toute sa critique politique. Plus encore, il osa assimiler Maria Anna Louisa Jablonowska et Catherine II, toutes deux femmes, ainsi conjointement présentées : « les personnes de votre sexe et de votre naissance », alors même que cette dernière renforçait le joug de la Russie sur la Pologne, tandis que Voltaire l’incitait, le 6 juillet 1771, à « pacifier la Pologne ».
La lettre - éclairant exemple de malhonnêteté de Voltaire - en date du 23 septembre 1771 fut en sus toute pétrie de grossièreté :
« Vous êtes comme les baleines qui se jouent dans les tempêtes », de mépris :
« Je vous respecte même assez pour croire que dans le fond de mon cœur vous pensez comme moi » et de mépris patriarcal, transformant notamment son analyse politique en pitié, pour lui, sans doute, toute « féminine » : il évoque notamment : « […] le chagrin de [sa] belle âme de voir les peines de vos compatriotes. » 934 (Cf. Patriarcat. Voltaire)
N.B.3. Maria Anna Louisa Jablonowska fut omise dans l’Index des noms de personnes et personnages citées par La Pléiade [1986] de la Correspondance de Voltaire. [Tome XIII. p.805]
Femmes (Remarquables. Jacquemart Justine) : 1860. Melle Jacquemart, [?-?] dite « la chanoinesse de Kopsel », après avoir été institutrice en Russie, avoir vécu « dans le monde » à Vienne (Autriche), puis en Crimée, a vécu comme une ermite, « dans l’isolement le plus absolu », pendant plus d’un dizaine d’années, dans « une modeste chaumière composée d’une seule pièce » ou elle fut soumise à de « nombreuses attaques ».
« Elle n’admettait dans sa chaumière que ceux dont les goûts, la réputation et la vie aventureuse ont quelque analogie avec la sienne. »
Au terme d’une rencontre, Adèle Hommaire de Hell [1810-1883] écrit la concernant :
« N’y a-t-il pas une vraie satisfaction à se garder soi-même, à se créer, au milieu des soins vulgaires de la vie, des jouissances intellectuelles que personne ne peut lui enlever ? » 935
Elle fut ’découverte’ par Adèle Hommaire de Hell [connue aussi sous les noms Adèle Hommaire, Adèle Hériot, Louise Adèle Hériot, Jeanne Louise Adelaïde Hériot], auteure de Voyage dans les steppes de la mer Caspienne et dans la Russie Méridionale. [1860]
Femmes (Remarquables. Jeanne d’Arc) : 1920. Jeanne d’Arc [1412-1431], brulée vive en 1431, suite à un procès religieux pour « hérésie », fut canonisée en 1920.
L’église catholique prend son temps… (Cf. Femmes. Remarquables. Ève, Patriarcat. Église catholique)
Par ordre chronologique. Femmes. Remarquables. Milena Jesenskà :
Femmes (Remarquables. Jesenskà Milena) (1) : Franz Kafka [1883-1924], concernant Milena Jesenskà [1896-1944], auteur de :
« C’est un feu vivant comme je n’en ai encore jamais vu… En outre, extrêmement fine, courageuse, intelligente… » 936
Un film de Véra Belmont [1990], intitulé Milena lui est consacré. (Cf. Culture. Cinéma)
De nombreuses publications la concernent, dont les Lettres à Milena de Kafka 937 dont elle fut la traductrice. (Cf. Femmes. Intelligentes)
Femmes (Remarquables. Jesenskà Milena) (2) : 1985. Une quarantaine d’articles de Milena Jesenskà [1896-1944] - sur plus de 400, souvent sous pseudonymes, connus - sont publiés en français dans le livre paru sous son nom : Vivre.
Une postface (Esquisse biographique) de 24 pages clôt le livre. 938
Femmes (Remarquables. Jesenskà Milena) (3) : 1923. Je découvre, dans ce même livre, que Milena Jesenskà [1896-1944], dans le cadre d’une analyse fort juste de critique du mariage, Le diable au foyer, avait employé en 1923 l’expression de « chambre à soi » :
« Pourquoi [les personnes mariées] ne se promettent-ils pas de s’accorder l’un à l’autre la liberté du silence, la liberté de la solitude, la liberté d’avoir une chambre à soi ? » Et elle poursuit :
« Pourquoi ne se promettent-ils pas toutes ces ‘petites choses’ infiniment difficiles, réalisables et pourtant jamais réalisées, au lieu de quelque chose d’aussi subalterne que le bonheur ? » (Cf. Femmes. Remarquables. Woolf Virginia, Famille. Mariage, Penser. Soi)
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Remarquables. Kahina La :
Femmes (Remarquables. Kahina La) (1) : (novembre. décembre) 1955. Mouloud Feraoun [1913-1922], auteur de :
« Non, le temps de Jeanne d’Arc est passé pour l’Algérie puisqu’il y a eu la Kahena. » 939 (Cf. Culture)
Femmes (Remarquables. Kahina La) (2) : 2004. Kateb Yacine [1929-1989], dans la superbe pièce écrite concernant La Kahina [reine berbère guerrière. VIIIème siècle], lui fait dire :
« […] Je suis tout simplement la voix des femmes libres / Le souffle inattendu d’un peuple qui fait appel à ses dernières ressources / Trop de nos hommes sont tombés. / Que les femmes prennent la relève ! » 940 (Cf. Politique. Peuple. Guerre. Femmes)
-------------
Femmes (Remarquables. Kautsky Louise) : Louise Kautsky [1864-1944] épouse divorcée de Karl Kautsky [1854-1938], penseur socialiste, devint la gouvernante-secrétaire d’Engels [1820-1895] jusqu’à sa mort. Celui-ci écrit, à l’occasion de la très profonde révision de son livre L’origine de la famille pour sa 4ème réédition :
« Mon inspiratrice a été, dans une large mesure, Louise, qui est pleine d’idées claires, limpides, originales sur le sujet. » 941
« Inspiratrice » ? C’est trop ou trop peu. Et surtout ce n’est pas intellectuellement honnête.
Femmes (Remarquables. Madame Kerivel) : (22 octobre) 1941. À Châteaubriant (Bretagne) les Allemands, en riposte à l’assassinat du commandant allemand de Nantes par un militant communiste, fusillèrent 27 otages. Aragon [1897-1982] qui fut le dépositaire des renseignements recueillis sur place et des lettres rédigées par les « martyrs », évoque « le courage de madame Kerivel (épouse de l’un des fusillés, internée au camp de Choisel) [?-?].
Cette femme admirable, quand elle est venue à la cellule des condamnés embrasser son mari, prise de pitié à la vue du jeune Guy Moquet [17 ans], a proposé aux officiers de prendre sa place. On le lui a refusé. Maintenant, son calme fait l’admiration de tous. […] » 942 (Cf. Relations entre êtres humains. Admiration. Pitié)
Femmes (Remarquables. Kiki de Montparnasse) : 2005. Kiki de Montparnasse [1901-1953], en réalité Alice Ernestine Prin, auteure, concernant un éventuel amant très riche, auteure de :
« C’était pourtant un homme charmant, et que j’aurais pu aimer peut-être, s’il n’avait eu tout ce fric ! Pouah ! Faire ça pour de l’argent ! Au milieu de toutes mes orgies, de mes nuits de folie, c’est la seule chose que je n’ai jamais salie, l’amour ! Je suis restée la fille très sentimentale et pleine d’affection que j’ai dû comprimer toute ma jeunesse. » 943
Chaque personne qui parle d’elle et qui, dès lors, sort du discours - quel qu’il soit - tenu sur elle, des représentations faites d’elle par les hommes [et, la concernant, ils furent légion] fait avancer et sa vérité et l’analyse féministe du monde.
Femmes (Remarquables. Klarsfeld Beate) : 1968. 2015. Beate Klarsfeld, après avoir, en 1968, au Bundestag, qualifié Kurt-Georg Kissinger, ministre-président de Bade-Wurtemberg qui se présentait à la Chancellerie de « nazi » et demandé sa démission, l’a giflé.
Son mari, Serge Klarsfeld, dépolitisant son initiative, infantilisant son épouse, a malheureusement évoqué une « gifle de la fille à son père ». 944 (Cf. Femmes. Épouse de)
Femmes (Remarquables. Kollontaï Alexandra) : 1992. Il est impossible de résumer la vie d’Alexandra Kollontaï [1872-1952]. Lire, la concernant, le livre d’Arkadi Vaksberg. 945 ; mais, dans ce livre, le rôle plus strictement étroitement politique, à savoir les analyses, les actions d’Alexandra Kollontaï sont plus rigoureuses que celles concernant « l’amour libre », « les femmes » … et ne sont pas comparables avec celles concernant la femme dite « amoureuse ».
Il importe aussi de noter qu’Alexandra Kollontaï, après avoir été, en 1922, l’une des responsables de l’opposition de gauche, dut vivre et mourut… stalinienne. Mais n’est-il pas facile de porter a postériori, hors contexte, un jugement ? Je ne sais. En tout état de cause, elle ne saurait être simplement qualifiée comme telle. Évident ? (Cf. Femmes. Bourgeoises. « Voilées », Féminismes. Antiféminisme, Histoire. Biographies)
Femmes (Remarquables. Kowalewski Sofia, Sophie, Sonia) : 1890. Sofia Kowalewski [1850-1891] : mathématicienne russe, première femme d’Europe à occuper une chaire d’Université (en Suède), rédactrice et éditrice de la revue Acta Mathematica. Parmi tant d’évènements notables de sa vie (elle a notamment soigné les blessés de la Commune), elle a rédigé un roman partiellement autobiographique Nihilist Girl, en 1890.
Elle fut qualifiée de « femme de génie » par Friedrich Engels [1820-1895]. 946 (Cf. Femmes. Commune La)
NB. Lire la concernant Wikipédia.
Femmes (Remarquables. Labourbe Jeanne) : Concernant Jeanne Labourbe [1877-1919], je lis dans trois sources, ici reproduites :
1) 1929. Vers l’autre flamme, de Panaït Istrati [1884-1935] :
« Je dois à un ouvrier roumain l’horrible récit de l’assassinat par les troupes blanches de l’institutrice Jeanne Labourbe, crime entre mille autres dont le prolétariat et les instituteurs français doivent un jour demander des comptes aux impérialistes de leurs pays. » 947
2) 1920. En Communisme de Pierre Pascal [1890-1983], en date du 1er avril 1920 un article publié par lui parut dans Le Bulletin Communiste n°3 qui faisait état de Groupe Communiste français de Moscou concernant Jeanne Labourbe qu’il nommait « la fondatrice du groupe. » :
« Jeanne Labourbe était un précurseur. Dans sa jeunesse laborieuse, elle avait gardé les troupeaux dans son village de Bourgogne. [Elle est née à Lapalisse dans l’Allier]. Puis, elle entre en service à la ville, jusqu’au jour la lettre d’une compagne fut l’occasion de son départ pour la Russie. Installée dans une famille polonaise, elle dut y jouer le rôle douloureux d’institutrice et de servante. Il lui permit cependant, tout en enseignant à son élève sa langue maternelle de compléter sa propre éducation.
Lorsqu’éclata la révolution de 1905, son grand cœur, son courage viril, son dévouement absolu à toutes les causes justes la lancèrent dans le mouvement libérateur. Elle se donna à lui certainement toute entière, comme nous l’avons vu parmi nous ne vivre que pour le Groupe et pour le communisme.
On sait comment elle est morte la 2 mars 1919, lâchement assassinée dans la nuit, au fond d’un faubourg d’Odessa, par un groupe d’officiers français et russe sous la présidence d’un général Borius [?-1903]. Aussitôt arrivés dans la ville, les succès de sa propagande parmi les troupes d’occupation avaient effrayé le commandement. Il fallait à tout prix la faire disparaître. On n’osa pas l’exécuter. Le tout puissant général préféra la faire assassiner secrètement, avec un certain nombre d’autres communistes français d’Odessa, et le lendemain une note officielle attribuait le crime à des brigands anonyme.
À peine le Groupe communiste créé à Moscou, Jeanne Labourbe avait voulu fonder un journal. Elle rechercha les conseils de ceux qu’elle estimait le plus capable de mener l’œuvre à bien. Elle vit Lénine [1870-1924] qui lui donna son consentement. Le commissariat des Affaires étrangères lui fournit le papier, l’imprimerie, un rédacteur politique, le camarade Niourine. Le capitaine Sadoul, qu’elle connaissait de nom pour son rôle à la fois diplomatique et révolutionnaire à la Mission Militaire, promit sa collaboration active. Elle-même avec son activité dévorante, accomplit le travail absorbant et ingrat des démarches multiples à faire à travers Moscou. Mais surtout, elle redouble ses efforts de propagande. » (Cf. Femmes. Dévouement. Servantes, Hommes. « Virils », Penser. Consentement, Politique. Propagande)
Puis Pierre Pascal présente les nombreuses activités du Refuge français de Moscou. 948
3) 2016. Wikipédia :
« Elle meurt en mars 1919 à Odessa, vraisemblablement exécutée par la police locale aux ordres des Russes Blancs. »
Un timbre soviétique a commémoré le 110ème anniversaire de sa naissance, le 8 avril 1877.
Femmes (Remarquables. Lacasse Victoire) : 1898. Victoire Lacasse fut la seule femme rescapée du naufrage du Bourgogne, le 2 juillet 1898 qui assurait la liaison entre Le Havre et New York : 700 personnes étaient à bord, dont 125 femmes. L’historienne Dagmar Bellmann qui rapporte ces chiffres poursuit en déclarant que les femmes « ne faisaient pas le poids face aux hommes ».
Et elle conclut que « lors des naufrages, les rescapés sont presque exclusivement des hommes. » 949
N.B. Jean-Paul Bossugue a publié un roman intitulé 700 hommes à la mer [Éditions du Rocher. 2011] dans lequel il revient sur les réactions des hommes et des femmes lors de ce naufrage.
Femmes (Remarquables. Melle de Lachaux) : 1962. Je lis dans une note de Maurice Allem [1872-1959], qui a introduit, annoté et relevé les variantes de La cousine Bette [1846] d’Honoré de Balzac [1799-1850] :
« Melle de Lachaux [?-?] aima avec un désintéressement, un dévouement et une passion rare, un homme ‘bourru, taciturne et caustique, le visage sec, en tout une figure mince et chétive’ comme l’écrit Diderot [1713-1784]. C’était un linguiste et qui s’appelait non pas Gardene, comme l’écrit Balzac, mais Gardeil [1736-1818]. Quand sa santé fut altérée, Melle de Lachaux, afin de l’aider dans ses travaux, apprit plusieurs langues anciennes (sic). Un jour pourtant il l’abandonna. Le récit de cet abandon, de l’ingratitude de Gardeil, de la douleur de Melle de Lachaux fut l’objet du petit ouvrage de Diderot : Ceci n’est pas un conte [1772], et qui n’est pas un conte en effet. Diderot connut Melle de Lachaux et Gardeil. Il fut mêlé aux incidents de leur rupture. Il dédia à Melle de Lachaux sa Lettre sur les aveugles. Melle de Lachaux a traduit les Essais sur le commerce de Hume [David. 1711-1776], faisant partie des Essais sur l’entendement humain. » 950
Par ordre chronologique. Femmes. Remarquables. Élisabeth Lacoin :
Femmes (Remarquables. Lacoin Élisabeth) (1) : 1929. À la lecture de ses écrits, j’ai pensé qu’Élisabeth Lacoin (surnommée Zaza par son amie Simone de Beauvoir) [1907-1929] pouvait incarner le terrifiant statut imposé - contesté par certaines d’entre elles, les plus lucides - à des jeunes filles intelligentes, sensibles, catholiques, riches et bourgeoises au début du XXème siècle.
Élisabeth Lacoin en effet, notamment, écrit le 4 juillet 1929, quatre mois avant sa mort :
- « Nous avions un dîner essentiellement ‘bourgeois’ et ‘bien-pensant’. J’ai regardé à un certain moment les dames assises les unes à côté des autres, avec la même physionomie tranquille et résignée, avec cet air irrévocablement honnête et vide. Serons-nous toutes comme cela un jour ? Ne peut-on être une femme honnête et chrétienne qu’au prix d’un étouffement pareil ? Est-ce cela l’éducation, ce lent endormissement qui fait des femmes, des jeunes filles bien, des êtres inoffensifs, bons mais si décourageants. […] »
- Elle écrit aussi dans une lettre adressée à un ami, le 25 juin 1929 :
« Je ne comprends pas la vie comme vous la comprenez. Le bonheur tel que la plupart de gens le définisse, santé, fortune, affections de famille, plaisir, cela ne me fait pas envie du tout, cela me donne même l’envie de dormir. Pour avoir ce bonheur bête, il suffit, comme vous dites, d’accepter des ‘compromis’, mais cela je ne le veux pas. J’aime bien mieux être malheureuse qu’heureuse à ce prix-là. ‘Il faut être raisonnable’, c’est la phrase du monde que je déteste le plus. En ce moment, on veut me faire épouser un garçon d’excellente famille, très intelligent, riche, qui a une très belle situation d’ingénieur. […] » 951 (Cf. Femmes. Bourgeoises. Heureuses. Intelligentes. Jeunes filles)
Femmes (Remarquables. Lacoin Élisabeth) (2) : 1958. Le jugement de Simone de Beauvoir [1908-1986], concernant Élisabeth Lacoin [1907-1929], dans les Mémoires d’une jeune fille rangée, :
« J'ai pensé longtemps que j'avais payé ma liberté de sa mort (à 22 ans) » est difficilement oubliable. 952 (Cf. Femmes. Jeunes filles)
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Remarquables. Laura Lafargue :
Femmes (Remarquables. Lafargue Laura) (1) : Laura Lafargue [1845-1911] l’une des filles de Karl Marx [1818-1883], fut une femme politique socialiste marxiste, traductrice de nombre de textes marxistes, épouse de Paul Lafargue [1842-1911], auteur du livre Le droit à la paresse. Elle se suicidera avec son mari. (Cf. Femmes. Épouse de, Hommes. Remarquables. Lafargue Paul, Famille. Couple)
Femmes (Remarquables. Lafargue Laura) (2) : (8 janvier) 1890. Friedrich Engels [1820-1895] lui écrivit :
« Je crois vraiment que tu es à peu près la seule personne à Paris capable de conserver la tête froide et lucide : cette ville semble rendre les gens fous. » 953
Ce jugement doit aussi être interprété comme étant une critique de la politique des socialistes français, et notamment de son mari.
Femmes (Remarquables. Lafargue Laura) (3) : (27 mai) 1892. Friedrich Engels [1820-1895] prolongera ce jugement deux ans plus tard. Alors que Le Socialiste devait se transformer en quotidien, il écrira :
« Dans ce nouveau quotidien, tu es un élément absolument nécessaire. Si l’on veut faire quelque chose de supérieur à la moyenne courante des quotidiens français, il faut que quelqu’un suive attentivement au jour le jour le mouvement en Angleterre et en Allemagne, et en rende compte de temps en temps. Et tu es la seule personne dans toute la belle France qui en soit capable… Il faut que tu sois membre régulier de la rédaction et payée en conséquence. Paul [son mari] a trop du hidalgo pour penser à de telles questions ou pour exiger qu’on y pense, mais c’est indispensable. […] » Il n’en fut plus question et le quotidien ne vit pas le jour. 954
Femmes (Remarquables. Lafargue Laura) (4) : 1979. Maria Antonietta Macciocchi [1922-2007] écrira concernant Laura Lafargue :
« Laure se mariera avec Lafargue, en 1868 et se suicidera avec lui, selon les récits de la presse, en 1911, sans laisser un mot, tandis que Lafargue laissa un testament retentissant à la cause du socialisme. Lénine [1870-1924], qui le 3 décembre 1911, prononça le discours funèbre, le dédia entièrement à Lafargue, en ne nommant Laura, seulement, en passant, au début, comme fille de Karl Marx. » 955 (Femmes. Comment faire disparaître les femmes ? Hommes. « Politiques », Patriarcat)
-------------
Femmes (Remarquables. Lagroua-Weil-Hallé Marie-Andrée) : 1984. Dominique Desanti [1914-2011], dans La femme au temps des années folles, auteure de :
« […] En 1955 le Dr Lagroua-Weill-Hallé [Marie-Andrée Lagroua-Weill-Hallé. 1916-1994], elle aussi mère de famille [comme Simone Veil. 1917-2017], subit à un congrès médical des insultes qu’on ne saurait imaginer chez des hommes qui se targuent de culture - ou du moins de diplômes. » 956 (Cf. Femmes. Accouchements. Avortements. Contraception. Criminelles, Hommes. Grossiers)
Femmes (Remarquables. La Rochejaquelein, Marquise de) : 1823. La marquise de La Rochejaquelein [1772-1857] : fille, épouse, cousine de dirigeants de l’insurrection Vendéenne, ses Mémoires sont un remarquable document historique dans lequel, confrontée à d’innombrables évènements, elle fait notamment part avec un naturel incroyable de son courage. La révolution, la contre-révolution présentée par une femme qui les a, à plus d’un titre, vécues.
Elle était née sous le nom de Marie-Louise-Victoire de Donnissan, puis, à son premier mariage, elle fut nommée marquise de Lescure, puis, à son second mariage, marquise de La Rochejaquelein. 957 (Cf. Femmes. Noms)
* Ajout. 21 décembre 2018. Je lis dans l’introduction de 1872 d’Hippolyte Taine [1828-1893] au livre qu’il a traduit : Une anglaise témoin de la révolution française, concernant l’apport qu’a pu avoir M. Gifford - qui a préfacé ce livre à sa parution en Angleterre - à sa rédaction :
« L’œuvre est d’elle [restée anonyme] jusque dans ces moindres détails, bien plus que les Mémoires de Madame de La Rochejacquelein ne sont de Madame de La Rochejacquelein. » 958 Peu clair…
* Ajout.15 janvier 2019. Je lis dans une note de l’Histoire de la Révolution française [1853] de Jules Michelet [1798-1874] évoquant un souvenir, enfant, de Madame de La Rochejacquelein : « Voyez le roman, ici véridique, que M. de Barante [1782-1866] a publié sous son nom. » 959 Peu clair…
Femmes (Remarquables. La Vallière Madame de) : 1813. Germaine de Staël [1766-1817] écrit dans De l’Allemagne :
« Louis XIV [1638-1815], si vanté par sa galanterie chevaleresque, ne se montra-t-il pas le plus dur des hommes dans sa conduite envers la femme dont il avait été le plus aimé, Madame de La Vallière [1644-1710] ?
Les détails qu’on en lit dans les Mémoires de Madame sont affreux.
Il navra de douleur l’âme infortunée qui n’avait respiré que pour lui, et vingt années de larmes au pied de la croix purent à peine cicatriser les douleurs que le cruel dédain du monarque avaient faites. » 960 (Cf. Hommes. « Galants », Relations entre êtres humains. Dédain. Galanterie)
Femmes (Remarquables. Lavoisier Marie-Anne Pierrette) : (16 octobre) 1789. Arthur Young [1741-1820], lors de son premier Voyage en France écrit :
« Rendez-vous chez M. Lavoisier [Antoine. 1743-1794]. Mme Lavoisier [Marie-Anne Pierrette. 1758-1836], femme pleine de vitalité, de sens et de savoir, avait préparé un ‘déjeuner anglais’ au thé et au café. Mais sa conversation, aussi bien sur l’Essai de Phlogistique de M. Kirwan, qu’elle est en train de traduire, que sur d’autres sujets qu’une femme d’esprit, qui travaille avec son mari dans son laboratoire, sait rendre agréable, était encore la meilleure partie (sic) du repas. » 961
Femmes. Remarquables. Anne Le Fèvre Dacier :
Femmes (Remarquables. Le Fèvre Dacier Anne) (1) : 2020. Je lis dans le chapitre du livre Femmes savantes. De Marguerite de Navarre à Jacqueline de Romillly, consacré à Anne le Fèvre Dacier [1645-1720], cette appréciation de Mary Astell [1666-1731] :
« J’estime infiniment Mme Dacier. Notre sexe lui dit beaucoup : elle a protesté contre l’erreur commune qui nous condamne à l’ignorance. Les hommes, autant pas dédain que par supériorité, nous ont interdit tout savoir : Mme Dacier est une autorité qui prouve que les femmes en sont capables. Elle a associé l’érudition et les bienséances. » 962 (Cf. Femmes. Comparaison. Femmes / Hommes. Astell Mary)
Femmes (Remarquables. Le Fèvre Dacier Anne) (2) : 2020. Je lis aussi :
« C’est grâce à Mme Dacier que le nom ‘traductrice’, forgé pour elle par Claude Brossette à la parution de L’Odyssée, est entré dans notre langue. » 963
-------------
Femmes (Remarquables. Lefort Gertrud von) : 1931. Gertrud von Lefort [1876-1971] écrivait notamment, en 1931, la nouvelle intitulée La dernière à l’échafaud (Die Letze am Schaffot). Inspirée des manuscrits de Sœur Thérèse de l’Incarnation, Françoise-Geneviève Philippe [1731-1836] qui fut la seule rescapée des seize carmélites de Compiègne guillotinées sous la Terreur à Paris, le 17 juillet 1794 et l’auteure du Récit des martyres des seize carmélites de Compiègne.
Après la publication du livre en français, La dernière à l’échafaud [Plon], Georges Bernanos [1888-1948] en novembre 1947, écrivit à la marquise de Zayas [1900-1977. vérifier] :
« Le P. Brückberger [Raymond. Léopold. 1907-1998] en tire un film, et m’a demandé d’en écrire les dialogues. Je le fais avec beaucoup de soin et d’amour. » 964 Le film ne fut pas réalisé, mais le Dialogue des Carmélites fut publié en 1949, un an après la mort de Georges Bernanos.
Francis Poulenc [1899-1963] s’en inspira pour écrire le livret d’opéra, Le Dialogue des carmélites en 1957.
Deux films sous le même titre suivront.
La correspondance de Gertrud von Lefort, très proche d’Édith Stein [1891-1942], elle aussi convertie au catholicisme, a été publiée (en français) dans la correspondance de la seconde.
Gertrud von Lefort aurait choisi son nom : Von Le Fort en identification avec celui de Blanche de la Force. 965 (Cf. Dialogues, Femmes. Guillotinées. Remarquables. Stein Édith)
* Ajout. 13 novembre 2024. 1996. Je lis dans une note des Oeuvres complètes de Jacques Prévert [1900-1977] en commentaire de cette phrase d’une lettre du 13-15 mai 1960 à Boris Vian [1909-1959] : « […] On entendait le bruit de la mer et en même temps le strident et réconfortant tintamarre des torpilles du grand film Coulez le Bismarck ! en attendant les édifiants échos du Dialogue des Carmélites. Si Dieu veut, bien entendu que cet autre chef d’œuvre passe aussi ici » :
« […] On se doute que cette évocation du destin tragique des Carmélites pendant la révolution n'était pas plus faite pour émouvoir Prévert que les malheurs du cuirassier allemand racontés dans le film nommés précédemment. »
Outre cette interprétation excessive, fausse, de ce qu’avait écrit Jacques Prévert, c’est ne faire aucun cas, n’accorder aucune valeur à l’assassinat de ces seize femmes. 966
Femmes (Remarquables. Leguay Catherine) : 1977. Catherine Leguay, fut la première femme à rejoindre le Comité d’action des prisonniers [CAP] fondé en 1977 par Serge Livrozet [1937-2022]. Dans Prisonnières, écrit en 1978, alors qu’elles avaient 27 ans, avec Catherine Ehrel, et d’autres femmes emprisonnées, auteure de :
« La justice, la prison furent une permanence de ma vie. La valeur n’attend pas le nombre des années ; ainsi du haut de mes neuf ans, je devins une délinquante juvénile, au casier judiciaire couvert d’un ‘avertissement’ pour un vol d’enfant désœuvré […]
Rebelle à tout ce qui tentait de me normaliser, la prison finit par m’accueillir pour y fêter mes dix-sept ans. […]
Les prisons d’Avignon, Versailles, Monte Carlo, la Roquette et Fleury-Mérogis m’accueillirent pour des détentions plus ou moins longues. Ces aller-retours auraient pu s’éterniser si, à vingt-trois ans, je n’avais fini par exploser, l’arbitraire et l’oppression de l’administration pénitentiaire me sortant par tous les pores de la peau. Mon impuissance à me révolter fut le déclic qui amorça ma prise de conscience, mon engagement politique. […] »
Concernant les femmes en prison, en voici le constat :
« Écrasées, normalisées, dépersonnalisées, silencieuses, dépossédées, mutilées, asexuées, opprimées, réprimées, infantilisées, les femmes détenues continuent d’être sans exister, car il est lourd, le poids de cette oppression ; lourd, le poids de ce silence. » 967 (Cf. Corps. Peau, Femmes. Silence, Justice, Patriarcat, Politique. Prison)
Par ordre chronologique. Femmes. Remarquables. André Léo :
Femmes (Remarquables. Léo André) (1) : 1871. André Léo [1824-1900] écrivaine, romancière, journaliste, militante, Communarde, auteure de :
« de belles fortunes pétries de tes misères, de la souffrance de ta femme, de la mort de ton enfant… Vive la Bourse ! La France se meurt ! » 968
Pour connaître sa pensée, son action politique, se référer au site de l’association André Léo. 969 (Cf. Féminismes, Économie. Bourse)
Femmes (Remarquables. Léo André) (2) : (8 mai) 1871. André Léo [1824-1900], auteure, aussi, dans un article (non lu intégralement) intitulé La révolution sans la femme 970 :
« Une fois de plus, les femmes n’ont rien à gagner à l’avenir immédiat de cette révolution [la Commune de Paris], car le but est l’émancipation des hommes, non des femmes. […]
On pourrait d’un certain point de vue écrire depuis 89 sous ce titre une ‘Histoire des inconséquences du parti révolutionnaire’.
La question des femmes en ferait le plus gros chapitre, et l’on verrait comment ce parti trouva moyen de faire passer du côté de l’ennemi la moitié de ses troupes qui ne demandait qu’à marcher avec lui. »
Auteure aussi, citée dans le même article (sans source spécifiée) de :
« Beaucoup de républicains - je ne parle pas des vrais - n’ont détrôné l’Empereur et le bon Dieu […] que pour se mettre à leur place. Et naturellement, dans cette intention, il faut des sujets ou au moins de sujettes. La femme ne doit plus obéir aux prêtres ; mais elle ne doit pas non plus relever d’elle-même. [Si] elle doit demeurer neutre et passive sous la direction de l’homme, elle n’aura fait que changer de confesseur. » (Cf. Droits. Droits de l’homme, Femmes. Commune La, Féminismes, Patriarcat, Politique. République, Histoire. Révolution française. Historiographie. Patriarcale, Violences)
Femmes (Remarquables. Léo André) (3) : 1980. Lu, concernant André Léo [1824-1900] :
« Restée veuve en 1861, elle se lança dans la littérature. » 971 (Cf. Femmes. Écrivaines. Veuves)
Femmes (Remarquables. Léo André) (4) : 2018. Lu concernant André Léo [1824-1900] :
« Lorsque la Commune décide de supprimer les journaux d’opposition, elle demande le respect sans condition de la démocratie : ‘Si nous agissons comme nos adversaires, comment le monde choisira-t-il entre eux et nous ?’ » 972 (Cf. Femmes. Commune La, Politique. Liberté d’expression. Médias)
-------------
Femmes (Remarquables. Lespinasse Julie de) : 1989. Lu :
« La correspondance de Melle de Lespinasse [1732-1776] (environ quatre cents lettres) permet de reconstituer la liste de familiers. Tous les noms qui comptèrent à l’époque y figurent, de Diderot à Helvétius, de Rousseau à Bernardin de Saint-Pierre, des poètes Delille à Roucher, de Marmontel à La Harpe, de l’abbé Galiani, le pétulant Napolitain à Lord Shelburne, le flegmatique collaborateur de Pitt, de la maréchale de Luxembourg à la comtesse de Bouflers, de Malesherbes à Turgot. On y vit surtout la génération des successeurs des encyclopédistes ; c’est de ces écrivains que Julie fut la ‘muse’, de Jean-Baptiste Suard à l’abbé Morellet, d’Arnaud à Condorcet. » 973 (Cf. Femmes. Muses, Patriarcat. Lespinasse Julie de)
Femmes. Remarquables. Levasseur Thérèse :
Femmes (Remarquables. Levasseur Thérèse) (1) : On comprendrait sans doute un peu mieux certaines des relations entre Jean-Jacques Rousseau [1712-1778] et Thérèse Levasseur [1721-1801] si on les lisait à la lumière de celles entre Émile et de Julie. Et vice versa. (Cf. Femmes. Épouse de. Mères. Veuves)
Par ordre chronologique. Femmes. Remarquables. Levasseur Thérèse :
Femmes (Remarquables. Levasseur Thérèse) (1) : (29 mai) 1790. Isabelle de Charrière [1740-1805], dans une lettre à Benjamin Constant [1767-1830], auteure de :
« […] Je soupçonne beaucoup de petites ruses littéraires dans ce monde-là. On n’a plus trouvé de Thérèse Le Vasseur [Thérèse Levasseur. 1721-1801] chez les libraires de Paris il y a déjà longtemps. […]. »
Une note précise qu’Isabelle de Charrière évoque son livre intitulé : Plainte et défense de Thérèse Levasseur [1789], « vive réponse au dénigrement des Lettres [sur les écrits et le caractère de] de Jean-Jacques Rousseau de Germaine de Staël [1766-1817]. » 974
Femmes (Remarquables. Levasseur Thérèse) (2) : 1808. Charles-Joseph de Ligne [1735-1814], écrit dans Mes deux conversations avec Jean-Jacques parues dans Lettres et pensées :
« Sa vilaine femme ou servante nous interrompait quelques fois par quelques questions saugrenues qu’elle faisait ou sur son linge. Il lui répondait avec douceur, et aurait ennobli un morceau de fromage, s’il en avait parlé. » 975
Femmes (Remarquables. Levasseur Thérèse) (3) : 1814. Germaine de Staël [1766-1817] écrit, dans une note dans ses Lettres sur les écrits et le caractère de J.-J. Rousseau, ceci :
« Un Genevois [François Coindet. 1734-1809] qui a vécu avec Rousseau pendant les vingt dernières années de sa vie, dans la plus grande intimité, m’a peint souvent le caractère abominable de sa femme.
Les sollicitations atroces que cette mère dénaturée lui fit pour mettre ses enfants à l’hôpital, ne cessant de lui répéter que tous ceux qu’il croyait ses amis s’efforceraient d’inspirer à ses enfants une haine mortelle contre lui ; tâchant enfin de le remplir, par ses calomnies et ses feintes frayeurs, de douleur et de défiance.
C’est une grande folie sans doute d’écouter et d’aimer une telle femme ; mais cette folie supposée, toutes les autres sont vraisemblables. » 976 (Cf. Femmes. Mères. Veuves. Levasseur Thérèse)
N.B. Une note de Simone Balayé [1925-2002] précise que François Coindet, longtemps ami de Jean-Jacques Rousseau, fut secrétaire de Jacques Necker, père de Germaine de Staël, et que celle-ci le connaissait depuis son enfance et le voyait souvent.
-------------
Femmes (Remarquables. Linder Maud) : Maud Linder [1924-2017], la fille de Max Linder [1883-1925], réalisatrice « s’est [notamment] distinguée par son travail de restauration et de mise en valeur de l’œuvre de son père. » [Wikipédia] (Cf. Culture. Cinéma)
Par ordre chronologique. Femmes. Remarquables. Lou Andreas-Salomé :
Femmes (Remarquables. Lou Andreas Salomé) (1) : Lou Andreas Salomé [1861-1937] : Une femme d’une remarquable intelligence, d’une remarquable sensibilité. Riche d’elle-même, riche de ses relations avec ceux [et dans une moindre mesure, avec celles] avec lesquel-les elle a partagé des moments, des expériences de vie, sans être réductible à aucun d’entre eux. Avoir découvert, à 25 ans, sa [première] biographie est l’un des cadeaux de la vie. (Cf. Relations entre êtres humains. Cadeau)
Femmes (Remarquables. Lou Andreas Salomé) (2) : 1951. Lou Andreas Salomé [1861-1937], auteure, dans Ma vie, publié après sa mort, de :
« Je ne peux conformer ma vie à des modèles, ni ne pourrais jamais constituer un modèle pour qui que ce soit ; mais il est tout à fait certain en revanche que je dirigerai ma vie selon ce que je suis, advienne que pourra. » 977
Femmes (Remarquables. Lou Andreas Salomé) (3) : 1951. Lou Andreas Salomé [1861-1937] Que penser de cette phrase :
« Je suis éternellement fidèle aux souvenirs ; je ne le serai jamais aux hommes. » ? 978
À la relecture, plus tard, de cette même phrase, non relevée de ma première lecture de Ma Vie, et dès lors resituée dans le cadre de ses réflexions concernant Rainer Maria Rilke [1875-1926] et de leurs relations, je comprends un peu mieux la signification de cette phrase « si crûment sincère ». 979
N.B. Jacques Nobécourt [1923-2011], dans sa Préface à Ma Vie de Lou Andreas Salomé présente son interprétation de cette phrase. 980
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Remarquables. Rosa Luxemburg :
Femmes (Remarquables. Luxemburg Rosa) (1) : Rosa Luxemburg [1871-1919], auteure de :
« L’épreuve de force entre l’homme et la femme [est un] problème purement académique, tiré par les cheveux qui n’existe pas dans la réalité. Car ou bien la femme est une personnalité - je ne veux pas dire une femme remarquable - mais un cœur plein de bonté et d’énergie intérieure [...] et alors elle s’impose et triomphe moralement, même si elle cède sur des détails. Ou bien, intérieurement, elle n’est rien - et alors le problème n’existe plus. » 981
Ce déni, cet impensable même, de toute pensée politique féministe, tel qu’ici exprimée par celle qui est présentée comme l’un-e des plus brillant-es théoricien-nes marxistes, qui plus est, l’ « une des plus fortes personnalités du socialisme » selon Boris Souvarine, 982 permet de mieux appréhender l’incompatibilité théorique entre marxisme et féminisme.
À la relecture, c’est d’elle qu’elle parle. (Cf. Êtres humains. Soi. Luxembourg Rosa, Féminismes. Marxisme incompatible avec le féminisme)
Femmes (Remarquables. Luxemburg Rosa) (2) : 1916-1919. Les Lettres de prison de Rosa Luxemburg, [1871-assassinée le 15 janvier 1919] : un joyau de philosophie politique.
Lues par Anouk Grinberg : une merveille d’humanité, de sensibilité. 983 (Cf. Êtres humains. Soi. Luxembourg Rosa, « Sciences » sociales. Philosophie)
Femmes (Remarquables. Luxemburg Rosa) (3) : (16 mars) 1919. Lu dans Les Cahiers du comte Kessler [1868-1937], écrit de Berlin, en vue d’une éventuelle alliance politique pour remplacer le régime de la république de Weimar « discrédité, souillé de sang » :
« Chez les communistes, on ne trouvera personne sur qui l’on puisse compter comme homme d’État. Rosa Luxemburg aurait été la seule personnalité politique du parti capable de gouverner l’Allemagne. » 984
* Ajout. 30 avril 2021. 1998. James C. Scott [1926-2024], dans L’œil de l’État, auteur de :
« Il est intéressant de se demander dans quelle mesure la foi de Luxembourg aurait été préservée si elle était effectivement parvenue au pourvoir en Allemagne. En tout état de cause, il est clair que sa vision des choses, alors qu’elle n’était pas au pouvoir, était radicalement différente de celle de Lénine [1870-1924] lorsque lui non plus n’était pas au pouvoir. » 985
-------------
Femmes (Remarquables. Luxemburg Rosa & Clara Zetkin) : Lors d’une réunion (sans date) chez Auguste Bebel [1840-1913], avec d’autres socialistes, Rosa Luxemburg [1871-1919] et Clara Zetkin [1857-1933] se perdent en route et arrivent très en retard. Soulagés, ceux qui les attendaient s’amusent à rédiger des épitaphes à leur mémoire. Rosa Luxemburg les rejette toutes et en propose une autre de son cru :
« Ici sont enterrés les derniers hommes de la social-démocratie allemande. » 986
Interprétation pas très claire pour moi : évoquait-elle elle-même et Clara Zetkin ? (Cf. Politique. Social-démocratie)
Femmes (Remarquables. Macciocchi Maria-Antonietta) : 1971. À ma connaissance (actuelle, limitée et partielle), la [l’une des ?] critique féministe la plus pertinente du marxisme est lisible dans le petit texte de Maria-Antonietta Macchiocchi [1922-2007] : « Quelques thèmes autour du marxisme et du féminisme », en conclusion de la publication de son Séminaire de Vincennes en 1977-78. 987 (Cf. Femmes. Écrivaines. Macciocchi Maria Antonietta, Politique. Marxisme)
Femmes (Remarquables. Madame Simone) : (12 juillet) 2024. À l’entendre [madame Simone. 1877-1985 - morte à 107 ans -] quelle riche, vraie et rigoureuse personnalité ! 988
Femmes (Remarquables. Maier Vivian) : (septembre) 2024. Yann Foucher, dans le Courrier de lecteurs du Monde Diplomatique (p.2), évoque « la photographe Vivian Maier [1926-2009] qui toute sa vie a souhaité rester dans l’anonymat. Elle gagnait sa vie en tant que nounou (sic), ce qui lui lassait le temps pour s’adonner à sa passion. Elle a confié son œuvre au hasard d’une éventuelle postérité, ce qui rend sa démarche exceptionnelle. […] À notre époque de réseaux dit ‘sociaux’ et d’espaces médiatiques saturés, l’anonymat et la solitude sont peut-être les derniers espaces de liberté. »
Femmes (Remarquables. Mallet Isabelle) : 1927. Isabelle Mallet [?-?], atteinte de poliomyélite et paralysée, a créé, en 1927, La semaine de la bonté.
Lu, la concernant, sur le site officiel de cette association :
« [Elle] surmontait sa maladie et mettait toute son énergie et une partie de sa fortune pour créer [cette] association caritative pionnière de l'aide sociale, qui servira de modèle à de nombreuses autres institutions et qui sera reconnue d'utilité publique en 1955. »
L’une des premières initiatives faisant appel publiquement à la générosité privée ? (Cf. Femmes. Charité. Pionnières)
Femmes (Remarquables. Manchu Rigoberta) : 2007. Rigoberta Manchu, prix Nobel de la paix en 1992 et notamment membre du comité d'honneur de la Fondation Chirac, aurait, selon Le livre noir de la condition des femmes, déclaré (source non citée, à vérifier) que : « le féminisme était le dernier avatar du colonialisme ». 989 (Cf. Féminismes. Antiféminisme, Patriarcat. Colonialisme, Politique. Colonialisme)
Femmes (Remarquables. Marie) : Marie, supposée mère du fils du dieu (chrétien), lorsqu’elle fut informée - nous dit-on - qu’elle devait l’enfanter, répondit :
« Je suis la servante du Seigneur. Qui me soit fait selon ta parole [ou : selon qu’il m’advienne]. Et l’ange (Gabriel) la quitta. » (La Bible)
Ça commença mal… (Cf. Femmes. Servantes)
Femmes (Remarquables. Mademoiselle Mars) : (26 mars) 1849. Victor Hugo [1802-1885], concernant la comédienne mademoiselle Mars [1779-1849], présent à son enterrement, dans Choses Vues, écrit :
« Elle laisse un fils… On n’a pas envoyé de billets de faire-part à cause de l’embarras de mettre : ‘Mademoiselle Mars est morte. Son fils a l’honneur de vous en faire part’. » 990
Victor Hugo note aussi que « pendant les discours, au cimetière, les prêtres sont remontés dans leur voiture pour ne point entendre l’éloge d’une comédienne. » (Cf. Femmes. Artistes. Noms, Famille. Mariage, Relations entre êtres humains. Traités de savoir-vivre, Patriarcat, Politique. Religion)
Par ordre chronologique. Femmes. Remarquables. Mère Teresa :
Femmes (Remarquables. Mère Teresa) (1) : 1993. Bernard Kouchner se souvient de Mère Teresa [1910-1997] :
« Au Guatemala, elle a été reçue dans un stade immense, elle est arrivée devant la foule, malade, coudée comme un vieil olivier, elle a touché les malades grabataires alignés devant elle. ‘Lève-toi et marche’. Ils ne se sont pas levés ! Enfin, passons. Elle a alors commencé à parler très bas…Personne n’entendait. On croyait qu’elle allait rendre l’âme, mais elle s’est redressée, et à la fin, d’une voix fracassante, elle s’est mise à prêcher…Il y avait bien vingt mille personnes. Et que leur annonce-t-elle ? ‘Le grand danger, au Guatemala, comme au Bengladesh, ce n’est pas la pauvreté, c’est l’avortement’. Inimaginable ! » 991
Elle fut canonisée le 4 septembre 2016. (Cf. Femmes. Avortements)
Femmes (Remarquables. Mère Teresa) (2) : 2010. Catherine Clément, dans son autobiographie, Mémoire, écrit :
« Ils [Les communistes du West Bengale, au gouvernement] avaient eu avec Mère Teresa [1910-1997] des rapports difficiles au début, à cause du combat contre l’avortement que menait activement la sainte dans Calcutta.
Mais quand elle mourut, ces communistes bengalais organisèrent pour la Mother de l’Inde des funérailles grandioses en plaçant son cercueil sur l’affût de canon qui avait servi pour les obsèques du Mahatma Gandhi [1869-1948]. Pour la chrétienne et le hindou également non-violents, cet objet militaire était un peu bizarre, mais dans les deux cas, l’hommage national fit oublier le canon. » 992
« Oublier le canon », c’est occulter, dénier sinon l’essentiel du moins une fraction importante de l’essentiel, et plus simplement, l’idée même de la différence, voire de la pensée… (Cf. Femmes. Avortements)
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Remarquables. Louise Michel :
Femmes (Remarquables. Michel Louise) : 1886. Louise Michel [1830-1905] : pour connaître ses analyses plus clairement féministes, se reporter plus précisément notamment aux pages 118 à 125 de ses Mémoires. 993 (Cf. Féminismes)
Femmes (Remarquables. Michel Louise. Enterrement) : 1905. Louise Michel [1830-1905] meurt, le 9 janvier 1905, à l’hôtel L’Oasis à Marseille. Elle est enterrée le 22 janvier 1905 à Paris. L’Humanité, le 23 janvier 1905, en fait part :
« Constatons que Monsieur Lépine (Le préfet de police) avait mis sous la protection (?) de 25 officiers de paix, 80 brigadiers, 880 sous brigadiers, 8000 sergents, sans bâton, mais avec sabre et probablement casse-tête, 400 agents de la brigade des recherches, 350 inspecteurs de la Sûreté (alias agents de la Secrète qui, notamment lorsqu’ils sont déguisés en pékins, fleurent à dix lieux leur roussin), et de 100 agents de la mobile, plus des petits soldats ; en effet, trois bataillons d’infanterie et six escadrons de cavalerie sont disposés dans les rues adjacentes et toutes les troupes consignées l’arme au pied. » […] 994
Une reconnaissance policière qui vaut reconnaissance politique. (Cf. Politique. État, Histoire)
* Ajout. 16 mai 2014. 1930. Lu ultérieurement, dans Souvenirs d’un révolté de Jean Grave, :
« Son corps [celui de Louise Michel] ramené à Paris, la population lui fit de magnifiques funérailles. Comme d’habitude, la police avait fait un déploiement formidable de forces le long du cortège, Lépine [Louis. 1846-1933] et ses subordonnées déployant un zèle intempestif.
Un fait significatif qui prouve que lorsque la foule est bien résolue à ne pas se laisser em…bêter, elle peut avoir le libre exercice de sa volonté. […]
Lépine nous jappait aux talons. Il ordonna à un peloton de gardes municipaux qui se trouvait là de mettre baïonnette au canon. Ce qui fut fait. Mais un cri formidable de ‘À bas les baïonnettes !’ sortit des rangs de la foule. Et les baïonnettes furent remises au fourreau, sans attendre l’ordre des chefs. Lépine sut se taire cette fois. » 995 (Cf. Politique. Anarchisme. Démocratie. Peuple, Histoire)
* Ajout. 2 juin 2025. (30 janvier) 1905. Jules Renard [1864-1910] écrit dans son Journal :
« Quelqu’un demandait, à l’enterrement de Louise Michel : « Est-ce pour lui faire honneur qu’il y a tant de troupe ? »
Aujourd’hui, je répondrais : oui.
-------------
Femmes (Remarquables. Missy / Mathilde de Morny) : Mathilde de Morny [1863-1944] dénommée Missy fut celle à qui Colette [1873-1954] écrivit :
« C’est toi ma raison de vivre » ; celle qui écrivit à Henry de Jouvenel [1876-1935], son futur mari :
« Je vous confie Colette ». 996
- Je découvre aussi qu’à la fin de sa vie Mathilde de Morny, aurait « subi » (?) « une hystérectomie (ablation de tout ou partie de l’utérus) et une ablation des seins ». Elle s’habillait avec des vêtements d’hommes et se faisait appeler Monsieur.
- Que sait-on vraiment d’elle, au-delà des stéréotypes, des platitudes concernant les femmes dites lesbiennes et / ou dites masculines, pseudo-alternative qui par ailleurs ne manque pas de sel…
N.B. Si l’habit ne fait ni l’homme, ni la femme, ne le révèle-t-il - un peu - à eux / elles-mêmes ? (Cf. Corps. Seins. Utérus, Êtres humains. Vêtements, Femmes. Lesbiennes)
Femmes (Remarquables. Mladic Ana) : 1994. Anna Mladic, fille de Ratko Mladic, ancien chef militaire des Serbes de Bosnie, qualifié de « bourreau de Srebrenica », étudiante en médecine s‘est suicidée, en mars 1994, avec l’arme de service de son père.
Femmes (Remarquables. Monica) : Monica, pour les chrétien-nes, sainte Monique [331-387], mère d’Augustin d’Hippone [354-430], pour les chrétien-nes, saint Augustin, voici, la concernant, ce que celui-ci en écrit dans ses Confessions :
« Formée à la modestie et à la sagesse, plutôt soumise par vous (au dieu chrétien) à ses parents que par eux à vous, à peine nubile, elle fut remise à un homme qu’elle servit comme son maître ; jalouse de l’acquérir à votre épargne, elle n’employait, pour vous prouver à lui, d’autre langage que sa vertu.
Et vous (dieu chrétien) la rendiez belle de cette beauté qui lui gagna l’admiration et le respectueux amour de son mari.
Elle souffrit ses infidélités avec tant de patience que jamais nuage ne s’éleva entre eux à ce sujet.
Elle attendait que votre miséricorde lui donnât avec la foi la chasteté.
Naturellement affectueux, elle le savait prompt et irascible, et n’opposait à ses emportements que calme et silence.
Aussitôt qu’elle le voyait remis et apaisé, il le lui rendait à propos raison de sa conduite, s’il était arrivé qu’il eût cédé trop légèrement à sa vivacité.
Quand plusieurs des femmes de la ville, mariées à des hommes plus doux, portaient sur leur visage quelque trace des sévices domestiques, accusant, dans l’intimité de l’entretien, les mœurs de leurs maris, ma mère accusait leur langue, et leur donnait avec enjouement ce sérieux avis, qu’à dater de l’heure où lecture leur avait été faite de leur contrat de noces, elles avaient dû le regarder comme l’acte authentique de leur esclavage, et ce souvenir de leur condition devait comprimer en elles toute révolte contre leurs maîtres. Et comme ces femmes, connaissant l’humeur violente de Patricius, ne pouvaient témoigner assez d’étonnement qu’on n’eût jamais ouï dire qu’il eût frappé sa femme, ou que leur bonne intelligence eût souffert un seul jour d’interruption, elles lui en demandaient l’explication secrète ; et elle leur enseignait le plan de conduite dont je viens de parler. Celles qui en faisaient l’essai, avaient lieu de s’en féliciter ; celles qui n’en tenaient compte, demeuraient dans le servage et l’oppression. » 997
On peut noter que Patricius, son mari, est présenté par Wikipédia, comme « un homme bon, affectueux et ouvert d’esprit » [29 février 2016]. (Cf. Corps. Visage, Femmes. Mères. Monica. Silence, Famille. Mariage, Patriarcat, Domination masculine, Politique. Esclavage, Histoire, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
Par ordre chronologique. Femmes. Remarquables. Adrienne Monnier :
Femmes (Remarquables. Monnier Adrienne) (1) : (Textes divers) 1929-2977. Jacques Prévert [1900-1977], dans La boutique d’Adrienne, auteur de :
« Adrienne Monnier [1892-1955] […] dans la rue de l’Odéon où s’épanouissaient, s’échangeaient, se dispersaient où se fanaient les idées en toute liberté, en toute hostilité, en toute promiscuité, en toute complexité, souriante, émue et véhémente, elle parlait de ce qu’elle aimait : la littérature. » 998 (Cf. Culture. Littérature. Livres, Penser. Idées)
N.B. Sa librairie s’appelait : « La maison des amis des livres ».
Femmes (Remarquables. Monnier Adrienne) (2) : 1960. Adrienne Monnier [1892-1955], dans Rue de l’Odéon, concernant André Breton [1893-1966], auteure de :
« Je crois bien que nous ne fumes jamais d’accord. Même sur les sujets où nous aurions pu nous entendre : Novalis, Rimbaud, l’occultisme… il avait des vues exclusives qui me dépaysaient tout à fait. […] Je lui paraissais certainement réactionnaire, tandis qu’aux yeux de la clientèle courante, je faisais figure de révolutionnaire. […] D’autre part, je ressentais moins que lui le besoin de nouveautés violentes. […]
La lecture achevée [celle par André Breton des Champs magnétiques], je fis à Breton des éloges beaucoup plus modérés que ceux qu’il attendait. Il dut me juger définitivement sans intérêt. Et nous nous fréquentâmes de moins en moins. » 999
Femmes (Remarquables. Monnier Adrienne) (3) : (16, 23 mars) 2024. [1ère diffusion, 25 avril 2021] Écouter, sur France Culture, le vivant et riche portait d’Adrienne Monnier [1892-1955] qui la situe dans son siècle.
Dans la foulée, je regarde la présentation qui est faite d’elle par Wikipédia, elle aussi, fort riche.
-------------
Femmes (Remarquables. Morawiecki Laurence) : Jean Morawiecki [?-2015] est le ‘fiancé’ auquel Hélène Berr [1921-1945] dédia son Journal et pour lequel, partiellement, elle l’écrivit.
Lorsque ce journal, après sa mort, fut publié, en 2008, celui-ci rédigea un petit texte intitulé : Ma vie avec le journal d’Hélène, dans lequel il écrit que, plusieurs années après l’avoir gardé pour lui seul, il le donna à lire, à Laurence Morawiecki [?-1992] qui était son épouse depuis 1956. Et il rapporte sa réaction :
« Elle me le rendit en disant : ‘Qu’il était beau d’avoir ainsi été aimé par une personne de cette qualité.’ » 1000
Femmes (Remarquables. Morgenstern Sophie) : 1940. Sophie Morgenstern [1875-1940], psychiatre et psychanalyste, fut l’une des premières à avoir initié en France la psychanalyse des enfants. Après, suite à une opération, avoir perdu sa fille unique et alors qu’elle savait que sa famille, juive, avait été massacrée à Lvov (Pologne), elle s’est suicidée, le 13 juin 1940, la veille de l’entrée des nazis à Paris. (Cf. Famille, « Sciences » sociales. Psychanalyse)
Femmes. Remarquables. Violette Morris :
Femmes (Remarquables. Morris Violette) (1) : Violette Morris [1893-1944], auteure de :
« Ce qu’un homme peut faire, Violette peut le faire. »
- Même tuer…
Elle a en effet tué en décembre 1937 un légionnaire, a plaidé la légitime défense et a bénéficié d’un non-lieu.
Femmes (Remarquables. Morris Violette) (2) : Lu sur Wikipédia : « Sportive puissante et complète, Violette Morris multiplie les performances remarquables dans les années 1920. Athlète émérite, elle détient les records du monde du lancer du disque et du lancer de poids et remporte dans les deux disciplines les premières Olympiades féminines en 1921 et 1922. Au football, elle est capitaine de l’Olympique et remporte le titre de championne de France et de la Coupe la Française en 1925. Talentueuse pilote de course, elle remporte le Bol d’Or automobile en 1927. Elle devient la sportive la plus titrée, hommes et femmes confondus. »
Elle a aussi joué au basket, au hockey, au cricket, a fait de la boxe anglaise, du ski, de la natation…
Elle perd le procès qu’elle avait intenté à la Fédération française sportive féminine - dont elle est radiée [vérifier] - pour des ‘raisons’ qui n’ont bien évidemment rien à voir avec le sport…
À quand sa réhabilitation - officielle - par les institutions sportives françaises ?
-------------
Femmes (Remarquables. Mota Gisela) : (2 janvier) 2016. Mota Gisela [1987-2015] : maire de Temixco, dans le sud du Mexique, après tant d’autres, assassinée chez elle, à 33 ans, d’après les « autorités », par le cartel de la drogue, Los Rojos, le lendemain de la prestation de serment au cours de laquelle elle s’était engagée à lutter contre la criminalité. (Cf. Femmes. Comment meurent les femmes ? « Politiques », Politique. État, Économie. Drogue)
Femmes (Remarquables. Mnouchkine Ariane) : 2016. Ariane Mnouchkine, auteure de :
« L’immédiat handicape le futur. » 1001 (Cf. Penser, Politique. Médias, Histoire)
Femmes (Remarquables. Necker Suzanne) : 1818. Lu, concernant Suzanne Necker, née Churchod [1737-1794], dans les Considérations sur la révolution française de Germaine de Staël [1766-1817], sa fille :
« L’hôpital, qui porte encore aujourd’hui le nom de Necker, fut créé à la fin de 1778 par Madame Necker. C’était alors un petit hôpital de 128 lits où tous les malades - grande innovation - étaient couchés seuls. Les soins y étaient dispensés par un médecin, deux chirurgiens et douze sœurs de Saint-Vincent de Paul. La mortalité y était plus faible que dans les autres hôpitaux parisiens. » 1002 (Cf. Femmes. « Filles de la charité »)
Madame Necker est aussi l’auteure d’un Mémoire sur l’établissement des Hospices [1786] et des Réflexions sur le divorce [1794] et, elle est aussi, bien sûr, outre l’épouse de son mari, Jacques Necker [1732-1804], et la mère de Germaine de Staël. (Cf. Famille. Divorce)
* Ajout. 7 mai 2019. Concernant ses Réflexions sur le divorce, lu :
« peut être inspirées par le fiasco matrimonial de sa fille ». 1003 (Cf. Femmes. Remarquables. Staël Germaine de, Famille. Divorce)
* Ajout. 16 janvier 2020. Un dossier intitulé « Autour de Mme Necker » a été publié par Les cahiers Staëliens. n°57. 2006.
* Ajout. 13 février 2022. Sur Wikipédia, elle est présentée comme « femme de lettres et salonnière franco-suisse ».
Que Wikipédia supprime une fois pour toutes le terme de « salonnière » ! (Cf. Femmes. Salons)
Femmes (Remarquables. Nehru Indira) : Indira Nehru [1917-1984] fut la fille aimée de son père [Nehru Jawaharal. 1889-1964] son bras droit, sa secrétaire particulière, la maîtresse de sa maison, son accompagnatrice, sa conseillère, son bâton de vieillesse, sa successeuse. Puis, une femme politique en titre. (Cf. Femmes. « Politiques ». Famille. Filliation)
Femmes (Remarquables. Nin Anaïs) : (janvier) 1944. Fragment de lettre adressée à Anaïs Nin [1903-1977] par Henry Miller [1891-1980], publiée dans son Journal :
« […] Tout ce que vous avez souhaité que je fasse, je l’ai fait. J’ai été mis à rude épreuve et j’en suis presque content. J’espère que vos luttes à vous se seront révélées aussi fécondes. J’aimerais bien le savoir, si cela ne vous fait rien. Toute ma force me venait de l’exemple que vous m’aviez donné. Il n’y a personne au monde que je vénère plus que vous. […] » 1004
Par ordre chronologique. Femmes. Remarquables. Ninon de Lenclos :
Femmes (Remarquables. Ninon de Lenclos) (1) : (1er mai) 1751. Voltaire [1694-1778], dans une lettre adressée au pasteur Johann-Heinrich-Samuel Formey [1711-1797], présente une longue, précise, passionnante et louangeuse biographie de Ninon de Lenclos [1620-1705].
Il considère comme « philosophe » celle généralement qualifiée de « courtisane ».
Il avait préalablement précisé que « le cardinal de Richelieu [1585-1642] eut les premières faveurs de Ninon, qui probablement eut les dernières de ce grand ministre. […] Elle avait alors seize à dix-sept ans. »
Voltaire cite, la concernant, deux livres [pour lui, récents], celui de Antoine Bret, Mémoires sur la vie de Mlle de Lenclos [Amsterdam. 1751] et celui de Douxmenil [?-1777], Mémoires et lettres pour servir à l’histoire de la vie de Mlle de Lenclos (Rotterdam. 1751)
- Sources non citées et donc à ajouter sur Wikipédia.
N.B. (29 mai) 1751. Dans une lettre adressée au comte d’Argental [1700-1788], Voltaire, courageux mais pas téméraire, considère huit jours plus tard, - sans doute pour se protéger d’éventuelles attaques - sa lettre du 1er mai, sus-citée comme « un peu ordurière » [ce qu’elle n’est en rien] et affirme qu’elle fut écrite « pour apprivoiser les huguenots » [!]. 1005
Femmes (Remarquables. Ninon de Lenclos) (2) : (janvier-février) 1755. Lu dans le Journal et mémoires de M. Charles Collé [1709-1783] :
« Thiriot [Nicolas. 1697-1772] avec lequel je dinais ces jours ce nous disait : ‘ Vous savez tous, Messieurs, que la célèbre Ninon [de Lenclos. 1620-1705] ne put être déterminée par Madame de Maintenon [1635-1719], à aller demeurer à Versailles ; mais vous ignorez peut-être que dans le temps que l’on lui en fit la proposition, monsieur de Fontenelle [1657-1767] lui demanda si le fait était vrai. - Oui, répondit-elle, rien n’est plus vrai. - Eh bien poursuivit Fontenelle qui vous a empêchée d’accepter ? Comment, répartit-elle, moi qui, lorsque j’étais jeune et belle n’ait jamais voulu vendre mon corps, vous croyez qu’à quatre-vingt ans, j’irai leur vendre mon âme ! » 1006 (Cf. Dialogues)
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Remarquables. Anna de Noailles :
Femmes (Remarquables. Noailles Anna de) (1) : 1921-1923. Lu, concernant Anna de Noailles [1876-1933] sous le plume de Charles du Bos [1882-1939] :
« J’ai noté dans une de mes conférences sur Madame de Noailles cette tendance irrésistible qui la pousse à dresser sa personne et sa figure comme une sorte de Victoire de Samothrace, mais chez elle cela relève de l’expansion et de la force de la personnalité ; chez Shelley, au contraire […]. » 1007
Analyse, la concernant, dont je ne peux rien dire, mais, du moins en elle-même, signifiante. De… ? (Cf. Êtres humains. Soi. Noailles Anna)
Femmes (Remarquables. Noailles Anna de) (2) : 1924. 1931. André Gide [1869-1951] écrit dans son Journal :
- Le 15 avril 1924 [concernant l’éloge que fit Anna de Noailles [1876-1933] d’Anatole France [1844-1924] : « On me demande, pour un numéro consacré à la gloire de France, des notes ‘que certainement je dois trouver dans mon tiroir’. Mais qu’oser écrire après l’éloge que je lis dans le Quotidien, signé de la comtesse de Noailles ?
- Ce n’est plus de la critique, même louangeuse, c’est de la pamoison. Un tel excès, une telle intempérance, une telle inflation de mots, des sentiments et des pensées, dévalorise tout ce qu’on pourrait dire ensuite de raisonnable et sensé. » (Cf. Penser. Critique)
- Le 28 juillet 1931 : « Ces lettres de Proust [1871-1922] à Mme de Noailles discréditent le jugement (ou la sincérité) de Proust bien plus qu’elles ne servent à la gloire de la poétesse. La flagornerie ne peut être poussée plus loin. Mais Proust connaissait assez Mme de N., la savait vaine et incapable de critique assez pour espérer que la louange la plus outrée lui paraitrait la plus méritée, la plus sincère ; il jouait d’elle comme il jouait de tous. Et je vois dans ces flatteries éhontées moins d’hypocrisie qu’un besoin maniaque de servir à chacun ce qui peut lui être le plus agréable, sans plus aucun souci de véracité, mais bien seulement d’opportunisme ; et surtout un désir d’épanouir et d’amener à se livrer celui sur qui il souffle de son plus chaud. » 1008 (Cf. Êtres humains. Soi. Noailles Anna, Femmes. Attirance pour les hommes politiques, Relations entre êtres humains. Hypocrisie. Flagornerie. Flatterie. Louange)
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Remarquables. Marie Noël :
Femmes (Remarquables. Noël Marie) (1) : 1959. Marie Noël [1883-1967], après avoir rencontré Charles de Gaulle [1890-1970], qui appréciait son œuvre, dit, admirative :
« […] C’est rare de voir un homme, un vrai, un vrai. Et celui-là, c’est un vrai. [...]
Ça, c’est un homme, c’est vrai. » 1009
La sincérité d’une femme qui avait si peu parlé et qui apparaissait, à 75 ans, savoir ce sur quoi elle se fondait pour être si affirmative… À moins que… (Cf. Hommes, Patriarcat)
Femmes (Remarquables. Noël Marie) (2) : 1976. Marie Noël [1883-1967], citée par François Mauriac [1885-1970], auteure de :
« Je fais des actions bonnes, je ne suis pas bonne, je suis domptée. Je reçois doucement ce qui m’est contraire, je ne suis pas douce, je suis tuée. En moi-même, je me révolte, je reverse, je frappe, je brise de toute ma violence. Mais tous les matins, le Christ m’encourage à ma destruction. Et je suis devenue tout comme une morte à force d’avoir bu avec lui son vin de condamné à mort. » 1010
Terrible… de lucidité ? (Cf. Femmes. Bonnes-à-tout-faire)
-------------
Femmes (Remarquables. Pahlavi Farah) : 2004. Je lis, épars, incidemment évoqué, dans les Mémoires de Farah Pahlavi écrites par la troisième épouse du Shah d’Iran ceci :
- [Avant l’arrivée au pouvoir de son époux, dans les années 1950] :
« Le taux d’alphabétisation n’atteint pas un homme sur cent, et les femmes n’ont aucun droit, pas même celui de fréquenter l’école. » (p.42) ;
- [Évoquant les (fastueuses) cérémonies du couronnement, le 26 octobre 1967 :
« Puis, ce fut mon tour (d’être couronnée…par lui). Je vins m’agenouiller aux pieds du roi et, quand il eut déposé la couronne sur ma tête, il me sembla qu’il venait de consacrer toutes les femmes iraniennes. […]
Cette couronne effaçait des siècles d’humiliation ; plus sûrement que toutes les lois, elle affirmait solennellement, l’égalité de l’homme et de la femme. » (p.156) ;
- [Concernant l’avenir de l’Iran] :
« Je pense particulièrement aux femmes pour montrer le chemin. La monarchie leur avait pratiquement donné les mêmes droits qu’aux hommes. » (p.406) (Cf. Politique. Égalité, Histoire)
Tout en notant l’absence de toute critique politique, y compris concernant la Savak, jamais critiquée (Cf. p.266, 338), sans omettre les dénis, les silences, les mensonges, la naïveté, au fondement de cette lecture de l’histoire Iranienne, ces Mémoires sont passionnants.
Je découvre que deux de leurs enfants se sont suicidés. 1011 (Cf. Êtres Humains. Naïveté)
Femmes (Remarquables. Païva Marquise de) : 1851. Marquise de Païva [1819-1884], née sous le nom d’Esther Lachmann, dit, avant de le quitter, à son mari - du moins, cela lui fut prêté - le marquis de Païva, le lendemain du mariage :
« Vous m'avez voulue, vous m'avez eue. Je voulais un nom, je l'ai. Nous sommes quittes. » 1012 (Femmes. Noms)
Femmes (Remarquables. Parks Rosa) : Il fut rendu hommage Rosa Parks [1913-2005] dénommée « la mère du mouvement des droits civiques » en ces termes :
« La femme qui s’est levée [ou : tenue debout] en restant assise ».
Pour rappel historique - succinct et incomplet - : elle avait refusé, dans un bus ségrégationniste, de laisser son siège à un homme blanc. (Cf. Femmes. Artistes. Holiday Billie, Penser. Obéir. Springsteen Bruce, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
Par ordre chronologique. Femmes. Remarquables. Jacqueline Pascal :
Femmes (Remarquables. Pascal Jacqueline) (1) : 1661. Jacqueline Pascal [1625-1661], en religion, Jacqueline de Sainte Euphémie, sœur de Blaise Pascal. 1013
Concernant l’ordre imposé aux religieuses de Port-Royal de signer en 1661 le Formulaire d’Alexandre VII qui s’opposait à leur foi, auteure de :
« Je sais le respect que je dois à MM les Évêques, mais ma conscience ne me permet pas de signer qu’une chose est dans un livre où je ne l’ai pas vue. […]
Je sais bien que ce n’est pas à des filles de défendre la Vérité, quoique, si l’on peut dire, par une triste rencontre, que, puisque les Évêques ont le courage des filles, les filles doivent avoir le courage des Évêques ; mais si ce n’est pas à nous de défendre à la Vérité, c’est à nous à mourir pour la Vérité. »
La même écrivait : « Que craignons nous ? Le bannissement et la dispersion pour les Religieuses, la saisie du temporel, la prison et la mort, si vous le voulez ; mais n’est-ce pas notre gloire et ne doit-ce pas être notre joie ? Renonçons à l’Évangile ou suivons les maximes de l’Évangile, et estimons-nous heureux de souffrir quelque chose pour la justice. Mais peut-être on nous retranchera de l’Église ? Mais qui ne sait que personne ne peut en être retranché malgré soi ? […] »
Quel courage … (Cf. Êtres humains. Conscience, Femmes. Religieuses, Penser. Vérité)
N.B. Elle signa néanmoins ce texte, et, dit-on, en mourut, à 36 ans.
Femmes (Remarquables. Pascal Jacqueline) (2) : Charles-Augustin Sainte-Beuve [1804-1869] écrivit concernant Jacqueline Pascal [1625-1661] :
« Cette sœur, comparée au frère, l’explique, le complète et peut être, à quelques égards, le surpasse… La sœur voilée de Pascal est son égal[e] pour le moins ; elle le précède presque en tout, elle le guide, même dans les âpres grandeurs de la mort. » 1014
Femmes (Remarquables. Pascal Jacqueline) (3) : 1931. François Mauriac [1885-1970] a publié un livre intitulé : Blaise Pascal et sa sœur Jacqueline. [Hachette]
Femmes (Remarquables. Pascal Jacqueline) (4) : 1980. Jacques Prévert [1900-1977], auteur du « dialogue » suivant :
« Sa sœur : ‘A quoi penses-tu, Blaise ?‘ / Pascal : ‘A rien’ / Sa sœur : ‘C’est bien ce que je pensais’. » 1015 (Cf. Dialogues, Penser)
-------------
Femmes (Remarquables. Pathé Odile) : 1946. George Orwell [1903-1950] après avoir évoqué le probable « boycott », en 1946, en Angleterre, de son livre, La ferme des animaux - une critique de la Russie Stalinienne -, bien qu’il ait été « traduit en neuf langues » poursuit :
« Le plus difficile à organiser a été le français. Un éditeur a signé un contrat et a dit ensuite que c’était ‘impossible’ pour des raisons politiques ; d’autres ont fait des réponses semblables : néanmoins, j’ai arrangé ça avec une éditrice qui se trouve à Monte-Carlo et que se sent un peu plus à l’abri. C’est une femme, Odile Pathé [fille de Charles Pathé [?-?], qu’il ne faut pas oublier au cas où d’autres auraient des livres impopulaires à traduire, car elle me parait avoir du courage, ce qui n’est pas très courant en France en ce moment. (avril 1946) » 1016
Pour une analyse plus précise et donc plus rigoureuse, Cf. la présentation, par les Éditions Agone du livre George Orwell, entre littérature et politique [2011], des Éditions Odile Pathé (« un lieu où se retrouvait des anciens du POUM, de la Révolution Prolétarienne et de la gauche révolutionnaire »), de la revue Paru et des conditions de la publication en français de La ferme des animaux. (Cf. Hommes. Remarquables. Orwell George)
Par ordre chronologique. Femmes. Remarquables. Magdeleine Paz :
Femmes (Remarquables. Paz Magdeleine) (1) : 2015. Après avoir évoqué « le courage d’une femme », dans un livre consacré à Magdeleine Paz [1889-1973], il est écrit :
« Dans ses reportages et articles à son combat pour Victor Serge [1890-1947], le temps est amplement venu pour que Magdeleine Paz soit autre chose qu’un nom hâtivement cité dans les histoires des intellectuels et une inconnue sur une photo. Son parcours journalistique et militant donne à voir sans aucun doute une personnalité qui fit de la cohérence de ses écrits avec ses actes son credo, du don de soi au service de la solidarité son expression essentielles, de l’intransigeance sa ligne de conduite. […]
Retenons encore d’elle cette phrase de son ouvrage, Femmes à vendre [Reider. Paris] publié en 1936, véritable profession de foi tout en formulation pré-sartrienne : ‘Nous sommes responsables, je suis responsable : il ne m’est jamais arrivé de constater une misère ou une iniquité sans que cette pensée ne m’emplisse l’âme jusqu’au bord’. Il serait peut-être bon que notre pâle époque en prenne de la pugnace graine. » (Non signé, mais sous la plume d’Anne Mathieu qui coordonne le livre passionnant qui lui est consacré). 1017
Notons qu’avant Femmes à vendre, elle avait publié en 1919 un livre (préfacé par Henri Barbusse), intitulé Femme. (Flammarion)
Plus largement, il faudrait publier ses écrits notamment féministes. (Cf. Femmes. Parcours. Travail, Proxénétisme. Abolitionnisme)
* Ajout. 21 octobre 2022. Non. Il faut publier l’intégralité de ses écrits.
Femmes (Remarquables. Paz Magdeleine) (2) : 1933. Magdeleine Paz [1889-1973], en rendant compte du dernier ouvrage de Panaït Istrati [1884-1935] [l’un des tous premiers intellectuels communistes ayant dénoncé l’évolution de la Russie postrévolutionnaire] La maison Thüriger [1932], l’avait considéré, dans Le Monde, comme « un livre réactionnaire » et avait ajouté :
« Ce n’est pas autre chose qu’une défense de la bourgeoisie que prononce Istrati. » 1018
* Ajout. 9 octobre 2022. Le 17 avril 1935, L’Humanité, pour sa part, écrit que Panaït Istrati « est mort dans la peau d’un fasciste. » (Cf. Êtres humains, Corps. Peau)
Femmes (Remarquables. Paz Magdeleine) (3) : 2016. Christophe Patillon, en présentation du livre de Magdeleine Paz [1889-1973] Je suis l’étranger, auteur de :
« […] L'un de ses grands combats : arracher des griffes du Guépéou Victor Serge [1890-1947], l'ex-anarchiste converti au bolchévisme, l'ardent défenseur de la Révolution russe devenu opposant au stalinisme, exilé loin de Moscou, aux confins de l'Oural. On craignait pour sa vie, à raison. Infatigable, Magdeleine Paz s'est démenée sans compter pour obtenir l'expulsion vers la France de Victor Serge. Tâche difficile puisque pour cela il lui fallait affronter tous les appareils de propagande du parti communiste pour qui, un opposant, même de gauche, à la dictature sur le prolétariat, ne pouvait être qu'un agent du fascisme et de la bourgeoisie. ‘Il faut une certaine vaillance pour aller contre le courant’ a-t-elle écrit en 1932. De vaillance, elle n'en a jamais manquée. » 1019
À son actif, en outre, elle démissionne du Monde ou elle était responsable de la rubrique de Critique littéraire du 6 février 1932 au 15 juillet 1933, à la suite de la publication d’un article d’Henri Barbusse [1873-1935].
Elle aurait aussi démissionné en 1938 de la Ligue des droits de l’homme qui refusait de condamner clairement l’URSS de Staline (source à retrouver). (Cf. Politique. Propagande)
-------------
Femmes (Remarquables. Pechkova [Ekaterina Pavlovna] : Ekaterina Pavlovna [1876-1965] Fondatrice et dirigeante de la croix rouge politique, organisation d’aide et de soutien aux détenu-es politiques, dissoute en 1939. Première épouse de Maxime Gorki.
Ekatrina Olitskaïa, dans Le sablier, auteure de :
« [Tarassova] m’apprit la vague d’arrestation du printemps 1932. Beaucoup de vétérans SR [Socialistes révolutionnaires] […] (et que) « l’on avait arrêté beaucoup de collaborateurs de la Croix rouge, ceux qui avaient soutenus Pechkova dans ce travail. » [lire Wikipédia] 1020
N.B. J’y lis que sa petite-fille, Marfa, s’est mariée à Sergo Béria, fils de Lavrenti Béria [1895-12 décembre 1953] : ! Que des recherches rigoureuses seraient nécessaires…
Femmes (Remarquables. Pencalet Joséphine) : 2009. Danielle Mitterrand [1924-2011], dans Le livre de ma mémoire, auteure de :
« (Concernant la grève des sardinières de Douarnenez [1924]) Qui se souvient encore de Joséphine Pencalet [1886-1972], héroïne de la grève des sardinières, qui se présenta au conseil municipal, l’année suivante, en 1925, au côté de Daniel Le Flanchec ? Une femme ! La première élue de France alors qu’aucune n’avait encore le droit de vote ! Le scrutin fut ‘évidemment‘ invalidé. Sébastien Velly et Daniel Le Flanchec ont tous deux leur rue à Douarnenez. Mais pas Joséphine Pencalet. Dommage… Et le féminisme l’a oubliée. » 1021
N.B. Pour précisions, rectifications, Cf. à son nom : Wikipédia. (Cf. Politique. Démocratie. Luttes de femmes)
Femmes (Remarquables. Peron Evita) : 1977. Annie de Pisan (pseudonyme), dans Histoires du MLF, vivant alors en Argentine, auteure de :
« À la maison, on discutait beaucoup de politique. Ma mère surtout avec nous comme si nous étions des adultes. Le personnage d’Evita [Peron.1919-1952] a commencé dès lors à prendre un relief considérable dans mon esprit. Son sourire implacable, ses cheveux bonds tirés en chignon, sa voix de fer.
Une femme dure, sans scrupules, en même temps une sainte aux yeux du peuple. Ses discours d’exprimaient que haine et revendication. ‘Je suis partie de rien, regardez ce que je suis devenue’ clamait-elle. En paroles, elle n’avait rien d’une féministe : ‘La femme doit se développer à l’ombre de l’intelligence de l’homme’ ; ‘Je suis l’intermédiaire entre le peuple et Péron’ ; ‘ Mon instinct me guide et me permet de comprendre les désirs du peuple’. En fait, elle agissait très différemment. Le pouvoir seul l’intéressait. Par ses discours-fleuves, véritables torrents de haine contre l’oligarchie, règlement d’un compte personnel jamais clos, elle a réalisé une sorte de révolution culturelle en Argentine, transformant un peuple conditionné à la soumission en un peuple assoiffé de justice. L’ambiguïté de sa politique tenait à sa volonté de se faire accepter. Pour cela elle se présentait comme conforme au modèle féminin : attachée aux valeurs traditionnelles, catholique, instinctive, seconde derrière le président [Juan Peron. 1895-1974]. Elle n’était pas féministe, pourtant elle obtenait le droit de vote pour les femmes et menait un mouvement purement féminin, elle se voulait désintéressée de la politique et seulement concernée pas les œuvres sociales, pourtant elle tentait désespérément - et en vain - de se faire désigner à la vice-présidence. Son bureau d’aide sociale devenait une poudrière où le peuple défilait chaque jour. Aucune lettre, aucune demande à Evita ne demeurait sans réponse. Evita était présente dans toute l’Argentine, chaque jour, chaque instant. […] » 1022 (Cf. Femmes. « Féminin ». « Politiques »)
Femmes (Remarquables. Perrot Michelle) : 1987. Michelle Perrot, dans les Essais d’ego histoire [Gallimard], concernant les conséquences de [19]68, qu’elle analyse justement comme « une rupture majeure dont aujourd’hui encore nous n’avons épuisé ni le sens ni les effets », et ses conséquences sur son activité intellectuelle, écrit notamment :
« […] Le souci de répondre aux ‘sollicitations du présent’ comme aussi cette nouvelle forme de culpabilisation des intellectuels qu’a été pour une large part, le maoïsme français, rendaient à la fois ouvert aux aspirations et aux idées nouvelles, et fragiles devant les modes. Je n’avais jamais eu la ‘conscience tranquille’. J’avais toujours été sensible à l’air du temps. La longue concentration de la thèse - mère protectrice ! - achevée, j’étais disponible. J’ai eu tendance à ‘éclater’ dans des directions multiples, à préférer le travail collectif à la poursuite d’une œuvre individuelle, au risque de me perdre car les ‘bonnes œuvres’ ne font pas une œuvre et ne servent parfois qu’à en masquer la carence. » 1023 (Cf. Histoire)
Par ordre chronologique. Femmes. Remarquables. Anne Pingeot :
Femmes (Remarquables. Pingeot Anne) (1) : 2016. Anne Pingeot, compagne cachée de François Mitterrand [19016-1996] et mère de leur fille Mazarine, elle aussi cachée, prit la parole pour la première fois sur France Culture. Après avoir rappelé son milieu bourgeois de province, de droite, peu évolué intellectuellement, patriarcal, ainsi que leur « vision de la femme : la femme est quelqu'un qui doit être soumis, qui ne doit avoir aucune vie intellectuelle » en conclut : « ça a compté beaucoup quand même ».
Puis elle évoque « […] ce côté de soumission a fait que j’ai accepté au fond l’inacceptable… »
Elle emploiera aussi concernant François Mitterrand, le terme de « pygmalion », de « prédateur », puis de « chasseur séducteur » … et parlera de la naissance de Mazarine [bien qu’elle lui ait ‘imposé’ sous peine de le quitter] comme son « seul acte altruiste ».
- Elle évoque, aussi, bien sûr, le rôle positif qu’il a joué pour elle, avec distance. J’ai noté :
« Je ne me suis jamais ennuyée, au moins… »
Une qualité que les femmes créditent souvent cette ‘qualité’ aux hommes. 1024 (Cf. Hommes. « Politiques ». Mitterrand François. Séducteurs)
Femmes (Remarquables. Pingeot Anne) (2) : 2016. Je lis dans un article de Catherine Nay, Les amours de Mitterrand, qu’il appelait Anne Pingeot : « ma fille », « ma merveilleuse fille », lui qui était l’ami de son père - lequel lui avait « demandé de veiller sur elle » - et qui aurait pu l’être. Il avait 33 ans de plus qu’elle. 1025 (Cf. Hommes. « Politiques ». Mitterrand François, Patriarcat. Pères)
Femmes (Remarquables. Pingeot Anne) (3) : 2016. Je lis dans un article du Figaro, Dans le secret des lettres à Anne, que, dans ses Lettres à Anne (pas lues),
« Mitterrand [lui] reprochait son caractère entier, son intransigeance » et ce, suivi, sans autres commentaires, de ce jugement : ‘émouvantes, ces missives…’ » 1026 (Cf. Hommes. « Politiques ». Mitterrand François)
-------------
Femmes (Remarquables. Pirogova Anna Stepanovna) : 1872. Lu, dans le dossier de l’édition de La Pléiade [1951], d’Anna Karénine de Léon Tolstoï [1828-1910] :
« Quant au tragique épisode du suicide, il se produisit réellement en janvier 1872 à quelques verstes d’Iasnaïa Poliana [lieu de résidence de la famille Tolstoï]. Anne Stepanovna Pirogova, abandonnée par son amant, Bibikov, propriétaire voisin et ami des Tolstoï, se jeta sous un train de marchandise. » Puis est citée cette référence au Journal de Sophie Tolstoï [1844-1919] :
« Léon Nicolaïevitch l’a vue, le crâne à nu, toute dévêtue et déchiquetée (dans le bâtiment de la gare). L’impression a été terrible et s’est gravée profondément en lui. » 1027 (Cf. Femmes. Comment meurent les femmes ? Patriarcat, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
Femmes (Remarquables. Pizzey Erin) : 1975. Erin Pizzey, créatrice en 1971 d’un refuge à Londres pour femmes et enfants battus (par les maris et les pères), auteure d’un livre pionner, remarquable et globalement toujours valide : Crie moins fort, les voisins vont t’entendre. 1028
Par ordre chronologique. Femmes. Remarquables. Phoolan Devi :
Femmes (Remarquables. Phoolan Devi) (1) : Phoolan Devi [1963-2001], surnommée « la reine des bandits » [terme auquel elle réagit : « Qui sont les bandits ? »], ou « une légende vivante », ou plus justement « Phoolan » auteure de :
« C’était parce que j’étais une femme que j’ai été humiliée au plus profond de mon âme.
Je n’ai jamais admis cette condition. Je me suis révoltée. » […]
Elle écrit aussi, après avoir été mise à nue, violée, battue, torturée, empalée, jetée en pâture à la population masculine des castes supérieures de plusieurs villages :
« J’étais enragée contre les hommes. Il fallait que je leur fasse subir tout ce qu’ils m’avaient fait subir […]
Détruire ce qui symbolise leur pouvoir. Anéantir le serpent. Et rire de les voir sauter comme des chevreaux castrés, pleurer comme des femmes, se rouler à mes pieds, supplier, supplier comme je l’avais fait. Les gens de ma caste le savaient tous. Si une mère voulait protéger sa fille, un mari, sa sœur, sa femme, ils n’avaient qu’à dire au violeur : ‘Phoolan Devi te punira, et je le faisais’ […]
Je ne tue pas pour rien. Je punis. […]
Les journaux n’arrêtent pas de parler de moi. Si seulement ils avaient parlé de moi avant, quand on me maltraitait. On ne parle donc que des crimes des pauvres gens et jamais de leurs malheurs… »
Et lorsqu’elle fit, à ses conditions, sa reddition, politiquement négociée (terres, emplois…), les gens pauvres ne voulaient pas qu’elle cède, tandis les gens des hautes castes disaient :
- « Ce n’est pas Phoolan Devi que se rend au gouvernement, c’est le gouvernement qui cède à Phoolan Devi. » 1029 Elle disait aussi :
« Je n’ai fait que rendre aux hommes ce qu’ils m’ont fait subir » ;
« Si quelqu’un porte la main sur une femme, coupez-lui la main » ;
« Mon vœu le plus cher est que les femmes ne supportent pas ce que j’ai subi. » 1030
Que les féministes - dites radicales, moi donc, bien sûr, incluses - apparaissent, après cette lecture, timorées… (Cf. Hommes. Castrés, Patriarcat, Politique, Violences. Violences à l’encontre des femmes. Phoolan Devi, Économie. « Pauvres Les »)
Femmes (Remarquables. Phoolan Devi) (2) : (21 mars) 2020. Une émission, rediffusée ce jour, de France Culture du 26 mars 1996 des Mardis du cinéma est intitulée « Entre histoire et légende. Métamorphoses du mythe de Phoolan Devi ». Elle est interviewée.
Elle s’y présente ainsi :
« Je suis une femme ordinaire. Je suis seulement Poohlan. Je suis une femme qui a su se faire respecter, qui a retrouvé sa dignité. »
J’apprends qu’elle a été (notamment) accusée d’avoir tué 22 hommes d’une caste supérieure, est entrée en prison à 20 ans, y a passé onze années, a été libérée sans procès. 1031 (Cf. Patriarcat, Politique, Violences. Violences à l’encontre des femmes. Phoolan Devi)
-------------
Femmes (Remarquables. Planiol Thérèse) : 1995. Jean Bernard [1907-2006] présente ainsi, en préface de Une femme, Un destin, l’histoire de la vie de Thérèse Planiol [1914-2014] :
« Être abandonnée par sa mère à la naissance, connaître l’enfance rude, souvent cruelle, des pupilles de l’Assistance Publique, passer d’établissement scolaire en d’établissement scolaire, en affrontant tantôt l’injustice, tantôt l’indifférence, combattre longtemps sans succès pour être autorisée à commencer des études de médecine, se voir proposer, après avoir obtenu une licence es-sciences un poste d’aide laborantine, assumer, tout à tout, les fonctions de commis de bureau, de secrétaire adjointe, entrer enfin en médecine, trouver de nouvelles injustices, de nouvelles indifférences, en triompher, grâce à une valeur exceptionnelle, rencontrer un grand amour partagé qui éclaire enfin une vie longue et triste, sauter de succès en succès, de l’internat à l’agrégation, de l’agrégation au professorat, devenir en France et hors de France un des premiers biophysiciens de notre temps, retrouver tardivement sa généalogie en remontant jusqu’au XVème siècle, telle est, brièvement résumée, l’existence admirable et émouvant de Thérèse Planiol qu’avec une constante discrétion, elle nous conte tout au long de ce livre. »
Il poursuit : « Toute l’existence ce livre est une rébellion. » [...]
Et il termine ainsi :
« C’est à la fois le portrait d’une personnalité de premier rang et l’image de notre société que nous apporte ce remarquable ouvrage. » Plus précisément : une « image de notre société » patriarcale, injuste, brutale, humiliante, sans excuse, pour les femmes.
Concernant sa jeunesse d’enfant « abandonné », elle écrit :
« Une fois de plus je rencontrais la bêtise, l’injustice ; j’ignorais encore la misogynie. Après avoir vécu la condition d’enfant assistée, j’abordais les problèmes de la condition féminine. » 1032
Toute sa vie, des mandarins de médecine qui n’ont cessé de bloquer ses recherches ne cesseront de les lui rappeler. (Cf. Femmes. « Féminin », Hommes. Savants, Famille, Patriarcat)
Femmes (Remarquables. Pougy Liane de) : (30 mai) 1922. Lu dans le Journal de l’abbé Mugnier [1853-1944] :
« J’ai fait la connaissance de la princesse Ghika, née Liane de Pougy [Anne-Marie de Chasseigne. 1871-1950]. Elle disait avoir été en Grèce, en Égypte, à Constantinople, promener son ‘chagrin d’aimer’. Elle racontait les coups qu’elle avait reçus de son premier mari [Joseph Armand Henri Pourpe. Mariage : 1886 - Divorce : 1890]. » 1033
Un autre regard sur la ‘célèbre courtisane’.
Son destin n’aurait-il pas été ‘autre’ sans ce début de vie de femme mariée avec un mari violent ? (Cf. Femmes. Nom, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
Femmes (Remarquables. Prédine Françoise) : 1976. Ménie Grégoire [1919-2014], dans Telle que je suis, auteure de :
« (Concernant l’occupation de la Sorbonne en mai 1968) J’y ai trouvé un très grand désordre, un immense besoin de destruction, mais pas grand-chose d’autre. La seule merveille constructive que j’aie alors découverte à la Sorbonne en folie, c’est l’effort de cette jeune femme qui a monté, seule, la crèche des ‘enfants de la révolution’, sorte de refuge pour les bébés des manifestants. Elle les a nourris, gardés, fait jouer avec des volontaires, pères et mères. Elle s’appelait Françoise Prédine. Elle a depuis lors beaucoup fait parler d’elle en matière de recherches et d’action sociale, d’une façon qui restera l’un des honneurs de cette génération. » 1034
Femmes (Remarquables. Price Leontyne) : 2019. Leontyne Price, interviewée dans Opéra international, auteure de :
« J’adore ma voix. Je suis mon artiste préférée et je suis ma plus grande fan. » 1035 (Cf. Êtres humains. Soi, Femmes. Artistes)
Femmes (Remarquables. Rachel) : Pour Béatrix Dussane [1888-1969], Rachel [1827-1857], fut « une petite fille de génie » […] « qui ressuscita la tragédie ».
On peut aussi écouter la présentation de Rachel faite par Pierre Janin. 1036
Femmes (Remarquables. Rand Ayn) : Qualifier Ayn Rand [1905-1982] de « philosophe », de « théoricienne » n’est pas défendable, tant ses pensées, ses écrits sont confus, contradictoires, incohérents, aberrants, souvent odieux… Et telle ou telle position, qui pour certain-es peuvent être positivement considérés, ne peuvent, ni ne doivent faire illusion, pas plus que, pour tant d’autres encore, la diffusion importante de ses livres. (Cf. Économie)
* Ajout. 6 août 2020. Pour le peu, le très peu que je connaisse de ses écrits ; mais ce que j’en connais me suffit…
Femmes (Remarquables. Réal Grisélidis) : Grisélidis Réal [1929-2005], auteure de :
« Si au moins on [les personnes-dites-prostituées] étaient des bêtes, mais on est des humains déshumanisés qui ne sont même pas des bêtes. » … 1037
* Ajout. 3 mars 2021. À lire notamment par ceux et celles qui justifiant le proxénétisme se sont employé-es, sans excès de scrupules, à l’enrôler dans leurs rangs. (Cf. Êtres humains, Politique. Animalisation du monde, Proxénétisme. Personnes-dites-prostituées. « Clients »)
* Ajout. 19 juin 2022. Entendu sur France Culture l’artiste Tatiana Trouvé présenter Grisélidis Réal comme celle qui « a beaucoup milité pour les droits de la prostitution ». (Cf. Droit, Langage, Proxénétisme. Personnes-dites-prostituées)
Femmes (Remarquables. Récamier Juliette) : La comtesse de Boigne [1781-1866] fit un remarquable portrait de Juliette Récamier [1777-1849], au sein duquel je relève :
« Tout le monde a fait des hymnes sur son incomparable beauté, son active bienfaisance, sa douce urbanité ; beaucoup de gens l’ont vantée comme très spirituelle. Mais peu de personnes ont su découvrir, à travers la facilité de son commerce habituel, la hauteur de son cœur, l’indépendance de son caractère, l’impartialité de son jugement, la justesse de son esprit. Quelques fois, je l’ai vue dominée, je ne l’ai jamais connue influencée. […] » 1038 (Cf. Femmes. Beauté, Relations entre êtres humains. Bienfaisance)
Femmes (Remarquables. Rendu Sœur Rosalie) : 1856. Sœur Rosalie Rendu [1786-1856], religieuse de la Congrégation des Filles de la Charité, vers 1833, participe avec Frédéric Ozanam [1813-1853] à la création de la Société Saint Vincent de Paul.
Sur sa tombe est gravé : « À la bonne mère Rosalie. Ses amis reconnaissants, les pauvres et les riches. » 1039 (Cf. Femmes. Charité, « Filles de la charité », Économie. « Pauvres Les »)
Femmes (Remarquables. Reverdy Michelle) : (25 mars) 2023. [1ère diffusion. 8 mars 1995] Michelle Reverdy, compositrice, sur France Culture, auteure de :
« J’ai écrit trois opéras ».
N.B. La présentation de l’émission par France Culture est :
« Michelle Reverdy : Il y a une analogie entre mettre un enfant au monde et composer une oeuvre musicale. » (Cf. Patriarcat. Permanence)
Femmes (Remarquables. Riccoboni Marie-Jeanne) : 1787. Carlo Goldoni [1707-1793], dans ses Mémoires, auteur de :
« Je rencontrais dans cette maison une charmante voisine, dont la société m’a été très utile et très agréable. C’était Madame Riccoboni [1713-1792], qui ayant renoncé au théâtre, faisait les délices de paris, par des romans, dont la pureté de style, la délicatesse des images, la vérité des passions, et l’art d’intéresser et d’amuser en même temps, la mettait au pair avec tout ce qu’il y a d’estimable dans la littérature française. C’est à madame Riccoboni que je m’adressai pour avoir quelques notices préliminaires sur mes acteurs italiens. Elle les connaissait à fond, et elle m’en fit un détail que je trouvais par la suite très juste, et digne de son honnêteté et de sa sincérité. » 1040 (Cf. Femmes. Écrivaines. Utiles, Relations entre êtres humains. Amour. « Faire l’amour ». Riccoboni Marie-Jeanne, Patriarcat. Penser le patriarcat. Riccoboni Marie-Jeanne)
Femmes (Remarquables. Riffaud Madeleine) : 2004. Madeleine Riffaud [1924-2024], après avoir été responsable au sein du Front national des étudiants du quartier latin, entre dans les FTP en mars 1944, participe à la préparation armée du soulèvement parisien d’août 1944, tue en plein jour un officier allemand [« Neuf balles dans mon chargeur / Pour venger tous mes frères / Ça fait mal de tuer / C’est la première fois / Sept balles dans mon chargeur / C’était si simple / L’homme qui tirait l’autre nuit / C’était moi. »], est capturée par un milicien, livrée à la Gestapo qui la torture rue des Saussaies, puis par des français à la Préfecture de police, ne parle pas, est condamnée à mort, mais n’est pas exécutée ; libérée mi-août, reprend immédiatement son combat dans la Résistance où elle est affectée à la Compagnie Saint-Just avec le grade d'aspirant.
Lire, d’elle, durant la guerre, On l’appelait Rainer (1939-1945). 1041
Je lis sur Wikipédia :
« Son engagement s'arrête à la fin des combats pour la Libération de Paris, l'armée régulière ne l'acceptant pas en tant que femme d'une part, mineure d'autre part. »
La poursuite de sa longue vie fut non moins remarquable que ses engagements dans la Résistance. Cette femme remarquable à tant de titres (journaliste de guerre, anticolonialiste, communiste, écrivaine…) a 90 ans. [en septembre 2014].
Son livre : Les linges de la nuit [1974] est un document / reportage - vécu par elle - de grande valeur sur la vie des travailleuses dans les hôpitaux. (Cf. Femmes. Travail, Politique. Tortures, Histoire. Riffaud Madeleine)
Femmes (Remarquables. Robert Marthe) : 2016. Avoir entendu Marthe Robert [1914-1996] analyser le Don Quichotte de Cervantès réconcilierait avec la critique littéraire l’être qui en serait son plus fervent détracteur. Et permet de mieux appréhender ce qu’est la claire l’intelligence d’une œuvre, à l’opposé du titre binaire de l’émission. 1042
Femmes (Remarquables. Roland Pauline) : 1854. George Sand [1804-1876], dans Histoire de ma vie, présente Pauline Roland [1805-1852] en ces termes :
« Cette tête exaltée et généreuse, cette femme qui avait les illusions d’un enfant et le caractère d’un héros, cette folle, cette martyre, cette sainte, Pauline Roland. » 1043 (Cf. Hommes. « Héros »)
Par ordre chronologique. Femmes. Remarquables. Jacqueline de Romilly :
Femmes (Remarquables. Romilly Jacqueline de) (1) : (10 mai) 2005. Jacqueline de Romilly [1913-2010], auteure de :
« Il est vrai que Thucydide [465-entre 400 et 395 avant J-C] a été l’homme de ma vie. II est vrai que je pouvais choisir plus mal. » 1044 (Cf. Hommes, Langage. Académie française, Histoire. Thucydide)
Femmes (Remarquable. Romilly Jacqueline de) (2) : 2006. Jacqueline de Romilly [1913-2010], dans Une certaine idée de la Grèce, auteure de :
« Avoir été juive sous l'Occupation, finir seule, presque aveugle, sans enfants et sans famille, est-ce vraiment sensationnel ? Prétendre que tout dans ma vie m’a parfaitement plu tiendrait du délire. Mais ma vie de professeur a été, d'un bout à l'autre, celle que je souhaitais. » 1045
-------------
Femmes (Remarquables. Rondeaux Madeleine) : (5 novembre) 1891. Madeleine Rondeaux [1867-1938] quatre ans avant qu’elle épouse André Gide [1869-1951], écrit dans son Journal, concernant les Cahiers d’André Walter [1892] qu’il lui avait fait lire :
« J’ai fait le sacrifice de ne pas emporter Les Cahiers d’A.W. Cela vaut mieux pour moi, puisque je veux, je dois tout finir [fermer la maison de son enfance]. J’ai relu plusieurs pages, avec un charme mélancolique et profond. Je le trouve toujours mieux, mais je suis trop ‘partie’ pour être bon ‘juge’.
Est-ce moi, est-ce toi qui pense ainsi ? Je ne sais plus. Tout est nous et à nous, là-dedans. C’est pourquoi je vous laisse, chers cahiers blanc et noir [intitulé des deux parties des Cahiers d’André Walter].
Cependant, André, tu n’avais pas le droit de les écrire… et ce premier essai, si plein de promesses au point de vue de l’Art, est une faute devant la Conscience. » 1046 (Cf. Culture. Gide André : ‘C’est avec les beaux sentiments qu’on fait de la mauvaise littérature’. Femmes. Épouse de, Penser. Morale, Patriarcat. Pères. Rondeaux Madeleine)
Par ordre chronologique. Femmes. Remarquables. Eleanor Roosevelt :
Femmes (Remarquables. Roosevelt Eleanor) (1) : Eleanor Roosevelt [1884-1962], auteure de : « Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people » [« Les grands esprits discutent des idées. Les esprits moyens discutent des évènements. Les petits esprits discutent des gens. »]
La hiérarchie posée entre les personnes gâche l’idée.
- Ses écrits devaient être traduits et publiés ; mais, sans doute, aux États-Unis le sont-ils. (Vérifier)
* Ajout. 15 novembre 2019. La hiérarchie ne « gâche » pas une idée, elle la délégitime. D’emblée, sans possibilité de rappel… (Cf. Femmes. Mères. Remarquables, Penser, Politique. Hiérarchie)
Femmes (Remarquables. Roosevelt Eleanor) (2) : Lu dans Hard times. Histoires orales de la grande dépression de Studs Terkel [1912-2008], ces différents jugements concernant Eleanor Roosevelt [1884-1962] :
- Le président Franklin Delano Roosevelt « avait un soutien extraordinaire grâce [à] sa femme » (p.133)
- « Des personnalités nationales ont contribué au financement de notre grève. [Grève ouvrière de la General Motors de Flint. 1936]. Madame Roosevelt par exemple. (p.183)
- « […] Je n’en remercierais pas Roosevelt, mais Mme Roosevelt. C’était elle le génie de la famille. Lui, c’était un homme arrogant. » (p.233)
- « Eleanor était une grande femme, une pauvre, pauvre bougresse. Elle faisait tout ce qu’elle pouvait pour tirer le maximum de quelque chose de mauvais. Mais elle a toujours été admirée. » (p.254)
- « (Concernant la création d’une coopérative - textile et rurale - de femmes juives à Highstown - aujourd’hui appelée Roosevelt) Mme Roosevelt essaya d’y intéresser Dubinski (président de l’International ladies garnement workers union), mais il n’aimait pas cette histoire de Coopérative. » (p.334)
- (Concernant un directeur de campagne de Franklin Delano Roosevelt) : « Je m’entendais très bien avec elle. Elle m’a demandé de l’aide à plusieurs occasions et j’ai essayé de l’aider. Elle était très bien intentionnée. En dépit de toute ce qu’on a pu dire, elle n’a jamais interféré avec mes activités politiques. Elle m’a demandé des conseils et fait passer quelques idées. Je les acceptais ou non. Nous n’avons jamais eu de problèmes. […] Quand j’ai quitté le gouvernement, des amis à moi sont allés la voir et elle a dit que Franklin - c’est comme cela qu’elle en parlait - n’avait pas su gérer correctement la situation. […] » (p.343, 344)
- « J’aimais beaucoup Eleanor. C’était une femme d’une grande générosité. […] » (p.415. note 89)
- « Plus tard, ils m’ont invitée à son anniversaire [celui de Roosevelt]. Je me suis acheté un chapeau John Frederick. Je suis allée à la Maison Blanche avec un gros bouquet de violettes et ce chapeau noir. J’étais dans l’entrée, et j’ai vu Mme Roosevelt. Je suis allée vers elle. Elle m’a dit : ‘Oh, ma chère, mon mari sera terriblement déçu’. Il était parti pour Téhéran. J’étais là toute pomponnée. Mais je suis tombée amoureuse d’elle dès l’instant où je l’ai vue. J’ai eu la chance de pouvoir passer beaucoup de temps avec elle. Elle me manque beaucoup. » (p.457)
- « Le Federal Theater […] était une idée de Mme Roosevelt. Elle pensait que ça diminuerait le chômage chez les acteurs. Au lieu de mettre William A. Brady [1863-1950] à sa tête, ou un autre homme de théâtre reconnu, elle a choisi Hallie Flanagan [1890-1969] qui était allée à Vassar [Collège]. C’est devenu un refuge pour tous les marginaux. Et les acteurs qualifiés traînaient dans les rues. » (p.471)
- « Madame Roosevelt nous a aidés. Elle a adoré la pièce [Tobacco Road] parce que ça parlait des conditions sociales. Quand ça a ouvert à Atlanta, elle y est allée de peur que ça se passe mal. Mais ça n’a pas été le cas. » (p.482) 1047 (Cf. Culture, Droit, Famille, Politique, Histoire)
-------------
Femmes (Remarquables. Rothschild Gudule) : 1934. Sándor Márai [1900-1999], dans Les Confessions d’un bourgeois, auteur de :
« (Francfort. Années 1920) Tous les jours, à onze heures du matin, je voyais passer devant ma fenêtre, tirée par deux chevaux noirs d’ébène, la calèche de la vieille Madame Gudule, l’aînée des aïeules Rothschild [?-?] ; la tête coiffée d’un fichu, le corps enveloppé d’une mantille, elle tenait à la main une ombrelle en dentelle. La vieille dame habitait le château familial situé au bout de la rue, au milieu d’un vaste parc, gardée, nuit et jour, par des sentinelles armées. Confortablement installée dans son carrosse, elle saluait de la main les badauds qui, de leur côté, ôtaient leur chapeau à son passage. Décatie, le visage couvert de ruse, elle se déplaçait en compagnie de son cocher et de son valet, tous deux vêtus de pantalon blancs et chaussés de bottes vernies. Dans cette république allemande issue de la révolution [1919-1923], ses apparitions constituaient un véritable défi : rois et princesses passaient au gré de l‘Histoire, mais les Rothschild demeuraient. ‘Tante’ Gudule jouissait d’une sorte d’exterritorialité : une fois par an, à l’occasion d’une fête de famille, ses fils et membres de sa parenté, Rothschild de Paris, de Londres ou de Vienne, venaient lui rendre une visite - cependant que, de leurs fenêtres, les indigènes de la rue Liebig [celle où il habitait] assistaient au défilé de la dynastie. »
N.B. Je n’ai pas retrouvé son nom - connue sous un autre prénom ? - parmi les membres de la famille Rothschild.
Femmes (Remarquables. Roussopoulos Carole) : Carole Roussopoulos [1945-2009].
À rédiger sa si riche vie. (Poursuivre) (Cf. Culture. Cinéma, Féminismes, Patriarcat, Politique, Histoire. Mémoire)
Femmes (Remarquables. Rykiel Sonia) : (30 août) 2016. Dans le carnet du Monde annonçant le décès de Sonia Rykiel [1916-2016], je lis :
« À Sonia Rykiel, géniale créatrice, incessante révolutionnaire, depuis 1968, avec Antoinette Fouque, en mouvements. Notre infinie tendresse. Ses amies du MLF et des Éditions des Femmes. »
Pourquoi ces hyperboles ? (Cf. Femmes. Fouque Antoinette, Féminismes. Histoire du féminisme)
Femmes (Remarquables. Saartjie Baartman) : De son vrai nom, Swatche, Saartjie Baartman [1789-1815] fut surnommée ignominieusement par la science française « La Vénus Hottentote », après, esclave, s’être vue attribuer le nom de son propriétaire.
Son corps nu, exhibé à sa mort, elle a fait « partie des collections de l'établissement public du Muséum national d'histoire naturelle ».
Sa « dépouille mortelle » fut remise à l’Afrique du Sud en 2002. (Cf. Êtres humains, Corps, Femmes. Noms, Patriarcat. Colonialisme, Politique. Esclavage)
* Ajout. 5 novembre 2018. La photo du moulage de son corps tel qu’il fut présenté dans les galeries de l’anthropologie du Musée de l’homme jusqu’en 1974 est visible dans le livre : Le Musée de l’homme. Histoire d’un musée Laboratoire. 2015 1048 (Cf. Culture. Musées, « Sciences » sociales. Ethnologie)
* Ajout. 24 décembre 2019. J’apprends sur France Culture par François-Xavier Fauvelle, auteur de À la recherche du sauvage idéal, que Saartjie Baartman a, vivante, été exhibée, nue, au Musée de L’homme devant plusieurs « savants », dont Etienne Geoffroy St Hilaire [1772-1884] et que, morte, son corps a été « disséqué » par Georges Cuvier [1769-1832] afin de savoir si elle « appartenait ou non à l’espèce humaine. » 1049 (Cf. Culture. Musées, Êtres humains. « Espèce », Femmes. Animalisation des femmes. Nues. « Espèce », Hommes, Politique. Colonialisme, Patriarcat. « Espèce », Violences, Histoire)
Femmes (Remarquables. Salomé) : Voici l’histoire de Salomé [et sa mère, de Hérode et de la tête de Jean Baptiste] telle que transmise par l’Évangile selon saint marc (VI, 17-20) :
« … Hérode, à l’anniversaire de sa naissance, donna un banquet aux grands de sa cour, à ses officiers et aux principaux personnages de la Galilée : la fille de ladite Hérodiade entra et dansa et elle plût à Hérode et à ses convives. Alors, le roi dit à la jeune fille : ‘Demande -moi ce que tu voudras, je te le donnerai.’ Et il lui fit un serment : ‘Tout ce que tu me demanderas je te le donnerai, fut-ce la moitié de mon royaume !’. Elle sortit et dit à sa mère : ‘Que faut-il demander ?’. ‘La tête de Jean le Baptiste’, répondit celle-ci. Rentrant aussitôt en hâte auprès du roi, la jeune fille lui fait cette demande : ‘Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête Jean-Baptiste’. Le roi fut très contristé mais à cause de ses serments, de ses convives, il ne voulut pas lui manquer de parole. Et aussitôt, le roi envoya un garde en lui ordonant d’apporter la tête de Jean. Le garde s’en alla et le décapita dans sa prison, puis il apporta la tête sur un plat et le donna à la fillette, et la fillette le donna à sa mère. » 1050 (Cf. Femmes. Jeunes filles)
Par ordre chronologique. Femmes. Remarquables. George Sand :
Femmes (Remarquables. Sand George) (1) : (3 décembre) 1859. Victor Hugo [1801-1885], dans une lettre à Pierre-Jules Hetzel [1814-1886], auteur de :
« […] Je vous remercie d’avoir glorifié George Sand [1804-1876] particulièrement en ce moment-ci. Il y a à cette heure où nous sommes une sorte de haine grossière et sacrilège montant partout contre cet esprit généreux et noble. Je ne comprends pas cet acharnement d’homme contre une femme. George Sand est un cœur profond, une belle âme, un généreux et puissant écrivain, une flamme dans notre temps. Et c’est un bien plus vrai et bien plus grand philosophe que certains bonshommes qu’elle a eu auprès delle et qu’elle avait la candeur d’admirer. […]
Quant à moi, je n’ai jamais plus senti le besoin d’honorer George Sand qu’à cette heure où on l’insulte. » 1051
- Le 23 décembre 1859. George Sand écrira à Pierre-Jules Hetzel :
« Il y a eu, dans ces derniers temps, un tel déchainement contre moi, que la décoration, me venant de l’empereur des lettres, sur le champ de bataille répondrait à tout. […] Trois paroles tombées de si haut feront plus pour moi que je ne saurai jamais faire. » 1052
Femmes (Remarquables. Sand George) (2) : (10 juin) 1876. Début de l’éloge funèbre de George Sand [1804-1876] par Victor Hugo [1802-1885], lu par M. Paul Meurice [1818-1905], à Nohant, le jour de ses obsèques :
« Je pleure une morte, et je salue une immortelle. Je l’ai aimée, je l’ai admirée, je l’ai vénérée ; aujourd’hui dans l’auguste sérénité de la mort, je la contemple. Je la félicite parce que ce qu’elle a fait est grand et je la remercie parce que ce qu’elle a fait est bon.
Je me souviens d’un jour où je lui ai écrit : ‘Je vous remercie d’être une si grande âme’. Est-ce que nous l’avons perdue ? Non.
Ces hautes figures disparaissent, mais ne s’évanouissent pas. Loin de là ; on pourrait presque dire qu’elles se réalisent. En devenant invisibles sous une forme, elles deviennent visibles sous l’autre. Transfiguration sublime. La forme humaine est une occultation. Elle masque le vrai visage divin qui est l’idée.
George Sand était une idée ; elle est hors de la chair, la voilà libre ; elle est morte, la voilà vivante. Patuit dea. [Une déesse dévoilée ?]
George Sand a dans notre temps une place unique. D’autres sont les grands hommes ; elle est la grande femme. Dans ce siècle qui a pour loi d’achever la Révolution française et de commencer la révolution humaine, l’égalité des sexes faisant partie de l’égalité des hommes, une grande femme était nécessaire. Il fallait que la femme prouvât qu’elle peut avoir tous les dons virils sans rien perdre de ses dons angéliques ; être forte sans cesser d’être douce. George Sand est cette preuve.
Il faut bien qu’il y ait quelqu’un qui honore la France, puisque tant d’autres la déshonorent.
George Sand sera un des orgueils de notre siècle et de notre pays. Rien n’a manqué à cette femme pleine de gloire.
Elle a été un grand cœur comme Barbès, un grand esprit comme Balzac, une grande âme comme Lamartine. […] » (Cf. Femmes. Artistes. Écrivaines. Orgueil, Hommes. « Grands ». « Virils »)
Femmes (Remarquables. Sand George) (3) : (juin) 1876. Fiodor Dostoïevksi [1821-1881], à l’annonce de la mort de George Sand [1804-1876], dans le Journal d’un écrivain, écrit :
« […] À sa seule nouvelle, j’ai éprouvé tout ce qu’a signifié ce nom dans ma vie, combien revient à ce poète, en son temps, de mes enthousiasmes et de mes adorations, et combien elle m’a donné autrefois de joies et de bonheurs ! Je n’hésite pas à choisir ces mots, car c’est à la lettre ce qui fut. C’est un de ces noms de notre siècle puissant, présomptueux et en même temps malade, regorgeant des idéaux les moins élucidés et des aspirations les plus insolubles, un de ces noms qui surgit là-bas, chez eux au ‘pays des saintes merveilles’* ont fasciné et attiré de chez nous, de notre Russie en perpétuelle création, tant de pensées, d’amour, de saints et nobles élans, de vie vivante et de convictions chéries. […] Qu’on ne s’étonne pas de me voir parler ainsi, et surtout à propos de George Sand, qui peut encore être discutée et qu’on a déjà, chez nous, à moitié oubliée sinon même au neuf-dixièmes ; elle n’en a pas moins fait son œuvre chez nous en son temps, et qui lui donnerait un souvenir sur sa tombe sinon nous, ses contemporains du monde entier ? »
N.B. * En note : « Expression devenue presque proverbiale, du poète slavophile Alexis S. Khomiakov [1804-1860] dans son poème Un rêve [1834], où elle [Il] qualifie avec une nuance d’amère ironie, l’Occident et spécialement la France. »
Puis suivent neuf pages intitulées : « Quelques mots sur George Sand » dans lesquelles il la qualifie de « femme presque unique pour la vigueur de son intelligence et de son talent » et surtout - à l’opposé des jugements littéraires en France - juge la femme en fonction de « la pureté morale » de ses héroïnes. 1053 (Cf. Culture. « Mélo »)
Femmes (Remarquables. Sand George) (4) : (29 octobre) 1908. Lu dans le Journal de l’abbé Mugnier [1853-1944] :
« Été voir Pauline Viardot. [1821-1910] […]. La sœur de la Malibran [1808-1836] est très âgée, 87 ans. Elle m’a dit la bonté de George Sand [1804-1876] ‘bonté bourgeoise, bonté simple’. On parle toujours de son génie. On ne saura jamais combien elle était bonne. […] » 1054
C’était aussi l’opinion de Marie Dorval [1798-1849], de Gustave Flaubert [1821-1880] et de tant d’autres, dont sa vie et ses écrits témoignent. (Cf. Femmes. Artistes. Écrivaines)
Femmes (Remarquables. Sand George) (5) : 1935-1936. Nicolas Berdiaev [1874-1948], dans Les sources et le sens du communisme russe, auteur de :
« Les romans de George Sand [1804-1876] ont joué un rôle décisif dans la formation de la vie émotionnelle russe, dans la position de la classe cultivée russe face aux problèmes sentimentaux, dans son horreur de la contrainte, de la convention et de l’insincérité. » 1055 (Cf. Culture, Femmes. Écrivaines, Politique. Sand George)
-------------
Femmes (Remarquables. Satrapi Marjane) : (15 janvier) 2025. Lettre de Marjane Satrapi à la ministre de la culture :
« Objet. Refus de légion d’honneur,
Madame la ministre,
Je tiens d’abord à vous remercier […].
Cependant, après une décision approfondie, j’ai pris la décision de décliner cette décoration. Cette décision repose sur des principes qui me sont chers et sur mon attachement à ma patrie de naissance, l’Iran. Je ne peux ignorer ce que je perçois comme une attitude hypocrite de la France vis à vis de l’Iran qui a forgé l’autre partie de mon identité. […] » En commentaire :
« Mais je ne peux plus voir les enfants des oligarques iraniens venir passer des vacances en France, voire se faire naturaliser alors que les jeunes dissidents ont du mal à obtenir même un visa touristique pour voir enfin à quoi ressemble le pays des lumières et des droits de l’homme. » (Cf. Histoire. Satrapi Marjane)
Femmes (Remarquables. Schloss Simone) : 1942. Simone Schloss [1920-2 juillet 1942] fut l’une des premières résistantes, communiste. Arrêtée, puis jugée par un tribunal de guerre nazi, avec ses 27 compagnons, après avoir été livré-es à lui par la police de Vichy.
Eux, seront fusillés au Mont Valérien ; elle, condamnée aussi à mort, mais graciée, « en tant que femme », sera décapitée, 3 mois après, en Allemagne. Une plaque à la Maison de la chimie, 28 rue Saint Dominique (Paris VIIème) leur rend hommage. (Cf. Femmes. Résistantes)
Femmes (Remarquables. Schopenhauer Adèle) : Adèle Schopenhauer [1797-1849], dans une lettre à son frère Arthur Schopenhauer [1788-1860], lui écrit :
- « J’ai trouvé moyen de supporter la vie sans être heureuse mais sans me plaindre […].
- Ici, nous (sa mère et elle) vivons tranquilles […].
- Nous resterons ici et cette perspective me laisse dans un calme indescriptible, ni gaie, ni triste, ni enjouée, mais tranquille […].
- Nul sentiment ne m’agite plus. Aucun espoir, aucun plan d’avenir, à peine un désir […].
- Je vis malgré moi, l’âge m’effraie. J’ai peur de la solitude qui m’attend sans doute. Je ne veux pas me marier parce que je trouverai difficilement un homme qui soit fait pour moi […].
- J’ai bien la force de supporter ma solitude, mais je serais profondément reconnaissante au choléra s’il voulait bien, sans trop de douleur, mettre fin à toute l’histoire […]. » 1056
Je lis ensuite sur Wikipédia :
« Très douée, Adèle s'occupe de (sic) littérature et de poésie. Elle n'écrit pas seulement des histoires, des poèmes et des romans, elle est aussi un maître du papier découpé : ses remarquables silhouettes ainsi que son œuvre littéraire sont honorées principalement en langue anglaise. » 1057
Femmes (Remarquables. September Dulcie) : 1988. Lu sur France Culture :
« Dulcie September [1935-1988] a été assassinée en plein Paris, 3 ans avant la fin de l’apartheid et la libération de Nelson Mandela. Presque 30 ans après les faits, que sait-on de ce meurtre politique sur lequel les autorités françaises de l’époque n’ont pas montré beaucoup d’empressement pour enquêter ? […]
Installée comme représentante de l’African National Congress en France en 1984, Dulcie September ne compte pas ses heures. Elle court le pays pour participer à des manifestations contre l’apartheid. Elle apporte des faits, des chiffres, la description crue du régime en place depuis 1948. Elle noue aussi des contacts plus discrets avec des personnes de l’ombre. C’est en tous cas, ce que développe le journaliste et chercheur sud-africain Hennie Van Vurren dans son livre - non traduit - Apartheid, guns and money. Selon lui, Dulcie September s’apprêtait, au moment de sa mort, à dénoncer les relations étroites nouées par les gouvernements français successifs avec le régime sud-africain, lui permettant notamment de contourner l’embargo sur les armes. La militante de l’ANC en savait-elle trop sur des dossiers compromettants ? » 1058
La réponse est oui. Et la responsabilité du gouvernement français est évidente. (Cf. Langage. Mots. September Dulcie, Politique. Apartheid. État. Répression, Histoire. « Longue »)
* Ajout. 27 juillet 2022. Écouter France Inter. Rendez-vous avec X. Dulcie September.
* Ajout. 6 décembre 2023. En décembre 2022, la justice française a débouté la famille de Dulcie September qui avait assigné l'État pour faute lourde dans l’espoir de rouvrir l’enquête sur cet assassinat jamais élucidé.
Femmes (Remarquables. Séverine) : (janvier) 1898. (date exacte à retrouver). Séverine [1855-1929], dans La Fronde, concernant le J’accuse d’Émile Zola [1840-1902], auteure de :
« Quelle que soit l’opinion que l’on professe au sujet de la cause défendue par M. Émile Zola [l’innocence d’Alfred Dreyfus], il est impossible de ne pas reconnaître qu’en adressant à L’Aurore la lettre que nous reproduisons plus loin, l’éminent écrivain a fait preuve de bravoure. Des femmes sont heureuses de saluer, par ce temps de veulerie et de lâcheté, un acte de courage moral. » 1059 (Cf. Femmes. Journalistes. Heureuses, Justice. Procès. Zola Émile, Relations entre êtres humains. Solidarité, Féminismes, Patriarcat, Politique. Morale)
* Ajout. 26 septembre 2025. À la relecture ici de cette seule citation, je suis gênée : il y aurait tant et tant de choses à dire, à écrire, concernant cette femme si remarquable à tant de titres : Séverine.
Femmes (Remarquables. Sharawi Huda) : Revenant du Congrès de l’Alliance internationale des femmes, Huda Sharawi est considérée comme la première féministe Égyptienne se dévoilant publiquement en 1923 au Caire.
Pour connaitre l’histoire de sa vie, resituée dans son contexte, lire l’article de Sonia Dayan-Herzbrun, Féministe et nationaliste égyptienne : Huda Sharawi. 1060
Femmes (Remarquables. Sophie) : (25 octobre) 2022. Écouter sur France Culture :
« Sophie, gilet jaune. Trois ans plus tard ». (Cf. Famille. Couple. Divorce, Politique. « Gilets jaunes »)
Femmes (Remarquables. Souvestre Marie) : 1863. Marie Souvestre [1836-1905], avec Caroline Dussault - « avant Camille Sée, avant le collège Sévigné » - soutenue par Victor Duruy [1811-1894], créa à Fontainebleau en 1863, l’école Les Ruches.
Destinée à des jeunes filles riches et étrangères (la plus ‘célèbre’ étant la jeune Eleanor qui devait plus tard épouser Franklin Delano Roosevelt), l’enseignement non religieux, était ouvert sur le monde de l’époque.
Après une rupture avec Caroline Dussault, l’école fut transférée à Allenswood en Angleterre.
Un exemple de la pédagogie appliquée :
« Les élèves écrivaient des rédactions sur des sujets donnés qu’elle déchirait rageusement en deux si elles n’atteignaient pas la qualité requise. Malheur à celle qui, dans une rédaction, se contentait de régurgiter ce qui avait été expliqué en classe. Eleanor se souviens de ses propos : ‘Vous me rendez ce que je vous ai donné et cela ne m’intéresse pas’ disait-elle.’ Pourquoi vous a-t-on donné un cerveau sinon pour penser librement ?‘ » 1061
Le livre de David Steel : Marie Souvestre lui est consacré. (Cf. Êtres humains. Cerveaux, Femmes. Jeunes filles, Penser)
Femmes (Remarquables. Spiridonova Maria) : 1996. Lire la présentation de la remarquable vie de Maria Spiridonova [1884-1941], dans la longue note qui lui est consacrée par le non moins remarquable Alexander Berkman [1870-1936], dans son livre Le mythe bolchévik. Journal 1920-1922. 1062
Par ordre chronologique. Femmes. Remarquables. Germaine de Staël :
Femmes (Remarquables. Staël Germaine de) (1) : Germaine de Staël [1766-1817], auteure de : « […] Nous sommes assez esclaves sans river nous-mêmes nos fers. »
Pourquoi cette assertion (parmi tant et tant d’autres) si forte, si puissante, si vraie, ne nous a-t-elle jamais été transmise ? 1063 (Cf. Femmes. Écrivaines. Staël Germaine de. Esclaves, Politique. Esclavage)
Femmes (Remarquables. Staël Germaine de) (2) : 1796. Germaine de Staël [1766-1817] : De subtiles analyses féministes à lire dans : De l’influence des passions sur le bonheur des individus et des nations (p.124 à 129). 1064 (Cf. Femmes. Écrivaines. Staël Germaine de, Penser. Pensées. Subtiles)
Femmes (Remarquables. Staël Germaine de) (3) : L’intelligence de Germaine de Staël ne doit pas occulter le fait qu’elle était fille de banquier [et non pas « banquière » comme la nomme Henri Guillemin [1903-1992] 1065] et épousa un baron.
Ayant écrit ceci, je dois ici préciser, que - comparaison de fortune et de tout lien avec l’aristocratie mises à part - je suis moi aussi, une nantie, une privilégiée… Oh ! combien !
* Ajout. 30 juillet 2017. Pour atténuer la grossièreté de ce que j’ai plus haut écrit - mais que je maintiens - se référer à ce que Germaine de Staël écrivait, le 30 mai 1808, à la grande duchesse Marie Paulovna [sœur du tsar Alexandre 1er] :
« Il me semble bien naturel de faire un long voyage pour y apercevoir une femme unique, dit-on, entre les femmes, quand son rang n’y ajouterait aucun prestige. » 1066 (Cf. Femmes. Écrivaines. Staël Germaine de. Conscience de classe)
-------------
Femmes (Remarquables. Stein Édith) : (avril) 1933. Édith Stein [1891-1943], après avoir demandé « audience privée » au pape qui lui fut refusée, adressa une lettre à Pie XI [1857-1939] qui lui fut remise par son « père spirituel », Dom Raphaël Walzer [1888-1966], Bénédictin, « militant anti nazi convaincu ».
- Dans cette lettre, lucidement alarmiste, « fille du peuple juif » et « fille de l’Église catholique », elle « ose exprimer devant le Père de la chrétienté ce qui accable des millions d’Allemands » :
« Depuis des semaines, nous voyons en Allemagne se produire des agissements qui témoignent d’un total mépris de toute justice et de toute humanité, sans parler de l’amour du prochain ? Des années durant, les chefs du national-socialisme ont prêché la haine des juifs. [Dans une lettre datée du 11 novembre 1919, elle avait évoqué « l’effroyable antisémitisme qui règne maintenant partout ».] 1067
Elle évoque aussi « une opinion publique bâillonnée », « le boycottage des magasins et institutions juives qui ôtent aux personnes leurs moyens d’existence, leur honneur de citoyen et leur patrie [et] en pousse beaucoup au désespoir ».
Et elle poursuit :
« Tout ce qui s’est produit et se déroule encore quotidiennement est le fait d’un gouvernement qui se déclare ‘chrétien’. Depuis des semaines, non seulement des juifs mais aussi des milliers de catholiques fidèles en Allemagne - et je pense dans le monde entier - attendent et espère que l’Église du Christ fasse entendre sa voix pour mettre un terme à cet abus du nom du Christ. Cette idolâtrie de la race et du pouvoir étatique - martelée chaque jour aux masses par la radio, n’est-elle pas une hérésie ouverte ? […]
Nous tous qui sommes les enfants fidèles de l’Église et qui, observons les évènements qui se déroulent en Allemagne sans fermer les yeux nous craignons le pire pour l’image de l’Église si jamais son silence durait encore.
Nous sommes aussi convaincus que ce silence ne sera pas en mesure d’acheter la paix face à l’actuel gouvernement allemand.
La lutte contre le catholicisme est provisoirement encore menée avec discrétion et sous des formes moins brutales que celle contre les juifs, mais elle n’en est pas moins systématique.
Sous peu, aucun catholique ne pourra plus exercer une charge sans avoir soustrait inconditionnellement à la nouvelle orientation. […] »
Édith Stein reçut un accusé de réception.
Cette lettre fut mensongèrement déclarée perdue par le Vatican, puis refusée de publication et ce n’est qu’en février 2003, à la suite de l’ouverture d’archives du Vatican, qu’elle fut rendue publique. (Cf. Histoire. Archives)
Rappelons aussi qu’Édith Stein avait préalablement été béatifiée par Jean Paul II en 1987.
Rappelons enfin que devenue Carmélite, Édith Stein, déportée, mourut avec sa sœur Rosa, assassinée à Auschwitz en 1942. (Cf. Relations entre êtres humains. Haine, Femmes. Noms, Silence, Patriarcat. Église catholique, Politique. Démocratie. « Masses ». Sondages d’opinion. « Opinion publique »)
Femmes (Remarquables. Sullerot Évelyne) : 2012. Évelyne Sullerot [1924-2017], concernant l’avortement et la contraception, auteure de :
« Maintenant, vous avez une augmentation sans cesse chez les très jeunes, les 16,17, 18,19 ans de filles qui demandent, pour la deuxième, pour la troisième fois des avortements, parce qu’elles n’ont pas à se casser la tête. Alors que la pilule, il faut se prendre en main et assurer soi-même cette maitrise. Et à ce moment-là, la femme devient absolument responsable. Elle découvre une double liberté, la liberté de n’être enceinte que si elle le veut, donc de ne pas l’être si elle ne le veut pas, et la liberté de rechercher son épanouissement sexuel dans la sexualité par rapport à la procréation. […] » 1068 (Cf. Femmes. Avortements. Enceintes, Féminismes, « Sciences » sociales. Sociologie)
Femmes (Remarquables. Suze de la Henriette) : 1751. Je lis parmi l’importante présentation par Voltaire [1694-1778] des Écrivains, dans Le siècle de Louis XIV :
« De la Suze (la comtesse Henriette de Coligny) [1618-1673] célèbre dans son temps par son esprit et par ses élégies. Ce fut elle qui se fit catholique parce que son mari était huguenot, et qui s’en sépara, afin (disait la reine Christine [1626-1689]), de ne voir son mari ni dans ce monde-ci, ni dans l’autre. Morte en 1673. » 1069
N.B. Cf. une autre présentation sur Wikipédia.
Femmes (Remarquables. Sylvestre Anne) : (1er décembre) 2020. Catherine Le Magueresse, à l'annonce du décès de cette femme exceptionnelle [Anne Sylvestre. 1934-2020] lui a écrit ce texte :
« Chère Anne,
J’aurais pu être de la génération des Fabulettes mais je t’ai découverte un dimanche après-midi de la fin des années 80. Je descendais les escaliers de la maison parentale et ta chanson « Écrire pour ne pas mourir » passait sur FIP. Je me suis arrêtée, assise dans l’escalier, bouleversée, j’ai écouté. Depuis, tu as accompagné ma vie. Je t’ai écoutée et lue. Tes textes ont enrichi ma vie, m’ont guidée lorsque je suis devenue mère, ils m’ont animée, consolée, portée dans mes combats contre les violences masculines à l’encontre des femmes.
Une fois, à la sortie d’un concert, nous avons échangé quelques mots. Tu m’as demandé ce que je faisais. J’ai expliqué. Tu as pris un papier, noté ton numéro de téléphone et dit quelque chose comme « Si je peux être utile, n’hésitez pas ».
Nous avions rendez-vous à la Cigale en janvier 2021. J’y allais avec ma fille. J’attendais ces retrouvailles avec toi et ton public vibrant d’amour, de respect, de gratitude, murmurant tes poèmes ciselés, suppléant aux facéties de ta mémoire qui parfois se faisait la malle ; ton public insatiable.
Depuis l’annonce de ton départ, je reçois des messages partageant l’immense tristesse et la chance que nous avons eue de te rencontrer. « Pour tant de beauté, merci et chapeau bas ». 1070 (Cf. Femmes. Artistes. Sylvestre Anne)
Femmes (Remarquables. Tabouis Geneviève) : 1949. Jean Lacouture [1921-2015], concernant Geneviève Tabouis [1892-1985] :
« [Au Quai d’Orsay, en 1949] il y avait […] et surtout Geneviève Tabouis qui représentait tout et rien ; excentrique, toujours coiffée d’un petit chapeau multicolore, elle avait vu le monde entier et les ambassadeurs accourraient à sa table. » 1071 (Cf. Femmes. Journalistes)
Femmes (Remarquables. Taratouta Olga) : (1er février) 1928. Lu dans le Journal de Russie 1928-1929, de Pierre Pascal [1890-1983] :
« Le Libertaire publie une lettre d’Olga Taratouta [1876-1938] qui traite les dirigeants aussi librement que si elle était en sûreté ; or, elle est à Moscou, malade. On a trouvé chez elle les mêmes manifestes pour lesquels on a arrêté Varchavski (militant anarchiste) : elle dit : ‘Lâches, arrêtez-moi aussi, je n’ai pas peur, je suis vieille… Être dans une petite prison ou dans une grande prison comme sous votre joug en Russie, il n’y a pas de différence.’ »
Et, dans une note, il est écrit : « Olga Taratouta, pseudonyme d’Olga Rouvinskaïa : militante des groupes ‘anarchistes-communistes’ avant la révolution, plusieurs fois emprisonnée. Malade, elle se retire de la vie politique en 1917 et s’engage à nouveau en 1920 pour protester contre les persécutions des anarchistes par la Tcheka, animant la ‘Croix-Rouge anarchiste’. Torturée en prison, déportée en Sibérie, elle est relâchée au milieu des années 1920, puis disparaît dans les purges staliniennes. » 1072 (Cf. Politique. Anarchisme)
Femmes Remarquables. Thiam Awa : Le livre remarquable d’Awa Thiam, née en 1950, La parole aux négresses, écrit en France en 1977, a été réédité au Sénégal en mai 2024. (Cf. Culture. Livres, Femmes. Remarquables. Dooh-Bunya Lydia)
Femmes (Remarquables. Tillion Germaine) : (25 juin) 1960. Concernant la dénonciation des tortures infligées à Djamila Boupacha par l’armée française, Gisèle Halimi [1927-2020] fit un compte rendu d’un rendez-vous, le 25 juin 1960, chez M. Patin, président de la « Commission de sauvegarde » avec Germaine Tillion. [1907-2008]. Je lis :
« Germaine Tillion parla la première : elle relata notre visite au Garde des Sceaux [Edmond Michelet. 1899-1970] comme à ce dernier, elle expliqua la nécessité du dessaisissement (des tribunaux d'Algérie en France) : ‘J'ai vu beaucoup d'affaires de tortures, Monsieur le Président, dit-elle. Jamais les plaintes n'ont abouti. Elles ne sont pas instruites : les policiers et les magistrats d'Algérie étouffent les affaires.’
M. Patin semblait écouter et ponctuait de raclements de gorge discret l'exposé de Germaine Tillion. ‘Voyez-vous, Monsieur le Président, pendant six ans je n'ai rien voulu divulguer des innombrables cas de tortures que je connaissais… Aujourd'hui, en désespoir de cause, je m'associe au Comité pour Djamila Boupacha’.…
Le Président eut, à ce moment, un regard rapide sur chacun d'entre nous, pour voir de quelle manière était fait ce Comité. ‘Oui, conclut Germaine Tillion, l'ultime recours, c'est l'opinion publique.’ » 1073 (Cf. Justice, Politique. Sondages d’opinion. « Opinion publique ». Tortures, « Sciences » sociales. Ethnologie. Tillion Germaine)
Femmes (Remarquables. Tomyris) : Tomyris : « reine légendaire, célèbre pour avoir mis fin au règne de Cyrus le Grand ; considérée comme la dernière reine des Amazones. » [Wikipédia]
Femmes (Remarquables. Traoré Assa) : 2016. Assa Traoré, sœur d’Adama Traoré, tué le 19 juillet 2016, asphyxié sous le poids de trois gendarmes, concernant son livre Lettre à Adama [Le Seuil. 2017] :
« Ce livre, je l’ai d’abord écrit pour rétablir l’honneur de mon frère. Les autorités se sont empressées d’écrire l’histoire d’Adama : il était malade, drogué, alcoolique, délinquant… Pour moi, c’est d’abord une victime. Victime de la violence des gendarmes, victime de la violence d’un système. La seule qui mérite d’être dénoncée, celle d’une société qui discrimine, criminalise les jeunes des quartiers populaires. C’est ce système qu’il faut casser. » 1074
Sur France Culture, le lendemain, concernant les classements sans suite, les non-lieux décidés par la justice dès lors que les plaintes mettent en cause la police et la gendarmerie, elle déclara :
« C’est comme s’ils avaient un manuel », pour enfin conclure par cette si radicale critique :
« Il faut se défendre comme des coupables. » 1075 (Cf. Famille, Justice. Adama Traoré, Politique. État. Répression)
* Ajout. 14 août 2017. Madame de Sévigné [1626-1696], cite le 23 décembre 1671, le jugement M. de Lauzun [1632-1723] arrêté sur ordre du roi puis emprisonné de 1671 à 1681 :
« Il dit qu’il est très innocent à l’égard du roi, mais que son crime est d’avoir des ennemis trop puissants. » 1076 (Cf. Justice, Politique. État. Répression)
* Ajout. 21 juillet 2018. Deux ans après la mort d’Adama Traoré, les trois gendarmes qui ont, pour reprendre la formulation du Monde, procédé à son ‘interpellation’ n’ont toujours pas été entendus par les juges d’instruction. 1077 (Cf. Justice, Politique. État. Répression)
* Ajout. 20 juillet 2019. Toujours pas de procès en vue : lu une pancarte lors du rassemblement, à Beaumont sur Oise, contre les violences policières :
« Ce ne sont pas des bavures ; c’est un système d’oppression ». (Cf. Justice. Adama Traoré, Politique. État. Répression)
* Ajout. 8 juin 2022. Je lis ce jour dans Le Canard enchaîné (p.7) qu’Assa Traoré « a développé un partenariat avec Louboutin (plus de 3.000 euros la paire de chaussures avec des cristaux Swarovski). »
Femmes (Remarquables. Tristan Flora) : 1843-1844. Flora Tristan [1803-1844], dans Le tour de France. Journal, auteure, notamment, de :
« Mon Dieu, dites-moi donc à quoi servent les riches sur la terre ? […]
Jamais, je n’ai regretté ce que j’ai fait depuis 13 ans que j’ai abandonné la vie calme, sûre, tranquille, pour la vie agitée, précaire - Mais aujourd’hui, moins que jamais, je regrette le parti que j’ai pris. Si j’avais voulu, aujourd’hui, je serais (?) ; j’aurais des maisons, des terres, des rentes, mais je n’aurais point le bonheur, pas de vie, mon existence serait monotone.
Dieu soit loué, je suis pauvre mais j’ai du bonheur de la vie, une existence remplie, en un mot une position que je ne changerais pas pour aucune autre. […]
Je reconnais aussi une chose, c’est que je ne suis pas faite pour les choses matérielles, je n’y apporte pas la même grandeur et la même hardiesse que dans les choses morales et intellectuelles. C’est un tort dont il faut que je me corrige. […]
C’est singulier que je sois sans force pour les petites contrariétés, quand, au contraire j’ai une force invincible pour les grandes douleurs.
Quelle bizarrerie il y a dans l’organisation humaine ! Chargez-moi de remuer le monde - cela me va. - Si vous me chargez de remuer un imprimeur et marchand de papier - cela m’irrite, me désole, me rend malade. - Je suis désespérée d’être ainsi ! mais que faire ? Il faut pourtant s’accepter comme on est. - J’enrage tout en me résignant. » 1078 (Cf. Êtres humains, Penser. Morale, Politique. Morale, Économie. « Pauvres Les »)
Femmes (Remarquables. Vaillant-Couturier Claude) : (17 septembre) 2025. J’entends, sur France Culture [L’engagement et le risque de la ‘pensée captive’], qu’à Auschwitz, Marie-Claude Vaillant-Couturier [1912-1996] a - aurait- dit, concernant la solidarité communiste dans le camp de concentration :
« Il faut privilégier les cadres, les militantes il y en aura toujours. » (Cf. Penser, Politique. Parti communiste)
Par ordre chronologique. Femmes. Remarquables. Françoise Verny :
Femmes (Remarquables. Verny Françoise) (1) : 1990. Françoise Verny [1928-2004], dans Le plus beau métier, présente le tableau, tel qu’elle l’a vécu, du rôle (fort politique, antiféminisme inclus) qu’elle joua longtemps dans l’édition française.
Son livre se termine par une belle ode à sa longue relation avec Françoise Mallet-Joris [1930-2016] :
« […] En travaillant ensemble, Françoise et moi, nous avons mêlé nos vies. […]
Nous avons traversé les tourments de la passion avant de jouir d’une tendresse partagée. Notre intimité me comble et m’étonne chaque jour. Peut-on rêver deux êtres plus différents qu’elle et moi ? Elle ménage ses forces alors que je prodigue les miennes. Je dévore tandis qu’elle savoure. Elle se concentre et je me disperse. J’adore la compagnie et elle n’apprécie que le tête-à-tête. Je me plais à rire, elle plonge volontiers dans la tristesse. Elle souhaite un échange permanent auquel je me dérobe le plus souvent. Elle m’ouvre son cœur, je me préserve de toute intrusion. Je l‘inquiète par mes excès, la blesse par ma brutalité et plus encore par ma réserve. Elle m’irrite par sa mélancolie et ses soupirs. Je voudrais qu’elle ‘s‘éclate’, elle désire que je me discipline. Et pourtant, je ne puis me passer d’elle qui ne peut se passer de moi. […] » 1079 (Cf. Relations entre êtres humains. Aimer)
Femmes (Remarquables. Verny Françoise) (2) : 1992. Françoise Verny [1928-2004] auteure de :
« Je suis grosse de tout ce que j’absorbe comme de tout ce que je mange. J’ai accepté mon poids, malgré la disgrâce qu’il implique, pour la stature qu’il me confère : je m’impose par ma prestance autant que je séduis par mon intelligence. » 1080 (Cf. Êtres humains, Corps. Femmes, Femmes. Intelligentes)
-------------
Femmes (Remarquables. Vida Movahed, Narges Hosseini…) : (27 décembre) 2017. À Téhéran, Vida Movahed, s’est tenue, seule, sans voile, en silence, sur un coffre électrique dans une rue très fréquentée. Interpellée et placée en détention, la jeune femme n’avait plus donné signe de vie depuis et a finalement été libérée mardi 30 janvier 2018.
- le 29 janvier 2018, Narges Hosseini, montée tête nue sur une armoire électrique, a posé plusieurs minutes avec son foulard pendu au bout d’une perche pour dénoncer l’obligation de port du voile. D’autres femmes auraient mené le même jour une action similaire dans d’autres villes d’Iran. Même jour, 29 femmes dévoilées auraient été arrêtées. Quel courage … (Cf. Femmes. « Voilées », Patriarcat, Politique. Islam)
Par ordre chronologique. Femmes. Remarquables. Andrée Viollis :
Femmes (Remarquables. Viollis Andrée) (1) : Andrée Viollis [1870-1950] qui avait été journaliste à La Fronde, publiera, durant les années 1930, plusieurs livres issus de ses reportages : Seule en Russie, de la Baltique à la Caspienne, Gallimard, 1927 ; L'Inde contre les anglais, Éd. des portiques, 1930 ; Tourmente sur l'Afghanistan, Librairie Valois, coll. ‘Explorations du monde nouveau’, 1930 ; Changhaï et le destin de la Chine, R.-A. Corrêa, coll. ‘Faits et gestes’, 1933 ; Le Japon et son empire, B. Grasset, coll. ‘Les Écrits’, 1933 ; Le Japon intime, F. Aubier, coll. ‘des Documents’, 1934 ; Indochine S.O.S, Gallimard, 1935 (Préface de d’André Malraux ; et en 1949, pour sa réédition, de Francis Jourdain) ; Le Conflit sino-japonais, M. Maupoint, 1938 (conférence du Cercle Descartes donnée dans l'amphithéâtre Descartes à la Sorbonne, le 1er décembre 1938) ; Notre Tunisie, Gallimard, 1939.
Je lis aussi qu’elle a écrit un roman, Criquet. 1913 (réédité en 1934). Je lis aussi qu’à Lyon, en décembre 1943, les Éditions de la clandestinité font paraître anonymement d’elle, le Racisme hitlérien, machine de guerre contre la France qui sera diffusée en 1944 par le mouvement national contre le racisme. En 1948, elle publie L’Afrique du Sud, cette inconnue. Cf. Femmes. Écrivaines. Journalistes, Histoire)
N.B. Il faut rééditer l’intégralité des écrits d’Andrée Viollis.
* Ajout. 4 novembre 2024. En relisant cela, je m’interroge : Selon quels critères, Andrée Viollis n’a-t-elle pas été publiée dans La Pléiade ? Se poser la question est peut-être la meilleure critique que l’on puisse faire à Gallimard, et, au-delà, à ce qui est traditionnellement considéré comme relevant de « culture française ». (Cf. Culture. Patriarcale)
N.B. Andrée Viollis était le pseudonyme de Françoise-Caroline Claudius Jacquet de la Veyrrière.
Femmes (Remarquables. Viollis Andrée) (2) : (27 novembre) 1929. Je lis dans le Journal de Russie. 1828-1929 de Pierre Pascal [1890-1983] :
« Andrée Viollis [1870-1950] : Déjà âgée [elle a 59 ans], elle est d’une énergie étonnante : elle revient d’Afghanistan, elle a failli être massacrée à Caboul [Kaboul] où fuyards et vainqueurs ont pillé à qui mieux mieux, elle a traversé l’Hindoukouch dans le dernier avion de l’armée, à 5.500 m de hauteur, avec un prince Afghan qui en a pensé mourir, elle a vu Boukhara, Samarkand, Tachkent, a couché dans les gares, les hôtels étant pleins, vécu de poisson sec, le cuisinier du wagon restaurant étant tombé malade du typhus, et elle vient enquêter sur ‘la jeunesse et l’amour’ selon la nouvelle morale communiste. Elle trouve que les transports ont empiré depuis son dernier voyage, il y a trois ans : moins de trains, moins de fiacres. Mais elle a vu un journaliste anglais enchanté du Kolkhoze et M. Rothstein [qui dirige alors le secteur d’information et de presse au Commissariat des Affaires étrangères de l’URSS] lui a raconté tant de merveilles du plan de 5 ans.
Elle déborde de sympathie, aveugle ou perspicace, on verra plus tard. » 1081
Femmes (Remarquables. Viollis Andrée) (3) : 1932. Andrée Viollis [1870-1950], à un officier japonais, furieux de sa présence lors violences Japonaises à Shanghai, qui lui avait demandé :
« Que faites-vous là ? », répondit :
« Mon métier ! » 1082 (Cf. Dialogues, Femmes. Journalistes)
Femmes (Remarquables. Viollis Andrée) (4) : 1972. Jacques Prévert [1900-1977], dans Hebdromadaires (avec André Pozner), auteur de :
« […] Ce serait trop long de tout citer. Tous ces témoignages, et bien d’autres encore concernant les suites de la conquête de l’Indochine, cette belle épopée française, ont été recueillis par madame Andrée Viollis [1870-1950]. Son livre, Indochine SOS, a été publié en septembre 1935. En l’écrivant, elle ne faisait pas simplement preuve de courage, de lucidité et d’un incontestable goût pour la vérité, maison pourrait également dire qu’elle présentait beaucoup de choses qui par la suite devait se passer. » […] » 1083 (Cf. Penser, Politique, Histoire)
Femmes (Remarquables. Viollis Andrée) (5) : 2004. Marie Fourcade, au terme de son texte intitulé, Les Britanniques en Inde où le règne du ‘cyniquement correct’ [1858-1947], publié dans le Livre noir du colonialisme, publie huit pages passionnantes tirées du livre d’Andrée Viollis [1870-1950], L’inde contre les Anglais [1930]. 1084 (Cf. Enfants. Garde des enfants, Femmes. Journalistes, Histoire)
Femmes (Remarquables. Viollis Andrée) (6) : 2004. Présentation du livre d’Anne Renoult aux Presses universitaires de Rennes, Andrée Viollis, Une femme journaliste :
« Journaliste d'investigation, envoyée spéciale, correspondante de guerre, critique et chroniqueuse littéraire, romancière, essayiste, traductrice… Andrée Viollis [1870-1950] se sera illustrée pendant plus d'un demi-siècle dans tous les domaines et sur tous les théâtres des opérations, de la guerre civile en Irlande à celle d'Espagne, de la Russie soviétique à l’Allemagne nazie, en passant par l'Inde en révolte, l'Afghanistan dans la tourmente, l'Indochine malmenée, la Chine et le Japon aux prises… » (Cf. Femmes. Journalistes)
-------------
Femmes (Remarquables. Voronianskaïa, Élisabeth) : [?-1973] Élisabeth Voronianskaïa fut « au cœur du dispositif » important caché de personnes qui aidèrent (frappe, relecture, informations, corrections…) Soljenitsyne [1918-2008] pour la rédaction de L’Archipel du Goulag. 1085 Retrouvée par le KGB, elle se suicidera après avoir avoué sous la torture où se cachait le tapuscrit tant recherché, qu’elle avait enterré au fond de son jardin. Soljenitsyne s’en voudra longtemps, car son amie ignorait qu’il existait d’autres copies, cachées chez d’autres complices. En 1973, en apprenant la pendaison d’Élisabeth Voronianskaïa, il se décide à divulguer la nouvelle et à faire publier l’Archipel du Goulag à Paris. (Cf. Politique. Tortures)
Femmes (Remarquables. Walentynowicz Anna) : Anna Walentynowicz [1929-2010] : fondatrice de Solidarnosc, avec Lech Walesa.
Comment, pourquoi, quand, par quels processus, son effacement de la scène politique a-t-il eu lieu, au seul profit de Lech Walesa ?
Femmes. Remarquables. Simone Weil :
Femmes (Remarquables. Weil Simone) (1) : Qualifier Simone Weil [1909-1943] d’« être supérieur », c’est n’avoir rien compris d’elle. C’est la nier, nier sa vie, nier son œuvre, indissociables. 1086
Incidemment, personne n’est « supérieur » à personne.
Femmes (Remarquables. Weil Simone) (2) : 1971. Gustave Thibon [1903-2001], auteur de :
« Simone Weil [1909-1943] - ses défauts, ses misères, je les ai vus des très, très près - est le seul être dans lequel je n’ai vu aucun décalage réel, sauf des broutilles, entre l’idéal qu’elle affirmait et la vie qu’elle menait et tout ce qu’elle éprouvait. » 1087 (Cf. « Sciences » sociales. Philosophie)
-------------
Femmes (Remarquables. Woodhull Victoria) : (8 juin) 2016. Lu dans Libération, concernant Victoria Woodhull [1838-1927] première femme américaine à la présidence des États-Unis :
« Victoria Woodhull était une formidable aventurière. Elle a fait fortune sur les routes, comme voyante et magnétiseuse ambulante, avant de fonder une société d'agents de changes à Wall Street, et pour ses activités politiques un journal, le ‘Woodhull & Claflin's Weekly’.
Passionnée, elle a pris la défense de la classe ouvrière (c'est elle qui a, la première aux États-Unis, traduit ‘Le Manifeste du parti communiste’ de Friedrich Engels et Karl Marx), de la cause des femmes et de ‘l’amour libre’. Rappelons qu’à l’époque, il était d’usage que seuls les hommes aient des maîtresses, et qu'ils pouvaient même tranquillement violer leur femme.
Annoncée en 1870, sa candidature, près de 50 ans avant le droit de vote des femmes (1920), avait fait sensation.
Elle avait choisi comme candidat à la vice-présidence un autre aventurier célèbre, un ancien esclave qui avait réussi à s’instruire et à s’évader, l’écrivain abolitionniste Frederick Douglass.
Quelques jours avant l’élection de 1872, Victoria Woodhull était arrêtée par la police de New York pour ‘obscénité’. Son crime ? Avoir publié le récit d’une affaire adultérine impliquant un pasteur important, Henry Ward Beecher, qui, l'hypocrite, fustigeait dans ses sermons l’immoralité du mouvement pour l'amour libre. Le jour de l'élection, elle était en prison, donc. On ignore combien elle a eu de voix, probablement quelques milliers.
Même si cette élection s’est mal terminée pour elle, Victoria Woodhull gardera à jamais le titre de ‘première candidate à l’élection présidentielle américaine’. Les plus pointilleux notent que sa candidature n’était pas des plus régulière : si elle l'avait emporté, elle aurait eu 34 ans le jour de son inauguration comme présidente, alors que la constitution prévoit qu’il en faut au moins 35. Mais dans la vie tumultueuse de Victoria Woodhull, ce détail juridique est insignifiant. » 1088 (Cf. Droit, Politique. Esclavage. Vote des femmes, Économie)
Par ordre chronologique. Femmes. Remarquables. Véra Zassoulitch :
Femmes (Remarquables. Zassoulitch Véra) (1) : 1878. Pierre Kropotkine [1842-1921], écrit dans les Mémoires d’un révolutionnaire, concernant Véra Zassoulitch [1849-1919] :
« [Le 24 janvier 1878] Une jeune fille, Véra Zassoulitch qui ne connaissait même pas personnellement Bogoloubov [un prisonnier politique, emprisonné, frappé, puis fouetté par Trépov, le chef de la police parce qu’il avait refusé de « quitter son chapeau pour saluer le satrape omnipotent »] prit un révolver, alla [chez lui] et tira sur lui. Trépov fut seulement blessé.
Alexandre II [1818-1881], qui vint visiter le blessé, se fit ouvrir la porte de la salle où l’on tenait Véra Zassoulitch arrêtée, et jeta un coup d’œil sur l’héroïque jeune fille. Elle dut faire impression sur lui, par l’extrême douceur de sa physionomie et la modestie de son maintien. Trépov avait tant d’ennemis à Pétersbourg qu’on réussit à porter l’affaire devant le jury de la Cour d’assises.
Là, Véra Zassoulitch déclara qu’elle n’avait recouru au révolver qu’après que tous les moyens employés pour porter l’affaire à la connaissance du public et obtenir réparation avaient été épuisés. […]
Maintenant que l’affaire était devenue publique, elle était très heureuse que Trépov n’avait été que légèrement blessé. Le jury l’acquitta et lorsque la police essaya de l’arrêter à nouveau, au moment où elle quittait le palais de justice, les jeunes gens de Pétersbourg, qui se tenaient aux alentours du palais, la sauvèrent des griffes des agents. Elle passa à l’étranger et bientôt, elle fut des nôtres. Cette affaire fit sensation dans toute l’Europe. […] » 1089
N.B. Véra Zassoulitch prit ses distances avec l’anarchisme, puis, après notamment des échanges avec Karl Marx, rejoint progressivement le marxisme, auquel elle adhéra formellement en 1883. (Cf. Femmes. Heureuses. Jeunes filles, Justice. Jury. Procès, Politique. État. Kropotkine Pierre. Anarchisme. Marxisme)
Femmes (Remarquables. Zassoulitch Véra) (2) : 1929. Léon Trotsky [1879-1940], dans Ma vie, écrit, concernant l’année 1903 :
« Non seulement son héroïque passé mettait au premier rang Véra Ivanovna [Zassoulitch. 1849-1919] - c’était un des esprits les plus pénétrants, d’une large instruction, principalement historique, et d’une rare intuition psychologique. Par l’intermédiaire de Zassoulitch s’était faite, en son temps, la liaison du ‘Groupe’ [L’Iskra] avec le vieil Engels [1820-1895]. » 1090 (Cf. Femmes. « Politiques »)
Femmes (Remarquables. Zassoulitch Véra) (3) : 1937. Lou Andreas Salomé [1861-1937], concernant son adolescence dans la Russie prérévolutionnaire, écrit Ma vie :
« Le seul indice de mon intérêt pour la politique fut que je conservai, caché dans mon bureau un portait de Vera Zassoulitch [1849-1919], qui fut en quelque sorte l’instigatrice du terrorisme en Russie : elle ira sur le capitaine Trépov, et, après acquittement des conjurés [...], elle fut portée en triomphe par une foule en délire ; elle s’enfuit à Genève et est peut être en vie aujourd’hui. » 1091 (Cf. Femmes. Remarquables. Lou Andreas Salomé, Justice, Politique. « Terrorismes », Histoire)
Femmes (Remarquables. Zassoulitch Véra) (4) : 1951. Albert Camus [1913-1960], dans L’homme révolté, dans le paragraphe intitulé Les meurtriers délicats [!], écrit :
« L’année 1878 est l’année de naissance du terrorisme russe. Une très jeune fille, Véra Zassoulitch [1849-1919], au lendemain du procès des 196 populistes, le 24 janvier, abat le général Trepov [1855-1906], gouverneur de Saint Pétersbourg. Acquittée par les jurés, elle échappe ensuite à la police du Tsar. Ce coup de révolver déclenche une cascade de répressions et d’attentats, qui se répondent les uns les autres, et dont on devine que déjà la lassitude seule, peut y mettre fin. » 1092
Une femme - certes liée au « terrorisme russe » … - serait seule, principale cause des « répressions et attentats », et pourrait dès lors en être jugée responsable …. Quels manques de rigueur ! (Cf. Femmes. Jeunes filles, Langage. Adjectif. Sujet, Politique. État. Répression. « Terrorismes », Histoire, Violences)
* Ajout. 3 août 2025. Quant à « la lassitude devin[ée] » …
-------------
X. Femmes :
Femmes :
Femmes (1) : Êtres humains politiquement en devenir, souvent situé-es entre « la famille » et « la vie privée [des hommes] ».
Nouvel avatar : elles sont - nous sommes - dorénavant aussi situées « entre sexe et genre » 1093, et même, dernièrement, entre « l’orientation sexuelle et l’identité de genre ». 1094
Femmes (2) : 2010. Dans un livre récent consacré aux « femmes » 1095, j’ai relevé au singulier et/ou au pluriel, l’existence de femmes qualifiées de : mères, épouses, filles, fiancées, maîtresses, amantes, concubines, mariées, célibataires, de qualité, maîtresses de maison, ménagères, sœurs, veuves, chefs de famille, nobles, aristocrates, bourgeoises, républicaines, révolutionnaires, socialistes, démocrates, citoyennes, militantes, oratrices, marginales, paysannes, domestiques, journalières, cantinières, ambulancières, ouvrières, servantes, domestiques, institutrices, libres penseuses, intellectuelles, guerrières, combattantes, engagées, plébéiennes, pétroleuses, criminelles, condamnées, oratrices, électrices, etc., etc.…
Mais où était leur équivalent masculin qui aurait permis une comparaison terme à terme ? Tant que de telles comparaisons ne seront pas systématiquement explicitées et /ou la norme, les femmes demeureront l’exception - jamais justifiée donc toujours arbitraire - des impositions masculines, patriarcales, dès lors confortées.
Femmes (3) : Les femmes, partout refoulées ressurgissent partout dans le refoulé : naturalisées, chosifiées, objectivées, transfigurées, déformées, idéalisées, découpées, recomposées, mythifiées, adorées, haïes… Jamais elles ne s’y retrouvent… (Poursuivre)
Femmes (4) : Renoncer à soi-même, se résigner, se sacrifier pour d’autres, s’est avéré l’ambition la plus aisément atteignable par les femmes. En assignant à cette construction de vie un sommet à atteindre, beaucoup y trouvèrent une réponse à d’autres désirs enfouis, détournées, étouffés, devenus progressivement des habitudes sécurisantes ; beaucoup en moururent.
Femmes (5) : Les femmes si souvent jugées sur des agissements, des fautes, des erreurs qu’elles n’ont pas commises, chacune d’entre elles étant censée porter le poids des préjugés dont toutes les autres ont été accablées…
Femmes (6) : Les femmes s’épuisent trop souvent à expliquer aux hommes qui ne le savent pas qui ils sont et qui elles sont.
Par ordre alphabétique. Femmes :
Femmes (Abaissement) (1) : 1839. Stendhal [1783-1842], dans La chartreuse de Parme, auteur de :
« Elle [« la triste princesse de Parme »] reçut la duchesse [Sanseverina] avec une timidité si marquée que quelques courtisans, ennemis du comte Mosca, osèrent dire que la princesse avait l’air de la femme qu’on présente et la duchesse d’une souveraine. La duchesse, surprise et presque déconcertée, ne savait où trouver des termes pour se mettre à une place inférieure à celle que la princesse se donnait à elle-même. » 1096 (Cf. Politique. Égalité)
Par ordre chronologique. Femmes. Abêtissement :
Femmes (Abêtissement) (1) : 1894. Anton Tchékhov [1860-1904], dans Le professeur de lettres, auteur de :
« [..] Ce qu’elle disait de juste lui apparaissaient extraordinaire, surprenant ; ce qui ne concordait pas avec ses convictions, était, à son avis, naïf et attendrissant. » 1097
Femmes (Abêtissement) (2) : Lucienne Delyle [1913-1962] dans : Le reste est sans importance, dont voici un couplet, chante :
« Le reste est sans importance / Puisqu'on est là tous les deux / On a toute l'existence / Pour s'aimer, c'est merveilleux / Près de moi quand tu t'avances / Le ciel gris devient tout bleu / Le reste est sans importance / Quand on s'aime on est heureux. » (Cf. Culture, Femmes. Chanteuses françaises d’antan)
Femmes (Abêtissement) (3) : (7 mars) 2017. Dans le Figaro Madame, je suis interpellée par le titre d’un article intitulé Doria Tillier [‘Miss Météo’ de Canal plus de 2012 à 2014 « un visage marquant de la chaîne payante » [Wikipédia], auteure notamment de : ‘Il m'arrive d'oublier le nom de François Hollande’].
En sus de la manipulation politique - poursuivre, lors d’une campagne électorale, le processus de dévaluation politique de François Hollande - voici les questions, lesquelles, elles-mêmes, renvoyaient à d’autres articles du Figaro Madame, qui furent posées à Doria Tillier :
- « […] Vous en avez une, d'idole professionnelle ? […]
- Vous avez des fans qui hurlent sous vos fenêtres, vous ? […]
- Elle est dans quel état votre mémoire ? […]
- C’est quoi votre complexe physique ?
- Vous avez cet objet [celui qui ‘procure une étincelle de joie’] vanté dans les parages ? […]
- C’est quoi le truc le plus bizarre que vous ayez avalé ? […]
- Quel truc un peu dingue avez-vous fait pour une soirée (d’anniversaire) ? »
- À la relecture, le terme d’ « abêtissement » pourrait être considéré comme insuffisant.
- Les organes de presse (internet inclus), ceux relevant de la presse dite féminine plus spécifiquement, institutionnellement pourrait-on dire, sont des organes de mystification massives, de véritablement foyers de détournements d’intelligences. (À prolonger) (Cf. Femmes. « Féminin ». Intelligentes)
-------------
Femmes (« Abandonnées ») : (9 mars) 2025. Entendu : « Je me suis faite quittée [quitter?] (Cf. Femmes. « Seules », Famille. Couple, Langage. Verbe. Faire)
N.B. Quitter n’est pas synonyme d’abandonner. (Poursuivre)
Femmes. Achat / [Vente] :
Femmes (Achat) (1) : (28 janvier) 2025. J’ai enlevé les guillemets à « Femmes. Achats » et ai ajouté [Vente]. (Cf. Langage. Guillemets)
Un continuum patriarcal : femmes achetées, prises, raptées, asservies, épousées, enfermées, embauchées, louées, salariées, harcelées, prostituées, violées… ?
Par ordre chronologique. Femmes. Achat / [Vente] :
Femmes (Achat) (1) : 1675-1677. Lu dans les Mémoires, rédigées autour de 1662, du cardinal de Retz [1613-1679] :
« Peu après que je fus sorti de collège (en 1625) [le] valet de chambre de mon gouverneur qui était mon tercero [en espagnol : intermédiaire, entremetteur] me trouva chez une misérable épinglière une nièce de 14 ans qui était d’une beauté surprenante. Il l’acheta pour moi cent cinquante pistoles, après me l’avoir fait voir ; il lui loua une petite maison à Issy, il mit sa sœur auprès d’elle ; et j’y allais le lendemain qu’elle y fut logée. Je la trouvais dans un abattement extrême, et je n’en fus point surpris, parce que je l’attribuais à la pudeur. […] »
- La suite : Ayant admiré « son esprit » et « sa vertu », il eut « honte » pour lui-même, la mena chez sa tante « qui la mit dans une religion ou elle mourut huit ou dix ans après, en odeur de sainteté. » 1098 (Cf. Êtres humains. Pudeur, Enfants, Pudeur, Femmes. Beauté. Pudeur, Proxénétisme, Violences. Violences à l’encontre des enfants)
Femmes (Achat) (2) : 1785. Sade [1740-1814], dans Les cent Vingt Journées de Sodome auteur de :
« Une de nos marcheuses [‘racoleuses’ pour les « clients » des bordels], aux aguets d’une jeune fille qu’une de mes pratiques me demandait dans le même goût de celle que m’avait demandée le marquis de Mesanges, c’est à dire à acheter pour n’en jamais entendre parler (c.à.d. pour la tuer, après tortures), une de nos marcheuses, dis-je, vint me rapporter, comme j’étais au lit avec Lucile, qu’elle avait trouvé une petite fille de quinze ans, très sûrement pucelle, extrêmement jolie, et ressemblant disait-elle comme deux gouttes d’eau à mademoiselle Lucile, mais qu’elle était dans un tel état de misère, qu’il faudrait la garder quelques jours pour l’empâter avant de la vendre. […] » 1099 (Cf. Enfants, Femmes. Jeunes filles, Politique. Tortures, Proxénétisme, Violences. Sade. Violences à l’encontre des enfants)
Femmes (Achat) (3) : 1880. Fiodor Dostoïevski [1821-1881], dans Les frères Karamazov, auteur de :
« Nos domestiques, de serfs, étaient quatre, tous achetés au nom d’un propriétaire foncier de nos amis. Je me souviens encore que ma mère [veuve] vendit pour soixante roubles assignats la cuisinière Afimia, boiteuse et vieille et la remplaça par une servante de condition libre. » 1100 (Cf. Êtres humains, Femmes. Servantes, Patriarcat, Politique. Servage)
Par ordre chronologique. Femmes. Achat. Émile Zola :
Femmes (Achat) (4) : 1880. Émile Zola [1840-1902], dans Nana, auteur de :
« On connaissait le banquier [Steiner] pour ses coups de cœur, ce terrible juif allemand, ce brasseur d’affaires, dont les mains fondaient les millions, devenait imbécile lorsqu’il se toquait d’une femme : et il les voulait toutes, il n’en pouvait paraître une au théâtre sans qu’il l’achetât, si chère quelle fut. On citait des sommes. À deux reprises son furieux appétit de filles l’avait ruiné. Comme disait Vandoeuvres, les filles vengeaient la morale, en nettoyant sa caisse. » 1101 (Cf. Êtres humains, Hommes, Économie. Argent, Proxénétisme)
Femmes (Achat) (5) : 1883. Émile Zola [1840-1902], dans Au bonheur des dames, auteur de :
« […] Il [Mouret] songeait qu’il était un des maitres de la fortune publique, qu’il tenait dans ses mains le sort de la fabrication française, et qu’il ne pouvait acheter le baiser d’une de ses vendeuses. » 1102 (Cf. Êtres humains, Femmes. Travail, Relations entre êtres humains, Économie. Salariat)
-------------
Femmes (Achat) (6) : (16 janvier) 1896. Jules Renard [1864-1910], dans son Journal, auteur de : « (Concernant Alfred Capus [1857-1922]) Il a promu son groom au grade de chef de cuisine et ‘acheté’ une jolie petite bonne qui a bien peur de tout ce monde-là. » 1103 (Cf. Femmes. « Bonnes-à-tout-faire ». Peur)
Femmes (Achat) (7) : (12 novembre) 1925. André Gide [1869-1951] écrit dans son Voyage au Congo :
« Cabris et poulets sont objets d’échange. La monnaie encore aujourd’hui, c’est le fer de sagaie qu’il forge lui-même, estimé à cinq francs la pièce. Le cabri vaut de quatre à huit fers de sagaie. On achète une femme indifféremment avec des sagaies ou des cabris (de dix à cinquante fers de sagaie, soit de cinquante à deux cents cinquante francs). […]
Il n’y a dans tout le pays, aucun marché, aucune offre, aucune demande.
D’un bout à l‘autre du village, il n’est pas un indigène qui possède quoi que soit d’autre que ses femmes, son troupeau, et peut être quelques bracelets ou fers de sagaies. » (Cf. Êtres humains, Femmes, « Objets », Famille, Langage. Possessif. Zeugma, Patriarcat. Colonialisme, Politique. Colonialisme, Économie. Marché)
Femmes (Achat) (8) : 1936. Les Troubadours chantent : Avec un peu d’argent, la vie est belle dont voici un couplet :
« Avec un peu d'argent, la vie est belle / On peut s'offrir ce qu'on veut ou ce qu'on n'a pas / On peut même se payer une femme fidèle / Tout aussi facilement qu'un bout d' nougat ».
Femmes (Achat) (9) : (Après) 1941. Un Sicilien pendant la seconde guerre mondiale, après divers ‘méfaits’, se retrouve intégré à la Légion étrangère ; on lui demande simplement d’être ‘un bon soldat français’ à Sidi bel Abbes en Algérie.
Interviewé en 1957, il écrit notamment :
« Nous achetions les femmes au marché arabe algérien pour 47 francs, 52 francs tout au plus [leur paie, dit-il était ‘misérable’, ‘42 francs par jour’]. Les femmes étaient voilées. Il y en avait de belles et il y en avait de laides. Parfois pour savoir si elles étaient bien, nous faisions semblant de nous jeter sur elles avec nos poignards, et nous apercevions vite par leurs regards si elles avaient peur de nous autres légionnaires. Si une femme était laide, les légionnaires la frappaient car c’était de l’argent jeté. Si elles savaient qu’elles étaient laides, elles se refusaient pour ne pas être frappées après. Je m’achetai aussi quelques jeunes filles pour qu’elles lavent mon linge. […]
Nous pouvions acheter des femmes, mais la police de la légion nous empêchait d’aller au bordel.
Le prix le plus bas aux enchères était de 47 francs, mais il pouvait monter jusqu’à 100 francs. J’arrivais, je disais ‘46 francs’, un autre ‘50, 52, etc.’ Le prix montait toujours. On regardait surtout la tournure de la jeune fille. Mais cet argent n’était pas pour elle ; nous le versions aux hommes qui dénichaient les filles. La femme ne touchait rien, car elle trouvait un homme qui la nourrissait, l’habillait et lui donnait même un peu d’argent. Des enfants naissaient ; elles-mêmes en désiraient. Elles étaient âgées de 21 à 35 ans. Pas moins de 21 ans : les filles mineures vont dans les harems. La loi prescrit que celui qui prend une fille mineure doit l’épouser.
L’un de nous achetait une femme, un autre, deux. Elles avaient des toukouls, sorte de huttes de paille et de boue. Le légionnaire devait faire savoir à son commandement où il était logé. Parfois, la nuit, la ronde de la Légion venait voir si on était bien là. À la Légion, nous avions trop de nourriture et nous l’apportions aux femmes. Lorsqu’il fallait partir pour quelque ratissage en plein Sahara, comme on ignorait si l’on reviendrait, on renvoyait les femmes.
Nous parlions français avec elles. Elles n’étaient pas mécontentes de s’en aller parce qu’elles se faisaient acheter à nouveau par des légionnaires qui revenaient. […]
Ceux qui coulaient une vie heureuse au Maroc et en Tunisie se naturalisaient et parfois se mariaient avec une fille qu’ils avaient achetée. » 1104 (Cf. Femmes. Jeunes filles. « Voilées », Patriarcat. Colonialisme, Politique. Colonialisme. État. Guerre, Économie. Marché, Proxénétisme. Personnes-dites-prostituées, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
Femmes (Achat) (11) : 1936. Entendu le 3 janvier 2018 sur Radio courtoisie (radio d’extrême-droite) dans la chanson intitulée Avec un peu d’argent, des Troubadours :
« Avec un peu d'argent, la vie est belle / On peut s'offrir ce qu'on veut ou ce qu'on n'a pas / On peut même se payer une femme fidèle / Tout aussi facilement qu'un bout d'nougat. »
Femmes (Achat) (11) : (1er janvier) 2018. Entendu une archive d’une émission Les mardis de la mémoire (sans date) de l’historien Pierre Chaunu [1923-2009] sur Radio courtoisie (radio d’extrême-droite), au cours de laquelle il se souvenait d’une phrase d’une chanson de l’entre-deux guerres [que je n’ai retrouvée] :
« Je l'achetais à son père grâce à la baisse du dollar. »
Et ce souvenir, remémoré d’un ton fort plaisant… (Cf. Penser. Chaunu Pierre, Histoire. Patriarcale. Chaunu Pierre)
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Accouchements :
Femmes (Accouchements) (1) : 1847. Honoré de Balzac [1799-1850], dans Splendeurs et misères des courtisanes, évoque, dans la bouche d’un médecin, les femmes qui « supportent les tortures de certains accouchements. » 1105
Sans oublier celles, innombrables, qui en sont mortes et qui meurent encore. (Femmes. Comment meurent les femmes, Politique. Tortures)
Femmes (Accouchements) (2) : 1865-1869. Léon Tolstoï [1828-1910], dans La guerre et la paix, auteur de :
- « Marie Bogdanovna, il me semble que c’est commencé, dit Marie, en jetant sur la sage-femme des yeux écarquillés d’effroi.
- Dieu merci, princesse, dit Marie Bogdanovna, sans presser le pas. Mais ce sont là des choses que les jeunes filles doivent ignorer. » (Cf. Corps, Enfants, Femmes. Jeunes filles, Hommes, Famille. Mariage, Sexes […]) 1106
Par ordre chronologique. Femmes. Accouchements. Émile Zola :
Femmes (Accouchements) (3) : 1884. Émile Zola [1840-1902], dans La joie de vivre, auteur de :
« On le savait bien, toujours l’idée qu’un homme l’accoucherait, l’avait révoltée. C’était en elle une pudeur maladive de femme coquette, un malaise de se montrer dans l’abandon affreux de la souffrance, qui, même devant son mari et sa cousine, lui faisait serrer le peignoir autour de ses pauvres reins tordus. » 1107 (Cf. Êtres humains, Corps. Femmes, Femmes. « Coquettes ». Pudeur)
Femmes (Accouchements) (4) : 1884. Émile Zola [1840-1902], dans La joie de vivre, auteur de :
« - Attendons, dit stoïquement madame Bouland [l’accoucheuse]. Je ne puis absolument rien. Il faut laisser faire la nature.
Et même, elle entama une discussion sur le chloroforme, contre lequel elle avait les répugnances de la vieille école. A l’entendre, les accouchées mourraient comme des mouches, entre les mains de médecins qui employaient cette drogue. La douleur était nécessaire, jamais une femme endormie n’était capable d’un aussi bon travail, qu’une femme éveillée. » 1108 (Cf. Femmes. Souffrances)
Femmes (Accouchements) (5) : 1884. Ce sont toutes les pages - remarquables - qu’Émile Zola [1840-1902], dans La joie de vivre, consacre à l’accouchement de Louise qu’il faut lire. 1109
Femmes (Accouchements) (6) : 1887. Émile Zola [1840-1902], dans La terre, auteur de :
« Déjà, la Frimat avait préparé le lit de misère, selon l’usage dans les campagnes : un simple drap jeté au milieu de la pièce, sur une botte de paille, et trois chaises renversées. Lise s’accroupit, s’écartela, adossée à une des chaises, la jambe droite contre la seconde, la gauche contre la troisième. […]
Par terre, Lise, entre trois chaises, était comme parcourue d’une houle, qui lui descendait des flancs, sous la peau, pour aboutir au fond des cuisses, en un élargissement continue des chairs.
[…] Le trou béant s’arrondit encore, à croire que la Frimat, toujours à genoux, allait y disparaitre ; et, d’un coup, comme d’une femme canon, l’enfant sortit tout rouge, avec ses extrémités détrempées et blêmes. On entendit simplement le glouglou d’un goulot géant qui se vidait. […] » 1110
-------------
Femmes (Accouchements) (7) : (octobre) 1926. Paul Claudel [1868-1955], dans son Cahier V, auteur de :
« La dernière guerre. Après chaque accouchement, pas de femme qui ne dise qu’elle n’aura pas d’enfant. » 1111 (Cf. Femmes. Mères, Patriarcat, Politique. Guerre, Économie. Natalité)
Femmes (Accouchements) (8) : 1981. Une femme dit : « l’accouchement que j’ai subi », se reprend un moment, puis précise qu’il s’agit d’elle lorsqu’elle naquit de sa mère. Mais la même formulation aurait pu être employée la concernant, lorsqu’elle donna naissance à son enfant. 1112 (Cf. Langage. Sujet)
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Adultère :
Femmes (Adultère) (1) : 1792. Beaumarchais [1732-1797], dans La mère coupable, auteur de :
« - Le comte : Les misérables femmes en se laissent séduire, ne savent guères les maux qu’elles apportent…Elles vont, elles vont…les affronts s’accumulent… et le monde injuste et léger accuse un père qui se tait, qui dévore en secret ses peines ! On le taxe de dureté, pour les sentiments qu’il refuse au fruit d’un coupable adultère ! Nos désordres, à nous, ne leur enlève presque rien [!] ; ne peuvent du moins leur ravir la certitude d’être mères, ce bien inestimable de la maternité [!] tandis que leur moindre caprice, un goût, une étourderie légère [!], détruit dans l’homme le bonheur…le bonheur de toute sa vie, la sécurité d’être ère. Ah ! ce n’est point légèrement qu’on a donné tant d’importance à la fidélité des femmes ! Le bien, le mal de la société sont attachés à leur conduite ; le paradis ou l’enfer des familles dépend à tout jamais de l’opinion qu’elles ont donné d’elle [!]. » [Acte II. scène III]. Et en note, je lis :
« Cette tirade est à rapprocher du passage supprimé à la représentation du Mariage de Figaro [Acte III. scène XVI] .Voir aussi Notes et réflexions [Paris, Hachette. 1961. p.114, 115], en particulier ce passage : « Le motif de [la ] retenue [des femmes] est l’extrême différence qu’il y a entre le crime [!] de la femme ou de l’homme adultère, relativement au droit des gens, à la justice et à l’ordre social. Comme époux, comme épouse, ils sont également répréhensibles. Comme père ou mère, la différence est énorme, car l’adultère d’une femme enlève à son mari la douceur certaine d’être père, influe sur le père et les enfants, les sépare et fait le malheur de tous, au lieu que l’adultère d’un mari n’ôte pas à la femme la certitude de sa maternité. » 1113 (Cf. Enfants. « Bâtards », Droit. Patriarcal, Femmes. Coupables. Mères, Hommes. Adultère, Irresponsables, Famille, Patriarcat. Pères, Politique. Égalité, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
Femmes (Adultère) (2) : 1830. Stendhal [1783-1842], dans Le rouge et le noir, auteur, concernant madame de Rênal, de :
« Aucune hypocrisie ne venait altérer la pureté de cette âme naïve, égarée par une passion qu’elle n’avait jamais éprouvée. Elle était trompée, mais à son insu, et cependant un instinct de vertu était effrayé. Tels étaient les combats qui l’agitait quand Julien parut au jardin. […]
Madame de Rênal ne put fermer l’œil. Il lui semblait n’avoir pas vécu jusqu’à ce moment. Elle ne pouvait distraire sa pensée du bonheur de sentir Julien couvrir sa main de baisers enflammés. Tout à coup l’affreuse parole : adultère, lui apparut. Tout ce que la plus vile débauche peut imprimer de dégoûtant à l’idée de l’amour des sens se présenta en foule à son imagination. […] Elle se voyait méprisable. Ce moment fut affreux. […] » 1114
Pour la suite, lire le livre… (Cf. Femmes. « Trompées », Hommes. Adultère, Relations entre êtres humains. Baiser. Hypocrisie, Famille. Adultère, Langage. Mots)
Femmes (Adultère) (3) : 1846. Honoré de Balzac [1799-1850], dans La cousine Bette, auteur de :
« […] Tu ne sais pas combien il faut aimer un homme pour imposer silence à ces remords qui viennent vous pincer le cœur d’une femme adultère. » 1115 (Cf. Relations entre êtres humains. Remords)
Femmes (Adultère) (4) : 1857. Gustave Flaubert [1821-1880], dans Madame Bovary, auteur de :
« Emma retrouvait dans l’adultère toutes les platitudes du mariage. » 1116 (Cf. Hommes, Famille. Mariage)
Femmes (Adultère) (5) : 1900. Jules Mary [1851-1922], dans La pocharde, auteur de :
« (Avant de mourir de honte et de chagrin, Clotilde, épouse adultère, demande à son mari de lui pardonner) : « Quand il eut compris - car il lui fallut un effort pour comprendre l’affreuse révélation - il se pencha, les points crispés vers cette agonisante que protégeait (sic) la mort prochaine et il murmura :
- Ah ! la misérable ! Ah ! la misérable créature !
- Oui… je suis une misérable… Tue-moi… Cela me sera très doux… Tue-moi… » 1117 (Cf. Culture. « Mélo », Femmes. Comment meurent les femmes ? Hommes. Violents, Dialogues, Relations entre êtres humains, Violences)
N.B. Jules Mary est ainsi présenté :
« Condisciple de Rimbaud au petit séminaire de Charleville, franc-tireur après Sedan, journaliste, devient très vite un auteur à succès. C’est le principal feuilletoniste des années 1890-1900. Très consciencieux il aborde à peu près tous les genre, romans militaires, de mœurs, dramatiques, d’actualité, judiciaires. Applique quelques recettes naturalistes au roman populaire traditionnel. Une relative sobriété est mise au service du mélodramatique et du judiciaire. Roger la-Honte et La pocharde restent ses titres les plus célèbres. »
Lire aussi sa présentation sur Wikipédia.
Femmes (Adultère) (6) : (février) 1931. Paul Claudel [1868-1955], dans son Cahier VI, auteur de :
« La lapidation de l’adultère. Pour que la main ne touche pas ce qui est impur. »
L’horreur…
- (janvier) 1932. « Pas une pierre dans toute la Russie de l’Oural à la Finlande. Avec quoi lapiderons-nous la femme adultère ?
- Si quelqu’un se trouve pour jeter la première pierre, je réclame la seconde. » 1118
L’horreur…
Femmes (Adultère) (7) : 1971. Ménie Grégoire [1919-2014], dans Les cris de la vie, présentant ses analyses des témoignages de femmes reçues dans son émission de RTL Allo, Ménie, écrit :
« Dans l’autopsie de l’adultère, ce qui éclate, ce n’est pas seulement la culpabilité qu’il entraîne, mais la transformation qu’il opère chez toutes ces vierges-mères. Nous les avons vues liquides, effondrées, molles, cruches cassées de l’intérieur, portant leurs tripes dans la main.
Les voilà brusquement débout, guéries, fortes et triomphantes.
Je ne voudrais pas sembler faire l’éloge de l’adultère, mais je ne puis taire la description clinique de ses miracles. […] » 1119 (Cf. Femmes. Fortes, Famille. Mariage)
Femmes (Adultère) (8) : 1975. Jean-Louis Barrault [1910-1994] se souvient d’une discussion entre lui, son frère et sa mère - « très libre » - en présence de sa grand-mère concernant « l’acte charnel » :
« Ma grand-mère était une sainte femme, distinguée, réservée, sensible. […] De honte, elle rougissait un peu, puis tout à coup, entre deux cliquetis d’aiguilles, elle nous décrocha d’une voix très douce : ‘Eh bien moi, mes enfants ! Si je n’avais pas trompé votre grand-père, je n’aurais jamais joui de ma vie’. Et elle se remit au chandail qu’elle me destinait pour l’hiver. » 1120 (Cf. Femmes. Grands-mères)
-------------
Femmes (Africaines) : (juillet) 2014. La présidente d’un mouvement de femmes Gabonaises, auteure de :
« La condition des femmes sur le continent africain est inadmissible ; ce sont ces femmes-là qui portent ce continent sur leur dos. […] »
Universel, et ce, quels que soient les continents et la nature des régimes politiques. 1121 (Cf. Féminisme. Coordination des femmes africaines, Patriarcat. Colonialisme)
Femmes (Âge) : 2018. Michel Bozon, présenté par Le Monde Diplomatique, comme « directeur de recherche à l’Institut national d’études démographiques (INED), auteur notamment de Pratique de l’amour. Le plaisir et l’inquiétude [Payot. Paris. 2016] », et de :
« [...] C’est un grand changement par rapport aux années 1950 et au début des années 1960 : les jeunes femmes étaient alors tenues de se préserver (sic) pour le mariage, tandis que les hommes pouvaient largement profiter de leur jeunesse (sic) avec des femmes plus âgées ou des prostituées. » 1122 (Cf. Hommes, Patriarcat, Proxénétisme, « Sciences » sociales. Sociologie)
Femmes. Âgées :
Femmes (Âgées) (1) : Les années [me] gagnent et je ne perds pas mon temps.
Femmes (Âgées) (2) : Une femme d’ « âge mûr », une femme « mûre ».
En attendant d’être blette, puis pourrie. Et de ne plus pouvoir être consommée.
Par ordre chronologique. Femmes. Âgées :
Femmes (Âgées) (1) : 1748. Denis Diderot [1713-1784], dans Les bijoux indiscrets, auteur de :
« J’avais dix-huit ans lorsque j’eus le bonheur de vous plaire. Il y a quatre ans que vous m’aime. Dix-huit et quatre font vingt-deux. Me voilà bien vieille. » 1123
Femmes (Âgées) (2) : (10 juin) 1844. Flora Tristan [1803-1844], dans Le tour de France. Journal. 1843-1844, écrit :
« […] Je suis sortie de là fort satisfaite. Tant que le clergé aura de pareils hommes à sa tête nous ne courrons aucun risque : il ne convaincra que les vieilles femmes. » 1124
Femmes (Âgées) (3) : 1865-1869. Léon Tolstoï [1828-1910], dans La guerre et la paix, auteur de :
« (Anna Pavlovna à Hélène) Vous avez besoin de conseils. Ne vous fâchez pas, si j’use de mes droits de vieille femme. - Elle marqua une pause, dans l’espoir d’un compliment, comme le font toutes les femmes lorsqu’elles font allusion à leur âge. » 1125
Femmes (Âgées) (4) : (14 juillet) 1870. George Sand [1804-1876], dans une lettre à Marie-Sophie Leroyer de Chantepie [1800-1888], auteure de :
« La vieillesse n’est pas forcément la décadence intellectuelle. C’est quelquefois tout le contraire. » 1126
N.B. Ne concerne pas que les femmes.
Femmes (Âgées) (5) : (23 juillet) 1871. George Sand [1804-1876], dans une lettre à Gustave Flaubert [1821-1880], auteure de :
« Le jour où j’ai résolument enterré la jeunesse, j’ai rajeuni de vingt ans. » 1127
Femmes (Âgées) (6) : 1936. Louis Aragon [1897-1982], dans Les beaux quartiers, auteur de :
- « Il avait devant lui une femme, pas mal mise, mais déjà ravagée par la quarantaine […]. »
- « Il y avait là toute la violence de la femme qui se sent vieillir et peut être de plus obscurs sentiments. »
- « (à 30 ans) « les seins » d’Yvonne, étaient « déjà flétris ». (Cf. Corps. Seins, Femmes. Beauté)
- « Il y a dans ces mots de feu, de plomb et de rafale, les fureurs de la classe qu’on ne veut pas libérer à cause des années creuses, les fureurs devant la gamelle ignoble et la vioque puante […]. »
- « Est-ce qu’il n’aurait pas dû, tant pis, courir après la vieille putain ? […] pour ce que ça lui coûtait, à elle ! » 1128 (Cf. Corps. Seins, Femmes. Vieillesse, Hommes. Âgés)
Femmes (Âgées) (7) : 1958. Doris Lessing [1919-2013], dans La cité promise. Les enfants de la violence (3), auteure de :
« Elles éprouvaient un sentiment de douloureux étonnement : comme se pouvait-il que du jour au lendemain (ainsi le ressentaient-elles) elles fussent devenues, de personnes responsables et puissantes qu’elles étaient des mendiantes pour obtenir le privilège de faire les courses de leurs petites filles ou de faire travailler son anglais à la nièce d’un cousin pour l’aider à passer le baccalauréat ? » 1129 (Cf. Êtres humains. Privilégiés)
Femmes (Âgées) (8) : 1958. Doris Lessing [1919-2013], dans La cité promise. Les enfants de la violence (3), auteure de :
« On l’avait forcée à devenir vieille : on l’avait mêlée de force à ce groupe de vieille poules caquetantes, avec qui elle n’avait rien de commun : on la forçait à jouer au bridge et à s’asseoir à l’abri du vent, à tricoter et à chercher l’évasion dans le sommeil parce qu’elle n’avait rien à faire. » 1130 (Cf. Femmes. Animalisation des femmes. Tricot)
Femmes (Âgées) (9) : 1967. Serge Reggiani [1922-2004] chante Sarah, écrite par George Moustaki [1934-2013], qui débute par :
« (Parlé) Si vous la rencontrez, bizarrement parée, traînant dans le ruisseau, un talon déchaussé et la tête et l’œil bas comme un pigeon blessé, Messieurs, ne crachez pas de jurons ni d’ordures au visage fardé de cette pauvre impure que déesse famine, a, par un soir d’hiver, contraint à relever ses jupons en plein air ; cette bohème-là, c’est mon bien, ma richesse, ma perle, mon bijou, ma reine, ma duchesse. » [Baudelaire]
(Puis chanté) :
« La femme qui Est dans mon lit N'a plus 20 ans Depuis longtemps.
Les yeux cernés, Par les années, Par les amours, Au jour le jour, La bouche usée, Par les baisers, Trop souvent, mais, Trop mal donnés, Le teint blafard, Malgré le fard, Plus pâle qu'une Tâche de lune.
La femme qui Est dans mon lit N'a plus 20 ans Depuis longtemps.
Les seins si lourds De trop d'amour Ne portent pas Le nom d'appas. Le corps lassé, Trop caressé, Trop souvent, mais, Trop mal aimé. Le dos voûté Semble porter, Des souvenirs Qu'elle a dû fuir.
La femme qui Est dans mon lit N'a plus 20 ans Depuis longtemps.
Ne riez pas, N'y touchez pas, Gardez vos larmes Et vos sarcasmes. Lorsque la nuit Nous réunit, Son corps, ses mains, S'offrent aux miens. Et c'est son cœur, Couvert de pleurs Et de blessures, Qui me rassure. »
Femmes (Âgées) (10) : 1971. Simone de Beauvoir [1908-1986] concernant sa mère, alors âgée de 76 ans, dans Une mort si douce, écrit :
« Malgré son infirmité, ma mère était solide. Et, somme toute, elle avait l’âge de mourir. »
La fin du livre est une remise en cause de ce « cliché ». 1131
Femmes (Âgées) (11) : 1980. Marguerite Yourcenar [1903-1987], dans Les yeux ouverts, auteure de :
« Je ne me sens d’aucun âge. » 1132
Femmes (Âgées) (12) : Écouter Grand-mère d’Anne Sylvestre [1934-2020], celle qui « est morte cette nuit », « d’ennui », et dont voici le premier couplet :
« Grand-mère, Grand-mère / Vous êtes morte cette nuit / Grand-mère, Grand-mère / Vous êtes morte d'ennui / Vous êtes morte d'ennui /
Dans votre intérieur modèle / Entre vos nappes brodées / Vos napperons de dentelle / Vous avez capitulé / Du haut de leurs étagères / Vos confitures en pot / Vos terrines, vos tourtières / Ont enfin eu votre peau. » (Cf. Femmes. Grands-mères)
Femmes (Âgées) (13) : (6 juin) 2025. Entendu une infirmière psychiatrique dire que les femmes âgées dans le pavillon de l’hôpital ou elle travaillait étaient nommées : « les gâteuses ».
-------------
Femmes (Agricultrices) : (8 mars) 2025. Vu sur la chaîne LCP. Assemblée nationale. DébatDoc, le film remarquable, bien qu’insuffisant, comme la place que je leur accorde (actuellement) :
« Agricultrice : le long chemin de l’émancipation ». (Cf. Femmes. Remarquables)
Femmes. Aiguilles :
Femmes (Aiguilles) (1) : 1878. Friedrich Nietzsche [1844-1900], dans Humain, trop humain, auteur de :
« […] Les femmes, au contraire, parlent comme des êtres qui, durant des siècles, furent assises au métier à tisser ou tirèrent l’aiguille ou firent l’enfant avec les enfants. » 1133 (Cf. Femmes. Mères, Patriarcat)
Femmes (Aiguilles) (2) : 1931. Gina Lombroso [1872-1944], [qui se qualifie d’ « antiféministe convaincue » mais néanmoins, de ce fait, fort intéressante], auteure dans La femme aux prises avec la vie, traduit de l’Italien :
- « L’aiguille (et je comprends dans ce mot, le crochet, les aiguilles à tricoter, la navette et tous les instruments propres à réaliser l’antique travail féminin) l’aiguille est la gloire de la femme, son invention la plus importante. […]
- L’aiguille est le moyen le plus simple que la civilisation ait inventé pour faire une œuvre complète par elle-même, utilisable à l’instant même. […]
- Le maniement de l’aiguille est une immense supériorité que la femme possède sur l’homme. […]
- Avec elle, la femme peut calmer les angoisses les plus torturantes et transformer parfois la douleur en une magnifique œuvre d’art. » […] 1134
Nous sommes toutes, qu’elle qu’ait été notre éducation, avec ou sans aiguilles, peu ou prou les filles de ces assignations à « l’aiguille » … (Cf. Femmes. « Féminin ». Faire-valoir. Tricot, Féminismes. Antiféminisme)
-------------
Femmes (Aimables) : (27 novembre) 1793. Isabelle de Charrière [1740-1805] écrit à Benjamin Constant [1767-1830] :
« J’ai reçu ce soir une lettre de Mme de Staël [1768-1817]. Elle m’étonne presque à chaque phrase par un mélange d’amabilité et quelque chose qui gâte cette amabilité. » 1135
Femmes (Allaitement) : 1939. Lu dans Le guide de la jeune mère [1939. 2ème édition, la première datant de 1937. 150ème mille] :
- « Le lait de la mère est le seul qui conviennent à l’enfant (en italique). […]
- Il meurt trois ou quatre fois plus d’enfants au biberon que d’enfants au sein (en italique). Tous ceux qui s’occupent des tous petits reconnaissant que la première cause de mortalité du premier âge est l’abandon du lait maternel (en gras). […]
- Trop de mères ne se rendent pas compte du tort fait au nourrisson. […]
- Parmi les femmes bien portantes, il en est peu qui n’aient pas assez de lait pour nourrir leur enfant (en gras). […]
- Toutes les mères devraient comprendre le devoir d’allaiter leur enfant (en gras). […]
- Toute accouchée bien portante peut et doit allaiter (en italique). […]
- Il faut qu’elles comprennent ce grand devoir de l’allaitement, qu’elles aient plaisir et fierté à l’accomplir. »
Et enfin, concernant « l’aide sociale aux jeunes mères » :
- « Si, pour des raisons d’ordre médical, la femme est dans l’impossibilité d’allaiter son enfant, elle peut recevoir des bons de lait, dont la valeur ne peut dépasser 60 % de la Prime d’Allaitement. » 1136 (Cf. Femmes. Nourrices)
Par ordre chronologique. Femmes. Alcoolisme :
Femmes (Alcoolisme) (1) : 1802. Mary Robinson [1758-1800], dans les Mémoires de Mistriss Robinson, auteure de :
« Je me rappelle qu’un jour elle me parla du vice qui dégrade encore plus les femmes que les hommes ; mais son excuse pour s’y adonner était l’abandon qu’elle avait éprouvé d’un amour chéri, et elle me déclara, avec regret, qu’elle ne s’y était livrée que pour se consoler de sa perte, et qu’effectivement, elle avait moins ressenti depuis cette époque, les regrets qui l’accablaient. » 1137
Femmes (Alcoolisme) (2) : 1975. Marie Cardinal [1928-2001], dans Les mots pour le dire, auteure de :
« Je n’en pouvais plus. En sortant de ces séances (de psychanalyse), j’allais me soûler la gueule, me soûler à mort. Quand une femme emploi l’expression ‘se soûler la gueule’, ça fait vulgaire et bas, pour un homme, c’est moins vulgaire et ça sonne fort et triste. Une femme, ça se grise, ça s’enivre, au pire, ça boit. Je refuse d’employer ces mièvreries hypocrites. Je me soûlais : je me détruisais, je me perdais, je me méprisais, je me haïssais.
C’est que je n’avais plus aucune prise sur moi-même. J’étais personne. Je n’avais pas de désir, pas de volonté, pas de goût, pas de dégoût. J’avais été entièrement façonnée pour ressembler à un modèle humain que je n’avais pas choisi et qui ne me convenait pas.
Jour après jour, depuis ma naissance, on avait fabriqué : mes gestes, mes attitudes, mon vocabulaire.
On avait réprimé mes besoins, mes envies, mes élans, on les avait endigués, maquillés, déguisées, emprisonnés.
Après m’avoir décervelée, après avoir vidé mon crâne de moi, on l’avait bourré de la pensée adéquate qui m’allait comme un tablier à une vache. […] » 1138 (Cf. Êtres humains. Soi, Femmes. Remarquables. Cardinal Marie, Langage, « Sciences » sociales. Psychanalyse)
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Algériennes :
Femmes (Algériennes) (1) : Combien de femmes Algériennes ont-elles été violées par les Français pendant les 130 années de la colonisation de l’Algérie, et plus particulièrement pendant la guerre d’Algérie ? Combien d’entre elles ont-elles été prostituées dans les bordels d’Alger, Oran, Constantine et autres, sans oublier ceux de la Légion étrangère, ainsi que les BMC [Bordels militaires de campagne] généreusement « approvisionnés », notamment dans l’Indochine coloniale, par l’armée française en femmes algériennes ?
- Quel silence ! Quand sera-t-il enfin brisé ?
* Ajout. 5 novembre 2014. 2014. Si vous voulez maintenir cette chape de plomb, organisez un colloque : Cf. notamment « La Guerre d’Algérie, le sexe et l’effroi », le 9 et 10 octobre 2014, organisé à la BNF-François Mitterrand et à l’Institut du Monde Arabe. 1139 (Cf. Femmes. Silence, Violées, Patriarcat. Colonialisme, Politique. Colonialisme. Nationalisme. Guerre. Algérie, Proxénétisme. Bordels, Histoire, Violences. Viols. Violences à l’encontre des femmes)
* Ajout. 22/ 23 septembre 2019. Gisèle Halimi [1927-2020], dans Le Monde évoque, concernant la « justice » française pendant la guerre d’Algérie « les viols systématiques des militantes arrêtées ». 1140 (Cf. Justice. Coloniale, Patriarcat. Colonialisme, Politique. Colonialisme. Nationalisme. Guerre. Algérie, Histoire, Violences. Viols. Violences à l’encontre des femmes)
* Aout. 19 novembre 2023. Ai lu le Journal de Mouloud Faraoun [1213-2023], dans lequel, entre autres remarquables analyses, j’y ai lu ce que j’ai lu de plus justes, de plus vraies constats - qui sont autant d’analyses - concernant l’évolution du rôle, du statut, des fonctions des femmes Algériennes du fait de la guerre. Concernant les viols, les violences à leur encontre du fait des hommes de l’armée française, des hommes du FLN : (Cf. Violences. Violences à l’encontre des femmes)
Femmes (Algériennes) (2) : (4 juillet) 1962. Dans le cadre d’un film consacré aux Français-es resté-es en Algérie après l’indépendance, un Dominicain raconte, qu’en tenue de moine, le jour de l’indépendance, à pied, heureux de l’évènement, il est doublé par un camion dans lequel plusieurs femmes, en liesse, lui font « un bras d’honneur ». « Les écailles me sont tombées des yeux » raconte-t-il honnêtement. 1141
Femmes (Algériennes) (3) : 1982. Concernant la lutte des femmes algériennes contre le code de la famille, cf. http://www.marievictoirelouis.net/document.php?id=399&themeid=397
* Ajout. 16 novembre 2022. 1995. Lire le chapitre 5, Code de la famille, code de l’infamie du livre de Khalida Messaoudi, Une algérienne debout. 1142
Femmes (Algériennes) (4) : (21, 22 juin) 2019. Une vingtaine de collectifs et d’associations féministes avec la participation de 50 femmes réunies à Tighremt à Bejaïa les 21, 22 juin 2019 ont adopté la déclaration suivante :
« Nous femmes et Algériennes, avons conscience d’appartenir à̀ une longue histoire de femmes, qui ont permis à̀ l’Algérie d’exister à travers les siècles et les vicissitudes de l’histoire. Le combat que nous menons et qui dure depuis des décennies, ne saurait cesser sans que nous ayons accès à tous nos droits.
Le mouvement populaire du 22 février a surpris l’ensemble des Algériennes et des Algériens par son immensité́, sa diversité́ et son intelligence collective. Il a grandi, évolué d’un vendredi à l’autre et rejeté́ les tentatives de récupération et de division opérées par le régime en réponse à ses revendications. La présence massive des femmes dans les marches a étonné́ ceux qui n’avaient pas enregistré́ notre progression dans la vie publique. Présence qui en elle-même est une avancée dans notre combat. Au cours de ce mouvement, de multiples collectifs et associations de femmes se sont mobilisés, d’autres sont nés partout sur le territoire national pour exprimer notre vision d’une Algérie nouvelle, démocratique et plurielle. Une Algérie qui prenne en compte nos préoccupations, notre exigence de dignité́ et d’émancipation et notre revendication d’Egalité. En un mot pour dire notre féminisme.
Les revendications féministes portées dans le Hirak [mouvement populaire] ont réveillé́ des résistances rétrogrades et provoqué des agressions et des intimidations à notre encontre, cependant la mobilisation des femmes n’en a été́ que plus forte. C’est pourquoi, nous, femmes représentantes de 17 associations et collectifs de femmes ainsi que des indépendantes, de plusieurs wilayas, nous nous sommes réunies du 20 au 22 juin 2019 à Tighremt, afin de nous mobiliser en tant que force politique féministe et autonome pour contribuer à l’avènement d’une nouvelle république basée sur la justice sociale pour toutes et tous et contre toute forme de discrimination.
Nous revendiquons l’égalité́ entre les sexes, à laquelle se réfèrent les constitutions algériennes successives, qui doit permettre aux femmes d’avoir accès aux mêmes droits que les hommes, sur les plans politique, civil, économique, culturel, personnel, social et juridique, sans discrimination aucune. Cette égalité́ implique de mettre un terme aux violences physiques, économiques, sexuelles, psychologiques et symboliques contre les femmes, l’abrogation du code de la famille et une participation libre et effective des femmes dans toutes les sphères de la société́.
Aussi, les luttes que nous menons depuis des décennies, ont permis des acquis qui aujourd’hui doivent trouver une application réelle et une transcription effective dans le droit à̀ une égalité́ citoyenne pleine et entière. Nous avons donc décidé́ de faire entendre nos voix et d’inscrire nos revendications dans ce qui se joue aujourd’hui du point de vue de l’exigence démocratique.
Nous n’accorderons notre soutien à nulle force qui nous ignorera. Nous appelons toutes les femmes et groupes de femmes à se joindre à̀ cette mobilisation. » 1143 (Cf. Famille. Code de la famille, Penser, Politique. Luttes de femmes)
-------------
Femmes (Alibis) : Femmes « alibis », mais femmes réelles.
N.B. « Alibi » : « Circonstance, activité qui cache et justifie autre chose »
Femmes. Aliénées :
Femmes (Aliénées) (1) : Il y a des femmes qui :
- attendent, sagement, le retour d’un mari ‘volage‘,
- espèrent attirer l’attention d’un ‘libertin’,
- se satisfassent de ne pas être ‘battues’,
- quémandent qu'on leur ‘fasse l’amour’,
- font ‘bonne figure’ lorsque humiliées en public,
- accouchent d’enfants qu’elles n’ont pas voulu voir vivre,
- abandonnent leurs études, travaillent jeunes pour que leur conjoint, leur frère puissent faire des études,
- injurient les maîtresses de leur mari,
- se cachent pour pouvoir faire ce dont elles ont envie, besoin,
- doivent se contenter de l’argent qui leur est ‘donné’ chaque semaine et rendre compte de leur bon usage,
- n’osent demander ce que leur mari ont fait de leur dot, leur héritage, leurs propres revenus,
- se contentent d’une ridicule pension alimentaire, tant elles sont ravies d’espérer être débarrassés de leur maris,
- acceptent de se cacher pour que leur liaison ne soit pas connue des collègues, ami-es, enfants, épouse de leur amant ,
- vantent, car elles (seules) les connaissant bien, les qualités de leur amis, patrons…, (Poursuivre)
Par ordre chronologique. Femmes. Aliénées :
Femmes (Aliénées) (1) : 1667. Andromaque dans Andromaque de Jean Racine [1639-1699] :
« Je t’aimais inconstant ; qu’aurai-je fait fidèle ?
Et même en ce moment où ta bouche cruelle
Vient si tranquillement m’annoncer le trépas
Ingrat, je doute encore si je ne t’aime pas » [Acte IV. Scène V]
N.B. « Aliénation » : « Transmission qu’une personne fait d’une propriété ou d’un droit. »
Femmes (Aliénées) (2) : 1859. Léon Tolstoï [1828-1910], dans Le bonheur conjugal, auteur de :
« Écoute ! dis-je en effleurant sa main pour qu’il tourne les yeux vers moi. Écoute : pourquoi ne m’as-tu jamais dit que tu voulais que je vive exactement comme tu le désirais, pourquoi m’as-tu laissé une liberté dont je n’ai pas su user ? pourquoi as-tu cessé de me conseiller ? Si tu avais voulu, si tu m’avais dirigé autrement, il ne me serait rien, rien arrivé, dis-je d’une voix qui exprimait de plus en plus le reproche, un froid dépit et non l’ancien amour. » 1144
-------------
Femmes. Amants :
Femmes (Amants) (1) : Avoir ‘eu’ suffisamment d’amants pour ne pas regretter de ne pas en avoir ‘eu’ plus ?
Femmes (Amants) (2) : Du fait des relations qu’elle voulait avoir avec son amant (certes, intermittent), la première fois qu’il évoqua son épouse, elle lui fit comprendre, sans même aborder la question en elle-même, que cela ne la concernait en rien et que cette référence serait la seule. Il se le tint pour dit. Et ce fut très bien ainsi.
Femmes (Amants) (3) : Non seulement, l’histoire patriarcale a défini les femmes par, enfouit les femmes sous leurs amants, mais elle a eu une fâcheuse tendance, la suspicion faisant office de preuve, à en multiplier le nombre.
Femmes (Amants) (4) : Pourquoi, généralement, pour une femme, un amant rencontré, connu sur un site est-il jugé de moindre valeur [qu’un autre] ?
Femmes (Amants) (5) : Évoquer ses « amants » - réels ou non - suffisait, pensait-elle, ou du moins, espérait-elle - la ranger dans le camp des « femmes libres », sans trop chercher à comprendre ce que ces termes signifaient.
Par ordre chronologique. Femmes. Amants :
Femmes (Amants) (1) : 1773. Denis Diderot [1713-1784], dans Ceci n’est pas un conte, auteur de :
« Elle ne regretta ni sa fortune dissipée, ni son honneur flétri. Son amant lui tenait lieu de tout. » 1145
Femmes (Amants) (2) : 1842. Honoré de Balzac [1799-1850], dans La femme de trente ans, auteur de :
« Cependant elle s’était déjà demandé pourquoi résister à un amant aimé, quand elle se donnait, contre son cœur et contre le vœu de la nature, à un mari qu’elle n’aimait plus. » 1146
Femmes (Amants) (3) : 1865-1899. Léon Tolstoï [1828-1911], dans La guerre et la paix, auteur de :
« (Hélène à Pierre, son mari) Je vous le dis tout franc, avec un mari tel que vous, quelle femme n’aurait pas pris des amants ?
Et pourtant, je ne l’ai, pas fait. » 1147
Par ordre chronologique. Femmes. Amants. Émile Zola :
Femmes (Amants) (4) : 1871. Émile Zola [1840-1902], dans La curée, auteur de :
« Ses premiers amants ne l’avaient pas gâtée ; trois fois elle s’était prise d’une grande passion ; l’amour éclatait dans sa tête comme un pétard, dont les étincelles n’allaient pas jusqu’au cœur ; puis, un matin, au milieu du tapage de sa tendresse, elle sentait un silence écrasant, un vide immense. Le premier [était] absolument nul, déteint, assommant », le second « faillit la battre », le troisième fut « un bel homme vaniteux », le quatrième, « l’être le plus insignifiant au monde » […] ; elle ne sut jamais comment elle s’était livrée à lui, et le garda longtemps, prise de paresse, dégoûtée d’un inconnu qu’on découvre en un heure, attendant, pour se donner les soucis d’un changement, de rencontrer quelque aventure extraordinaire. À vingt-huit ans, elle était déjà horriblement lasse. » 1148
Femmes (Amants) (5) : 1876. Émile Zola [1840-1902], dans Son excellence Eugène Rougon auteur de :
« Quand on parlait de quelque femme dont on ne comptait plus les amants, elle ouvrait de grands yeux d’enfant, des yeux surpris, en demandant : ‘Ça l’amuse donc ?’. » 1149
Femmes (Amants) (6) : 1877. Émile Zola [1840-1902], dans L’Assommoir, auteur de :
« […] Cependant Gervaise vivait tranquille de ce côté, ne pensant guère à ces ordures. […] Madame Lerat, qui adorait se fourrer enter les amoureux venait tous les soirs ; et elle traitait Lantier d’homme irrésistible, dans les bras duquel les femmes les plus huppées devaient tomber. Madame Boche n’aurait pas répondu de sa vertu, si elle avait dix ans de moins. Une conspiration sourde, continue, grandissait, poussait lentement Gervaise, comme si toutes les femmes, autour d’elle, avaient dû se satisfaire en lui donnant un amant. » 1150
Femmes (Amants) (7) : 1883. Émile Zola [1840-1902], dans Au bonheur des dames, auteur de :
« L’amant lui faisait peur, cette peur folle qui blêmit la femme à l’approche du mâle. » 1151
-------------
Femmes (Amants) (8) : 1935. Fréhel [1891-1951] auteure, bouleversante de :
« Où sont tous mes amants. Tous ceux qui m’aimaient tant / Jadis que j’étais belle… »
* Ajout. 11 juin 2024. Chanté aussi par Berthe Sylva [1885-1941] (Cf. Femmes. Chanteuses françaises d’antan)
Femmes (Amants) (9) : 1946. János Székely [1901-1958], dans L’enfant du Danube, auteur de :
« Cette escapade nocturne devint, paraît-il un grand amour passionnel. Certain assurent que l’instituteur aurait voulu épouser la comtesse, mais qu’elle ne désirait nullement renoncer à un titre et à trente mille arpents pour devenir la femme d’un misérable petit magister de village. Sa seigneurie pratiquait la division du travail ; elle conservait le comte comme époux et assignait à l’instituteur certaines autres fonctions dont il devait s’acquitter à son entière satisfaction, puisque, désormais, on les vit souvent ensemble ; la comtesse, apparemment, essayait de convaincre le rebelle de toute la générosité des classes aristocratiques. » 1152
Femmes (Amants) (10) : 1958. Doris Lessing [1919-2013], dans La cité promise. Les enfants de la violence (3), auteure de :
« […] Martha avait donc gagné le camp de ces femmes qui ont des liaisons parce que les hommes ont cessé de représenter l’exploration de possibilités inconnues. » 1153
Femmes (Amants) (11) : 2018. Elena Ferrante dans L’enfant perdue, auteure de :
« Je vis bien vite - dans ses yeux et ses paroles - que ce qui le désespérait, ce n’était pas d’avoir perdu mon amour ; mais que je sois allée avec d’autres hommes et la perspective que tôt ou tard, j’irai encore avec d’autres, et que je les préférerais à lui. Ce matin-là, il était réapparu uniquement pour retourner dans mon lit. Il exigeait que je dénigre mes amants récents, ce qui lui apporterait la preuve que mon seul désir était d’être à nouveau pénétrée par lui. Bref, il voulait réaffirmer sa primauté, ensuite il disparaitrait certainement encore. Je parvins à lui faire rendre les clés et le chassai. Je réalisai alors, avec surprise, que je n’éprouvais plus rien pour lui. La très longue époque de mon amour toucha définitivement sa fin ce matin-là. » 1154 (Cf. Relations entre êtres humains. Amour. « Faire l’amour », Hommes. Concurrence entre hommes)
-------------
Femmes (Ambition) : Une aspiration récente.
* Ajout. 14 juillet 2022. Démocratisée…
Femmes. Amies :
Femmes (Amies) (1) : Une définition simple : se faire mutuellement du bien…
Femmes (Amies) (2) : Elle était tout à la fois, comme tant de femmes, forte mais aussi dépendante, dominée par son mari, dont elle avait abandonné tout espoir de le quitter. Ce dernier eut pour maîtresse son amie. Il fit tout, efficacement, grossièrement, pour les séparer. En l’humiliant, c’était les deux femmes qu’il cherchait à atteindre. Elles se virent cependant, sans lui, et parlèrent. Mais, même absent, le mari faisait écran entre elles. À terme, cela ne fut plus possible. Elle demeura une amie… absente.
Par ordre chronologique. Femmes. Amies :
Femmes (Amies) (1) : 1958. Colette [1873-1954], dans ses Lettres à Hélène Picard [1873-1954], poétesse, son amie, lui rendit - ainsi qu’à l’amitié …- un bel hommage :
« […] Elle meurt et je pense à elle. Combien d’amies ont passé, que je puisse nommer amies ? Bien peu. Dieu merci, bien peu. Sinon, à la rareté du joyau, comment mesurerait-on l’amitié ? » 1155 (Cf. Femmes. Remarquables. Colette)
-------------
Femmes. Amoureuses :
Femmes (Amoureuses) (1) : Le nombre de femmes remarquables, d’une manière ou d’une autre, amoureuses d’un type minable que nous offrent le cinéma, la littérature, la presse est incommensurable. (Cf. Culture. Cinéma. Shanghai Express)
* Ajout. 19 avril 2017. À la relecture, j’ai oublié : la vie !
Par ordre chronologique. Femmes. Amoureuses :
Femmes (Amoureuses) (1) : (8 avril) 1794. Isabelle de Charrière [1740-1805] écrit à Benjamin Constant [1767-1830] :
« Deux mois. Vous me proposez de revenir dans deux mois. Puisse la chose dépendre de vous, en ce cas, elle sera, car vous n’êtes guère plus à votre place loin de moi, que moi je ne suis bien sans vous. […] Revenez : personne ne vous aime autant, ni vous apprécie ou ne vous prise si haut, ni si juste que moi ; et si je meurs, aussi longtemps avant vous que cela doit naturellement être, alors vous prendrez d’autres habitudes et il est inutile de les prendre d’avance. »
- Ce à quoi Benjamin Constant lui répond le 21 avril 1794 :
« Vous savez que nous nous convenons autant que je vous aime. » 1156
-------------
Femmes (Anarchistes individualistes) : 2008. Concernant les « femmes anarchistes individualistes », se référer à l’article d’Anne Steiner :
« Les militantes anarchistes individualistes ; des femmes libres à la Belle époque. 1157 (Cf. Politique. Anarchisme)
Par ordre chronologique. Femmes. « Anciennes » :
Femmes (« Anciennes ») (1) : 1989. Jules Roy [1907-2000], dans Mémoires barbares, auteur de :
« (concernant Joseph Kessel) Son ancienne femme, il l’avait mieux installée que la mienne, il allait régulièrement la voir, pleurant avec elle en bon Russe qu’il était et lui glissant tout l’argent qu’elle voulait. » 1158 (Cf. Langage. Possessif)
N.B. « Ancien » : « 1) Qui existe depuis longtemps, qui date d'une époque bien antérieure : Acheter un meuble ancien chez un antiquaire Synonymes : antique, vieux, nom Aimer l'ancien ; les objets anciens. 2) Qui est du passé et n'existe plus. Les langues anciennes. »
Femmes (« Anciennes ») (2) : (14 novembre) 2020. Lu dans Gala :
« À l’occasion de l’anniversaire de Dominique de Villepin, découvrez ce que devient son ancienne femme et mère de ses trois enfants. » (Cf. Famille, Patriarcat. Pères)
Femmes (« Anciennes ») (3) : (30 décembre) 2022. Lu dans Mondafrique, concernant Carlos Ghosn :
« ‘Avec son ancienne femme, il faisait profil bas, mais avec Carole, c’est autre chose. Il a connu le goût de la vie, on va dire’, confie une connaissance. » 1159 (Cf. Famille. Couple)
-------------
Femmes (« Au minimum ») : (5 janvier) 2018. Anastasia Colosimo, politologue, auteure de :
« Bertrand Cantat, qui a tué une femme, au minimum, fait la Une des Inrockuptibles, et… » 1160 (Cf. Êtres humains, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
Par ordre chronologique. Femmes. Animalisation des femmes :
Femmes. Animalisation des femmes (1) : (1) : 413-323 avant J-C, Diogène apercevant des femmes qui bavardaient ensemble, eut ce mot :
« L’aspic emprunte son poison à la vipère » et, voyant une femme s’entendant avec une autre, dit : « Le scorpion se procure un poison chez l’araignée ! ». 1161 (Cf. « Sciences » sociales. Philosophie)
Femmes (Animalisation des femmes) (2) : (9 août) 1684. Bossuet [1627-1704], dans l’Oraison funèbre d’Anne de Gonzague, princesse palatine [1616-1684], auteur de :
« […] Elle voit paraître ce que Jésus-Christ n’a pas dédaigné de nous donner comme l’image de la tendresse, une poule devenu mère, empressée autour des petits qu’elle conduisait. » Et cette note des Misérables de Victor Hugo de La Pléiade où je lis ce passage de Bossuet, cite Saint Mathieu [XXIII, 37] dont il se serait inspiré :
« Jérusalem […] combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. » 1162 (Cf. Femmes. Mères)
Femmes (Animalisation des femmes) (3) : 1688. Jean de La Bruyère [1645-1696], dans Les caractères - Des femmes - auteur de :
« Il faut juger les femmes depuis la chaussure jusqu’à la coiffure exclusivement à peu près comme on mesure le poisson entre queue et tête. » 1163
Femmes (Animalisation des femmes) (4) : 1724. Daniel Defoe [1660-1731], dans La maîtresse fortunée […] Lady Roxane, auteur de :
« J’étais (à l’âge de quatorze ans environ) grande et fort bien faite, vive comme l’épervier en matière de connaissances usuelles, preste et fine […]. » 1164
Par ordre chronologique. Femmes. Animalisation des femmes. Voltaire :
Femmes (Animalisation des femmes) (5) : (juin) 1739. Voltaire [1694-1778], dans une lettre adressée à madame de Champbonin [1700-1775], auteur de :
« Mon cher gros chat, je baise mille fois vos pattes de velours. Adieu, ma chère amie. » 1165
Femmes (Animalisation des femmes) (6) : (7 mai) 1759. Voltaire [1694-1778], dans une lettre adressée à Jean-Robert Tronchin [1710-1793], gestionnaire de ses intérêts, écrit :
« Je choisis mes juments comme on doit choisir sa femme, ni trop belle, ni trop laide, mais capable de faire des enfants ; et je veux que mes juments en fassent puisque mes servantes n’en font point ; si donc vous trouvez deux créatures convenables à mon sérail, noires et jeunes comme la maîtresse de Salomon, vous me ferez grand plaisir de me les envoyer à votre aise, à votre loisir, surtout si elles ne sont pas extrêmement chères. » 1166 (Cf. Femmes. « Créatures ». Servantes, Hommes. Grossiers, Famille, Langage. Possessif, Patriarcat, Politique. Animalisation du monde)
* Ajout. 26 novembre 2021. Revoir la-dite philosophie des Lumières à l’aune de si nécessaires critiques féministes. (Cf. Féminismes, « Sciences » sociales. Philosophie)
Femmes (Animalisation des femmes) (7) : (20 septembre) 1760. Voltaire [1694-1778], dans une lettre adressée au comte [1700-1788] et à la comtesse d’Argental [1703-1774], écrit :
« Il faudrait que Mme de Pompadour [1721-1764] fut une grande poule mouillée pour craindre une fière dédicace [de lui]. » 1167
-------------
Femmes (Animalisation des femmes) (8) : 1774. Denis Diderot [1713-1784], dans sa Réfutation d’Helvétius [1715-1771], qui avait écrit :
« Les seules affections dont l’influence sur les esprits soit sensible, sont les affections dépendantes de l’éducation et des préjugés », [lui] répond :
« Je ne crois pas qu’il soit possible de rien dire de plus absurde. Quoi donc ! Est-ce l’éducation et le préjugé seuls qui rendent en général les femmes craintives et pusillanimes ; ou la conscience de leur faiblesse, conscience qui leur est commune avec tous les animaux délicats ; conscience qui met l’un en fuite au moindre bruit, et arrête l’autre fièrement à l’aspect du péril et de l’ennemi ? » 1168
N.B. La fin de l’argumentaire est peu claire… ou contradictoire ? …
Par ordre chronologique. Femmes. Animalisation. Honoré de Balzac :
Femmes (Animalisation des femmes) (9) : 1837-1843. Honoré de Balzac [1799-1850], dans les Illusions perdues, auteur notamment de :
- « Coralie fut déshabillée en un moment, et se coula comme une couleuvre auprès de Lucien. »
- « Eh bien, ce sourire paye tout, répondit-elle en apportant par un mouvement de serpent ses lèvres aux lèvres de Lucien. »
- « Quant à ce que ces dames peuvent penser de moi, vous allez voir comment je vais me conduire pour glacer le venin sur leurs langues. »
- « Il était impossible de ne pas comparer cet avoué maigrelet, serré dans ses habits, à une vipère gelée […]. » 1169
Femmes (Animalisation des femmes) (10) : 1841. Honoré de Balzac [1799-1850], dans Mémoires de deux jeunes mariées, auteur de :
« Ne vous tourmentez pas, ma chère, m’a dit m’a dit ma mère qui s’est constituée ma garde [à sa fille qui venait d’accoucher], vous avez fait le plus bel enfant du monde. Évitez de vous troubler l’imagination, il vous faut mettre tout votre esprit à devenir bête, à vous faire exactement la vache qui broute pour avoir du lait. » 1170
Femmes (Animalisation des femmes) (11) : 1842. Honoré de Balzac [1799-1850], dans La femme de trente ans, auteur de :
- « Ce charme de l’amour s’est évanoui en 1789 ! Notre ennui, nos mœurs fades sont le résultat du système politique. Au moins, en Italie, tout y est tranché. Les femmes y sont encore des animaux malfaisants, des sirènes dangereuses, sans raison, sans logique autre que celle de leurs goûts, de leurs appétits, et des quelles il faut se méfier comme on se défie des tigres… »
- « Son cou était un peu long peut être ; mais ces sortes de cous sont les plus gracieux, et donnent aux têtes de femmes de vagues affinités avec les magnétiques ondulations de serpent. » 1171 (Cf. Culture. « Mélo », Corps, Femmes. Françaises)
Femmes (Animalisation des femmes) (13) : 1846. Honoré de Balzac [1799-1850], dans La cousine Bette, auteur de :
« […] En me préférant les sales guenons du coin de la rue, il me laisse libre. […] » 1172
Femmes (Animalisation des femmes) (13) : 1846. Honoré de Balzac [1799-1850], dans La cousine Bette, auteur de :
« Lisbeth, de même qu’une araignée au centre de sa toile, observait toutes les physionomies. » 1173
Femmes (Animalisation des femmes) (14) : 1846. Honoré de Balzac [1799-1850], dans La cousine Bette, auteur de :
« Si je le pouvais, j’écraserais cette femme comme on écrase une vipère... » 1174
Femmes (Animalisation des femmes) (15) : 1846. Honoré de Balzac [1799-1850], dans La cousine Bette, auteur de :
« […] Valérie fut plus qu’une femme, elle fut le serpent fait femme, elle acheva son œuvre diabolique en marchant jusqu’à Steinbock, une tasse de thé à la main. » 1175
-------------
Femmes (Animalisation des femmes) (16) : 1844. William Makepeace Thackeray [1811-1863], dans Barry Lyndon, auteur de :
« […] Eh bien ! pourquoi pas une fille de laitière ? Mon bon ami, j’ai été amoureux dans ma jeunesse, comme le sont la plupart des gentilshommes, de la fille de mon précepteur, Hélène, une grosse fille plus âgée que moi, comme de raison […] et, savez-vous, monsieur, que je regrette de tout mon cœur de ne pas l’avoir épousée ? Il n’y a rien de tel, monsieur, que d’avoir à la maison une vertueuse bête de somme, soyez-en sûr. […] Aucun homme n’a besoin de se restreindre ni de se refuser un seul amusement à cause de sa femme ; au contraire, s’il choisit bien sa bête, il la choisira de façon à ce qu’elle en soit point un obstacle à son plaisir, mais une consolation à ses heures d’ennui. […]
Ayez un ami, monsieur, que cet ami soit une femme, un bon cheval de bât qui vous aime. » 1176 (Cf. Femmes. Maison, Langage. Zeugma)
Femmes (Animalisation des femmes) (17) : 1847. Charlotte Brontë [1816-1855], dans Jane Eyre, auteure de :
« - Jane, tenez-vous tranquille ; ne vous débattez pas ainsi come un petit oiseau affolé qui déchire son propre plumage dans ses efforts frénétiques.
- Je ne suis pas un oiseau et nul filet ne me retient prisonnière ; je suis un être humain libre, doué d’une volonté indépendante, dont j’use à présent pour vous quitter. » 1177 (Cf. Dialogues)
Femmes (Animalisation des femmes) (18) : 1860. George Eliot [1819-1880], dans Le moulin sur la Floss, auteure de :
- « Mme Tulliver était une femme douce, mais même une brebis est capable de faire front un petit peu, quand elle a des agneaux. » Et de :
- « Mme Tulliver n’allait jamais jusqu’à se disputer avec elle, pas plus qu’on ne peut dire d’une poule d’eau, qui sort sa patte d’un geste suppliant, qu’elle se dispute avec un gamin qui lui jette des pierres. » Et de :
- « M. Tulliver avait vraiment l’impression que l’air était débarrassé de mouches bien gênantes, maintenant que les femmes avaient quitté la pièce. » 1178 (Cf. Femmes. Écrivaines. Eliot George)
Par ordre chronologique. Femmes. Animalisation des femmes. Victor Hugo :
Femmes (Animalisation des femmes) (19) : 1862. Victor Hugo [1802-1885], dans Les misérables, auteur de :
« Une bigote qui jase d’une dévote est plus venimeuse que l’aspic et le bongare bleu. » 1179
Femmes (Animalisation des femmes) (20) : 1862. Victor Hugo [1802-1885], dans Les misérables, concernant la Jondrette, alias la Thénardier, la décrit en ces termes :
« C’était une truie avec le regard d’une tigresse. »
Il la décrit peu après comme « la mère louve », tandis que même page, son mari la présente en ces termes : « Ce n’est pas une femme, c’est un bœuf. »
Et Victor Hugo écrira ensuite : « La Thénardier obéit, comme la louve obéit au loup, avec un grondement. » 1180
C’est beaucoup d’animaux pour une même femme…. Et un seul eut été de trop. (Cf. Politique. Animalisation du monde)
Femmes (Animalisation des femmes) (21) : 1874. Victor Hugo [1802-1893], dans Quatre-vingt-treize, concernant Michelle Fléchard, à la recherche de ses trois enfants, qu’elle retrouve dans une maison en train de brûler, auteur de :
« Elle jeta un cri effrayant. Ce cri de l’inestimable angoisse n’est donné qu’aux mères. Rien n’est plus farouche ; et rien n’est plus touchant. Quand une femme le jette, on croit entendre une louve ; quand une louve la pousse, on croit entendre une femme. » 1181 (Cf. Femmes. « Espèce ». « Femelles », Patriarcat. « Espèce », Politique. Animalisation du monde)
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Animalisation des femmes. George Sand :
Femmes (Animalisation des femmes) (22) : (4 janvier) 1864. George Sand [1804-1876], dans une lettre à Victor Borie [1818-1880], concernant sa belle-fille, Lina Dudevant-Sand [1842-1901], auteure de :
« Elle est excellente nourrice et bonne poule s’il en fut. » 1182 (Cf. Femmes. Nourrices)
Femmes (Animalisation des femmes) (23) : (29 octobre) 1864. George Sand [1804-1876], dans une lettre à Maurice [1823-1889] et Lina Dudevant Sand [1842-1901], auteure de :
« Nous amènerons probablement notre bonne qui profitera des leçons de cuisine de Marie [Caillaud] et qui l’aidera au ménage au besoin. C’est un vrai mouton qui ne fera pas plus de bruit dans la maison qu’une croûte de pain dans une malle. » 1183 (Cf. Êtres humains, Femmes. Bonnes-à-tout-faire. Maison. Silence)
-------------
Femmes. Animalisation des femmes. Léon Tolstoï :
Femmes (Animalisation des femmes) (24) : 1865-1869. Léon Tolstoï [1828-1910], dans La guerre et la paix, auteur de :
- « (Concernant Lise) Son ton avait monté, sa lèvre retroussée lui donnait non plus un air joyeux mais l’expression animale d’un rongeur. »
- « La princesse parut bouleversée : la mine d’écureuil en courroux fit place à une expression de frayeur touchante, pitoyable. Ses beaux yeux lancèrent à la dérobée vers le prince [son mari] un regard soumis, tandis que son visage prenait l’expression du chien timide qui vient frétiller doucement auprès de son maître, la queue basse. »
- (Concernant Sonia) Une allure légère, des membres souples et graciles, des façons quelque peu futées lui donnaient l’air d’une jolie minette encore un peu pataude, mais qui promet de devenir une adorable chatte. »
- (Concernant Marie Dmitrievna) « […] Tu n’as plus de chien tarabuster. Rien à faire, mon ami. Ces oiseaux-là grandissent. Elle désignait les jeunes filles. Bon gré, mal gré, il faudra leur trouver un mari. »
- (Natacha à Sonia) : « Elle la baisa au front. Sonia se redressa. La petite chatte reprit vie, ses eux lancèrent des éclairs, elle semblait prête à frétiller de la queue, à bondir sur ses pattes souples, à jouer avec le peloton de laine, bref à obéir à sa nature. » 1184
Femmes (Animalisation des femmes) (25) : 1865-1869. Léon Tolstoï [1828-1910], dans La guerre et la paix, auteur de :
« Hélène s’était trouvée à Erfurt [27 septembre-14 octobre 1808] lors de la fameuse entrevue des empereurs [entre l’empereur Napoléon et le tsar Alexandre Ier] ; elle y avait et de brillants succès et ébauché des relations avec tous les hommes illustres de l’Europe Napoléonienne. L’Empereur lui-même, l’ayant remarquée au théâtre, avait dit d’elle : ‘C’est un superbe animal’. » 1185
Femmes (Animalisation des femmes) (26) : 1865-1869. Léon Tolstoï [1828-1910], dans La guerre et la paix, auteur de :
« La cuisinière courait comme une poule affolée dans le vestibule, quand Alpatytch y pénétra. - Il l’a battue, la patronne, il l’a battue à mort !... Ah, la pauvre, comme il l’abattue, comme il l’a traînée ! » 1186 (Cf. Femmes. Comment meurent les femmes ?)
Femmes (Animalisation des femmes) (27) : 1865-1869. Léon Tolstoï [1828-1910], dans La guerre et la paix, auteur de :
« En longeant l’étang où d’ordinaire tout un essaim de femmes lavaient et battaient leur linge en bavardant, il remarqua que le radeau des laveuses, détaché du bord et à demi enfoncé dans l’eau, flottait au beau milieu. » 1187
N.B. « Essaim » : « Rassemblement en nombre important d'insectes de la même famille. Il correspond à un comportement d’agrégation. » [Wikipédia]
-------------
Femmes (Animalisation des femmes) (28) : (3 mai) 1867. Edmond [1822-1896] et Jules [1830-1870] de Goncourt écrivent dans leur Journal :
« Rome. Tout ce qui est beau ici, la femme, le ciel, les fleurs est crûment, brutalement et matériellement beau. La beauté de la femme est la beauté d’un bel animal. » Ils avaient préalablement écrit :
« Ce peuple-ci, un peuple animal avili par la religion. » 1188 (Cf. Femmes. Beauté, Langage. Zeugma, Politique. Animalisation du monde)
Femmes (Animalisation des femmes) (29) : 1875. Fiodor Dostoïevski [1821-1881], dans L’adolescent, auteur de :
« C’est une femme, c’est un serpent ! Toute femme est un serpent et tout serpent est femme. » 1189
Femmes. Animalisation des femmes. Émile Zola :
Femmes (Animalisation des femmes) (30) : 1871. Émile Zola [1840-1902], dans La curée, auteur de :
« Les cheveux tombés, les épaules nues, elle [Renée] s’appuyait sur ses poings, l’échine allongée, pareille à une grande chatte aux yeux phosphorescents. Le jeune homme [Maxime], couché sur le dos, aperçut au-dessus des épaules de cette adorable bête amoureuse qui le regardait le sphinx de marbre, dont la lune éclairait les cuisses luisantes. Renée avait la pose et le sourire du monstre à tête de femme et, dans ses jupons dénoués, elle semblait la soeur blanche de ce dieu noir. » 1190 (Cf. Relations entre êtres humains. « Faire l’amour »)
Femmes (Animalisation des femmes) (31) : 1893. Émile Zola [1840-1902], dans sa critique - élogieuse - du livre de Jules [1830-1870] et Edmond [1822-1896] de Goncourt Germinie Lacerteux [1865],décrit notamment Germinie comme « […] lâche devant la volupté au point de quêter des plaisirs comme une louve affamée […]. » 1191 (Cf. Proxénétisme. Germinie Lacerteux. Personnes-dites-prostituées)
-------------
Femmes (Animalisation des femmes) (32) : (3 février) 1896. Jules Renard [1864-1910], dans son Journal, auteur de :
« - Quand mènerez-vous votre fille dans le monde, disait M. Legrand.
- Oh, répondait Mme Moreau, les bons chevaux on vient les chercher à l’écurie ; inutile de les mener à la foire. » 1192 (Cf. Dialogues)
Femmes (Animalisation des femmes) (33) : 1911. Léon Tolstoï [1828-1910], dans Le faux coupon, auteur de :
« Solidement bâtie, belle, toujours calme, sans enfants, grasse comme une vache stérile, la femme de Piotr Nikolaïtch avait vu de sa fenêtre comment on avait tué son mari et traîné son corps quelque part dans les champs. » 1193
Femmes (Animalisation des femmes) (34) : (10 mai) 1911. Rémy de Gourmont [1858-1915], dans Épilogues. Réflexions sur la vie, auteur de :
« Les femmes, quels ruminants ! » 1194
Femmes (Animalisation des femmes) (35) : (31 janvier) 1915. Sigmund Freud [1856-1939], dans une lettre à Lou Andreas Salomé [1861-1937], lui écrit :
« Je ne me suis octroyé ni chien ni chat, il me reste encore assez d’éléments féminins à la maison : par bonheur, les filles ne sont pas appelées sous les drapeaux. » 1195 (Cf. Êtres humains, Femmes. « Féminin ». Maison, Penser. Utilitarisme, « Sciences » sociales. Psychanalyse)
N.B. « Éléments » : « Chacune des choses dont la combinaison, la réunion forme une autre chose, un tout »
Femmes (Animalisation des femmes) (36) : (18 octobre) 1928. L’abbé Mugnier [1853-1944], dans son Journal écrit :
« Marie Noël [1883-1967] m’a dit qu’elle avait eu une enfance malheureuse, elle m’a remis son livre Les chansons et les heures, avec cette dédicace :
« À M. l’abbé Mugnier, le Bon Pasteur, sa chèvre reconnaissante ». 1196 (Cf. Enfants, Femmes. Écrivaines. Noël Marie)
Femmes (Animalisation des femmes) (37) : (5 octobre) 1931. Antonio Gramsci [1891-1937], dans une lettre à sa belle-sœur Tania, cite ce « proverbe paysan :
‘Épouse et bœufs, qu’ils soient de ton village’. » 1197 (Cf. Patriarcat. Proverbe, Politique. Animalisation du monde)
Femmes (Animalisation des femmes) (38) : 1933. D. H Lawrence [1885-1938], dans L’homme et la poupée, auteur de :
- « Toute sa vie, comme un petit singe intelligent qu’elle était, elle a fait les gestes habituels de la vie. Elle m’y battait à plate couture. »
- « Vous et votre beauté, ce n’est que l’envers de votre personnalité ; votre moi réel, c’est le chat sauvage invisible dans la nuit qui lance une flamme rouge par ses larges yeux sombres. Et votre beauté n’en est que le pâle sépulcre. » 1198
Femmes (Animalisation des femmes) (39) : 1942. Vercors [1982-1991], dans Le silence de la mer, auteur de :
« Les femmes ont une divination de félin. » 1199
Femmes (Animalisation des femmes) (40) : (28 janvier) 1946. Témoignage de Marie-Claude Vaillant-Couturier au tribunal de Nuremberg :
« En sortant d’Auschwitz, nous avons été envoyées à Ravensbrück. Là, nous avons été envoyées au bloc NN qui voulait dire Nacht und Nebel [Nuit et brouillard] c’est à dire ‘le secret’. Dans ce bloc, avec nous, il y avait des Polonaises portant le matricule 7.000 et quelques-unes qu’on appelait ‘les lapins’ parce qu’elles avaient servi de cobayes. On choisissait dans leurs (sic) transports des jeunes filles ayant des jambes bien droites, et étant elles-mêmes bien saines, et on leur faisait subir des opérations. À certaines, on a enlevé des parties d’os dans les jambes, à d’autres, on a fait des injections, mais je ne saurais pas dire de quoi. Il y avait parmi les opérées une grande mortalité. […] Il y a des survivantes de ces ‘lapins’, elles souffrent encore énormément maintenant. » 1200 (Cf. Femmes. Jeunes filles, Politique. Animalisation du monde. Tortures, Violences. « Survivantes ». Tortures)
Femmes (Animalisation des femmes) (41) : (3 juillet) 1952. Paul Claudel [1868-1955], dans son Cahier X, auteur de :
« Déconfiture de la Truie Anna Pauker [1893-1960]. La justice de Dieu est marche ! » 1201 (Cf. Hommes. Grossiers, Justice, Politique. Religion)
Femmes (Animalisation des femmes) (42) : (1er mai) 1956. Jean-René Huguenin [1936-1962], dans son Journal, auteur de :
« Hormis l’ours et le chien quand ils font le beau, la femme est le seul mammifère qui se tienne ordinairement sur ses deux pattes. » 1202
N.B. « Mammifères » : « Classe d’animaux vertébrés, vivipares, qui sont caractérisés essentiellement par des mamelles, d’un cœur à quatre cavités, d’un système nerveux et encéphalique développé, d’une température interne constante et d’une respiration de type pulmonaire. » (Cf. Êtres humains. Cerveaux, Penser)
Femmes (Animalisation des femmes) (43) : 1956. 1969. Jean Guitton [1901-199], dans le Journal de ma vie, écrit :
- le 8 mai 1956 : « Les ‘grandes baigneuses’ de Cézanne [1839-1906], où les femmes sont peintes comme des animaux allongés et sans sexe… »
- le 1er janvier 1969, après sa visite au musée Matisse, à Cimiez : « J’examine les dessins des femmes, où il est remarquable que ce qui frappe Matisse [1869-1954], c’est le socle de la femme, c’est-à-dire sa croupe. »
N.B. « La croupe est une partie de la morphologie externe de certains mammifères, qui s'étend des hanches à l'origine de la queue, en particulier chez les équidés comme le cheval, mais aussi chez les bovins et les chiens. Elle correspond aux fesses chez l'homme. » [Wikipédia]
- le 11 janvier 1969 : « Rembrandt. [1606-1669] […] Il est peut-être d’entre tous les peintres celui qui a le mieux pénétré l’Évangile. Ses femmes sont des femmes, elles ont même quelque chose de la vache, de l’animal, les mamelles remplies, et certaines sans aucune beauté. En particulier, les dessins des vieilles femmes nous donnent cette impression presque animalière de la femme, qui est vraiment l’inverse de ce qu’on entend par Vénus, et proprement l’invention de Rembrandt. » 1203 (Cf. Culture, Êtres humains. Corps, Femmes, Hommes, Patriarcat, Politique. Animalisation du monde, Sexes […], « Sciences » sociales. Philosophie)
Femmes (Animalisation des femmes) (44) : 1964. Roger Vaillant [1907-1965] écrit La truite. Je lis sur Wikipédia :
« Seule Frédérique la Truite échappe à 'l'attraction terrestre', insaisissable, ne s'attachant pas. Un autre animal hante le roman, le tamanoir qui se nourrit d'insectes grouillants symbolisant les populations exploitées par le tamanoir solitaire. Seuls les animaux mus par leur instinct, échappent à cette logique. Le problème de Vailland, c'est de concilier instinct et lucidité, rester souverain en refusant de céder à l'esclavage de la drogue, de l'amour... Si Frédérique est une truite, Vailland voit plutôt la femme comme un être différent, qu'il représente en licorne jument au front cornu ou 'femme-chèvre' selon l'auteur, une femme mythique en tout cas, appartenant à l'univers aquatique. »
Femmes (Animalisation des femmes) (45) : 1968. Claude Chabrol [1930-2010], metteur en scène de : Les biches, présenté [en 2025] comme « Tous publics. Érotisme. Thriller ». (Cf. Culture. Cinéma)
Femmes (Animalisation des femmes) (46) : 1982. André Morali-Daninos [1909-1986], dans Sociologie des relations sexuelles, évoquant la périodicité des relations sexuelles - « L’optimum peut devenir pour une femme aimante, sinon tous les jours, du moins, tous les deux jours […] - poursuit :
« L’attente vaine ou trompée rend la femme semblable à un poisson tiré sur le sable. […] » 1204
Femmes (Animalisation des femmes) (47) : 1984. Philippe Berthier, en introduction à Gobseck et à Une double famille d’Honoré de Balzac [1799-1850], auteur de :
« Une pseudo-pédagogie, qui n’est jamais pensée, livre en masse des troupeaux d’oies blanches à toutes les hasardeuses tribulations auxquelles on s’expose lorsqu’on s’aperçoit que la vie n’est pas celle que l’on croyait. » 1205
Femmes (Animalisation des femmes) (48) : 1992. Lu dans un Dictionnaires des femmes célèbres concernant Rosita Mauri [1849-1923], « danseuse espagnole » :
« François Coppée s’exclamait : ‘La Mauri est divine, c’est un des grands évènements de ma vie d’avoir vu cette artiste extraordinaire. […] Elle est la danse personnifiée. […] Elle tient à la fois du coursier arabe et de l’hirondelle. » 1206
Femmes (Animalisation des femmes) (49) : 1992. Lu dans un Dictionnaires des femmes célèbres concernant Marion Mould, « cavalière anglaise » :
« On ne peut dissocier le nom de Marion Mould de celui de son cheval, le célèbre Stroller. » 1207
Par ordre chronologique. Femmes. Animalisation des femmes. Jean Tulard :
Femmes (Animalisation des femmes) (50) : 1995. Jean Tulard dans son Guide des films. 1895-1995. L-Z, auteur, concernant :
- Lizza [1972. Marco Ferreri] : « Giorgio […] s’est réfugié dans un île où son existence est bouleversée par l’arrivée d’une belle jeune femme capricieuse. Après quelques heurts, une histoire d’amour va naître. La jeune femme prendra la place du chien mort de Giorgio. Elle deviendra chienne et exécutera les ordres de son maître.
La singulière vision de l’amour par Ferreri. »
- Le crime de la rue Morgue [1932. Robert Florey] : « Le Dr Miracle racole une prostituée qui doit lui servir à croiser son sang avec celui d’un gorille. L’expérience manque et la fille est jetée à la Seine. […] »
- Network [1976. Sidney Lumet] : « Max, directeur de l’information est révoqué et remplacé par un jeune requin en jupons, Diana Christenson […] »
- Sherlock Holmes et la femme araignée [1944. Roy William Neill] : « Une femme d’une étrange beauté commet des meurtres au moyen d’araignées. […] »
- Sorcières de Salem (Les) [1956. Raymond Rouleau] : « […] La grande révélation du film fut en définitive Mylène Demongeot, extraordinaire Abigail, vipère pleine de venin qui attire la mort sur Salem. » 1208 (Cf. Culture. Cinéma, Femmes. Comment meurent les femmes ? Politique. Animalisation du monde)
Femmes (Animalisation des femmes) (51) : 2003. Jean Tulard dans son Dictionnaire du cinéma. Les réalisateurs, concernant Shohei Immamura [1926-2006] auteur de :
« Et quel joli titre il donne à la peinture d’une déchéance féminine : La femme insecte. » 1209 (Cf. Culture. Cinéma, Femmes. « Féminin »)
-------------
Femmes (Animalisation des femmes) (52) : 1996. Victor Klemperer [1880-1960], dans LTI. La Langue du IIIème Reich, auteur de :
« Et si un couple de Juifs devait avoir l’idée saugrenue, en dépit de la situation très pénible, de mettre au monde un enfant, alors les parents ne doivent pas donner à leur ‘portée’ - J’entends encore le cracheur’ hurler à une vieille dame délicate : ‘Ta portée nous a échappée, espèce de truie de juive, par contre, on va te faire faire ton affaire’ - leur progéniture, un prénom allemand qui pourrait induire en erreur […] » (Cf. Politique. Racisme)
N.B. Victor Klemperer, auteur de : « Himmler, ce chien sanguinaire » (Cf. Politique. Animalisation du monde) 1210
Femmes (Animalisation des femmes) (53) : 1997. Lu, à propos d’une femme journaliste :
« Elle se déclare ‘intellectuellement’ hostile aux quotas dans la représentation politique. ‘À ce compte-là, pourquoi ne pas instituer des quotas pour les singes ?’ » 1211 (Cf. Politique. Animalisation du monde)
Femmes (Animalisation des femmes) (54) : 1998. Robert Beck (alias Iceberg Slim) [1918-1992], dans Pimp. Mémoires d’un maquereau, emploie systématiquement, tout au long du livre, concernant la manière dont les hommes parlent des femmes, le terme d’ « écurie ». 1212 (Cf. Proxénétisme)
Femmes (Animalisation des femmes) (55) : 2000. Lu dans Le sexe du savoir de Michèle Le Dœuff :
« ’Pour moi, j’ai toujours considéré la gynécologie comme une branche de l’art vétérinaire‘ : ce mot fin d’un président de la société française de gynécologie figurait en épigraphe sur le polycopié pour étudiant-es préparant l’internat il y a vingt ans. […] » 1213 (Cf. Êtres humains, Corps, Femmes. Accouchements, Féminismes, Langage)
Femmes (Animalisation des femmes) (56) : 2005. Lu, à la rubrique : « Orientation sexuelle » du Dictionnaire de la pornographie :
« La recherche de partenaires sexuels est une préoccupation importante pour les animaux et les humains qui veulent transmettre leurs gênes ! Toutes une série de mécanismes sont mis en jeu qui sont liés à l’interaction entre les sexes. 1/ Attractivité : c’est l’attirance du mâle pour la femelle. Elle est possible grâce à l’ensemble des signaux émis par la femelle. Ces signaux sont d’une variété extraordinaire dans le monde animal. Les femmes utilisent parfums, maquillage, vêtements et lingeries, parures, bijoux, tatouages, piercings, chant, vocalisation. […] » 1214 (Cf. Êtres humains. Gênes, Femmes. « Femelles », Politique. Animalisation du monde, Pornographie. Dictionnaire de la pornographie, Sexes. Orientation sexuelle)
Femmes (Animalisation des femmes) (57) : 2014. Pascal Bruckner, dans Un bon fils, auteur de :
« Je lui avais passé [à son père] La femme changée en renard [1922] de David Garnett [1892-1981] […] Lors d’une chasse en forêt, un gentleman anglais voit avec stupéfaction son épouse se transformer en renarde au pelage rouge vif et filer dans les sous-bois. Il accepte cette métamorphose et la laisse chaque nuit partir au loin rejoindre ses frères goupils. Elle revient au matin, crottée, lacérée, griffée. Ce récit, merveilleuse métaphore de la féminité comme sauvagerie, l’avait scandalisé. Il l’avait mis à la poubelle où j’étais allé le récupérer. » 1215 (Cf. Femmes. « Féminin », Hommes. « Gentleman »)
Femmes (Animalisation des femmes) (58) : 2015. Juliette Minces [1937-2021], dans De Gurs à Kaboul, rapporte son souvenir d’un « tout petit compte rendu dans le Monde des livres » concernant son livre paru en 1979, Je hais cette France-là :
« L’auteur parlait [la concernant] d’une ‘chatte en colère’ ». 1216 (Cf. Femmes. Colère)
Femmes (Animalisation des femmes) (59) : (16 août) 2017. Geneviève Brisac, dans une série d’émissions de France Culture consacrées à Virginia Woolf [1882-1941], concernant celle intitulée Du côté des bêtes, des poètes, des biographies inventées, présente l’émission comme étant « consacrée aux animaux, aux poètes et aux femmes ». 1217 (Cf. Politique. Animalisation du monde, Langage. Zeugma)
Femmes (Animalisation des femmes) (60) : (3 octobre) 2017. Élisabeth de Fontenay, auteure notamment de Sans offenser le genre humain. Réflexions sur la cause animale - 2008 -, auteure de :
« Je n’ai jamais été très féministe… Je me suis plutôt occupée des bêtes que des femmes ; dans ma vie théorique et militante, j’étais plutôt de ce côté des bêtes que des femmes. […] »
Réaction du journaliste : ‘pas très féministe comme comparaison !’.
Mais, c’est la comparaison qui est inadmissible. 1218 (Cf. Êtres humains, Relations entre êtres humains. Comparaison, Politique. Animalisation du monde)
N.B. Élisabeth de Fontenay est présentée par Wikipédia comme : « philosophe reconnue (sic) de la question juive et de la cause animale. »
Faut-il être aveugle ?
Femmes (Animalisation des femmes) (61) : 2018. Je dois, avec regret, insérer Les Chiennes de garde (association à laquelle j’ai activement participé dès son tout début, mais dont je n’ai pas été à l’initiative) et Balancetonporc dans cette rubrique.
Apprendre à [re] connaitre ses actions par les critiques que l’on leur porte. (Cf. Féminismes, Politique. Animalisation du monde, Langage. Mots)
Femmes (Animalisation des femmes) (62) : (16 mars) 2018. Jean-François Kahn [1938-2025], auteur de :
« […] Et puis il y a l'amalgame qui associe ces femmes aux porcs, comme Staline associait les Trotskystes aux fascistes. » 1219 (Cf. Hommes. « Porcs », Féminismes. Antiféminisme, Politique. Animalisation du monde)
Femmes (Animalisation des femmes) (63) : (21 mars) 2018. Dans le cadre d’une série documentaire de France Culture : Quatre femmes de sciences, voici le titre et la présentation de l’émission en consacrée à une professeure au Museum national d’histoire naturelle : Marie-Claude Bomsel - La lionne de la Ménagerie :
« Chacun connaît cette vétérinaire du Muséum et sa crinière léonine - il arrive fréquemment que les professeurs du Muséum finissent par ressembler à leur sujet d’étude - maman putative de Nénette, la guenon orang-outan de la ménagerie du Jardin des Plantes, 48 ans environ [la guenon ou la chercheuse ?] Un franc-parler à nul autre pareil, et des convictions bien trempées. […] » 1220 (Cf. Politique. Animalisation du monde)
Femmes (Animalisation des femmes) (64) : (14 août) 2018. Donald Trump, président des États-Unis, auteur du tweet suivant [53 millions d’abonné-es] :
« Quand tu donnes sa chance à une crapule foldingue et pleurnicheuse et que tu lui donnes un boulot à la Maison Blanche, je me dis que ça n'a simplement pas marché. Une bonne chose que le général Kelly ait rapidement viré cette chienne ! » [« That dog »].
Ce tweet de Donald Trump concernait Omarosa Manigault Newman qui, après avoir été candidate de télé-réalité, après avoir été nommée conseillère à la Maison Blanche avait été licenciée par John Kelly, son chef du cabinet. Celle-ci dans un livre avait dénoncé un Donald Trump « raciste », « intolérant », « misogyne », souffrant d’une grave déficience mentale et « inapte » à la fonction de Président. Elle avait par ailleurs diffusé un enregistrement avec John Kelly et Donald Trump lors de son licenciement. 1221 (Cf. Hommes. Grossiers. Misogynes. « Politiques », Justice. Trump Donald, Politique. Animalisation du monde)
Femmes (Animalisation des femmes) (65) : 2018. Ségolène Royal, dans Ce que je peux enfin vous dire [Fayard] se souvient de la présentation qui fut faire la concernant :
« En novembre 2000, elle participe à la commission d’enquêtes sur les farines animales. Le député qui préside la commission dont elle ne donne pas le nom commente alors : ‘Ségolène Royal est désignée. Nous nous réjouissons ainsi de la participation d’une vache folle au bureau de la commission d’enquêtes’.
Selon cette page du Sénat [sus-citée], le président de cette commission est l’actuel sénateur [UMP] de l’Allier, Gérard Dériot. » 1222 (Cf. Hommes. « Politiques », Politique. Animalisation du monde. État. Sénateurs)
Femmes (Animalisation des femmes) (66) : (7 décembre) 2018. Lors la 42ème journée nationale du Collège National des Gynécologues et des Obstétriciens Français [CNGOF], les participant-es ont pu lire cette phrase du professeur Renaud de Tayrac [CHU de Limoges qui a déclaré, après la dénonciation publique de son jugement, « être absolument étranger à cette polémique » (sic)] :
« Les femmes c’est comme les juments, celles qui ont de grosses hanches ne sont pas les plus agréables à monter, mais c’est celles qui mettent bas le plus facilement. »
Israël Nisan, le président, face aux réactions qui s’en sont suivies a prié « tous ceux (sic) qui ont pu être choqués par l’affichage inapproprié de cette phrase moyenâgeuse d’accepter les excuses du CNGOF qui, bien sûr, regrette cet acte déplacé. »
« Inapproprié », « Déplacé » : moyenâgeux ? …
- Lors de cette même rencontre, une conférence était intitulée : « Ces prétendues violences obstétricales : les enjeux juridiques ». 1223 (Cf. Droit, Femmes. Accouchements, Penser. Polémique, Politique. Animalisation du monde, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
Femmes (Animalisation des femmes) (67) : 2018. Je lis sur internet dans l’ABC de la langue française à la recherche de liens entre « Biche » [femelle du cerf] et « Femme » :
- Biche : prostituée, femme galante, femme entretenue, femme légère ; prostituée qui n'a pas de client
- Ma biche, mes petites biches ; biche : appellation affectueuse d'homme à femme ; terme d'amitié adressé à une femme, à une jeune fille ; de femme à femme (plutôt d'un niveau social aisé, snob, guindé)
- Bichette. Jeune femme jolie et légère ; mot d'amitié à l'adresse d'une femme, appellatif amoureux d'homme à femme.
- Ma bichette ; ma bichette en sucre ; ma tendre bichette : Terme d'amitié, terme affectueux d'homme à femme, terme de tendresse
- Biche : Jolie jeune femme
- Bicherie, Haute Bicherie : ensemble des femmes galantes, courtisane de premier ordre. (Cf. Hommes. « Galants », Langage. Langue. Française, Politique. Animalisation du monde)
Femmes (Animalisation des femmes) (68) : (19 décembre) 2018. Un policier de la BAC [Brigade anti-criminalité], à Nantes, insulte une passante :
« Dégage, vieille truie ». Elle réagit fortement, longtemps, et l’on entend un jeune homme lui dire :
« Bravo Madame, Merci, Madame ». [YouTube] (Cf. Dialogues, Politique. Animalisation du monde. État. Répression)
Femmes (Animalisation des femmes) (69) : (25 février) 2019. Gérald Darmanin, ministre du budget, « lors d’un dîner avec des élus », auteur de :
« Les parlementaires, c’est comme les chiens. Il y a les truffiers qui ramènent de grosses truffes, ceux-là, il faut les traiter ; il y a ceux qui ramènent des petites truffes et qu’on fait traiter par des collaborateurs ; et il y a les labradors, comme Montchalin [Amélie de Montchalin, députée LAREM, du même parti que lui, donc] : vous leur mettez une claque et ils reviennent au pied. » 1224 (Cf. Hommes. « Politiques ». Darmanin Gérald, Politique. Animalisation du monde, Violences)
Femmes (Animalisation des femmes) (70) : (30 septembre) 2019. Sur France Culture, dans l’émission Le réveil culturel, Tewfik Hakem interroge Bernard Werber :
Question : Cette fois-ci, vous prenez la voix d’une chatte…
Réponse : C’est très rafraîchissant, déjà, on sort de ses problèmes d'humain, tout d’un coup, on voit le monde autrement. Et puis il s’avère que j'ai vécu avec trois chats, dont notamment ma dernière chatte Domino, qui m’a inspirée mon héroïne, Bastet. J’avais l’impression qu’elle m’observait et qu’elle avait l’air de comprendre des choses que je ne comprenais pas. C’est ça qui m’a inspiré. À partir de là, vu qu’elle est un peu diva et qu’elle est peu prétentieuse et narcissique, je me suis dit, en fait, c’est une femelle, c’est un chat, c’est une diva, du coup, j’ai une héroïne presque un peu négative… […] » (Cf. Femmes. « Femelles », Langage. Possessif)
N.B. La présentation écrite publiée sur le site de France Culture, a été réécrite : en a été supprimé le passage le plus choquant. 1225
Femmes (Animalisation des femmes) (71) : (28 septembre) 2020. Entendu, concernant Juliette Gréco [1927-2020] aux lendemains de son décès, évoquer son « œil de biche » et la présenter comme « ronron[nant] comme une tigresse (sic) ». (Cf. Femmes. Artistes)
Femmes (Animalisation des femmes) (72) : (18 janvier) 2021. Sur France Musique, Lionel Esparza, évoquant le fait que la chanteuse Victoria de Los Angeles [1925-2013] exigea du compositeur Heita Villa-Lobos [1887-1959] qu’il cessa de fumer ses cigares et de s’asperger de parfum qui l’incommodait, évoqua ses « naseaux ». 1226 (Cf. Hommes. Grossiers. Esparza Lionel)
Femmes (Animalisation des femmes) (73) : (27 février) 2021. Sur France Culture, l’émission Toute une vie est intitulée :
« Christiane Rochefort [1917-1998], l’écrevisse combattante ».
*Ajout. 30 août 2025. J’entends sur France Culture que Christiane Rochefort « préférait ce terme à celui d’écrivaine ». (source ?)
Femmes (Animalisation des femmes) (74) : (2 mars) 2021. Sur France Culture, dans une série intitulée Ménopause pour tout le monde, la deuxième émission s’intitule :
« Les femmes sont des orques comme les autres. »
Là, l’attaque, à la suite de toutes les autres, est frontale. 1227 (Cf. Femmes. Ménopause)
Femmes (Animalisation des femmes) (75) : (21 juin) 2021. Sur France Culture, Xavier Mauduit, dans l’émission Le cours de l’histoire, à Nicole Guichard, conservatrice en chef au département des antiquités Égyptiennes au musée du Louvre, concernant une statue du « Bas empire », auteur de :
« La déesse Thouéris m’a beaucoup plu, je ne vous le cache pas : elle a une tête d’hippopotame, un corps de femme et une queue de crocodile. » 1228 (Cf. Culture. Statues, Histoire. Mauduit Xavier, Historiographie. Patriarcale. Mauduit Xavier)
Femmes (Animalisation des femmes) (76) : (automne) 2021. Le collectif de mères « pour reprendre nos droits de décision sur le bien-être et l’avenir de nos enfants » et qui dénoncent la maltraitance des enfants du fait de la politique dite sanitaire dont ils sont les victimes s’appelle :
« Mamans Louves en action ». (Cf. Femmes. Mères, Politique. Coronavirus. Extrême-droite)
Femmes (Animalisation des femme) (77) : 2023. Entendu dans une même séquence à la radio la référence à la « toison du pubis » et « la tonte des femmes » [à la Libération]. (Cf. Femmes. Tondues à la libération, Sexes. Femmes)
N.B. « Toison » : « Pelage laineux des ovidés ; chevelure très fournie »
« Tonte » : « Action de tondre. la tonte des moutons ; laine obtenue en tondant les moutons »
Femmes (Animalisation des femmes) (78) : (12 juillet) 2023. Le Canard enchaîné (p.6) publie dans sa rubrique littéraire - Lettres ou pas lettres - deux passages de la dernière édition de La Pléiade des Romans. 1936-1947 de Louis-Ferdinand Céline [1894-1961], dont voici le second :
« Le narrateur rapporte le désordre laissé par les couturières dans les tissus de la maison où il est apprenti : ‘Ça s’éparpille, faufile, déglingue et s’entortille à l’infini. Toute la journée, les petites volailles de la couture viennent s’ébrouer, glousser à travers les coupons, fouillassent, trifouillent et ramènent tout un délire dans les chichis, mousseline et moires.’ »
Je n’ai pas la même lecture : d’une part, je n’y ai pas vu « le désordre laisse par les couturières », mais l’environnement dans lequel ces femmes travaillent ; d’autre part, j’y ai vu l’incroyable mépris d’un apprenti pour des femmes de métier ; enfin je n’y ai lu aucune « profusion du style - ce qui ne veut rien dire par ailleurs - due à l’effet grossissant de la vision ».
Des femmes transformées « en volailles » relève-t-il d’un « style » ? ; plus encore, le sous-titre de l’article est : « L’édition complète de ses romans [ceux de Céline] reparait enrichie d’inédits de haut style. »
N.B. J’ai souvent remarqué que lorsqu’on ne sait quoi dire d’un-e auteur-e, on évoque son « style » : il y a peu de craintes d’être démenti-e. (Cf. Culture. Style)
Femmes (Animalisation des femmes) (79) : (9 août) 2023. Lu, dans Le Canard enchaîné, dans un article consacré à la sculptrice Germaine Richier [1952-1954] :
« Alors Germaine Richier invente, renoue physiquement avec la nature. La femme devient sauterelle, mante ou araignée. » (Cf. Femmes. Artistes)
Femmes (Animalisation des femmes) (80) : (18 décembre) 2023. Nancy Houston, sur France Culture, auteure de :
« C’est une chance ou moi de me réveiller tous les matins et de me dire : ‘Je suis un animal’. »
Femmes (Animalisation des femmes) (81) : (10 juillet) 2024. Entendu sur France Culture, concernant Carl Jung [1875-1961] :
« Les femmes tombaient comme des mouches autour de lui. » 1229
Femmes (Animalisation des femmes) (82) : (29 juillet) 2024. Titre de l’émission de ce jour de France Culture : « Le discours d’Emmeline Pankhurst [1858-1928], indomptable suffragette ».
N.B. « Dompter » : « Réduire à l'obéissance (un animal sauvage, dangereux). Soumettre à l’autorité »
Femmes (Animalisation des femmes) (83) : (12 août) 2024. Jean Lebrun, sur France Culture, auteur de :
« Il s’occupait de chevaux et de dames. » (Cf. Langage. Zeugma)
Femmes (Animalisation des femmes) (84) : (3 septembre) 2024. [1ère diffusion. 6 novembre 2017] Titre de l’intitulé de l’émission de France Culture : Anna Magnani, la louve du cinéma italien. (Cf. Patriarcat. Permanence)
Femmes (Animalisation des femmes) (85) : (27 octobre) 2024. Lu dans People :
« Crinière de lionne et robe de lumière pour Angelina Jolie au Festival du film de Hollywood »
Femmes (Animalisation des femmes) (86) : (5 décembre) 2024. Fabrice Drouelle, dans l’émission Affaires sensibles de France Inter, évoquant la prison de femmes de Lyon où Berty Albrecht [1893-31 mai 1943] est enfermée, évoque un « vacarme […] de poulailler. »
Femmes (Animalisation des femmes) (87) : (3 avril) 2025. Dans l’émission Les pieds sur terre de France Culture : Dernières nouvelles du sexe. 20 ans d’évolution des mentalités 14/15. Le sexe après 50 ans : ce qui, change pour les femmes, après : « La sexualité des femmes après 50 ans, autrement dit la ménopause… j’entends :
« On a étudié de près récemment les seules autres espèces qui connaissent la ménopause, c’est à dire les orques et les baleines pilotes… » (Cf. Êtres humains. Espèces, Femmes. Corps, Politique. Animalisation du monde, Pornographie. France Culture, Proxénétisme. France Culture, Sexes. Sexualité)
Femmes (Animalisation des femmes) (88) : (18 juillet) 2025. Je lis dans Match : « La lettre au nom de Donald Trump [à Jeffrey Epstein] comporte plusieurs lignes de texte dactylographié entourées d'un croquis de femme nue avec sa signature évoquant une toison pubienne, selon le journal. ‘Joyeux anniversaire - et que chaque jour soit un autre merveilleux secret’, affirme avoir lu le Wall Street Journal, sans reproduire la lettre. » (Cf. Corps. Femmes, Hommes. « Politiques ». Trump Donald, Proxénétisme. Epstein Jeffrey, Sexes. Femmes)
Femmes (Animalisation des femmes) (89) : (7 août) 2025. Lu sur Mediapart sous l’intitulé « Carol J. Adams : le steak et le patriarcat » :
« Récemment traduite en France, l’œuvre de l’écoféministe Carol J. Adams, qui interroge les dominations croisées sur les femmes et les animaux, a irrigué dans le monde anglo-saxon tout un courant militant. »
Sur Wikipédia, je lis : « Carol J. Adams est une écrivaine américaine féministe et militante pour les droits des animaux. Son ouvrage principal, The Sexual Politics of Meat : A Feminist-Vegetarian Critical Theory traduit en français en 2016, traite des liens entre l'oppression des femmes et des animaux non humains. »
Femmes. Apparence :
Femmes. Apparence (1) : Juger une femme selon son apparence, c’est ipso facto la nier. (Cf. Femmes. Beauté)
Par ordre chronologique. Femmes. Apparence :
Femmes (Apparence) (1) : 1762. Jean-Jacques Rousseau [1712-1778], dans Émile ou de l’éducation, met « l'apparence même au nombre des devoirs des femmes ». 1230
Femmes (Apparence) (2) : 1965. Je lis dans le livre de Behoteguy de Teramond Comment recevoir sans personnel, accompagnant, illustrant le visage d’une femme jeune, bien habillée, jolie, au sourire épanoui :
« Voici quel droit être le visage et l’apparence de la femme qui reçoit de nos jours ». Suivi de cette menace d’emblée accusatoire :
« Et qu’on ne l’entende plus jamais ce ‘excusez-moi, je reviens…’ placé de force [!] au milieu d’une histoire, pour courir au secours d’un rôti en train de brûler… » 1231
Femme (Apparence) (3) : (décembre) 2017. Dans un article du Monde Diplomatique consacré à l’ « invisible pénibilité du travail féminin », je lis :
« Mme Sylvie T., blonde pimpante, raconte son quotidien de femme de ménage dans une institution culturelle. » 1232
C’est, dès lors, pour moi, tout l’article qui est, peu ou prou, décrédibilisé.
-------------
Femmes (Appel de Coluche) : (30 octobre) 1980. Appel de Coluche [1944-1986] :
« J'appelle les fainéants, les crasseux, les drogués, les alcooliques, les pédés, les femmes, les parasites, les jeunes, les vieux, les artistes, les taulards, les gouines, les apprentis, les Noirs, les piétons, les Arabes, les Français, les chevelus, les fous, les travestis, les anciens communistes, les abstentionnistes convaincus, tous ceux qui ne comptent pas pour les hommes politiques, à voter pour moi, à s'inscrire dans leurs mairies et à colporter la nouvelle. Tous ensemble pour leur foutre au c… avec Coluche. Le seul candidat qui n’a aucune raison de vous mentir. »
Conclusion : les « femmes » ne sont pas lesbiennes et les lesbiennes ne sont pas des « femmes », et elles ne sont ni « fainéantes », ni « crasseuses », ni « arabes », ni... (Cf. Langage. Féminisation du langage, Femmes. Lesbiennes, Politique. Coluche. Médias)
Femmes (Arpètes) : 1984. Dominique Desanti [1914-2011], dans La femme au temps des années folles, auteure de :
« (Dans la couture) La première régnait sans charte. L’arpète (qui parfois, malgré la loi, avait quitté l’école avant ses douze ans) ne jouissait d’aucun droit. Comment apprenait-elle son métier, l’apprentie ? Toute la journée, on lui criait de ‘passer l’aimant’ par terre pour agglomérer les aiguilles tombées. De balayer les fils et rognures. D’aller assortir aux ‘fournitures’, le fil, les aiguilles au tissu. De transporter les rouleaux, de tenir une toile, de poser sa main ici et là, d’aller chercher de l’eau, du café et même des cigarettes (fumer, péché interdit). L’apprentissage dépendait de la bonne volonté des ouvrières et de la volonté tout court de l’apprentie. L’argent, peu ou pas de salaire puisqu’elle apprenait.
À la longue, l’arpète tenace ou douée passait ‘petite main’ et parvenait alors à saisir quelques coups du métier, avant de devenir ouvrière seconde, et - mais très rarement- première. » 1233 (Cf. Enfants, Femmes. Comment devient-on femme ? Travail)
Femmes. Assassinées :
Femmes (Assassinées) (1) : (Date ? : Ancienne) En France, des femmes sont quasi quotidiennement assassinées par des hommes sans que ces crimes ne fassent le plus souvent plus de bruit que celui de l’arrivée d’une dépêche sur un ordinateur. L’analyse dans la presse dépasse rarement celle du constat selon lequel l’homme était « inconnu des services de police », qu’il était dépressif, sans emploi, bon voisin, « ivre au moment des faits » 1234, « venait d’un milieu social extrêmement défavorisé », qu’il avait été lui-même, violé, qu’il y avait eu une « dispute », un « conflit » (la quasi norme…), que son épouse l’avait quitté ou dont il était séparé…
Puis, le filon étant un peu épuisé, il reste alors à s’interroger - dans la recherche de son humanité - ou plutôt, de son bon droit ? - sur ses « motivations », sur la conscience qu’il avait ou non de son ‘acte’, de son ‘geste’.
- Mettre en relation le sexe de la victime avec celui du criminel est hors sujet.
- L’émotion politique - si souvent de commande - n’est de mise que si l’assassin est récidiviste, tandis que « les marches blanches » sont censées n’avoir aucune signification politique.
- Chaque assassinat (et/ou viol) transmet le message suivant : Quoi que vous pensiez, qui que vous soyez, je suis plus fort que vous, je suis maître de votre corps, de votre sexe, de votre vie, de vous, que je peux marquer à vie et /ou supprimer. Et voici la preuve de ma vérité, c’est celle de ma puissance.
- La société dans son ensemble, a fortiori le monde politique, sauf exceptions, globalement cautionne. Si, pour pouvoir agir, il faut, a minima, pouvoir s’identifier à la souffrance de la victime, alors, les hommes continueront à tuer des femmes. Nous n’en sommes même pas là, tant s’en faut. 1235
Femmes (Assassinées) (2) : 1849. À méditer, cette puissante analyse de François-René de Chateaubriand [1768-1848], dans les Mémoires d’Outre-tombe, concernant les conventionnels :
« Ils ne voulaient pas lâcher le crime, de peur de perdre la puissance. » 1236
-------------
Femmes. Assassinées, prostituées, violées, harcelées, battues... :
Femmes (Assassinées, prostituées, violées, harcelées, battues...) (1) : Ces femmes paient de leur vie le prix de l’indépendance de toutes les femmes.
Femmes (Assassinées, prostituées, violées, harcelées, battues...) (2) : Une - la - parole de vérité :
« On est trop nombreuses. »
-------------
Femmes (Assises) : 1905. Louise Michel [1830-1905], dans Souvenirs et aventures de ma vie, rapporte cette réaction d’un surveillant de sa prison, après qu’elle eut fini de « frotter avec ardeur le parquet de [sa] geôle » :
« - Et quoi, me dit-il, d’un ton rogue, c’est ainsi que vous balayez… Au lieu de me frotter ce parquet, vous êtes là, assise comme une rentière…A-t-on jamais vu une flemmarde pareille… » 1237 (Cf. Femmes. Paresseuses)
Femmes (« Asservies ») : 1921. Marcel Proust [1871-1922], dans Sodome et Gomorrhe, auteur de :
« Et [Albertine] désireuse de se montrer gentille mais contrariée d’être asservie, elle avait plissé le front, puis tout de suite, très gentiment dit : ‘C’est cela’ et elle avait envoyé le lift. » 1238 (Cf. Femmes. Gentilles)
N.B. « Asservi » : « Qui est soumis, sous le contrôle, en état de dépendance »
Femmes (Attirance pour les hommes courageux) : 1696. Le comte de Bussy-Rabutin [1618-1693], dans ses Mémoires, auteur de :
« Les femmes ont naturellement de l’estime pour les actions de courage… » 1239
Par ordre chronologique. Femmes. Attirance pour les hommes « forts » :
Femmes (Attirance pour les hommes « forts ») (1) : 1839. Stendhal [1783-1842], dans La chartreuse de Parme, auteur de :
« L’amour et l’amour-propre de la duchesse [Sanseverina] eurent un moment délicieux ; elle regard le comte [Mosca], et ses yeux se mouillèrent de larmes. Un ministre si puissant, environné de cette foule de courtisans qui l’accablaient d’hommages égaux à ceux qu’ils adressaient au prince lui-même, tout quitter pour elle et avec cette aisance !» 1240
Femmes (Attirance pour les hommes « forts ») (2) : 1884. À l’opposé - enfin, pas vraiment…- Marie Bashkirtseff [1858-1884], auteure, de :
« Vous n’êtes pas l’homme que je cherche. Je ne cherche personne, monsieur, et j’estime que les hommes ne doivent être que des accessoires pour les femmes fortes. » 1241 (Cf. Êtres humains, Femmes. Fortes. Orgueil. Remarquables, Hommes. Forts)
Femmes (Attirance pour les hommes « forts ») (3) : 1928. Isadora Duncan [1877-1927], dans Ma vie, auteure de :
« Et maintenant tout mon être aspirait au contact d’un mâle fort. Je vis en Stanislavsky [1863-1938] le mâle que je cherchais. » 1242
Il faut préciser qu’elle chercha et trouva bien d’autres ‘qualités’ chez d’autres hommes. (Cf. Femmes. Remarquables. Duncan Isadora, Hommes. Forts, Famille. Mariage)
Femmes (Attirance pour les hommes « forts ») (4) : 1981. Lu, dans Un homme d’Oriana Fallaci [1929-2006], concernant Alekos Panagoulis [1939-1976] :
« […] Je ne comprenais pas les femmes qui […] tombaient éperdument amoureuses, prêtes à trahir leur mari, à s’humilier pour être malmenées cinq minutes contre un mur ou sur un lit, afin de pouvoir raconter aux autres ou à elles-mêmes qu’elle t’avait touché. […] » 1243 (Cf. Femmes. Écrivaines. Fallaci Oriana, Hommes. Forts)
-------------
Femmes (Attirance pour les hommes incarnant des idées progressistes) : 1940. Je lis dans l’Essai d’autobiographie spirituelle de Nicolas Berdiaev [1874-1948] :
« [En Russie] Comme un idéaliste romantique en 1840 de même en 1860, un matérialiste et un réaliste pensant, en 1870, un populiste se sacrifiant pour le bien et l’affranchissement du peuple, en 1890, un marxiste pouvait seul espérer les faveurs des belles dames. » 1244 (Cf. Hommes. « Intellectuels », Langage. Critique. Mot : « Progressiste »)
Femmes (Attirance pour les hommes « Politiques ») : (22 juin) 1914. Lu dans le Journal de l’abbé Mugnier [1853-1944] un échange entre lui et Marie Scheikévitch [1882-1964] concernant Anna de Noailles [1876-1933] qu’elle « connaît bien » :
- « Comme je lui demandais pour quoi Madame de Noailles aime tant les hommes politiques, Madame Scheikévitch m’a répondu : ‘C’est le goût de l’esclavage’ […]. »
Et, à la date du 6 décembre 1923, neuf ans plus tard, l’abbé Mugnier évoquant la mort d’Anna de Noailles, concernant Maurice Barrès [1862-1923] (« très cruel », « qui n’aimait qu’elle ») cite ce jugement tel qu’émis par elle :
« J’ai tout donné, comme une fille de l’Orient. J’étais une esclave. » 1245 (Cf. Femmes. Remarquables. Noailles Anna de, Hommes. « Politiques », Langage. Académie française. Barrès Maurice, Politique. Esclavage)
Par ordre chronologique. Femme. « Attachées » :
Femme (« Attachées ») (1) : (8 décembre) 1805. Stendhal [1783-1842] écrit dans son Journal ce qu’il a dit la veille à Mélanie Guilbert [1780-1828] dont il est amoureux… et jaloux :
« Tu es un lierre, tu es attachée à un petit arbre et tu t’en inquiètes, au lieu qu’il faudrait que tu le fusses à un gros arbre en qui tu eusses pleine confiance. » 1246
Femme (« Attachées ») (2) : 1935. Entendu dans Toni [Jean Renoir] :
« Les femmes, plus elles vous aiment, plus elles sont crampons. » (Cf. Culture. Cinéma)
-------------
Femmes (Autisme) : 2016. Josef Shovanec, auteur de Voyages en autistan [Plon. 2016] en évoquant « la problématique des viols » poursuit :
« Il s’avérerait que la majorité des femmes autistes aient été violées. » 1247
Rapide, non ? Scandaleux ? Pourquoi ? (Cf. Langage. Mots. Critique de : « Scandale », Violences)
Femmes (Autodéfense) : Nécessaire.
* Ajout. 7 avril 2025. Assertion irresponsable.
* Ajout. 27 avril 2025. Pourquoi ?
Femmes. Avortements :
Femmes (Avortements) (1) : Aucune femme ne veut - positivement - « avorter ».
Les femmes ne veulent pas avoir un enfant qui décidera de toute leur vie alors qu’elles ne l’ont pas voulu.
Cette volonté est si forte qu’elles prennent souvent cette décision, au risque de leur vie.
Par ordre chronologique. Femmes. Avortements :
Femmes (Avortements) (1) : IVème siècle avant J-C. Serment d’Hippocrate :
« […] De même je ne remettrai pas non plus à un femme un pessaire abortif. »
Femmes (Avortements) (2) : 1946. János Székely [1901-1958], dans L’enfant du Danube, auteur de :
« Le paysan hivernait comme la graine sous la neige ; mais tandis que la graine devenait tige au printemps pour le plus grand bienfait de tous ; mais tandis que la graine devenait tige au printemps pour le plus grand bienfait de tous, les rêves d’hiver du paysan ne profitaient qu’aux faiseuses d’anges du village. » 1248 (Cf. Femmes. Comment faire disparaître les femmes ?)
Femmes (Avortements) (3) : 1980. Véra Goloubeva, dans Le revers de la médaille publié dans Femmes et Russie. 1980, auteure de :
« […] C’est ainsi que la femme s’approche, heure par heure, de la torture assignée par le destin. Elle arrive à l’abortarium. L’abortarium est situé sur la voie Lermontov. C’est un énorme bâtiment. Les femmes l’appellent ‘le hachoir à viande’. Le rendement de la clinique est de 200 à 300 personnes par jour. […] »
Mais les femmes qui arrivent ici ne prêtent pas attention à ce incommodités, saisies d’effroi par l’attente du sacrilège prévu. Et voici venue la minute fatidique. Les femmes se déplacent en rang devant la salle d’opération. Deux à six femmes avortent à la fois dans la même salle. Les sièges sont disposés de façon à ce que chacune voit tout ce qui se passe, en face. Le visage déformé par la souffrance, la bouille sanglante qu’on extrait du corps de la femme. […] Sans anesthésie, la femme ressent une douleur atroce. Certaines s’évanouissent. L’infirmière, servant deux médecins à la fois, n’a pas le temps d’aider la patiente. On la rappelle péniblement à la vie, puis on l’éconduit. C’est aux femmes qui attendent leur tour, de la raccompagner jusqu’à la salle commune. Pendant une heure et demi encore, elle s’y tord de douleur, de nausées, vomit parfois. […] » 1249 (Cf. Politique. Tortures)
Femmes (Avortements) (4) : 2000. Maya Surduts [1937-2007], secrétaire générale de de la CADAC [Coordination nationale pour le droit à l’avortement et à la contraception], auteure de :
« Un de nos principes en matière de contraception et d’avortement est que ce sont les femmes elles-mêmes qui décident et non pas les médecins. Ce sont les rares actes où la femme ne demande pas un diagnostic au médecin, mais lui indique ce qu’elle veut. Ce point heurte les médecins ; ils n’aiment pas que les femmes viennent leur indiquer ce qu’elles veulent, car ils considèrent que, par leur formation, ils sont les seuls à même de dire aux patients ce dont elles sont besoin. De plus, être enceinte ou veiller au choix de sa fécondation n’est pas une maladie. » 1250 (Cf. Femmes. Enceintes, Féminismes)
Femmes (Avortements) (5) : 2020. Cf. Femmes d’Argentine. Le film - formidable - sur la lutte - formidable - des ’foulards verts’ en 2018 pour le droit à l’avortement. (Cf. Culture. Cinéma, Êtres humains, Patriarcat, Politique. Luttes de femmes)
Femmes (Avortements) (6) : (25 septembre) 2021. Sur C. News, les avortements sont qualifiés « d’épisodes très répandus chez les femmes ».
N.B. « Épisode » : « Fait particulier que se rattache à un ensemble. »
Femmes (Avortements) (7) : 2023. Il aura fallu en France attendre 2023 pour que les sages-femmes soient autorisées, officiellement, mais à titre expérimental, et pas seules, à procéder à une IVG. (Préciser)
Femmes (Avortements) (8) : (5 mars) 2024. Lu sur Franceinfo : « Selon le Code pénal allemand, l’avortement reste un acte illégal, mais dépénalisé jusqu’à 12 semaines de grossesse. Il faut cependant respecter des procédures particulières pour pouvoir en bénéficier. Ainsi, une femme qui souhaite avorter doit obligatoirement assister à une discussion avec une personne du planning familial pour prouver qu'elle prend cette décision en toute conscience. Et l’IVG reste à la charge financière des femmes, sauf en cas de viol ou de danger pour la vie de la mère. »
Femmes (Avortements) (9) : (26 septembre) 2025. Lu sur L’Humanité l’article intitulé :
« Monument aux avortées de Paris : « L’histoire des femmes décédées d’avortements clandestins n’est inscrite nulle part ».
Celles des femmes mortes suite de tous les avortements, clandestins ou non, non plus. Sans oublier les femmes mortes enceintes, à la naissance de leurs enfants, après, du fait de leur naissance. (Cf. Êtres humains. Vies. Vies / Morts, Femmes. Comment meurent les femmes ? Patriarcat. Permanence, Histoire. Patriarcale)
-------------
Femmes (Bagnes) : 1873. Henri Rochefort [1831-1913], dans Les aventures de ma vie, note qu’en partance pour le bagne en Nouvelle Calédonie à bord de « la Virginie », sur 125 déporté-es, l’on comptait 22 femmes.
Parmi elles, Louise Michel [1830-1905], madame Lemel [1826-1921] « socialiste ardente, blessée sur les barricades lors de la ‘semaine sanglante’ [de la Commune de Paris], une des plus belles et des plus fortes intelligences que j’ai connues. L’éloquence et le bon sens, chez elle, sont égaux à la bravoure. » écrit-il.
Il évoque aussi « la grande Victorine » qui disait aux religieuses :
« Ah, je vous prie de croire, mes sœurs, que je ne suis pas ici pour avoir enfilé des perles ! […] », Madame Leroy et Madame Leblanc « dont l’odyssée était si particulièrement lamentable qu’il était impossible de la regarder sans que le cœur se serrât. L’histoire de Mme Leblanc justifiait amplement l’exclamation de la grande Victorine : Quelles crapules que ces Versaillais ! […] ».
Henri Rochefort constate que les 22 femmes étaient placées dans « une cage » […] « pas plus grande que [le lieu qui lui fut affecté] où [il était] seul ». (Cf. Femmes. Remarquables. Lemel Nathalie. Michel Louise, Commune La, Patriarcat, Politique. État. Répression. Prison, Histoire) 1251
Par ordre chronologique. Femmes. Honoré de Balzac :
Femmes (Balzac Honoré de) (1) : 1831. Honoré de Balzac [1799-1850], dans La peau de chagrin auteur de :
« (La terrible Aquilina) [L’hôpital !] […] Quand nous ne sommes ni mères, ni épouses, quand la vieillesse nous met des bas noirs aux jambes et des rides au front, flétrit tout ce qu’il y a de femme en nous, et sèche la joie dans le regard de nos amis, de qui pouvons-nous manquer ? … Alors vous ne voyez plus en nous que la fange primitive. » 1252 (Cf. Êtres humains. Fange, Femmes. Âgées)
Femmes (Balzac Honoré de) (2) : 1831. Honoré de Balzac [1799-1850], dans La peau de chagrin auteur de :
« (Euphrasie) Se donner pendant toute une vie à un être détesté, savoir élever des enfants qui vous abandonnent, et leur dire : Merci ! quand ils vous frappent au cœur… Voilà les vertus que vous ordonnez à la femme ! Encore pour la récompenser de son abnégation, venez-vous lui imposer des souffrances en cherchant à la séduire… Si elle résiste, vous la compromettez… Jolie vie… Autant rester libre, aimer ceux qui nous plaisent, et mourir jeune… » 1253 (Cf. Femmes. Libres, Hommes. Séducteurs, Famille. Mariage, Patriarcat)
Femmes (Balzac Honoré de) (3) : 1832. Honoré de Balzac [1799-1850], dans Le colonel Chabert, auteur de :
« Les femmes croient les gens quand ils farcissent leurs phrases du mot amour. » 1254 (Relations entre êtres humains. Amour, Langage. Paroles, Patriarcat)
Femmes (Balzac Honoré de) (4) : 1834. Honoré de Balzac [1799-1850], dans La duchesse de Langeais, auteur de :
- « La France est souvent trompée, mais comme une femme l’est, par des idées généreuses, par des sentiments chaleureux dont la portée échappe d’abord au calcul. […] »
- « Les peuples, comme les femmes aiment la force en quiconque les gouverne, et leur amour ne va pas sans respect. » 1255
- « […] Jamais nation ne fut plus complaisante, elle était alors comme une femme fatiguée qui devient facile : jamais pouvoir ne fit alors plus de maladresse : la France et la femme aime mieux les fautes. » (Cf. Patriarcat, Politique)
Femmes (Balzac Honoré de) (5) : 1834. Honoré de Balzac [1799-1850], dans La duchesse de Langeais, auteur de :
« […] C’était une femme artificiellement instruite, réellement ignorante ; pleine de sentiments élevés, mais manquant d’une pensée qui les coordonnât ; dépensant les plus riches trésors de l’âme à obéir aux convenances ; prête à braver la société, mais hésitant et arrivant à l’artifice par suite de scrupules ; ayant plus d’entêtement que de caractère, plus d’engouement que d’enthousiasme, plus de tête que de coeur ; souverainement femme et souverainement coquette, Parisienne surtout ; aimant l’éclat, les fêtes ; ne réfléchissant pas ou réfléchissant trop tard ; d’un imprudence qui arrivait presque à la poésie ; insolente à ravir, mais humble au fond du cœur ; affichant la force comme un roseau bien droit, mais, comme ce roseau, prête à fléchir sous une main puissante ; parlant beaucoup de la religion, mais ne l’aimant pas, et cependant, prête à l’accepter comme un dénouement. […] » 1256
Femmes (Balzac Honoré de) (6) : 1834. Honoré de Balzac [1799-1850], dans La duchesse de Langeais, auteur de :
« […] La duchesse de Langeais avait reçu de la nature les qualités nécessaires pour jouer les rôles de coquette, et son éducation les avait encore perfectionnées. Les femmes avaient raison de l’envier, et les hommes de l’aimer. Il ne lui manquait rien de ce qui peut inspirer l’amour, de ce qui le justifie et de ce qui le perpétue. Son genre de beauté, ses manières, son parler, sa pose s’accordaient pour la douer d’une coquetterie naturelle, qui, chez une femme, semble être la conscience de son pouvoir. […] Mais pour la bien peindre ne faudrait-il pas accumuler toutes les antithèses féminines ; en un mot, elle était ce qu’elle voulait être ou paraître » 1257 (Cf. Femmes. « Coquettes ». « Féminin ». Paraître. Pouvoir, Relations entre êtres humains. Aimer. Amour, Patriarcat)
Femmes (Balzac Honoré de) (7) : 1847. Honoré de Balzac [1799-1850], dans Splendeurs et misères des courtisanes, auteur de :
« - J’ai commis la sottise de déployer tout ce talent pour mille écus !...
- Non, pour une femme ! reprit Jacques Collin. Quand je te disais quelles nous ôtent toute notre intelligence ! ... » 1258 (Cf. Dialogues, Patriarcat, Penser. Intelligence, Économie. Argent)
Femmes (Balzac Honoré de) (8) : 1847. Honoré de Balzac [1799-1850], dans Splendeurs et misères des courtisanes, auteur de :
« On ne se figure pas de quelle utilité sont les femmes de Paris pour les ambitieux en tout genre ; elles sont aussi nécessaires dans le grand monde que dans le monde des voleurs, où, comme on vient de le voir, elles jouent un rôle énorme. » 1259 (Cf. Femmes. Utiles, Penser, Utilitarisme)
Femmes (Balzac Honoré de) (9) : 1847. Honoré de Balzac [1799-1850], dans Splendeurs et misères des courtisanes, auteur de :
« […] Ce dernier mot fut toute la femme, la femme de tous les temps et de tous les pays. » 1260
-------------
Femmes. « Bas-bleus » :
Femmes (« Bas-bleus ») (1) : Combien de génies, de talents, d’intelligences, de passions, combien de germes de pensées et de vies, étouffées, détruites du fait de l’emploi, aux seules femmes, de ce qualificatif ?
N.B : « cuistre » n’est pas le masculin de « bas-bleus ». (Cf. Langage)
Par ordre chronologique. Femmes. « Bas-bleus » :
Femmes (« Bas-bleus ») (1) : 1878. Jules Barbey d’Aurevilly [1808-1889] écrit Les bas-bleus (341p.), dont le sous-titre est Les oeuvres et les hommes, mais dans lequel il présente plus d’une vingtaine de femmes écrivaines.
Femmes (« Bas-bleus ») (2) : 1802. Mary Robinson [1758-1800], dans les Mémoires de Mistriss Robinson, évoque « les dames du club nommé les Bas-Bleus », qu’elle décrit positivement comme « une société de savants célèbres et aimables », tandis qu’une note précise : « Mary Robinson acquit l’admiration de femmes cultivées et philanthropes que l’on appelait les Bas-bleus depuis des décennies. »
Serait-ce en traversant la Manche que le terme acquit une acception toute négative ? (Cf. Culture, Femmes. Écrivaines, Langage) 1261
Femmes (« Bas-bleus ») (3) : 1934. Émile Gérard-Gailly [1882-1974], acharné par ailleurs, à la détruire, dans Les véhémences de Louise Colet, la qualifie de : « bas-bleus vaniteux et dame vindicative ». 1262
Femmes (« Bas-bleus ») (4) : 1968. Alexandre Soljenitsyne [1918-2008], dans Le premier cercle, auteur de :
« Un bas-bleu, ça fait horreur à un homme… » 1263
Femmes (« Bas-bleus ») (5) : 1976. H.F Peters [1910-1990], dans le livre consacré à Lou Andreas Salomé [1861-1937], Ma sœur, mon épouse, écrit :
« Rien ne l’effrayait d’avantage que le spectacle de ces bas-bleus militants qui, en essayant d’affirmer leur égalité avec les hommes, cessaient d’être des femmes. » 1264
Femmes (« Bas-bleus ») (6) : 1995. Je lis dans un livre consacré à Schopenhauer [1788-1860] publié au Seuil :
« Toute sa vie, Schopenhauer considéra sa mère comme un bas-bleu. » 1265 (Cf. Femmes. Mères, Hommes. Remarquables, Langage, Patriarcat. Permanence, « Sciences » sociales. Philosophie)
Femmes (« Bas-bleus ») (7) : 1996. Je lis, en note, dans Benjamin Constant. Isabelle de Charrière. Correspondance. [1787-1805] :
« Julie Rieu [1755-1839]. Redoutable bas-bleu lausannois » 1266
Femmes (« Bas-bleus ») (8) : (25 mai) 2020. Entendu sur France Culture définir ainsi Les Bas-bleus :
« Ces femmes écrivains qui ont des prétentions intellectuelles. » 1267 (Cf. Femmes. « Intellectuelles »)
-------------
Femmes. Battues :
Femmes (« Battues ») (1) : Ces deux petits mots ont servi, pendant tant et tant d’années, à occulter, repousser, nier les violences patriarcales.
D’où la nécessité de fuir les pseudo-analyses fondées sur les seules victimes. (Cf. Violences)
Par ordre chronologiques. Femmes. Battues :
Femmes (« Battues ») (1) : (24 mai) 2019. Pour dissuader de jamais plus employer ces termes - ni aucun autre ici cité d’ailleurs - cf. le « grand reportage » de France Culture intitulée « Les jeune face à l’Europe ». On y apprend dans la bouche de la journaliste que des financements européens « à destination des publics dits fragiles, décrocheurs scolaires, anciens délinquants, sans domicile, femmes battues ou personnes handicapés [car ces publics-là sont prioritaires dans l’Europe de la formation, c’est en tout cas, c’est que ce qu’affiche la Commission européenne] ». 1268 (Cf. Êtres humains. Handicapés, Patriarcat, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
-------------
Femmes. Beauté :
Femmes (Beauté) (1) : Toute référence à la (supposée) beauté (ou non) d’une femme est - dois -je ajouter : selon moi ? - une injure (grossière) à l’intégrité de sa personne, par là même niée. En sus, elle confirme le droit de celui qui la juge ainsi de son bon droit à la juger ainsi. Refuser d’emblée toute appréciation sur ce fondement : mieux, que l’hypothèse même en soit exclue. L’intelligence, notamment masculine, un moment, déstabilisée, s’en trouverait fort bien, tandis que la concurrence entre femmes en serait d’autant allégée. Et la solidarité entre elles raffermie.
Femmes (Beauté) (2) : Évoquer la beauté d’une femme, c’est la faire vieillir avant l’heure.
Par ordre chronologique. Femmes. Beauté :
Femmes (Beauté) (1) : 1623. William Shakespeare [1564-1616], dans Henri VI, auteur de :
« Elle est belle, donc faite pour être courtisée ;
Elle est femme, donc faite pour être conquise. » [Acte V, 4 V.34, 35]
Femmes (Beauté) (2) : 1727. Marivaux [1688-1763], dans La vie de Marianne, auteur de :
« Car je n’avais que ma beauté qui pût me faire des amis. Et voyez quelle ressource que le vice des hommes ! N’était-ce pas là de quoi renverser une cervelle aussi jeune que la mienne ? » 1269 (Cf. Hommes. Féminismes. Marivaux)
Femmes (Beauté) (3) : (2 janvier) 1758. Voltaire [1694-1778] écrit à Nicolas-Claude Thieriot [1697-1772] :
« Nous avons [à Lausanne où il réside avec madame Marie-Louise Denis. 1712-1790] une fille du général Constant [1773-1850] et une belle-fille de ce fameux marquis de Langalerie [1661-1717] qui ont aussi les meilleures mœurs du monde quoi qu’elles soient assez belles pour en avoir de très mauvaises. » 1270 (Cf. Politique. Lois. Mœurs)
Par ordre chronologique. Femmes. Beauté. Denis Diderot :
Femmes (Beauté) (4) : (20 septembre) 1760. Denis Diderot [1713-1784], dans une lettre à Sophie Volland [1716-1784], auteur de :
« C’est comme une belle femme qui porte une grande âme et qu’on loue de sa beauté. Elle vous remercie d’une manière si froide et dédaigneuse ! C’est comme si elle vous disait : ‘Vous vous en tenez à l’écorce’. » Pertinent. 1271 (Cf. Femmes. Diderot Denis, Relations entre êtres humains. Aimer. Diderot Denis)
Femmes (Beauté) (5) : 1776. Denis Diderot [1713-1784], dans Entretien d’un philosophe avec Mme la Maréchale de ***, auteur de :
« Elle est belle, et quoi qu’elle soit très dévote, elle ne l’ignore pas. » 1272 »
Femmes (Beauté) (6) : 1796. La religieuse, sous la plume de Denis Diderot [1713-1784] s’interroge :
« […] Serait-ce que nous croyons les hommes moins sensibles à la peinture de nos peines qu’à l’image de nos charmes ? Et que nous promettrions encore plus de facilité à les séduire qu’à les toucher ? » 1273 (Cf. Patriarcat. Sensibilité des femmes)
-------------
Femmes (Beauté) (7) : 1769. Madame de Puisieux [Madeleine. 1720-1798] (attribution incertaine), dans La femme comme il y en a beaucoup, auteure de :
« Elle avait fait du bruit par sa beauté, parce que ce n’est guère que par cet avantage que les hommes considèrent une femme : celle dont le mérite est dénué des agréments de la figure est, par hasard, et par un très petit nombre, tirée de pair. Je l’ai dit ailleurs, les hommes n’ont que des sens pour nous apprécier. » 1274 (Cf. Hommes, Patriarcat, Penser)
Femmes (Beauté) (8) : 1772. Mary Wollstonecraft [1759-1797], dans sa Défense des Droits des femmes, considérait déjà que : « […] si […] les femmes ne renoncent pas au pouvoir arbitraire de leur beauté, ce sera la preuve qu’elles sont moins intelligentes que les hommes. » 1275 (Cf. Femmes. Intelligentes, Féministes. Wollstonecraft Mary)
Femmes (Beauté) (9) : 1796. Germaine de Staël [1766-1817], dans De l’influence des passions sur le bonheur des individus et des nations, écrit :
« La figure d’une femme, quelle que soit la force ou l’étendue de son esprit, quelle que soit l’importance des objets dont elle s’occupe, est toujours un obstacle ou une raison dans l’histoire de sa vie ; les hommes l’ont voulu ainsi. Mais plus ils sont décidés à juger une femme selon les avantages ou les défauts de son sexe, plus ils détestent de lui voir embrasser une destinée contraire à la nature. » 1276 (Cf. Êtres humains, Corps, Femmes. Vie-de- femmes, Hommes, Patriarcat, Sexes. Femmes)
Femmes (Beauté) (10) : (Après juillet) 1815. Benjamin Constant [1773-1830] écrit à Juliette Récamier [1777-1849] :
« Je m’acquitte avec un peu d’embarras d’une commission que madame de Krüdner [Barbara Julia von Krüdener. 1764-1824] vient de me donner. Elle vous supplie de venir la moins belle que vous pourrez. Elle dit que vous éblouissez tout le monde et que par-là toutes les âmes sont troublées et toutes les attentions impossibles. Vous ne pouvez pas déposer votre charme, mais ne le rehaussez pas. [...] » 1277 (Cf. Relations entre êtres humains. Attentions)
Par ordre chronologique. Femmes. Beauté. Honoré de Balzac :
Femmes (Beauté) (11) : 1830. Honoré de Balzac [1799-1850], dans Gobseck, auteur de :
« Elle était si belle que, malgré sa faute, je la plaignis. » 1278
Femmes (Beauté) (12) : 1841. Honoré de Balzac [1799-1850], dans Mémoires de deux jeunes mariées, auteur de :
« […] La beauté, ce rare privilège que Dieu seul donne […] » 1279
-------------
Femmes (Beauté) (13) : 1835. Nicolas Gogol [1809-1852], dans La perspective Nevsky, auteur de :
« La beauté produit de vrais miracles : tous les défauts moraux et intellectuels d’une jolie femme nous attirent vers elle, au lieu de nous en écarter, et le vice même, en ce cas, acquiert un charme particulier ; mais dès que sa beauté disparait, la femme est obligée d’être beaucoup plus intelligente que l’homme pour inspirer non pas l’amour, mais, simplement, le respect. » 1280
Par ordre chronologique. Femmes. Beauté. Émile Zola
Femmes (Beauté) (14) : (25 juillet) 1860. Émile Zola [1840-1902], dans une lettre à Jean-Baptiste Baille [1841-1918], lui cite ces vers [Namouna. Chant 2. strophe 5] d’Alfred de Musset 1810-1857] :
« La muse est toujours belle / Même pour l’insensé, même pour l’impuissant / Car sa beauté pour nous, c’est notre amour pour elle. » 1281 (Cf. Femmes. Muses, Hommes. « Impuissants », Relations entre êtres humains. Amour)
Femmes. Beauté (15) : 1876. Émile Zola [1840-1902], dans Son excellence Eugène Rougon, auteur de :
« Elle oubliait sa beauté pendant des semaines, ne s’en souvenait que dans quelque besoin ; et alors, elle s’en servait terriblement, comme d’une arme. » 1282
-------------
Femmes (Beauté) (16) : 1862. Victor Hugo [1802-1885], dans Les misérables, auteur de :
- « Cosette, à se savoir belle, perdit la grâce de l’ignorer. »
- « Se sachant belle, elle sentait bien, quoi que d’une façon indistincte, qu’elle avait une arme. Les femmes jouent avec leur beauté comme les enfants avec leur couteau. Elles s’y blessent. » 1283
Femme (Beauté) (17) : 1880. Théophile Zolling [1849-1901], journaliste allemand qui interviewa Louise Michel [1830-1905], auteur de :
« Louise Michel est laide, mais si l’on essaie d’oublier qu’elle est femme, sa laideur ne choque plus. » 1284 (Cf. Femmes. Remarquables. Michel Louise, Homme. Laid)
* Ajout. 21 mai 2019. Emma Goldman [1869-1940], auteure de :
« Louise Michel est anguleuse, décharnée et vieillie avant l’âge, mais ses yeux sont pleins de jeunesse et d’ardeur, et son sourire est si tendre qu’il a gagné mon cœur immédiatement. » 1285 (Cf. Femmes. Remarquables. Michel Louise)
* Ajout. 24 mai 2019. 1937. Margaret Goldsmith [1894-1971], dans Cinq femmes contre le monde, auteure de :
« Son dernier portrait [celui de Louise Michel] exécuté alors qu’elle était sexagénaire, nous montre des traits virils, marqués par les stigmates d’une longue vie de luttes et d’épreuves. Elle portait les cheveux plus longs qu’il n’était d’usage parmi les femmes affranchies de sa génération, mais l’ensemble de sa tête demeurait essentiellement masculine. Le bas du visage évoque certain portrait de Frédéric le Grand : le front large et dénudé, aux lignes sévères, pourrait convenir à un vieux guerrier. Le nez disgracieux et trop long illustre avec justesse cette boutade de Napoléon [1769-1821] : ‘Lorsque je veux un chef habile et s’il possède déjà les qualités requises, je le choisis avec un long nez’. Son corps était plat et anguleux, ignorait les lignes arrondies et la douceur des courbes : il n’y avait aucune féminité en Louise Michel. » 1286 (Cf. Corps. Visage, Femmes. Remarquables. Michel Louise, Hommes. « Virils », Patriarcat. « Féminité »)
Femmes (Beauté) (18) : Jules Janin [1804-1874] concernant Flora Tristan [1803-1844] :
« […] Toute jeune qu’elle était, on comprenait tout de suite qu’elle ne s’inquiétait plus de plaire ou d’être trouvée belle ; c’était pour elle une émotion oubliée ou méprisée. » 1287
Femmes (Beauté) (19) : 1893. Jules Massenet [1842-912] [livret de Louis Gallet], dans son Opéra Thaïs, auteur de :
« (Thaïs à son miroir) « Dis-moi que je suis belle et que je serai belle éternellement. » (Cf. Culture. Musique, Femmes. Miroir)
Femmes (Beauté) (20) : Hedy Lamarr [1914-2000], actrice, auteure de :
« […] ma beauté, comme un masque que je ne peux pas enlever. » 1288 (Cf. Corps, Femmes. Artistes. Miroir)
Femmes (Beauté) (21) : (30 janvier) 1915. Guillaume Apollinaire [1880-1918], dans Lettre à Lou :
« Et sois la plus heureuse étant la plus jolie ».
Femmes (Beauté) (22) : (30 mars) 1941. Paul Claudel [1869-1955], dans son Cahier VIII, auteur de :
« Ces belles femmes q[ui] sont un danger public et qu’on devrait mettre en prison ». 1289 (Cf. Femmes. Enfermées, Langage. Mots. Critique de : « On », Politique. Prison)
Femmes (Beauté) (23) : (février) 1957. Georges Bataille [1897-1962], dans un article paru dans Critique, intitulé Emily Brontë, [1818-1848] auteur de :
« Car le destin, qui, selon toute l’apparence voulut qu’Emily Brontë, encore qu’elle fût belle, ignorât l’amour absolument […]. » 1290
Femmes (Beauté) (24) : 1969. Lu dans le Dictionnaires des femmes célèbres concernant Marie-Louise d’Autriche [1791-1847], deuxième épouse de Napoléon [1769-1821] :
« Marie-Louise ne fut jamais populaire. Elle était cependant belle, svelte, blonde aux yeux bleus ; elle avait seulement contre elle la lèvre des Habsbourg et le teint un peu haut en couleur. » 1291 (Cf. Êtres humains, Corps)
Femmes (Beauté) (25) : 1980. Jacques Prévert [1900-1977], auteur de :
« Sois belle et tais-toi ! Je souriais, j’étais belle et j’étais moi. » 1292 (Cf. Êtres humains. Soi, Féminismes)
Femmes (Beauté) (26) : 1995. Jean Tulard, dans Guide des films. 1895-1995. L-Z, auteur de :
- Sheena, reine de la jungle [1984. John Guillermin] : « Guillermin essaie de retrouver les charmes du sérail et Tanya Roberts est ravissante. De quoi peut-on se plaindre ? »
- Si tu crois, fillette… [1970. Roger Vadim] : « Roger Vadim (dont c’est la première réalisation américaine) aime les belles femmes et il a bien raison. » 1293 (Cf. Culture. Cinéma)
Femmes (Beauté) (27) : 2004. Elena Ferrante, dans Les jours de mon abandon, auteure de :
« Je pensais à la beauté comme un effort constant pour effacer le corporel. » 1294 (Cf. Corps)
Femmes (Beauté) (28) : (2 mars) 2020. Entendu affirmer l’ « association permanente de la beauté et du savoir ». 1295
Absurde.
Femmes (Beauté) (29) : (26 décembre) 2020. Alain Finkielkraut, auteur de :
« Elle n’est pas gâtée par la nature. » 1296
-------------
Femmes. « Bégueules » :
Femmes (« Bégueules ») (1) : Dictionnaire : « Femme Bégueule. Nom féminin et adjectif. Femme qui manifeste une pruderie affectée. »
Femmes (« Bégueules ») (2) : Elle riait, comme eux, de leurs ‘plaisanteries’ obscènes ; qualifiée de : « pas bégueule », elle fut intégrée à leurs bordées.
-------------
Femmes (Besoin d’être aimées) : Le besoin d’être aimées que l’on a si souvent reproché aux femmes n’était - n’est toujours, pour beaucoup d’entre elles - que l’expression nécessaire, exprimée selon les normes socialement acceptées, d’une sécurité matérielle, pour elles et leurs enfants, ou, plus justement, d’une croyance à ladite sécurité, affective et matérielle liées. En réalité : un leurre. Mais la question de la sécurité est bien là…
Pour approfondir la réflexion, Cf. Joseph Joubert [1754-1824] :
« Les hommes prennent le parti d’aimer ceux qu’ils craignent afin d’en être protégés. » 1297 Puissant. (Cf. Êtres humains. Relations entre êtres humains. Amour, Famille. Mariage, Langage. Mots. Critiques de mots : « Protéger »)
Par ordre chronologique. Femmes. « Bêtes » :
Femmes (« Bêtes ») (1) : 1748. Denis Diderot [1713-1784], dans Les bijoux indiscrets, auteur de :
« - Sultane, votre sagacité me donne de l’humeur.
- C’est-à-dire que vous m’aimeriez un peu bête. » 1298 (Cf. Dialogues, Relations entre êtres humains. Aimer)
Femmes (« Bêtes ») (2) : 1841-1870. Prosper Mérimée [1803-1870], dans Lettres à une inconnue, auteur de :
« J’ai été à un bal donné par des jeunes gens de mes amis, où étaient invitées toutes les figurantes de l’Opéra [« faire les vautours, les singes ou les diables à l’Opéra »]. Ces femmes sont bêtes pour la plupart, mais j’ai remarqué combien elles sont supérieures en délicatesse morale aux hommes de leur classe. Il n’y a qu’un seul vice qui les sépare des autres femmes, c’est la pauvreté. » 1299 (Cf. Patriarcat, Économie. « Pauvres Les »)
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Biens :
Femmes (Biens) (1) : 1731. Antoine François Prévost [1697-1763], dans Manon Lescaut, auteur de :
- « Je consolais Manon, en avançant ; mais, au fond, j’avais le désespoir au cœur. Je me serais donné mille fois la mort, si je n’eusse pas dans mes bras, le seul bien qui m’attachait à la vie. Cette seule pensée me remettait. Je la tiens du moins, disais-je ; elle m’aime, elle est à moi. Tiberge a beau dire : ce n’est pas là un fantôme de bonheur. »
- « J’avais perdu, à la vérité, tout ce que le reste des hommes estime ; mais j’étais maître du cœur de Manon, le seul bien que j’estimais. » 1300
Femmes (Biens) (2) : 1827. Alessandro Manzoni [1785-1873], dans Les fiancés, auteur de :
« Renzo était absent, chassé, banni, si bien que tout devenait licite contre lui, et que sa fiancée même pouvait être considérée, en quelque sorte, comme bien de banni. » 1301 (Cf. Famille. Couple, Patriarcat, Économie)
Femmes (Biens) (3) : 1982. Jean Cazeneuve [1915-2005], dans La vie dans la société moderne, auteur de :
- « Dans les sociétés primitives, par exemple chez les Peaux rouges, les jeux de hasard où l’on risquait tous ses biens, y compris ses épouses […]. »
- « Le rituel du potlatch fait s’affronter deux clans derrière leurs chefs. Au risque de se ruiner, chacun tente d’écraser par ses largesses son rival, qui se trouve obligé d’accepter et de rendre, en faisant preuve de plus de générosité encore, sous peine de perdre la face. Aussi passent de mains en mains les biens matériels ou spirituels qui comptent dans la tribu : les couvertures, les objets de cuivre, les bijoux, les femmes, les blasons totémiques. » 1302 (Cf. Langage. Zeugma, « Sciences » sociales. Ethnologie, Économie. Jeux de hasard)
Femmes (Biens) (4) : 2000. Claude Lefort [1924-2010], présentant positivement les thèses de Marcel Mauss [1872-1950], dans son Essai sur le don, auteur de :
« Pas d’échanges de biens entre des individus ; les partenaires sont des collectivités. Ce ne sont pas seulement des biens plus ou moins précieux qui sont échangés, mais des fêtes, des festins, des politesses, des services militaires, des femmes. » 1303
Les femmes : ni des individues, ni même des biens… des échanges immatériels « plus ou moins précieux » ? (Cf. Langage. Zeugma, « Sciences » sociales. Ethnologie)
-------------
Femmes (Bijoux) : Combien de morts d’hommes, dans les mines notamment, pour les bijoux d’argent, d’or, de pierres précieuses portés par les femmes ? (Cf. Économie)
Femmes. « Bonnes-à-tout-faire », employées de maison, gouvernantes, femmes-de-chambre, femmes de ménage, femmes de peine, femmes de charge, femmes de journée, filles de cuisine… :
Femmes (« Bonnes-à-tout-faire » […]) (1) : Elles étaient considérées comme « bonnes à rien », elles furent donc logiquement affectées à être « bonnes à tout [faire] ». Y compris à être violées.
Il en fut peu ou prou de même pour les « filles de cuisines » (renvoyées par la Françoise de Proust), les « femmes-de-chambre », les « employées-de-maison », les « femmes-de-ménage », les « femmes de charge » (André Maurois), les « femmes-de-journée », les « femmes-de-peine ») …
* Ajout. 26 octobre 2018. J’entends le chiffre de 7 millions de femmes « employées de maison » au Brésil : permanences de l’esclavage ? 1304
* Ajout. 27 septembre 2021. Variante : George Sand [1804-1876] espère « une très bonne cuisinière faisant tout. » 1305
Femmes (« Bonnes-à-tout-faire » […]) (2) : les « bonnes à tout-à-faire » : les premières travailleuses polyvalentes, éternellement non qualifiées. Et pourtant, elles devaient savoir et / ou apprendre à « faire » le ménage, le service à table, la vaisselle, l’argenterie, les vitres, les parquets, les courses, les lits, le lavage et le repassage du linge, la poussière, la cuisine...
Et souvent, en plus, à « s’occuper » des enfants.
Pourtant jamais ces qualifications ne leur furent reconnues ; pas plus qu’à leurs ‘patronnes’- terme souvent bien inapproprié, car l’argent qui leur était chichement versé était le plus souvent celui de leur mari.
Femmes (« Bonnes-à-tout-faire » […]) (3) : Quand on refuse le terme de « bonnes », de « femmes de chambre » …, on ne peut que récuser - en refusant, en critiquant l’emploi contemporain et en resituant dans son contexte historique l’emploi ‘autrefois’ - celui de de « valet » (dont j’ai découvert sa permanence, à l’occasion de la grève du Royal Monceau. 2014), de « valet de pied » (évoqué par Marcel Proust), 1306, de « valet de chambre » (évoqué par Émile Zola), de « valet d’écurie » (lu en note dans le Journal de Léon Tolstoï), comme celui d’« homme de ménage », d’« homme-à-tout-faire », comme d’« homme toutes mains », comme l’ai-je entendu une fois... (Cf. Êtres humains. Valets)
Femmes (« Bonnes-à-tout-faire » […]) (4) : Il est acquis, rarement remis en cause, depuis des siècles, qu’être « bonne-à-tout faire […] » est à la portée de toutes les femmes, n’exige aucune qualification. Mais alors, pourquoi tant d’exigences à leur embauche, tant de renvois pour incompétence ? Pourquoi les transmissions de savoir-faire - si souvent sous formes d’ordres, de dressage, de domestication, qui furent autant de violences, d’humiliations - de leurs employeuses ne sont-elles jamais prises en compte ? Ne leur fut-il pas transféré autant de qualifications, qui souvent nécessitaient des années d’apprentissages ? Et si ces tâches étaient si faciles, ni ‘naturelles’, pourquoi les hommes se sont-ils si souvent considérés comme inaptes, incapables, incompétents ?
Par ordre chronologique. Femmes. « Bonnes-à-tout-faire », employées de maison, gouvernantes, femmes-de-chambre, femmes de ménage, femmes de peine, femmes de charge, femmes de journée, filles de cuisine… :
Femmes (« Bonnes-à-tout-faire » […]) (1) : 1727. Marivaux [1688-1763], dans La vie de Marianne, auteur de :
« Dans ces entrefaites, la plus ancienne de deux femmes de chambre qu’elle avait, vieille femme qui avait toute sa confiance, et qui la servait depuis vingt-cinq ans, tomba malade d’une fièvre aiguë qui l’emporta en six jours de temps.
Mme Dursan en fut consternée ; il est vrai qu’à l’âge ou elle était, il n’y a point de perte égale à celle-là.
C’est une amie d’une espèce unique que la mort vous enlève en pareil cas, une amie de tous les instants, à qui vous ne vous donnez pas la peine de plaire ; qui vous délasse de la fatigue d’avoir plu aux autres ; qui n’est pour ainsi dire, personne pour vous, quoi qu’il n’y ait personne qui vous soit plus nécessaire ; avec qui vous êtes aussi rebutante, aussi petite d’humeur et de caractère que vous avez quelquefois besoin de l’être, avec qui vos infirmités les plus humiliantes ne sont que des maux pour vous, et point une honte ; enfin une amie qui n’en a pas même le nom, et que souvent vous n’apprenez que vous aimiez que lorsque vous ne l’avez plus, et que tout vous manque sans elle. Et voilà le cas où se trouvait Mme Dursan, qui avait près de quatre-vingt ans. » 1307 (Cf. Femmes. Âgées, Relations entre êtres humains. Amitié)
Femmes (« Bonnes-à-tout-faire » […]) (2) : (9 mai) 1755. Voltaire [1694-1778], dans une lettre à Nicolas-Claude Thieriot [1697-1772], auteur de :
« Mais vous qui [contrairement à son épouse] pouvez vous passer d’un cabinet de toilettes et d’une femme de chambre […]. » 1308 (Cf. Langage. Zeugma)
Femmes (« Bonnes-à-tout-faire » […]) (3) : 1847. Charlotte Brontë [1816-1855], dans Jane Eyre, auteure de :
« Il faudrait que vous entendiez maman parler sur ce chapitre [celui de l’« économie »] des gouvernantes ; Mary et moi, nous en avons eu, j’imagine, une bonne douzaine dans notre enfance ; la moitié étaient odieuses, les autres, ridicules, et toutes encombrantes… n’est-il pas vrai, maman ? […]
Ma bien-aimée, ne me parle pas de gouvernantes ; ce mot suffit à me rendre nerveuse. Leurs incompétences et leurs caprices m’ont fait subir le martyre ; je rends grâce au Ciel de n’avoir plus affaire à elles désormais. » 1309
Par ordre chronologique. Femmes. Bonnes-à-tout-faire » […]. George Sand :
Femmes (« Bonnes-à-tout-faire » […]) (4) : (5 septembre) 1868. George Sand [1804-1876], dans une lettre à sa belle-fille Lina Calamatta-Sand [1842-1901], auteure de :
« Peut-être serais-tu contente d’avoir Marie [Caillaud ?] en ce moment pour dresser la nouvelle bonne que tu prendras. » 1310
Femmes (« Bonnes-à-tout-faire » […]) (5) : (28 septembre) 1868. George Sand [1804-1876], dans une lettre à sa belle-fille Lina Calamatta-Sand [1842-1901, auteure de :
« Je crois qu’elle te plaira. […] Elle sait faire tout, bien qu’elle dise qu’elle ne sait rien. […] Elle est très modeste et d’une bonne volonté entière, pas vantarde, ni parleuse et promettant d’apprendre et de faire tout ce qu’on voudra. Elle accepte les 30 par mois. […] » 1311 (Cf. Femmes. Modestes)
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. « Bonnes-à-tout-faire » […]. Émile Zola :
Femmes (« Bonnes-à-tout-faire » […]) (6) : 1882. Émile Zola [1840-1902], dans Pot-Bouille, auteur de :
« Puis les premières discussions - dans le couple, Auguste et Berthe - avaient éclaté, au sujet des bonnes. La jeune femme, accoutumée à un service abêti de pauvres filles auxquelles on coupait leur pain, exigeaient d’elles des corvées, dont elles sanglotaient dans leur cuisine, pendant des après-midi entières. Auguste, peu tendre pourtant d’habitude, ayant eu l’imprudence d’aller en consoler une, avait dû la jeter à la porte une heure plus tard, devant les sanglots de madame, qui lui criant furieusement de choisir entre elle et cette créature. » 1312 (Cf. Femmes. Abêtissement. Jalouses. Licenciées. Pleurs, Famille. Couple, Penser. Pensées. Binaires, Économie. « Pauvres Les »)
Femmes (« Bonnes-à-tout-faire » […]) (7) : 1882. Émile Zola [1840-1902], dans Pot-Bouille, auteur de :
« (Le mari découchant tous les mardi) Mais Berthe, jusque-là s’était refusée à profiter de cette nuit de liberté [avec son amant]. Elle tremblait devant sa bonne, elle craignait qu’un oubli ne la livrât aux mains de cette fille. » Préalablement Émile Zola avait écrit :
« Pourtant Berthe n’était pas sans une sourde inquiétude devant Rachel, dont elle surprenait toujours le regard fouillant sa personne. Ça se voyait donc ? Une fille à renvoyer où à acheter décidément. » 1313 (Cf. Femmes. Filles)
-------------
Femmes (« Bonnes-à-tout-faire » […]) (8) : (22 décembre) 1906. Paul Léautaud [1872-1956], dans son Journal littéraire évoquant Charles-Louis Philippe [1874-1909], écrit :
« Il avait une femme de ménage, sorte de forme vague, peu femme, une femme de ménage, quoi ! » 1314 (Cf. Êtres humains, Corps, Femmes. Femmes-de-ménage. Travail)
Femmes (« Bonnes-à-tout-faire » […]) (9) : 1920. Katia Mann [1883-1980], épouse de Thomas Mann [1875-1955], contrainte de partir en convalescence, confia à sa fille Erika, alors âgée de 15 ans sa « suppléance » et notamment la charge de surveiller les « tâches domestiques ». Voici ce qu’elle lui écrivit concernant la « domestique » :
« Elle doit commencer le matin à 7 heures : te coiffer ?. Apporter le petit-déjeuner, préparer l’eau pour le bain. Au plus tard à 8 heures, balayage de la chambre à coucher des garçons et de la salle de jeu, du vestibule, du haut de la cage d’escalier, des chambres des enfants, de Moni et de Mademoiselle, de la salle de bains. Les sols seront balayés, passés à la serpillère mouillée, la poussière enlevée, et les matelas de lits retournés tous les jours. Selon moi, elle aura terminé facilement vers 10h, 10 h 30. Elle aura (sic) aussi nettoyé l’ensemble des escaliers et les buffets. Après quoi, elle s’accorde (sic) une pause pour déjeuner. Elle lave ensuite la vaisselle. » Et l’auteure du livre consacré à la famille Mann, poursuit : « Et cela continue ainsi jusqu’au soir. » 1315
N.B. Connaître ‘la suite’ de la journée serait fort intéressant. (Cf. Êtres humains. Domestiques, Enfants, Femmes. Bourgeoises. Maîtresses de maison, Famille. Filles aînées)
Femmes (« Bonnes-à-tout-faire » […]) (10) : (4 août) 1926. Georges Bernanos [1888-1948], écrit à Cosmao Dumanoir [?-?] :
« Je travaille six heures par jour à mon roman, j’occupe le reste de mon temps à répondre à des lettres, ou à aider ma femme au ménage, car nous n’avons pas de bonne ! » 1316
Femmes (« Bonnes-à-tout-faire » […]) (11) : 1935. Clara Malraux [1897-1982], dans Le bruit de nos pas, évoquant l’appartement de Louis Aragon [1897-1982] et Elsa Triolet [1896-1970] écrit :
« Comparés avec eux, nous [elle et André Malraux. 1901-1976] vivions dans le luxe. Leur appartement de la rue de la Sourdière, minuscule était dépourvu de bonne. » 1317
Disparaissent les « êtres humains » et donc les femmes. (Cf. Femmes. Bourgeoises. Comment faire disparaître les femmes ? Conscience de classe. Ornements [décoratifs]. Travail)
Femmes (« Bonnes-à-tout-faire » […]) (12) : 1966. Sembène Ousmane [1923-2007], auteur de : La noire de … (Cf. Culture. Cinéma)
Femmes (« Bonnes-à-tout-faire » […]) (13) : 1974. Françoise Giroud [1916-2003], qui fut secrétaire d'état auprès du Premier ministre, chargée de la Condition féminine entre juillet 1974 et août 1976, évoquait dans son Journal d’une Parisienne : « [sa] servante », « [sa] fidèle servante », « [sa] soubrette ».
Elle écrivait aussi, dans le même livre :
« Les rapports d’un homme, d’une femme avec les subalternes ne sont jamais insignifiants. »
Certes… 1318 (Cf. Femmes. « Féminin ». Servantes. « Politiques ». Travail, Langage. Possessif, Politique. Exploitation)
Femmes (« Bonnes-à-tout-faire » […]) (14) : 2014. Entendu : « Je suis à la fois la sonnette et la réponse à la sonnette. »
- Enrichit le concept d’exploitation ? 1319 (Cf. Femmes. Travail)
* Ajout. 20 janvier 2021. George Eliot [1819-1880], dans Middlemarch, auteure de :
« Ce fut une domestique qui répondit à l’appel de la sonnette. » 1320
N.B. Dans certaines maisons, la sonnette pour appeler « la bonne » était cachée, invisible, sous la table et / ou posée sur la table à côté de la « maîtresse de maison ». (Cf. Femmes. « Maîtresses de maison »)
Femmes (« Bonnes-à-tout-faire » […]) (15) : (30 juillet) 2019. Entendu concernant Céleste Albaret [1891-1944], l’expression de : « personne ancillaire ». 1321 (Cf. Êtres humains, Femmes. Remarquables. Albaret Céleste, Langage)
-------------
Femmes (« Bons Pasteurs ») : L’histoire et la dénonciation des tortures, enfermements, violences, sadismes, mépris, sans oublier le travail non payé, etc.…qui ont été le quotidien de tant de femmes pendant des siècles par les institutions du Bon Pasteur reste à écrire. On peut se référer à l’article de Jacques Tremintin, l’Internationale de la maltraitance (26 avril 2010) :
« Se retrouvaient enfermées dans ces établissements les rebelles, avec à leur actif fugues, petits larcins, ‘mauvaises fréquentations’, mais aussi les orphelines, les enfants de familles dissociées, et celles qui ‘ont connu la vie’ selon l’expression d’alors. Considérées comme dangereuses ou en danger, les voilà sous la coupe réglée des sœurs du Bon Pasteur. Privation de sommeil, d’hygiène, de vêtements adaptés, de nourriture suffisante, travaux épuisants, punitions corporelles, cachot, une discipline carcérale, tel était leur quotidien. Sans oublier l’isolement, la terreur, le refus de la féminité qui n’avait rien à envier au sort des femmes enfermées sous la burka. Et l’endoctrinement religieux, à toute heure du jour et de la nuit.
Au mépris de la loi de séparation [de l’église et de l’état], c’est l’État le plus souvent qui chargeait ces congrégations de corriger les mauvaises têtes, et ce jusque dans les années 1960. Il s’agit de faire d’elles, selon les prescriptions officielles, de bonnes ménagères ou des religieuses, ces jeunes filles devant pour cela être ‘élevées en commun, sous une discipline sévère et appliquées aux travaux qui conviennent à leur sexe.’ Communiquer à l’extérieur était impossible. Une fois libérées, auraient-elles eu la force de parler de ce qu’elles avaient enduré, personne ne les aurait crues, du moins jusqu’à ces dernières années. Le traumatisme ne pourra s’effacer, même par la thérapie du témoignage. Ce sont des enfances, des jeunesses brisées, volées. Par ces religieuses, par leur hiérarchie, par l’État qui leur abandonne ces malheureuses fillettes, par la bonne société qui les rejette. » 1322
La responsabilité de l’église catholique, mais aussi de l’État français qui s’est déchargé, sans contrôle, sur les Bons Pasteurs, est engagée.
Pourquoi ce qui a été dénoncé concernant Casa Pia au Portugal, les Laveries de sœurs de Marie-Madeleine en Irlande, la dénonciation des « enfants enlevés » en Espagne ne l’est-il pas concernant les Bons Pasteurs en France ?
N.B. Lire le chapitre concernant Marie Rose dans l’excellent livre de Maud Marin, Tristes plaisirs. 1323 (Cf. Enfants. Enfermement, Femmes. Enfermées. Jeunes filles. Rebelles. Religieuses, Langage. Patriarcat. « Féminité ». Église catholique, Politique. Tortures, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
Femmes (Bouleversées) : Pourquoi ce qui bouleverse tant de femmes laisse-t-il tant d’hommes - au mieux - indifférents ? (Cf. Culture. « Mélo »)
Femmes. Bourgeoises :
Femmes. Bourgeoises (1) : Dans la tradition politique marxiste, qualifier, dénoncer « les [femmes] bourgeoises » - laquelle se prolongea dans la pensée féministe - sans pour autant nier les présupposés, les acquis, les préjugés, les agissements, y compris criminels bourgeois - c’est non seulement nier leur statut dans la famille et l’État patriarcal, mais aussi, en les enfermant dans leur seule classe, censée être leur seule identité, c’est aussi dénier les valeurs auxquelles elles pouvaient adhérer.
Femmes. Bourgeoises (2) : Il ne suffit pas à une bourgeoise de n’avoir aucun mépris de classe ; encore faut-il qu’elle ne soit pas d’emblée perçue comme une bourgeoise.
Femmes. Bourgeoises (3) : Faute de se penser et comme femme, et comme bourgeoise, et comme française, et comme « occidentale », comment penser le patriarcat ?
Par ordre chronologique. Femmes. Bourgeoises :
Femmes (Bourgeoises) (1) : (17 janvier) 1869. George Sand [1804-1876], dans une lettre à Gustave Flaubert [1821-1880], auteure de :
« Le mot pignouf a sa profondeur, il a été créé pour les bourgeois exclusivement, n’est-ce pas ? Sur cent bourgeoises de province, quatre-vingt-dix sont des pignoufladres renforcées, même avec des jolies petites mines qui annonceraient des instincts délicats. On est tout surpris de trouver un fond de suffisance grossières dans ces fausses dames. Où est la femme maintenant ? Ça devient une excentricité dans le monde. »
N.B. En note : « Pignouf » [terme employé par Gustave Flaubert] : « individu mal élevé, indélicat ». 1324
Femmes (Bourgeoises) (2) : 1921. Alexandra Kollontaï [1872-1952], lors d’une série de conférences, sous le titre de : La révolution des mœurs - publiées en 1923 -, à l’Université Sverdlocsk de Moscou, destinées aux futures militantes des organisations ‘féminines’, après avoir critiqué « ces dames de la bourgeoisie, récemment encore parasites » […] qui « faisaient des crises de nerfs si leur mari ne leur donnait pas d’argent pour acheter le nouveau chapeau de printemps ou une nouvelle paire de chaussures », poursuit :
« Il faut dire cependant, pour être juste, que les femmes de la ci-devant classe bourgeoise ont supporté parfois avec courage - avec plus de courage que leurs intellectuels de maris (sic) - toutes les peines de la période du communisme de guerre, apprenant à concilier leur travail et leur ménage, luttant contre les privations et la désorganisation perpétuelle de la vie. […] » 1325 (Cf. Femmes. « Féminin ». Remarquables. Travail. « Voilées », Féminismes. Antiféminisme)
Femmes (Bourgeoises) (3) : 1931. Emma Goldman [1869-1940], dans Vivre ma vie, rapporte ses échanges avec Liza [?-?], épouse de Sergeï Zorine [1891-1937], à Moscou en 1920 :
« Elle attendait un enfant, et je la pressais de l’aider à préparer quelques affaires pour le bébé ; ‘Penses-tu, répondit-elle. En Russie prolétarienne, personne ne se tracasse pour la layette ; ces histoires-là, nous les laissons aux bourgeoises gâtées des pays capitalistes. Nous autres avons des choses plus importantes à faire.’ Je lui rétorquai que les bébés du présent devaient devenir les héritiers de cet avenir pour lequel elle œuvrait. Ne fallait-il tenir compte de leurs besoins de base dès avant leurs naissances ? Mais Liza écarta mon point de vue d’une plaisanterie et m’accusa de sentimentalité, tout le contraire de la combattante qu’elle avait vu en moi. […] » 1326
Femmes (Bourgeoises) (4) : 1938. Virginia Woolf [1882-1941], dans Trois guinées, concernant celles qu’elle nomme : « les filles d’hommes cultivés » [ce qui n’est pas synonyme de « bourgeoises » mais permet de réfléchir] écrit :
« […] Nous ne sommes pas seulement, et sans comparaison, plus faibles que les hommes de notre propre classe ; nous sommes plus faibles que les femmes de la classe ouvrière. Que les ouvrières de notre pays viennent à dire : ‘Si vous faites la guerre, nous refuserons de fabriquer des munitions ou d’aider à la production‘, les difficultés inhérentes à la guerre augmenteraient considérablement. Mais si toutes les filles d’hommes cultivés se mettaient en grève demain, cela ne changerait rien d’essentiel à la vie de la communauté ou à la conduite de la guerre. Notre classe est la plus faible de toutes les classes. Nous ne disposons d’aucune arme pour imposer notre volonté. »
Puis, elle récuse l’argument de « l’influence » …
Virginia Woolf, considère in fine, que ce n’est pas le droit de vote, mais « le droit de gagner leur vie » qui leur permet d’accéder sinon à une influence, du moins à la possibilité de « critiquer », de « détenir enfin une influence désintéressée » ; cependant, là encore, en rien comparables au pouvoir des hommes. 1327 (Cf. Femmes. Faibles, Relations entre êtres humains. Comparaison)
Virginia Wolf dénie ici, dans une vision étroitement, strictement matérialiste, tout pouvoir à la pensée.
Femmes (Bourgeoises) (5) : 1960. Pierre Reboul [1918-1989], alors professeur à la faculté des lettres de Lille, spécialiste de George Sand [1804-1876], en commentaire d’une lettre dans laquelle celle-ci écrivait en 1836 qu’elle modifiait le personnage de Trenmor dans Lélia [1833] de fait sans aucun rapport avec cette lettre - écrivait :
« En son pharisaïsme de grande bourgeoise progressiste, elle s’effrayait de la bassesse de ses origines. » 1328 Ce qui est archi-faux par ailleurs.
- Le même écrivait, concernant toujours Lélia, concernant un passage du livre :
« L’auteur [e] n’a même pas pris la peine de se documenter, voire de réfléchir. » […] suivi de :
« L’auteur[e] écrit au fil de la plume, selon les caprices de son imagination […] », crime effectivement insigne pour une romancière.
Le lien entre ces deux citations permet de mieux saisir ce qui, si souvent, se cache de mépris des femmes, lorsqu’il dénonce les « femmes bourgeoises. »
Femmes (Bourgeoises) (6) : 1972. Sándor Márai [1900-1989], dans Mémoires de Hongrie, dénonce « l’exploitation éhontée des bonnes par leurs maîtresses ». Universel. 1329
Femmes (Bourgeoises) (7) : 1974. Lu dans les Nouvelles Lettres portugaises :
« Je réponds à qui dit que le problème de la femme est petit bourgeois, d’origine bourgeoise [qu’il] oublie que la bourgeoisie s’est installée sur une terre déjà faite à la sueur des femmes. » 1330 Forte analyse. (Cf. Féminismes. Bourgeois. Marxisme, Politique. Marxisme, Histoire. Révolution française. Femmes. Pain)
Femmes (Bourgeoises) (8) : 1974. Jean-Paul Sartre [1905-1980], dans On a raison de se révolter, auteur de :
« Il faudrait approfondir les rapports des femmes et des classes. Par exemple, beaucoup de femmes de bourgeois sont (vérifier le mot) par leur mari. J’en connais qui n’avaient d’autre argent que celui de leur mari et qui, après divorce, se sont retrouvées avec une pension de 600 francs par mois et deux enfants. Ça les mettait en dessous du S.M.I.C. Elles vivent encore avec ça, elles n’ont pas trouvé de métier. » 1331 (Cf. Famille. Divorce. Pensions alimentaires, Féminismes. Bourgeois, Politique. Révolte)
Femmes (Bourgeoises) (9) : 1975. Erin Pizzey, dans Crie moins fort, les voisins vont t’entendre, auteure de :
« Ce que je sais, c’est que si les femmes battues commencent à se faire entendre, c’est parce que, pour la première fois, une femme de classe moyenne a dit : ‘Ça m’est arrivé à moi’. » 1332 (Cf. Violences. Violences à l’encontre des femmes)
Femmes (Bourgeoises) (10) : 1976. Ménie Grégoire [1919-2014], dans Telle que je suis, auteure de :
« Le métier de mon mari [conseiller d’État] m’avait permis à chaque voyage, d’avoir des contacts politiques à un très haut niveau, où que je sois allée, et de nouer des amitiés essentielles avec des femmes de premier plan. La révoltée dont je parlais [« être une femme tout en restant femme »] ne pouvait s’adresser à [critiquer ?] la ‘tutelle masculine’, alors que, comme toutes les bourgeoises, j’en avais profité et je m’y étais trouvée. » 1333 (Cf. Femmes. Devenir une femme, Famille. Mariage)
N.B. « Comme toutes les bourgeoises » : non.
Femmes (Bourgeoises) (11) : (18 avril) 2018. Mathieu Delormeau, « chroniqueur » de l’émission de Cyril Hanouna Touche pas à mon poste [TPMP], auteur de :
« Les bourgeoises, c’est les plus chaudes. » 1334
Femmes (Bourgeoises) (12) : (janvier) 2019. Concernant le film Le monde des Bouffons du Québécois Pierre Falardeau [1946-2009], je lis dans la présentation qu’en fait Le Monde Diplomatique qu’il « emprunte au registre de l'ethnographie : il observe la bourgeoisie coloniale canadienne comme l'anthropologue Jean Rouch [1917-2004] étudiait les tribus, avec leurs rites, leurs hiérarchies et leurs costumes. » […]
Toute la rapace est là : des boss, pis des femmes de boss, des barons de la finance, des rois de la pizza congelée, des mafiosos de l'immobilier [...] des journalistes rampants habillés en éditorialistes serviles, des avocats véreux, costumés en juges à 100.000 dollars par année, des lèche-culs qui se prennent pour des artistes ».
En regardant le film, j’entends que sont aussi citées « les bonnes femmes au cul serré ». 1335 (Cf. Culture. Cinéma, Corps, Femmes, Langage. Zeugma, Patriarcat, « Sciences » sociales. Ethnologie)
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Bouquets :
Femmes (Bouquets) (1) : Madame Constance Wilde [1859-1898], épouse d’Oscar Wilde [1854-1900], née sous le nom de Constance Llyod, auteure de :
« Je pense que joncher une nappe de fleurs coupées est une habitude peu sensée et, semble-t-il, cruelle. » 1336 (Cf. Femmes. Fleurs)
Femmes (« Bouquets ») (2) : 1995. Lu dans Jean Tulard, Guide des films. 1895-1995. L-Z, concernant Noyade interdite [1987. Pierre Garnier Deferre] :
« Un film banal […] heureusement rehaussé par la présence d’un bouquet de fines et excellentes comédiennes. » 1337 (Cf. Culture. Cinéma, Femmes. Ornements [décoratifs])
Femmes (Bouquets) (3) : 2012. Une femme anonyme, auteure de :
« Certains se réalisent dans le combat politique ; d’aucuns ont la fibre d’écrivain, tels aiment les enfants et se réalisent dans la famille.
Moi, finalement, ce qui m’aura le plus plu et ce que j’aurais fait le mieux, sur cette petite terre rigolote, ce sont les bouquets : bouquets de poèmes, bouquets de fleurs, peut être bouquets de visages sur certaines photos, c’est ce que j’aimerais qu’on grave sur ma tombe, si jamais on m’enterre au lieu de m’incinérer, comme c’est la mode en ce moment.
On dira : ‘Elle ne savait pas faire grand’ chose, mais Dieu ! Ce qu’elle faisait de jolis bouquets ! » 1338 (Cf. Êtres humains. Soi, Femmes. Artistes. Séraphine Louis. Fleurs)
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. « Bouteilles » :
Femmes (« Bouteilles ») (1) : 2003. Charles Bukowski [1920-1994], auteur de :
« Une femme, c’est comme une bouteille de bière, on la débouche, on la boit et on la pisse. » 1339 (Cf. Sexes. Hommes. Bouteille de bière)
Femmes (« Bouteilles ») (2) : (18 avril) 2018. Lu dans Le Canard enchaîné :
« David Gréa, prêtre défroqué, aujourd’hui marié, défend dans son livre Une vie nouvelle (Les Arènes) la fin du célibat obligatoire. Il se souvient qu’au grand séminaire des formateurs mettaient en garde les futurs curés en ces termes (Le Monde. 14 avril 2018) : ‘Si vous vivez mal le célibat, il vaut mieux prendre une femme qu’une bouteille, car, avec une femme, vous avez un vis-à-vis, pas avec une bouteille.’ » 1340
-------------
Femmes (« Cause de trouble ») : (16 novembre) 1910. Rémy de Gourmont [1858-1915], dans Épilogues. Réflexions sur la vie, auteur de :
« (Concernant « la question du latin ») Les femmes sont une grande cause de trouble dans cette question, comme dans toutes les autres d’ailleurs. » 1341 (Cf. Hommes. « Libertins », Proxénétisme. Gourmont Rémy de)
Là, il n’y a pas de « dissociation d’idées ».
Femmes (Catholiques) : (6 septembre) 1880. L’abbé Mugnier [1854-1944] écrit dans son Journal :
« Les anciens s’écriaient avec douleur : les dieux s’en vont, les dieux s’en vont ! C’est à nous de dire aujourd’hui : les hommes s’en vont, les hommes s’en vont ! Mais les femmes nous restent et je vous assure qu’elles s’entendent admirablement à faire perdre au clergé - vieux ou jeune -, le meilleur de son intelligence et de son temps. »
- Le 1er juin 1885 : « La religion qui était tout, autrefois, se renferme, de plus en plus, dans l’Église et devient le fait d’une minorité féminine. »
- Le 29 août 1890 : « Et je ne dis rien du confessionnal, sorte de terrier où la curiosité, l’indiscrétion, le verbiage, la niaiserie de disputent les consciences de quelques femmes hystériques, scrupuleuses, bavardes, désœuvrées, le dessous du panier. Les femmes et les enfants, tels sont nos fidèles. Le reste ne compte pas ou compte peu. Et encore, n’avons-nous pas toutes les femmes ! »
- Le 20 janvier 1894, il rapporte ce jugement de Mgr Foucault [1843-1930] : « Les femmes resteront accessibles à la religion parce qu’elles sont ‘malheureuses’. »
- Le 9 décembre 1897 : « Je descends d’une chaire pour monter dans une autre. Les réunions se succèdent : ouvroir, dames de charité, enfants de Marie, Mères chrétiennes de Sion, Filles de Sainte-Catherine, catéchismes. »
- Le 29 mars 1899 : « Défilé de femmes et de jeunes filles à mon confessionnal. Toutes les fautes. L’Humanité est incorrigible. Confessé de très grands noms et de très humbles. Toutes les consciences sont en butte aux mêmes tentations. »
- Le 2 juin 1899 : « Cette haine des juifs est vraiment insensée ! Les femmes s’exaltent contre eux. Des femmes qui se disent chrétiennes. Quelle misère ! »
- Le 23 février 1903 : « J’ai demandé à Huysmans [Joris Karl. 1848-1907] de m’éclairer sur les femmes qui perdent la foi pour ma prochaine conférence. Pour lui, la grosse difficulté pour la femme chrétienne, c’est ‘le lit’. La religion supprimé l’agrément dans les relations du sexe. »
- Le 15 mars 1905 : « Encore une conférence, rue Las Cases. Énormément de monde. C’est le sujet qui attirait : le mariage des filles. »
- Le 18 mars 1905 : « Confessé, confessé, confessé, à cause la Saint-joseph. Les femmes ne se lassent pas de ce sacrement. Les guichets se ferment, s’ouvrent. Des péchés à droite, des péchés à gauche. »
- Le 7 juillet 1908 : Ah ! la lassitude de mes fonctions, comme je l’éprouve ! Comme je dis intérieurement à ces femmes, à ces jeunes filles, à toute notre clientèle : Partez, partez ! Assez de péchés entendus, de ciboires vidés, de saluts donnés, de sermons, d’oraisons, de directions, que sais-je ! » 1342 (Cf. Femmes. « Féminin ». Jeunes filles)
Femmes (« Cent millions. Deux fois ») : (18 septembre) 2012. Entendu :
« On sait qu’il y a, dans le monde, à peu près cent millions de femmes qui sont éliminées tous les ans, [par l’avortement des fœtus de petits filles, infanticides à la naissance, ou de négligence des filles au profit des garçons] ; on sait qu’il y a dans le monde, à peu près cent millions de femmes sont excisées tous les ans. […] » 1343
- Cent millions (deux fois) de femmes : une broutille. (Cf. Êtres humains, Enfants, Violences à l’encontre des enfants. Infanticides)
Femmes. Charité :
Femmes (Charité) (1) : La charité (assimilée aux « bonnes œuvres » dont les femmes auraient le monopole) fut si souvent la seule manifestation d’expression religieuse, sociale, politique laissée aux femmes qu’il serait injuste de les critiquer sur ce fondement. Ce constat ne valide pas, pour autant le terme, ni la fonction politique qu’il a joué et joue encore : il demande simplement une analyse historicisée, distinguée selon que le terme concerne soit les femmes soit les hommes, soit qu’il signifie une pratique individuelle, soit une politique d’État, ou religieuse, servant ou non à conforter, à légitimer l’ordre social et politique. (Cf. Politique. Charité)
Par ordre chronologique. Femmes. Charité :
Femmes (Charité) (1) : 1763. Voltaire [1694-1778], dans son Traité sur la tolérance, auteur de :
« La charité qui, d’ailleurs est si souvent mesquine et insultante, est le partage des dévots […]. » 1344
Femmes (Charité) (2) : 1787. Marie-Armande Gacon-Dufour [1753-1835], dans Mémoire pour le sexe féminin contre le sexe masculin, [1787], écrit à l’auteur de Réflexions d’un jeune homme [1786], ceci :
« Que le Chevallier de Feucher, pour se convaincre de ce que je dis, se fasse ouvrir les registres des paroisses où sont inscrites les personnes bienfaisantes ; et il verra s’il y en a d’autres que les femmes. […] » 1345
Et, concernant les « jeunes gens », elle écrit :
« Ne risquez pas de leur parler de charité, vous courez le danger de les entendre s’écrier sottement : avons-nous trop d’argent pour nos plaisirs ? des jeunes gens n’ont-ils pas toujours de nouveaux besoins ? Et nos maîtresses ? Et nos habits ? et nos chevaux ? […] » (Cf. Femmes. Charité. « Féminin », Hommes, Langage. Possessif. Zeugma, Patriarcat, Politique. Charité, Sexes […])
Femmes (Charité) (3) : 1790. Jules Michelet [1798-1874], dans son Histoire de la Révolution française, évoquant diverses initiatives des femmes, écrit :
« Souvent les femmes font faire un service funèbre aux morts de la Bastille. Ajoutez d’immenses charités, des distributions de vivres ; ou, bien mieux que la charité, la communauté des vivres, les tables ouvertes à tous. » 1346 (Cf. Politique. Charité, Histoire. Révolution française)
Femmes (Charité) (4) : (18 avril) 1844. Flora Tristan [1803-1844], dans son Journal, à des femmes, des « grandes dames » de Dijon qui s’affirmaient : « femmes de charité », répondit :
« Non, mesdames, vous n’êtes que des femmes d’aumônes. » Et elle poursuivit :
« L’aumône, pour elles, satisfait leur vanité. » 1347 (Cf. Dialogues, Relations entre êtres humains. Vanité)
Femmes (Charité) (5) : 1877. Léon Tolstoï [1828-1910], dans Anna Karénine, auteur de ce dialogue :
« […] On ne met jamais son cœur dans ces institutions philanthropiques, et c’est pourquoi elles donnent de si piètres résultats.
- Oui, dit Anna après un moment de silence, je n’ai pas le cœur assez large pour aimer tout un ouvroir de vilaines petites filles. Pourtant combien de femmes ont affermi de la sorte leur position sociale ! Mais moi je ne le puis pas […] » 1348 (Cf. Dialogues)
Femmes (Charité) (6) : 1896. Séverine [1855-1929], dans En marche, auteure de :
- « […] La charité, la douce, tendre, adorable Charité, sœur cadette de la Justice a fait sa tâche, donné jusqu’au sang de ses veines ; et aujourd’hui, se tort les mains, désespérée, devant l’échec de son effort, l’inutilité de son sacrifice, le néant de son abnégation. Sur le champ de bataille social, comme jadis, le même cri s’élève : ‘Ils sont trop’ ! Ils sont trop, les sans-le-sou et les sans-pâture, les sans-souliers et les sans-gîte ; les mères au sein tari, les pères au cœur navré ; les enfants à bout de forces ; les vieux à bout de résignation ! » […]
- « La charité qui, ayant l’arbitraire pour base, laisse donc beaucoup à désirer, mais qui, somme toute, en attendant mieux, est encore la plus noble inspiration de l’âme humaine, parce qu’elle procède de l’esprit de justice, ne peut plus rien. Minime ou grandiose, elle est débordée : on n’aide plus les affamés qu’à prolonger leur agonie ! Jusqu’ici, ils se résignent ; et c’est tant mieux pour les possédants. Mais si, demain, ils se révoltaient ? » […]
- « Le grand Pan est mort - La Charité a vécu ! Est-ce à dire qu’on doit y renoncer ? - Jamais ! Tant qu’on n’aura pas changé l’ordre social. Il faut au contraire s’y adonner passionnément, éperdument ; mais reconnaître que l’unique Justice, l’espérée, l’attendue, peut seule, par une répartition plus égale des biens de ce monde, remédier au fléau. […] » 1349 (Cf. Femmes. Remarquables. Séverine, Politique. Résignation)
Femmes (Charité) (7) : 1909. Léon Bloy [1846-1917], dans Le sang du pauvre, auteur de :
« Une pauvre vieille doit une dizaine de francs à une dame de charité qui lui dit : - Vous ne pouvez pas me donner de l’argent, vous me donnerez votre travail. La malheureuse, pleine du désir de s’acquitter, travaille donc, faisant le ménage, le savonnage, la cuisine, la couture. Les semaines, les mois, les années passent ainsi. La mort arrive. Elle doit toujours dix francs et une reconnaissance éternelle. » 1350
Femmes (Charité) (8) : 1932. François Mauriac [1885-1970], dans Le nœud de vipères, auteur de :
« […] Ma pauvre Isa, aussi bonne chrétienne que tu fusses, avoue que j’avais beau jeu [de la « mettre en contradiction avec [sa] foi”].
Que charité soit synonyme d’amour, tu l’avais oublié, si tu l’avais jamais su.
Sous ce nom, tu englobais un certain nombre de devoirs envers les pauvres dont tu t’acquittais avec scrupule, en vue de ton éternité.
Je reconnais que tu as beaucoup changé ; maintenant tu soignes les cancéreuses, c’est entendu ! Mais, à cette époque, les pauvres - tes pauvres, une fois secourus, tu ne t’en trouvais que plus à l’aise pour exiger ton dû des créatures vivant sous ta dépendance.
Tu ne transigeais pas sur le devoir des maîtresses de maison qui est d’obtenir le plus de travail possible pour le moins d’argent possible. Cette misérable vieille qui passait, le matin, avec sa voiture de légumes, et à qui tu aurais fait la charité largement si elle t’avait tendu la main, ne te vendait pas une salade que tu n’eusses mis ton honneur à rogner de quelques sous son maigre profit. » 1351
N.B. Ces critiques, aussi justes soient-elles, m’interrogent sur leur auteur. (Cf. Femmes. « Créatures ». « Maîtresses de maison », Hommes)
Femmes (Charité) (9) : (5 décembre) 1933. André Gide [1861-1951], dans son Journal, écrit : « D’ailleurs, c’est bien simple, disait cette excellente dame, à cet excellent déjeuner d’hier… D’ailleurs, c’est bien simple : ‘si je n’avais plus de domestiques, je ne pourrais plus tricoter pour les pauvres’. » 1352 Une caricature ?
Cette citation donne aussi une - petite - idée d’un certain milieu auquel acceptait alors de participer André Gide. (Cf. Êtres humains. Gide André, Femmes. Tricot, Économie. « Pauvres Les »)
Femmes (Charité) (10) : 1940. Je lis dans Jeanne et les siens de Michel Winock concernant la vie de sa mère et son enfance à Arcueil, dans les années 1940 :
« Ces sœurs de Saint-Vincent-de-Paul exerçaient un vrai rôle social dans notre banlieue rouge. Outre l’assistance aux malades, l’école maternelle, elles offraient un des rares lieux de retraite pour les vieilles filles et les veuves nécessiteuses. […] » 1353 (Cf. Femmes. Veuves. « Vieilles filles »)
Femmes (Charité) (11) : 1950. Je lis l’histoire suivante :
« Lors d’un bombardement à Londres [pendant la Seconde guerre mondiale], une bombe avait balayé la maison d’une vieille dame ; celle-ci se tenait en face de l’employé du Bureau d’Assistance, les cheveux épars, entremêlés encore de morceaux de plâtre, ses vêtements couverts de poussière de la tête aux pieds.
Mais, même là, après une terrible épreuve, cette femme hésitait avant de signer un reçu pour le secours qu’on allait lui verser et, regardant l’employé du Bureau d’Assistance, elle demanda : ‘Dites, ce n’est pas de la charité, n’est-ce pas ? ’ On l’assura que non, que ce n’était pas de la ‘charité’, que c’était un droit pour les gens de toutes classes, et elle signa la feuille, manifestement soulagée que, même une bombe, ne l’ait pas contrainte à accepter la charité. » 1354 (Cf. Femmes. Bourgeoises. Conscience de classe)
De la permanence des effets des humiliations inhérentes aux ancestrales pratiques de la charité et des obligations qui en découlaient, y compris, peut être ici, émanant d’une personne qui l’avait non pas reçue, mais prodiguée…
Femmes (Charité) (12) : 1952. Béatrix Beck [1914-2008], dans Léon Morin prêtre, concernant « une œuvre de placement de nouveaux-nés de femmes de prisonniers », écrit :
« Au dire de Christine, les dirigeantes de l’association savouraient, en se penchant vers les mères coupables, leur écrasante supériorité.
- Je voudraient bien qu’elles fautent aussi, celles-là, dit notre camarade. Ça leur ferait du bien. » 1355 (Cf. Femmes. Écrivaines. Beck Béatrix)
Femmes (Charité) (13) : 1982. Je lis dans le livre de Judith Thurman consacré à Karen Blixen [1885-1962], concernant l’une des sœurs, à la fin du XIXème siècle, au Danemark, ceci :
« Elle avait hérité en grande partie de l’idéalisme de sa tante et d’un peu de sa lourdeur. Elle devint une jeune femme tourmentée et inquiète, à la recherche d’un idéal ou d’une cause qui aurait mérité qu’elle y consacrât sa vie - d’abord le socialisme, puis la reconquête du Sud du Jutland alors aux mains des Allemands. Dans le même esprit d’engagement, elle voulut faire plus tard de son improbable mariage une réussite et, devenue une riche mère de famille, elle se lança dans les bonnes œuvres en fournissant abris et nourriture aux chômeurs. »
Là encore, le mépris, le déni de ses engagements politiques. 1356 (Cf. Famille, Politique. Charité, Politique. Idéalisme)
Femmes (Charité) (14) : (13 avril) 2012. Lorsque Évelyne Sullerot [1924-2017] évoque ses activités de « terrain », « la pratique », elle les définit en ces termes : « essayer d’aider les femmes les plus défavorisées dans certains cas ». 1357
Là, s’exprime, notamment par la conditionnalité, l’un des liens historiques entre le féminisme et la charité ; là s’exprime, de manière flagrante, les graves limites des liens entre politique et charité. (Cf. Femmes. Charité, Féminismes, Politique. Charité, « Sciences » sociales. Sociologie)
-------------
Femmes (« Chevaux ») : 1967. José-Luis de Vilallonga [1920-2007], dans À pleines dents, auteur de :
- « Ça n’existe pas ‘les femmes’. Il y a une femme, puis une autre, et encore une autre. C’est comme les chevaux. J’en ai monté des centaines. […] »
- « Dans ma vie, j’ai passé beaucoup de temps à dîner avec des femmes du monde. Et je me suis souvent dit : ‘Quel dommage que l’on ne puisse pas dîner en tête à tête avec un cheval. »
Il raconte enfin, alors qu’adolescent il était « chez les jésuites, à Barcelone », « un vieil écuyer » lui avait dit :
« Vois-tu, mon petit, un cheval, c’est comme une femme, il ne faut pas être plusieurs à le monter. » 1358 (Cf. Êtres humains, Femmes. Animalisation des femmes. « Femmes du monde », Hommes. Grossiers, Langage. Zeugma, Politique. Animalisation du monde)
Femmes (« Chiennes ») : 1972. Léo Ferré [1916-1993], auteur, dans sa chanson :
« Nous sommes des chiens » de :
« […] Et nous ne sommes pas contre le fait qu´on laisse venir à nous certaines chiennes / Puisqu´elles sont faites pour ça et pour nous », et ce, quelques lignes après avoir écrit :
« Des armes et des mots c´est pareil / Ça tue pareil. » (Cf. Culture, Êtres humains, Femmes. Animalisation des femmes, Langage. Mots, Politique. Animalisation du monde, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
Femmes (Chefs) : S’extasier de leurs exceptionnelles qualités. Évite d’avoir à s’interroger pour comprendre par quels processus les hommes se sont, en moins d’un siècle, accaparé quasi exclusivement le quasiment seul domaine - la cuisine - réservé aux femmes. Celui, en outre, où elles excellaient.
Femmes (Choix) : 1958. Doris Lessing [1919-2013], dans La cité promise. Les enfants de la violence (3), auteure de :
« De nos jours, les filles choisissaient, elles étaient libres : mais du temps de sa jeunesse, les jeunes filles ne disposaient que de ce bref moment avant leur mariage, où on les courtisait et où elles étaient libres de choisir un mari, de dire oui, non, je veux celui-ci et pas celui-là, avant de devenir mères, infirmières, et de n’avoir d’autre choix que le sacrifice. » 1359 (Cf. Femmes. Jeunes filles, Famille. Mariage, Patriarcat)
Femmes (Chômage) : (7 août) 1932. Voici la description, dans l’entre-deux guerres, du congé d’un « fonctionnaire colonial » tel que présenté, dans les Carnets de Louis Guilloux [1899-1980] :
« Boire, manger, dormir, voilà mon programme. De temps en temps, je fais une petite virée à Paris. Depuis qu’il y a du chômage, on a des femmes épatantes pour pas grand-chose. » 1360 (Cf. Êtres humains, Femmes. Travail, Patriarcat. Division sexuelle du travail, Proxénétisme, Économie. Chômage)
Par ordre chronologique. Femmes. « Choses ».
Femmes (« Choses ») (1) : (30 septembre) 1749. Voltaire [1694-1778], dans une lettre à Marie-Louise Denis [1712-1790], lui écrit :
« Vous et la personne que je pleure [Émilie du Châtelet. 1706-1749], vous aurez été deux choses bien rares. » 1361 (Cf. Femmes. Remarquables. Denis Marie-Louise. Du Châtelet Émilie) N.B. « Chose » : « Réalité concrète ou abstraite perçue ou concevable comme un objet unique »
Ouvre de grands horizons à la pensée féministe.
Femmes (« Choses ») (2) : 1841. Honoré de Balzac [1799-1859], dans Mémoires de deux jeunes mariées, auteur de :
« D’ailleurs je l’ai trouvé si fort occupé de lui, si peu des autres, qu’il m’a fait penser que nous devons être des choses et non des âtres pour ces grands chasseurs d’idées. » 1362 (Cf. Hommes, Patriarcat, Penser. Idées)
Femmes (« Choses ») (3) : (30 mars) 1849. Eugène Delacroix [1798-1863] écrit dans son Journal :
« Vu le soir chez Chopin [1810-1849] l’enchanteresse Mme Potocka [1852-1930]. […] Je l’avais entendue deux fois ; je n’ai guère rencontré quelque chose de plus complet. Le premier jour surtout, il y avait un demi-jour complet, et sa toilette de velours noir, sa coiffure, tout, jusqu’à ce que je ne voyais pas, me l’avait fait juger ravissante par sa beauté, comme elle l’est effectivement par sa grâce. » 1363
N.B. « Demi-jour » : « Désigne parfois un dispositif de volets ou un rideau permettant de tamiser la lumière du jour. »
Femmes (« Choses ») (4) : 1887. Émile Zola [1840-1902], dans La terre, auteur de :
« […] Elle [Françoise] lui jura […] sur ce qu’elle avait de plus sacré, que Buteau mentait, lorsqu’il se vantait de coucher avec les deux sœurs, dans l’idée de faire le coq et de forcer à être des choses qui n’étaient pas. » 1364 (Cf. Hommes. Coqs, Relations entre êtres humains. Amour. « Faire l’amour », Langage. Verbe. Être)
Femmes (« Choses ») (5) : 1990. À la question : « Toutes les deux [Roselyne Bachelot et Geneviève Fraisse] vous êtes des femmes libres, vous ne transigez pas avec vos convictions. Au risque de compromettre vos carrières. C’est votre condition de femme qui vous permet cela ? Vous n’avez pas la même obligation de réussite que les hommes ? Vous prenez davantage de distance ? » Geneviève Fraisse répond :
« Je me demande si ce n’est pas parce que nous sommes plusieurs choses à la fois, amante, femme, intello, femme politique, sportive…. C’est une richesse et cela nous sauve. […] » 1365
Femmes (« Choses ») (6) : (20 octobre) 2024. Lu sur Franceinfo, à l’occasion d’une exposition à Londres la concernant, Marilyn Monroe [1926-1962], auteure de :
« Un sex-symbol devient une chose. Je déteste être une chose. » (Cf. Penser. Symbole, Sexes […])
-------------
Femmes (« Chouchoutes ») : (26 décembre) 2019. Éric Dussert, dans l’émission de France Culture, La compagnie des œuvres, auteur du livre Cachées par la forêt, 138 femmes de lettres oubliées, déclara qu’il avait, parmi elles, plusieurs « chouchoutes ». 1366
À quand les « chochottes », cela me rajeunirait… (Cf. Langage. Patriarcal)
* Ajout. 4 septembre 2020. C’est fait. Michel Onfray, sur BFM-TV, auteur de :
« On ne va pas faire la chochotte. Quand on donne des coups, on en reçoit. » (Cf. Violences. Patriarcales)
Femmes (CICR) : (7 juillet) 2012. Frédéric Joly, porte-parole du CICR [Comité International de la Croix Rouge], concernant la Syrie, auteur de :
« Ce qui est important, c’est que les belligérants (?) reconnaissent un espace humanitaire (?) dans lesquels sont protégés par nature [!], les blessés, les malades et tous les civils qui ne font pas partie du conflit [!], des violences [!] ; je pense essentiellement aux femmes, aux enfants et aux personnes âgées. » Et il poursuit en souhaitant « pouvoir travailler en faveur des personnes qui n’ont rien à voir avec le développement des violences actuelles. » 1367
Les Syriennes, plus particulièrement, apprécieront.
Il y a des institutions qui vieillissent vraiment mal… (Cf. Droit. « Humanitaire », Êtres Humains. « Humanitaire », Langage, Politique. Guerre. « Humanitaire »)
Par ordre chronologique, Femme. « Cigarettes » :
Femme (« Cigarettes ») (1) : 1950. Éliane Embrun [1923-2009] chante : Si j’étais une cigarette :
« Tu me tiendrais dans tes doigts. Et sous le feu d’une allumette. Tu me ferais flamber pour toi […].
Femme (« Cigare-ttes ») (2) : 1975. Guy Béart [1930-2015] chante Havane :
« Tu brûles tout doux comme une cigarette, et moi je te fume, le souffle coupé pour respirer ta peau de Havane… »
-------------
Femmes (« Cocotes ») : 1992. Je lis dans les notes d’Antoine Compagnon au livre de Marcel Proust [1871-1922], dans Sodome et Gomorrhe - 1921- présenter Émilienne André [1870-1945], comme une « célèbre cocotte ». 1368 (Cf. Femmes. Animalisation des femmes)
Par ordre chronologique. Femmes. Colère :
Femme (Colère) (1) : 1970. Écouter La colère de Barbara [1930-1997].
Femme (Colère) (2) : 1974. Écouter Marie Douceur, Marie Colère de Marie Laforêt [1919-1939].
Femmes (Colère) (3) : Si les femmes s’autorisaient plus de colère, et donc plus d’indignations, et donc plus de compréhension et d’intelligence d’elles-mêmes dans le monde, il y aurait beaucoup moins d’hommes violents, et les sociétés seraient plus et mieux vivables. La colère n’est pas qu‘émotion primaire, irréfléchie, immédiate, elle est aussi bonne conseillère, souvent nécessaire, contrairement à la fréquente affirmation contraire. (Cf. Femmes. Colère, Politique, Penser. Pensées. Indignation, « Sciences » sociales. Psychanalyse, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
* Ajout. 16 avril 2021. Entendu, exprimée par Marielle Macé, cette riche expression :
« La colère est une parole soignante. » 1369 (Cf. Êtres humains, Relations entre êtres humains, Politique)
-------------
Femmes. Comment faire disparaître les femmes ? :
Femmes (Comment faire disparaître les femmes ?) (1) : La GPA dite « Gestation pour autrui » - qui elle-même avait fait disparaître les femmes - a fait en sus disparaître les termes de « mère de substitution » et de « mère porteuse ». (Cf. Êtres humains. Comment faire disparaître les êtres humains, Femmes. Mères, Langage. Mots. Genre)
Par ordre chronologique. Femmes. Comment faire disparaître les femmes ? :
Femmes (Comment faire disparaître les femmes ?) (1) : 1637. Marie de Gournay [1565-1645], dans une lettre à André Rivet [1572-1651], écrit :
« De tout temps, dans l’histoire, les mémoires des noms de femmes ne sont pas plus en évidence que les traces laissées par un navire croissant dans l’océan. » 1370 (Cf. Femme. Noms, Histoire. Patriarcale)
Femmes (Comment faire disparaître les femmes ?) (2) : 1688. Jean de La Bruyère [1645-1696], dans Les Caractères - De l’homme -, auteur de :
« L'on voit certains animaux farouches, des mâles et des femelles, répandus par la campagne, noirs, livides et tout brûlés de soleil, attachés à la terre qu'ils fouillent et qu'ils remuent avec une opiniâtreté invincible ; ils ont comme une voix articulée, et quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils montrent une face humaine, et en effet ils sont des hommes. […] » 1371 (Cf. Êtres humains, Corps. Visage, Femmes. « Femelles », Économie. « Pauvres Les »)
Femmes (Comment faire disparaître les femmes ?) (3) : 1762. Jean-Jacques Rousseau [1712-1778], dans Du contrat social, auteur de :
« La famille est donc si l’on veut le premier modèle des sociétés politiques ; le chef est l’image du père, le peuple est l’image des enfants, et tous étant nés égaux et libres n’aliènent leur liberté que pour leur utilité. […] » 1372 (Cf. Enfants, Famille, Patriarcat. Pères, Politique. Égalité. Liberté)
Femmes (Comment faire disparaître les femmes ?) (4) : 1831. Honoré de Balzac [1799-1850], dans La peau de chagrin, évoque les « gens honorables qui […] iraient, dans une mansarde acheter, à bas prix, des remords pour trois mois. » 1373
Par ordre chronologique. Femmes. Comment faire disparaître les femmes ? Gustave Flaubert :
Femmes (Comment faire disparaître les femmes ?) (5) : (15 juillet) 1861. Gustave Flaubert [1821-1880] écrit à Edmond [1822-1896] et Jules [1830-1870] de Goncourt que leur livre Sainte Philomène [1861] a été lu par trois dames, amies de sa mère « qui s’en sont régalées ». Et il conclue : « Vous attendrissez le sexe. » 1374 (Cf. Femmes, Sexes. Femmes)
Femmes (Comment faire disparaître les femmes ?) (6) : (15 juillet) 1861. Gustave Flaubert [1821-1880] écrit à Ernest Feydeau [1821-1873] :
« Mais puisque tu as encore quelques livres dans ton sac et un intérieur domestique plein de tendresse [Il vient de se remarier], c’est à dire le dessus et le dessous de la vie (sic), marche sans tourner le tête et droit vers ton but. » 1375
Femmes (Comment faire disparaître les femmes ?) (7) : (mai) 1879. Gustave Flaubert [1821-1880] écrit à Edmond Laporte [1832-1906] :
« J’ai passé huit heures à ranger et bruler des lettres, une besogne depuis longtemps retardée. » Et dans une note de La Pléiade, je lis :
« Parmi ces lettres brûlées se trouvaient probablement celles de Louise Colet [1810-1876] et de Juliet Herbert [1829-?] (‘ses’ maîtresses). » 1376
J’avais lu aussi que sa nièce Caroline [1846-1931] supprima d’autres - quasiment toutes ? -, dont les siennes. (Cf. Histoire. Archives)
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Comment faire disparaître les femmes ? Émile Zola :
Femmes (Comment faire disparaître les femmes ?) (8) : 1880. Émile Zola [1840-1902], dans Nana, auteur de :
« […] Par instant, lorsqu’une nuque dorée se penchait sous une pluie de frisures, les feux d’une boucle de diamants allumaient un haut chignon. Des gaietés jetaient une flamme, des yeux rieurs, des dents blanches entrevues, le reflet des candélabres brûlant dans un verre de champagne […]. » 1377
Femmes (Comment faire disparaître les femmes ?) (9) : 1886. Émile Zola [1840-1902], dans L’œuvre, auteur de :
« - Et ton collage à propos, tu l’as donc épousé ? » 1378
-------------
Femmes (Comment faire disparaître les femmes ?) (10) : 1890. Théodore de Bainville [1823-1891], dans Nouveaux souvenirs [1890. p.5], auteur de :
« L’éblouissement d’une robe de Worth [Charles Friedrick. 1825-1885. « pionnier de la haute couture française »], agrémenté de plus d’ors, de broderies, de falbalas et de fanfreluches que le ciel n’a d’étoiles, ne suiffait pas à faire croire qu’il y a une femme dedans, s’il n’y en a pas. » 1379
Femmes (Comment faire disparaître les femmes ?) (11) : 1930. Sigmund Freud [1856-1939], dans Le malaise dans la culture, auteur de :
- « Il est un dernier trait caractéristique d’une culture que nous devons considérer, et non le moindre ; c’est la manière dont sont réglées les relations des hommes entre eux, les relations sociales qui concernant l’homme comme voisin, comme auxiliaire, comme objet sexuel d’un autre, comme membre d’une famille ou d’un État. »
- « Après que l’homme originel eut découvert qu’il avait - littéralement - entre ses mains l’amélioration de son sort sur la terre par le travail, il ne put lui être indifférent qu’un autre travaillât avec ou contre lui (sic). L’autre acquit pour lui la valeur de collaborateur (sic) avec qui était utile de vivre (sic). Encore auparavant, à l’époque reculée où il était proche du singe (sic), il avait pris l’habitude (sic) de fonder des familles ; les membres de la famille étaient vraisemblablement les premiers qui l‘ont aidé. […] »
- « L’homme culturel a troqué une part de possibilité de bonheur contre une part de sécurité. (sic) Mais n’oublions que, dans la famille originelle, seul le chef jouissait de telle liberté pulsionnelle (sic) ; les autres vivaient en esclaves opprimés. […] » 1380 (Cf. Femmes. Femme. Freud Sigmund. Utiles, Hommes, « Sciences » sociales. Psychanalyse. Freud Sigmund))
Femmes (Comment faire disparaître les femmes ?) (12) : 1932. Simone Weil [1909-1943], dans L’Allemagne en attente, écrit :
« La crise a brisé tout ce qui empêche chaque homme de se poser concrètement le problème de sa propre destinée, à savoir les habitudes, les traditions, les cadres sociaux, la sécurité ; surtout la crise, dans la mesure où on ne le considère pas, en général, comme une interruption passagère dans le développement économique, a fermé toute perspective pour chaque homme considéré isolément.
En ce moment, cinq millions et demi d’hommes vivent et font vivre leurs enfants grâce aux secours précieux de l’État et de la commune ; plus de deux millions sont à la charge de leur famille, ou mendient, ou volent. […]
Cherchent-ils une consolation dans la vie de famille ? Tous les rapports de famille sont aigris par la dépendance absolue dans laquelle se trouve le chômeur par rapport au membre de la famille qui travaille. […]
Quant à fonder soi-même une famille, à se marier, à avoir des enfants, les jeunes Allemands ne peuvent même pas en avoir la pensée. […] » 1381 (Cf. Hommes, Famille, Patriarcat, Politique. Économie)
Femmes (Comment faire disparaître les femmes ?) (13) : 1934. John Dos Passos [1896-1970], dans Sur toute la terre. Union soviétique, Mexique, Espagne, etc… raconte une course de taureaux organisée par le parti socialiste à Santander, dont les membres étaient venus de tout le nord de l’Espagne « avec leurs femmes et leurs enfants » et il poursuit :
« L’arène des courses de taureaux contenait à peu près dix mille personnes ; toutes les places étaient prises par des individus d’aspect aimable et intelligent pour la plupart (sic) : mécaniciens, petits boutiquiers, fermiers, fabricants de chaussures, tailleurs, clercs, instituteurs, quelques médecins et avocats. […] »
Puis, il évoque comment vivaient au Mexique les exilés qui avaient la conscription décidée au États-Unis, soit « parce qu’ils s’opposaient moralement à la guerre, soit à la guerre capitaliste » :
« Ils partageaient en frères. Tout était en commun. Il y avait des hommes de tous métiers et de toutes conditions dans la communauté : des boulangers, des bouchers, des tailleurs, des cordonniers, des cuisiniers, des menuisiers, des garçons de café. C’était la réalisation momentanée des espoirs anarchistes. »
Il évoque, aussi, en 1932, à l’écoute de Roosevelt à la radio, « des lois faites dans notre intérêts à nous, les salariés, les propriétaires, à nous le fermiers, à nous les mécaniciens, à nous les mineurs, à nous les débiteurs sur hypothèques, à nous les arpenteurs, à nous les détenteurs d’hypothèques, à nous qui avons des dépôts en banque, à nous les consommateurs, les marchands au détail, les banquiers, les agents de change, les actionnaires, les créditeurs, les débiteurs, les gens sans travail et les gens qui ont du travail. […] »
Il évoque enfin une rencontre organisée en 1934 par le Conseil des chômeurs :
« […] Il y avait des comptables, des fourreurs, des esclaves des usines de boites de conserve, des gens qui récoltent les coton, des tailleurs de pierre, des imprimeurs, des ouvriers en cigares, des menuisiers, des plombiers, de peintres, des cuisiniers, des garçons de café, des serviteurs, des ouvriers d’industrie automobile ou de l’aviation, des écrivains, des instituteurs, des architectes, des pharmaciens, des artistes, des chauffeurs, des mineurs, des puddlers [ouvriers qui transforment la fonte], des électriciens, des maçons, des boulangers et un tailleur de diamant. Ils représentaient à peu près douze cents conseils. […] » 1382
Femmes (Comment faire disparaître les femmes ?) (14) : (Avant) 1936. Jean Gabin [1904-1976] chante :
« Avec ma petite gueule ».
Femmes (Comment faire disparaître les femmes ?) (15) : 1937. Maurice Chevallier [1888-1972] chante :
« Si j’étais papa ».
Femmes (Comment faire disparaître les femmes ?) (16) : 1972. Jean-Paul Sartre [1905-1980], dans Plaidoyer pour les intellectuels, auteur de :
- « L’homme est l’avenir de ‘l’homme »
- « L’homme est le fils de l’homme. » 1383
Femmes (Comment faire disparaître les femmes ?) (17) : 1979. Jean Lacouture [1921-2015], dans Léon Blum [1872-1950], écrit :
« Ses amis les plus proches ne sont pas, comme on l’a dit parfois, les gens du ‘Tout Paris’. Certes il y a les Cortot et Reynaldo Hahn, les Vuillard et les Bonnard et, et jusqu’en 1924, Anatole France et le salon de Madame de Caillavet […]. » 1384
Femmes (Comment faire disparaître les femmes ?) (18) : 1983. Raymond Aron [1905-1983], dans ses Mémoires, concernant ses relations avec Éric Weil [1904-1977], dans les années trente, auteur de :
« Notre amitié, d’homme à homme, de famille à famille […], suivi, page suivante, d’une référence à « des chocs en retour de drames familiaux ». 1385
Par ordre chronologique. Femmes. Comment faire disparaître les femmes ? Jean Tulard :
Femmes (Comment faire disparaître les femmes ?) (19) : 1995. Relevé dans Jean Tulard, Le Guide des films. 1895-1995. L.Z :
- Mam’Zelle Spahi. 1934. Max de Vaucorbeil : « Le colonel du 3ème Spahis a une liaison. Les manœuvres offrent un bon prétexte pour découcher. »
- Que la fête commence. 1975. Bertrand Tavernier : « Philippe d’Orléans est régent de France. C’est un libéral et un réformiste, ainsi qu’un amateur de soupers galants. »
- Régiment des bagarreurs (Le) [1940. William Keighley] : « Pas une femme, et rien que des gueules de la Warner dans ce film de guerre bien réalisé, violent et cocardier. » (Cf. Politique. Guerre)
- Soleil de minuit (Le). 1943. Bernard Roland : « Son père, le prince Ireniev était un débauché. »
- Smoking / No Smoking. 1993. Alain Resnais : […] On rit beaucoup […] peut-être à cause des dialogues pétillants ou l’on retrouve la griffe de Jean-Pierre Bacri et de sa complice. [Agnès Jaoui, non citée]. »
- Solo. 1969. Jean-Pierre Mocky : « Au Vésinet, un groupe de terroristes abat des notables au cours d’une partie fine. »
- Soupçons. 1941. Alfred Hitchcock : « Lina McKinlaw, fille d'un riche général en retraite a épousé le beau John Aysgarth, qui a la réputation d’être coureur, joueur et dépensier. »
- Tondelayo. 1942. Richard Thorpe : « Une métisse entre deux hommes blancs, planteurs de caoutchouc, [au cœur de l’Afrique]. »
- Troubles. 1990. Wolfgang Peterson : « L’interprétation féminine est particulièrement séduisante. » (Cf. Femmes. « Féminin »)
- Une poignée de plombs. 1969. Allen Smithee, Don Siegel : « Un shérif marié à une Noire […]. » 1386 (Cf. Culture. Cinéma)
Femmes (Comment faire disparaître les femmes ?) (20) : 2003. Jean Tulard, dans son Dictionnaire du cinéma. Les réalisateurs, présente le sujet d’Une journée particulière [1977] de Ettore Scola [1931-2016] comme étant celui de « la persécution des homosexuels. » 1387 Quant à la bouleversante mère de famille / Sophia Loren, hors de sa vue… (Cf. Culture. Cinéma. Patriarcale, Femmes. Comment faire disparaître les femmes ? Hommes. Homosexuels)
-------------
Femmes (Comment faire disparaître les femmes ?) (21) : 1996. Régis Debray, dans Loués soient nos seigneurs. Une éducation politique, concernant François Mitterrand [1916-1996], évoque « le Président sautant de Conseil de défense en garçonnières, de cérémonies radio-télévisées, en équipées coquines. » 1388 (Cf. Hommes. « Politiques ». Mitterrand François, Langage. Zeugma)
Femmes (Comment faire disparaître les femmes ?) (22) : 2003. Lorsque Howard Zinn [1922-2010], dans son - grand - livre Le XXème siècle américain. Une histoire américaine de 1890 à nos jours, évoque « les droits des gays et des lesbiennes américains », suivi de : « Le mouvement gay », il fait disparaître les femmes. 1389 (Cf. Langage. Féminisation du langage)
Femmes (Comment faire disparaître les femmes ?) (23) : 2004. Philippe de Gaulle [1921-2024], dans De gaulle, mon père [1890-1970], concernant les relations entretenues par son père avec ses petits-fils, auteur de :
« Parfois, il glissait à ma mère : ‘Depuis combien de temps de ne les a-t-on pas vus ? Vous ne pourriez pas demander aux Philippe [c’est ainsi qu’il avait l’habitude nous appeler] de les faire venir ?’ » 1390 (Cf. Femmes. Noms. Prénoms)
Femmes (Comment faire disparaître les femmes ?) (24) : 2006. Claude Habib, dans Galanterie française, auteure de :
« Le Parc aux cerfs […] désigne une petite maison, située dans le quartier versaillais du parc-aux-Cerfs, où résidaient temporairement des beautés faciles, agrées par le roi [Louis XV] et par sa favorite [Mme de Pompadour]. » 1391 (Cf. Relations entre êtres humains. Galanterie, Proxénétisme)
Femmes (Comment faire disparaître les femmes ?) (25) : 2010. Catherine Clément, dans son autobiographie, Mémoire, auteure de :
« Des grossiers, des brutaux, il n’y en a guère à Normale sup., mais des violents, ça oui. Normale sup a été le théâtre du crime d’Althusser [Louis. 1918-1998] et Althusser avait une pensée créatrice. »
Que comprendre ? Qu’en déduire ? 1392 (Cf. Hommes. Althusser Louis. Assassin de sa femme. « Intellectuels ». Althusser Louis. Grossiers, Langage. Sujet)
Femmes (Comment faire disparaître les femmes ?) (26) : (1er août) 2017. George Sand [1804-1876] est qualifiée par France Culture de « métisse sociale [« écartelée entre deux mondes »] ». 1393
Femmes (Comment faire disparaître les femmes ?) (27) : (31 décembre) 2017. Pascal Perrineau, évoquant une historienne américaine, la présente ainsi :
« C’est un enfant d’un ouvrier blanc américain. » 1394 (Cf. Langage. Patriarcal. Gradvohl Paul, Politique. Perrineau Pascal, Histoire)
Femmes (Comment faire disparaître les femmes ?) (28) : (23 juillet) 2018. Olivier Philipponnat, biographe d’Emmanuel Berl [1892-1976], auteur de :
« Il a connu beaucoup d’aventures. Toujours pour en connaitre d’autres », ce qui fut suivi, peu après, de :
« Il va de femmes en femmes […] » 1395 (Cf. Langage. Verbe. Aller)
Femmes (Comment faire disparaître les femmes ?) (29) : (23 décembre) 2018. Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France, concernant l’élection (sic) de la nouvelle Miss France :
« Ils ont voté pour des rondeurs. » 1396
N.B.1. Sa taille : 42 !
N.B.2. Depuis cette année, le jury est composé exclusivement de femmes.
Femmes (Comment faire disparaître les femmes ?) (30) : (15 décembre) 2019. Entendu dans l’émission Questions d’Islam de France Culture :
« Rûmî [12012-1273] a fait une bonne alliance, il est le gendre de […]. » 1397 (Cf. Famille. Mariage, Langage. Sujet)
Femmes (Comment faire disparaître les femmes ?) (31) : (26 juillet) 2020. Adrien Taquet est nommé « secrétaire d’état en charge de l’enfance et des familles ».
Femmes (Comment faire disparaître les femmes ?) (32) : (28 septembre) 2020. Une femme, dans C’dans l’air, craignant la perte de son emploi à Brittany ferries, auteure de :
« Je suis une famille monoparentale. » (Cf. Êtres humains. Soi, Famille)
Femmes (Comment faire disparaître les femmes ?) (33) : (29 novembre) 2020. Dans le documentaire de France Culture consacré à Jeannette Dussarte-Chartreux [1923-2017], celle-ci est présentée par un syndicaliste CGT comme « un être du peuple » et sa mère comme « une personnalité ouvrière ». 1398
Femmes (Comment faire disparaître les femmes ?) (34) : (23 décembre) 2020. Dans un article du Canard enchaîné consacré à la difficile succession de Marcel Dassault [1892-1986], ses quatre enfants sont présentés : Laurent (67 ans), Olivier (69 ans), Thierry (63 ans) Dassault et Marie-Hélène Habert (55 ans). Puis je lis :
« À la mort de Serge, c’est Charles Edelstenne, son fidèle bras droit, qui hérite du spectre. Laurent, Thierry et Benoît Habert, l’époux de Marie-Hélène, sont nommés chacun directeur général délégué. »
Le mariage, ici pour Benoît, sans autre besoin de justificatifs, ouvre de brillantes carrières. 1399 (Cf. Femmes. Noms, Famille. Mariage, Économie)
Femmes (Comment faire disparaître les femmes ?) (35) : (20 novembre) 2021. Sur France Culture, Jean-Christophe Ruffin, auteur de :
« Mes parents ne m’ont pas vraiment élevé. Je n’ai connu que très tard mon père. » 1400 (Cf. Femmes. Mères, Langage. Académie française)
Femmes (Comment faire disparaître les femmes ?) (36) : (10 février) 2022. Dans Pure people, je lis le titre suivant :
« Diaporama. Marc-Olivier Fogiel : Qui est son mari François Roelants avec qui il a eu deux filles ? » (Cf. Corps. Gestation pour autrui [G.P.A])
Femmes (Comment faire disparaître les femmes ?) (37) : (22 mai) 2022. Je vois dans une librairie le livre de Zaineb Fasiki, Hshouma [honte en arabe] - 2019 - dont le sous-titre est :
Corps et sexualité au Maroc. [Prix en 2022 du « courage artistique » (sic) du Festival international de la B.D, d’Angoulême] (Cf. Corps, Sexes. Sexualité)
Femmes (Comment faire disparaître les femmes ?) (38) : (5 novembre) 2022. Je reçois le Courrier de La marche mondiale des femmes, dans lequel je lis :
« Le collectif #NousToutes et l’ensemble des associations féministes et organisations syndicales signataires de ce texte appellent tous•tes celles et ceux qui veulent en finir avec les violences sexistes et sexuelles à manifester le samedi 19 novembre 2022 à Paris et partout en France. […]
En 2022, les violences sexistes et sexuelles restent massives. Elles abiment et parfois brisent la vie de millions de femmes, de personnes LGBTQIA+. […]
Les violences sexistes et sexuelles surviennent partout, et tout le temps. Elles trouvent racine dans le patriarcat et se situent aussi, souvent, au croisement d'autres discriminations, racistes, classistes, validistes, psychophobes, LGBTQIA+phobes, sérophobes, grossophobes, âgistes, islamophobes, antisémites, xénophobes, etc. […]
Quand 225 000 femmes sont victimes de la violence de leur conjoint ou ex-conjoint chaque année, quand un tiers des femmes sont victime de harcèlement sexuel au travail, quand 80 % des femmes handicapées sont victimes de violences, quand 85 % des personnes trans ont déjà subi un acte transphobe, quand 69 % des femmes racisées sont victimes de propos discriminants au travail, quand les femmes grosses ont 4 fois plus de risque d’être discriminées au travail, quand 6,7 millions de français.es ont subi l’inceste, quand des patient•e•s sont violé•e•s dans des cabinets gynécologiques ou des maternités, nous n’avons pas le choix ! Et nous appelons toute la société à nous rejoindre. […] »
Qui veut tout embrasser, n’étreint plus rien. (Cf. Êtres humains. Trans. L.G.B.T, Féminismes, Langage. Mots. Crique de mots : « Choix ». « Phobies ».« Racisé-es », Violences. Violences. Incestueuses)
Femmes (Comment faire disparaître les femmes ?) (39) : (22 avril) 2024. Lu dans Elle :
« Ce lundi, le créateur de mode Simon Porte Jacquemus a annoncé la naissance de ses jumeaux avec son époux Marco Maestri. Il a annoncé l’heureuse nouvelle ce lundi 22 avril, sur sa page Instagram. Marié à Marco Maestri depuis 2022, le créateur français Simon Porte Jacquemus, a accueilli des jumeaux prénommés Mia et Sun avec son compagnon. ‘Bienvenus sur terre à nos amours. Nous vous aimons tellement. Notre rêve devient réalité avec vous. Papa Marco et papa Simon’, écrit-il sur le réseau social. » (Cf. Corps. GPA, Femmes. Mères)
Femmes (Comment faire disparaître les femmes ?) (40) : (17 juin) 2024. Entendu, dans un film américain sur la guerre du Vietnam ce dialogue :
« - Ou vas-tu ? »
« - Je vais tirer mon coup. » (Cf. Relations entre êtres humains. « Faire l’amour », Violences. Viols)
Femmes (Comment faire disparaître les femmes ?) (41) : (10 juillet) 2024. Entendu défendre sur Radio courtoisie (Radio d’extrême-droite) : « la défense de la famille et la promotion de la natalité ».
Femmes (Comment faire disparaître les femmes ?) (42) : (23 novembre) 2024. La marche mondiale des femmes annonce à Berne (Suisse) une manifestation « contre la violence et l’oppression » aussi présentée « contre la violence basée sur le genre » (Cf. Langage. Genre, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
Femmes (Comment faire disparaître les femmes ?) (43) : (23 novembre) 2024. France.
« Manifestation contre les fémicides, les violences sexuelles et la violence de genre »
Je lis aussi dans le texte de présentation qu’il est question de « violences faites aux femmes et minorités de genre ».
Je lis enfin :
« Les violences de genre interviennent aussi au croisement de plusieurs systèmes de domination et d’exclusion. Elles touchent particulièrement les personnes aux identités multiples et vulnérabilisées parce qu’elles sont racisées, précaires, lesbiennes, gays, bi, trans, queer, intersexes, exilées, sans papiers ou en situation irrégulière, incarcerées, handicapées, affectées par des maladies ou troubles psychiques, vivant avec le VIH, travailleuses du sexe, victimes de l’exploitation, à la rue, usagères de produits psycho- actifs, mères isolées, mineures, âgées, grosses. »
La confusion à son comble. (Cf. Langage. « Genre », Patriarcat, Violences. Violences à l’encontre des femmes. « Fémicides »)
Femmes (Comment faire disparaître les femmes ?) (44) : (23 novembre) 2024. Lu sur Franceinfo :
- « Plus de 100.000 personnes, selon la CGT, ont battu le pavé pour protester contre les violences faites aux femmes. Les manifestants demandent notamment un plus fort engagement des pouvoirs publics sur la question et ont présenté un plan chiffré pour éradiquer les violences sexuelles. »
- « La CGT revendique 100.000 personnes dans ses manifestations contre les violences faites aux femmes organisées partout en France. Le syndicat a compté 80 000 participants à Paris, 3 000 à Bordeaux, 2 500 à Montpellier, 300 à Metz, ou encore 300 à Perpignan. ‘La réussite de ces mobilisations est la preuve que la société française prend enfin conscience des réalités du patriarcat’, salue la CGT dans son communiqué. »
- « Les associations réclament un budget total de 2,6 milliards d'euros par an et une ‘loi-cadre intégrale’ pour remplacer une législation actuelle qu'elles jugent ‘morcelée et incomplète’. La secrétaire d'État chargée de l'Égalité femmes hommes, Salima Saa a promis ‘des mesures concrètes et efficaces’ pour le 25 novembre. Ces mesures viseront entre autres à ‘améliorer les dispositifs d'aller-vers’ les victimes, notamment en milieu rural, renforcer ‘l'accueil et de la prise en charge des victimes’ via une ‘formation des acteurs en première ligne’, a-t-elle précisé. »
Femmes (Comment faire disparaître les femmes ?) (45) : (décembre) 2024. Lu dans Le Monde Diplomatique, L’héritage occulté de Messali Hadj (p.19). Encore une fois, son épouse absente. Si « l’histoire est toujours écrite par les vainqueurs », comme débute l’article, elle est toujours écrite par les hommes, ou justement, par son auteur.
Femmes (Comment faire disparaître les femmes ?) (46) : (décembre) 2024. Lu dans Le Monde Diplomatique :
- dans l’article : « L’Amérique, plus que jamais polarisée. Un mandat puissant et sans précédent. (p.8), dans le tableau intitulé : Pour qui ont-ils voté ? je lis, dans Sexe et origine ethnique, trois rubriques. « Hommes Hispaniques », « Femmes noires », « Hommes blancs », accompagné de cette conclusion : « La question du genre [?], exploitée jusqu’à plus soif par la campagne républicaine - ne serait-ce pas plutôt démocrate avec la polarisation de Kamala Harris sur l’avortement ? -, n’est qu’un exemple parmi d’autres des guerres culturelles [?] dans lesquelles les démocrates se sont retrouvés du côté des perdants ? »
- dans l’article : « Bataille d’interprétation autour d’un scrutin. Et M. Trump prit sa revanche (p.9), je lis :
« Car M. Trump doit moins sa réélection, à une surmobilisation de ses bastions traditionnels (ruraux, évangéliques et blancs) qu’un basculement en sa faveur d’une fraction significative des jeunes, des hispaniques et des noirs. » Et, plus précisément, concernant les votes des femmes, je lis que Mme Harris a « moins mobilisé l’électorat féminin - les femmes -, y compris âgé de 18 à 29 ans que M. Biden que quatre ans plus tôt. »
N.B. Comme en 2020, les femmes ont majoritairement voté Kamala Harris ; les hommes majoritairement voté Donald Trump. (Poursuivre)
Femmes (Comment faire disparaître les femmes ?) (47) : (19 juin) 2025. Je reçois de Nous toutes, un texte intitulé Procès le Scouarnec / Le planning familial et le CIDFF en difficulté / Continuons de soutenir la Palestine, dans lequel je lis :
« C’est le mois des fiertés. Depuis le 1er juin, le mois des fiertés pour défendre les droits des personnes LGBTQIA+ a démarré. La montée du fascisme menace les droits des personnes trans et des personnes LGBTQIA+ partout dans le monde. Le mois des fiertés a donc pour but de donner de la visibilité aux minorités sexuelles et de genre et de continuer de revendiquer leurs droits, et ce, notamment pendant les prides. »
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Comment faire disparaître les hommes ? :
Femmes (Comment faire disparaître les hommes ?) (1) : 1986. Dr. Gilbert Tordjman [1927-2009], « président fondateur de l’Association mondiale de sexologie », auteur de :
« La femme et son plaisir » [Collection Marabout. Services. 395p.] (Cf. Sexes. Sexologie)
N.B. Je n’oublie pas pour autant les femmes lesbiennes…
Femmes (Comment faire disparaître les hommes ?) (2) : (2 octobre) 2025. Je reçois de l’association ‘Nous toutes’ un texte dans lequel je lis : « Femmes victimes de féminicides ». (Cf. Langage. Genre, Féminismes. Victimaire, Violences. Violences à l’encontre des femmes. « Féminicides »)
Par ordre chronologique (au début, approximativement). Femmes. Comment meurent les femmes ? :
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (1) : À Dinah et son amant, assassinés par le roi de perse Chahirar, si souvent oubliés du fait de l’intelligence et l’imagination de Shéhérazade.
Pour rappel de la genèse des Mille et une nuits : Chahirar trompé par son épouse avec un esclave noir, décide de se venger en violant chaque nuit une femme vierge qu’il tuera ensuite. Il estime qu’il lui faudra au moins mille et une femmes pour assouvir sa vengeance. Shéhérazade saura différer ces assassinats nuit après nuit en racontant au sultan des histoires qui s’emboitent et s’enchainent et dont il voudra à chaque fois connaitre la suite.
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (2) : 1261-1266. Exemples cités par la Légende dorée :
« - Dorothée, née d’une famille noble, inspire une violente passion au proconsul Fabrice. Mais elle lui répond qu’elle est fiancée à Jésus. Fabrice la fait jeter dans un tonneau d’huile bouillante, ce dont elle n’éprouve aucun mal. Puis, il la fait enfermer neuf jours en prison, sans nourriture. Mais d’autres supplices demeurent sans effet. Elle meurt décapitée. [II. p.283 à 285]
- Barbe a été enfermée dans une tour pas son père, Dioscore, afin que personne ne puisse la voir. Convertie à la suite d’un échange de lettres avec Origène, elle subit divers supplices avant d’avoir elle aussi la tête tranchée. [II. p.296 à 302]
- Geneviève, née au village de Nanterre, enseignée par Saint-Germain, évêque d’Auxerre, détourne de Paris Attila et les Huns, par ses prières. Elle sauve les parisiens de la famine, et multiplie les miracles. Elle meurt à plus de quatre-vingt ans. [II. p.322à 329]
- Agathe, fille noble de Cathane, est convoitée par le consul de Sicile, Qunicien. Sur son refus, celui-ci la fait torturer de diverses manières : ‘Il commande que ses mamelles fussent tordues, et qu’après qu’elles auraient été longtemps tordues, elles fussent coupées.’ » [I. p.135à 140] Le texte ici cité est celui précédé d’une notice historique et bibliographique par Gustave Brunet [éd. Gosselin, 1843. 2 vol.) 1401
N.B. « La légende dorée est un ouvrage rédigé en latin par Jacques de Voragine qui raconte la vie d'environ 150 saints ou groupes de saints, de saintes, de martyrs chrétiens […], puisés dans les textes classiques de la littérature religieuses de Moyen-Âge » [Wikipédia]
Et qui a imprégné, pendant des siècles, nombre de catéchismes enseignés, notamment, aux petites filles.
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (3) : Femmes guillotinées (connues par moi) : Marie-Antoinette [1755-16 octobre 1793], Lucille Desmoulins [1770-13 avril 1793], Charlotte Corday [1768-17 juillet 1793], Marie-Marguerite Françoise Hébert [1756-13 avril 1794], Olympe de Gouges [1748-3 novembre 1793, Madame Roland [8 novembre 1754], madame du Barry [1743-8 décembre 1793], les seize carmélites de Compiègne [le 17 juillet 1794], Georgette Thomas [?-24 janvier 1887], Mata Hari [1876-15 Octobre 1917], Olga Bancic [1912-10 mai 1944], France Bloch [1913-12 février 1943], Marie-Louise Birgy [1909-11 mai 1944], Suzanne Cointe [1905-20 août 1943], Renée Levy [1906-31 août 943], Suzanne Masson [1er novembre 1901-1943] Emilienne Mopty [1907-18 janvier 1943], Simone Schloss [1920-17 juillet 1942], Gertrud Weisler [1918-16 décembre 1943], Marie-Louise Giraud [1903-130 juillet 943]… (Poursuivre)
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (4) : Chanson : Ne pleure pas Jeannette.
« Ne pleure pas, Jeannette, Nous te marierons / Avec le fils d'un prince / Ou celui d'un baron. / Je ne veux pas d'un prince, / Encor' moins d'un baron. / Je veux mon ami Pierre, / Celui qu'est en prison. / Tu n'auras pas ton Pierre, / Nous le pendouillerons. / Si vous pendouillez Pierre, / Pendouillez moi avec. / Et l'on pendouilla Pierre, / Et sa Jeannette avec /
Tout en haut d'un grand chêne / Un rossignol chantait / Il chantait les louanges / De Pierre et de Jeannette. »
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (5) : Chanson : Le roi Renaud de guerre revient :
« Le roi Renaud de guerre revint / Tenant ses tripes dans ses mains, / Sa mère est à la tour en haut / Qui voit venir son fils Renaud
Renaud, Renaud réjouit toi / Ta femme est accouché d'un roi ! / Ni de femme ni de mon fils/ Mon cœur ne peut se réjouir.
Je sens la mort qui me poursuit / Mais refaites dresser un lit / Et faites-le dresser ci-bas / Que ma femme n'entende pas.
Guère de temps y dormirai / A minuit je trépasserai / Et quand ce fut vers la minuit / Le roi Renaud rendit l'esprit.
Il ne fut pas soleil levé / Que les valets l'ont enterré / Sa femme en entendant le bruit / Se mit à gémir dans son lit.
Ah dites-moi, ma mère m'amie / Ce qui vous fait pleurer aussi / Ma fille ne puis le cacher/ Renaud est mort et enterré.
Ma mère dites aux fossoyeux / Qui creusent la fosse pour deux / Et que le trou soit assez grand Pour qu'on y mettent aussi l'enfant
Terre fend toi, terre ouvre-toi / Que j'aille rejoindre mon roi / Terre fendit, terre s'ouvrit / Et la belle rendit l'esprit. »
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (6) : Chanson : La Femme de Saint Cloud (La) : [Souvenir d’enfance] :
« En revenant de la foire (bis) – De la foire de Saint Cloud (bis) – J’ai rencontré un brave homme (bis) – Je lui dis : que portez-vous ? (bis) – C’est ma femme que je porte (bis) – Je vous la laisse à cinq sous (bis) – Et de cinq, je passe à quatre (bis) – Et de quatre à rien du tout (bis) – Et si elle vous embarrasse (bis) – Mettez la dans un grand trou (bis) – Et remplissez-le de paille (bis) – Et mettez le feu dessous (bis) – Et dites au voisinage (bis) – Venez voir brûler le loup (bis) – Ce n’est pas le loup qui brûle (bis) – C’est la femme de Saint Cloud (bis) »
- Un autre souvenir d’une chanson d’enfance dont le dernier couplet se terminait par :
« Vive les vacances ! Fini les pénitences ! Les cahiers au feu ! Et la maîtresse au milieu ! »
* Ajout. 30 juin 2019. Je lis une référence à cette même comptine enfantine qui se termine par : « Et le maître au milieu ». 1402
Par ordre chronologique. Femmes. Comment meurent les femmes ? Voltaire :
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (7) : 1728. Voltaire [1694-1778], dans une ‘Avant-Lettre anglaise’, auteur de :
« […] Dans le moment, arriva un de leurs amis, qui leur dit avec un visage indifférent : ’Molly s’est coupé la gorge ce matin. Son amant l’a trouvé morte dans sa chambre, avec un rasoir sanglant à côté d’elle.’ Cette Molly était une jeune fille jeune, belle, et très riche, qui était prête à se marier avec le même homme qui l’a trouvée morte. Ces messieurs, qui étaient tous des amis de Molly, reçurent la nouvelle sans sourciller. L’un d’eux seulement demanda ce qu’était devenu l’amant : il a acheté le rasoir, dit froidement quelqu’un de la compagnie. » 1403 (Cf. Femmes. Jeunes filles)
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (8) : (janvier) 1774. Lu dans la Correspondance de Voltaire [1694-1778] :
« Un habitant de Tours, salpêtrier de sa profession, a tué sa fille de trois balles dans la poitrine après lui avoir fait un enfant. » 1404 (Cf. Violences. Violences à l’encontre des enfants. Violences. Incestueuses. Violences à l’encontre à l’encontre des femmes)
-------------
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (9) : 1778. Lettre de Mirabeau [1749-1791] (en prison) à Sophie de Monnier [1754-1789] :
« Je sais que tu ne vis qu’en moi et pour moi, que tu n’as jamais cru pouvoir ni devoir me survivre, et que le premier mouvement te serait probablement funeste, si je périssais avant toi. »
Je lis ensuite sur Wikipédia que, plus tard, « elle fit la connaissance et se lia avec Edme Benoît de Poterat, ancien capitaine de cavalerie, lieutenant des Maréchaux de France qu'elle devait épouser lorsqu'il mourut des suites d'une maladie de poitrine. Sophie, restée seule, se donna la mort par asphyxie, le 8 septembre 1789, à l'âge de 35 ans. »
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (10) : (12 février) 1791. Isabelle de Charrière [1740-1805] écrit à Benjamin Constant [1767-1830] :
« (Concernant madame Pourtalès [?-1791]) Quelques semaines avant sa mort [5 février 1791], elle a compris que la mort était inévitable. Son despotisme et son impatience ont fini aussitôt et hors quelques instants de douleur, tantôt vive et tenant du désespoir, tantôt sourde et s’exhalant en larmes, elle s’est montrée résignée et courageuse. » 1405
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (11) : 1796. Denis Diderot [1713-1784], dans La religieuse, auteur de :
« (Concernant sœur Ursule, au couvent des Clarisses de Longchamp, la seule amie de Suzanne Simonin, sœur Suzanne) : « La pauvre sœur n’était plus ; elle était étendue sur son lit, toute vêtue, la tête inclinée sur son oreiller, la bouche entrouverte, les yeux fermés, et le christ entre ses mains. La supérieure la regarde froidement : ‘Elle est morte. Qui l’aurait crue si proche de sa fin ? C’était une excellente fille : qu’on aille sonner pour elle, et qu’on l’ensevelisse.’ » 1406
Par ordre chronologique. Femmes. Comment meurent les femmes ? Honoré de Balzac :
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (12) : 1833. Honoré de Balzac [1799-1850], dans Le médecin de campagne, auteur de :
« […] Déjà j’étais embarrassé de savoir comment je me dégagerais de cette liaison. Cet embarras, cette honte, mènent à la cruauté. Pour ne point rougir devant sa victime, l’homme qui a commencé par la blesser, la tue. […]
Assassins de salon ou de grande route, nous aimons que nos victimes se défendent, le combat semble alors justifier leur mort. » 1407 (Hommes. Violents, Violences)
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (13) : (25 août) 1834. Honoré de Balzac [1799-1850] écrit à Ewelina Hanska [1801-1882] concernant Volupté - 1834 - de Charles-Augustin Sainte-Beuve [1804-1869] :
« Ce livre m’a fait faire une grande réflexion. La femme a un duel avec l’homme, et où elle ne triomphe pas elle meurt. Si elle n’a pas raison, elle meurt. Si elle n’est pas heureuse, elle meurt. Cela est effrayant. »
N.B. Le lys dans la vallée -1835 - fut écrit en réaction à Volupté. 1408
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (14) : 1846. Honoré de Balzac [1799-1850], dans La cousine Bette, auteur de :
« [...] Et l’on vit, ce qui doit être rare, des larmes sortir des yeux d’une morte. » 1409
-------------
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (15) : 1853. Jules Michelet [1798-1874], dans son Histoire de la Révolution française, rapporte comment le 17 juillet 1789, sous la pression populaire, Louis XVI [1754-1793] fut contraint de se rendre à Paris. Il écrit :
« L’ordre était grand, le silence aussi : pas un cri de ‘Vive le Roi’ ! ». Et, en note, Michelet écrit :
« Sauf un malheureux hasard : un fusil partit et une femme fut tuée. » 1410
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (16) : 1839. Charles Dickens [1812-1870], dans Les aventures d’Oliver Twist, auteur de :
« […] Le médecin le lui mit dans les bras. Elle pressa avec passion ses lèvres blanches et froides sur le front du bébé, se passa les mains sur le visage, jeta autour d’elle un regard éperdu, frissonna, retomba sur l’oreiller - et mourut. » 1411
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (17) : 1861. George Eliot [1819-1880], dans Silas Marner, auteure de :
« - C’est une femme, répondit Silas à voix basse et à demi hors d’haleine. Elle est morte, je crois… morte dans la neige, aux carrières… Non loin de ma porte. […]
- Chut, chut ! dit M. Crackenthorp. Passez là, dans le vestibule. Je vais aller chercher le docteur. […] Mieux vaut en parler le moins possible ; cela choquerait les dames. Dites-leur seulement qu’une pauvre femme est tombée malade de froid et de faim. » 1412 (Cf. Femmes. Écrivaines. Eliot George)
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (18) : 1862. Victor Hugo [1802-1885], dans Les misérables, auteur de :
« Fantine se dressa en sursaut, appuyée sur ses bras roides et sur ses deux mains, elle regarda Jean Valjean, elle regarda Javert, elle regarda la religieuse, elle ouvrit la bouche comme pour parler, un râle sortit du fond de sa gorge, ses dents claquèrent, elle étendit les bras avec angoisse, ouvrant convulsivement les mains, et cherchant autour d’elle comme quelqu’un qui se noie, puis elle s’affaissa subitement sur l’oreiller. Sa tête heurta le chevet du lit et vint retomber sur sa poitrine, la bouche béante, les yeux ouverts et éteints.
Elle était morte. »
« Un dernier mot sur Fantine.
Nous avons tous une mère, la terre. On rendit Fantine à cette mère. […]
Fantine fut donc enterrée dans ce coin gratuit du cimetière qui est à tous et à personne, et où l’on perd les pauvres. […] On coucha Fantine dans les ténèbres parmi les premiers os venus, elle subit la promiscuité des cendres. Elle fut jetée à la fosse publique. Sa tombe ressembla à son lit. 1413 (Cf. Corps. Cadavres. Os, Économie. « Pauvres Les »)
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (19) : (22 octobre) 1864. George Sand [1804-1876], dans une lettre à Nancy Fleury [1834-1889], concernant l’écriture d’un nouvelle - non citée, non publiée -, auteure de :
« Le récit est bien conduit, la fin est juste et bonne. Les choses immenses que voit Lunella sont habillement résumées et assez frappantes dans leur sobriété d’énonciation. La jeune fille qui meurt pour avoir trop dansé en même temps que celle qui meurt pour avoir trop travaillé est un trait charmant. Si tu pouvais en ajouter quelques autres aussi nets et aussi heureux […]. » 1414 (Cf. Femmes. Jeunes filles)
Par ordre chronologique. Femmes. Comment meurent les femmes ? Léon Tolstoï :
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (20) : 1865-1869. Léon Tolstoï [1828-1910], dans La guerre et la paix, auteur de :
« […] Le surlendemain, on fit le service funèbre de la petite princesse [Lise], et pour lui dire adieu, André [son mari] monta sur le catafalque. En dépit de ses yeux clos, le visage de la morte avait toujours la même expression et semblait toujours dire : ’Ah ! Qu’avez-vous fait de moi ?’ André sentit que quelque chose se déchirait en lui, il se sentit coupable d’une faute inexpiable. » (Cf. Femmes. Accouchements, Hommes. Responsables, Famille. Mariage, Patriarcat)
N.B. « Catafalque » : « Estrade décorée où l’on place un cercueil »
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (21) : 1877. Léon Tolstoï [1828-1910], dans Anna Karénine, auteur de :
« […] Là, se dit-elle en fixant dans ce trou noir les traverses recouvertes de sable et de poussière, là, au beau milieu, il sera puni et je serais délivrée de tous et de moi-même.’
Son petit sac rouge qu’elle eut quelque peine à détacher de son bras, lui fit manquer le moment de se jeter sous le premier wagon, force lui fut d’attendre le second. Un sentiment semblable à celui qu’elle éprouvait jadis avant de faire un plongeon dans la rivière s’empara d’elle et elle fit le signe de la croix. Ce geste familier réveilla dans son âme une foule de souvenirs d’enfance et de jeunesse ; les minutes heureuses de sa vie scintillèrent un instant à travers les ténèbres qui l’enveloppaient. Cependant, elle ne quittait pas des yeux le wagon, et lorsque le milieu entre les deux roues apparut, elle rejeta son sac, rentra sa tête dans les épaules et les mains en avant, se jeta sur les genoux sous le wagon, comme prête à se relever. Elle eut le temps d’avoir peur. ‘Où suis-je ? Que fais-je ? Pourquoi ?‘ pensa-t-elle, faisant effort pour se rejeter en arrière. Mais une masse énorme, inflexible, la frappa à la tête et l’entraina par le dos. ‘Seigneur, pardonnez-moi !’, murmura-t-elle, sentant l’inutilité de la lutte. […] »
N.B. Lu dans les notes de La Pléiade [1951] concernant la mort d’Anna Karénine, un passage d’une lettre du 8 septembre 1877 de Nicolaï Strakhov [1828-1896] à Léon Tolstoï :
« Parmi les reproches qu’on vous fait, un seul a du sens. Tous ont remarqué que vous refusiez de vous appesantir sur la mort d’Anna… Je ne comprends pas encore le sentiment qui vous a guidé. Peut-être que j’arriverai à saisir, mais aidez-moi. La dernière rédaction de la scène de la mort est si sèche que c’en est effrayant. Il me semble d’ailleurs qu’il vous est difficile d’en présenter une autre aux lecteurs quand tous les traits de celle-ci jusqu’aux derniers sont déjà gravés dans leur mémoire. » 1415 (Cf. Relations entre êtres humains. Reproches)
* Ajout. 30 mars 2023. (24 septembre) 1889. Léon Tolstoï [1828-1910] écrit, dans son Journal :
« Au dîner S[onia] - son épouse - disait qu’en voyant un train approcher, elle avait envie de se jeter dessous. […] » 1416
Par ordre chronologique. Femmes. Comment meurent les femmes ? Émile Zola :
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (22) : 1871. Émile Zola [1840-1902], dans La fortune des Rougon, auteur de :
« Vers les premiers jours de l’année 1850, Fine mourut presque subitement d’une fluxion de poitrine, qu’elle avait prise en allant laver un soir le linge de la famille à la Viorne, et en le rapportant mouillé sur son dos ; elle était rentrée trempée d’eau et de sueur, écrasée par ce fardeau qui pesait un poids énorme et ne s’était plus relevée. » 1417
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (23) : 1871. Émile Zola [1840-1902], dans La curée, auteur de :
« […] Elle pardonna au dernier soupir. Elle mourut comme elle avait vécu, mollement, s’effaçant dans la mort, après s’être effacée dans la vie. » 1418
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (24) : 1871. Émile Zola [1840-1902] termine La curée, ainsi :
« L’hiver suivant, lorsque Renée mourut d’une méningite aigüe, ce fut son père qui paya ses dettes. La note de Worms [Charles Frederik. couturier. 1825-1895] se montait à deux cent cinquante-sept mille francs. » 1419
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (25) : 1873. Émile Zola [1840-1902], dans Le ventre de Paris, auteur de :
« […] Dans la nuit du 4 décembre [1851], les soldats avaient balayé les trottoirs, à bout portant, pendant un quart d’heure. Lui, poussé, jeté à terre tomba. […] Quand il n’entendit plus rien, il voulut se relever. Il avait sur lui une jeune femme, en chapeau rose, dont le châle glissait, découvrant une guimpe à petits plis. Au-dessus de la gorge, dans la guimpe, deux balles étaient entrées ; et, lorsqu’il repoussa doucement la jeune femme, pour dégager ses jambes, deux filets de sang coulèrent des trous sur ses mains. […] » 1420
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (26) : 1875. Émile Zola [1840-1902], dans La faute de l’abbé Mouret, auteur de :
« Albine était morte dans un hoquet suprême de fleurs. » 1421
N.B. Albine, enceinte, s’était suicidée, après l’abandon de son amant, prêtre.
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (27) : 1877. Émile Zola [1840-1902], dans L’Assommoir, auteur de :
« Alors, prise d’une tristesse atroce, les larmes aux yeux, elle [Gervaise] raconta l’agonie de madame Bijard, sa laveuse, morte le matin, après d’épouvantables douleurs.
- Ça venait d’un coup de pied que lui avait donné Bijard, disait-elle d’une voix douce et monotone. Sans doute, il lui avait cassé quelque chose à l’intérieur. Mon Dieu ! en trois jours, elle avait été entortillée… Ah, il y, aux galères, des gredins qui n’en ont pas tant fait. Mais la justice aurait trop de besogne si elle s’occupait des femmes crevées par leurs maris ? Un coup de pied de plus ou de moins, n’est-ce pas ? ça ne compte pas, quand on en reçoit tous les jours. D’autant plus que la pauvre femme voulait sauver son homme de l’échafaud et expliquait qu’elle s’était abimé le ventre en tombant sur un baquet…Elle a hurlé toute la nuit avant de de passer. […] » 1422 (Cf. Justice. Patriarcale, Hommes. Féminismes. Zola Émile. Violents, Violences, Violences à l’encontre des femmes)
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (28) : 1880. Lire le long récit de la mort de Nana d’Émile Zola [1840-1902], entrecoupé des slogans entendus dans les rues : « ‘À Berlin, À Berlin, À Berlin ! » 1423
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (29) : 1887. Émile Zola [1840-1902], dans La terre, auteur de :
« Le lendemain, Rose ne put quitter son lit. On appela la docteur Finet, qui revint trois fois, sans la soulager. À la troisième visite, l’ayant trouvée à l’agonie, il prit Fouan à part, il demanda comme un service d’écrire tout de suite et de laisser le permis d’inhumer : cela lui éviterait une course, il usait de cet expédient, pour les hameaux lointains. Cependant elle dura trente-six heures encore. Lui, aux questions, avaient répondu que c’était la vieillesse et le travail, qu’il fallait bien s’en aller, quand le corps était fini. Mais, dans Rognes, où l’on savait l’histoire, tous disaient que c’était un sang tourné. Il y eut beaucoup de monde à l’enterrement, Buteau et le reste de la famille s’y conduisirent très bien. » 1424
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (30) : 1887. Émile Zola [1840-1902], dans La terre, auteur de :
« […] Mais elle [Palmyre] jeta un nouveau cri d’agonie, plus déchiré, d’une détresse affreuse ; et, lâchant tout, tournant sur elle-même, elle s’abattit dans le blé, foudroyé par le soleil qui la chauffait depuis onze heures. […]
Elle était allongée, la face au ciel, les bras en croix, comme crucifiée sur cette terre, qui l’avait usée si vite à son dur labeur, et qui la tuait. […] » 1425 (Cf. Femmes. Travail)
-------------
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (31) : (25 mai) 1871. Je lis dans le Petit dictionnaire des femmes de la Commune :
« M… Marie. 19 ans. ‘Habillée en fusilier marin, rose et charmante, aux cheveux noirs bouclés’, elle se bat tout un jour à la barricade du Château-d’Eau, elle y est tuée le jeudi 25 mai. » 1426
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (32) : 1871. Je lis dans Jean Grave [1854-1939], dans Mémoires d’un anarchiste [1930. 2009] :
« (Pendant la Commune) On avait inventé la légende des pétroleuses, transportant le pétrole dans des boîtes à lait. Combien de femmes furent fusillées en allant chercher cet aliment - le lait, pas le pétrole ! - pour enfants ! Ou parce qu’il prenait à quelque sadique de crier : ‘à la pétroleuse !’ » 1427
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (33) : (10 octobre) 1892. Jules Renard [1864-1910], dans son Journal, auteur de :
« Montjoyeux [Jules Poignand. 1851-1921] et un autre [?] avaient une femme de ménage à qui ils donnaient à boire. Un jour, ils rentrent soûls. Ils broient du tripoli dans du vinaigre et le font boire à la femme qui meurt. Ni le médecin, ni personne ne remarque qu’elle a été empoisonnée. On la conduit au cimetière pieusement et sans remords… » 1428 (Cf. Hommes. Assassins)
N. B. « Tripoli » : « Poudre utilisée dans le récurage et le polissage du verre, du bois et des métaux »
Par ordre chronologique. Femmes. Comment meurent les femmes ? Anton Tchékhov :
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (34) : 1893. Anton Tchékhov [1860-1904], dans Récit d’un inconnu, auteur de :
« Dans la nuit Daria Mikhaïlovna m’annonça que Mme Krasnovskaïa avait mis au monde un petite fille, que son état était inquiétant ; puis j’entendis des pas précipités, du bruit. Daria Mikhaïlovna revint et me dit, d’un air désespéré, en se tordant les mains :
‘ Oh, c’est affreux ! Le docteur la soupçonne de s’être empoisonnée ! Ce que les Russes peuvent manquer de tenue, ici !’
Et le lendemain à midi, Mme Krasnovskaïa mourut. » 1429
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (35) : 1896. Anton Tchékhov [1860-1904], dans Ma vie. Récit d’un provincial, auteur de :
« Les jours de la semaine je travaille du matin au soir. Les dimanches, quand il fait beau, je prends dans mes bras ma minuscule nièce (ma sœur voulait un garçon mais elle a eu une fille) et je vais me presser au cimetière. J’y reste un bon moment et je dis à la fillette que c’est là que repose sa maman. » 1430
-------------
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (36) : 1905. Louise Michel [1830-1905], dans Souvenirs et aventures de ma vie, auteure de :
- « (Après avoir évoqué le froid dans sa cellule - « l’eau gelait dans ma cellule de grès ») - elle poursuit : « Cette année, plusieurs détenues de Clermont succombèrent. Presque chaque jour je voyais passer, de ma fenêtre, de pauvres convois noirs, frangés de neige, qui se dirigeaient vers le petit cimetière dont j’ai déjà parlé. Pauvres êtres que la mort a déjà fauchés et qui étaient morts sans avoir pu serrer, une dernière fois dans leurs bras, leur mari ou leurs enfants ! Rien n’est triste comme la mort dans une prison ! »
- « Les suicides que j’ai vu à Saint-Lazare sont innombrables. Mais l’administration a trouvé un délicieux euphémisme pour consigner sur ses registres les suicides des détenues. Elle appelle cela un ‘anévrisme’. » 1431 (Cf. Famille, Patriarcat, Politique. Répression. Prison)
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (37) : (25 mars) 1911. Dans l’incendie de la Tringle Shirtwest Company, 146 salariées ont été brûles vives à leurs postes de travails - les portes des ateliers étaient fermées - et les 8e, 9e, 10ème étage étaient inaccessibles aux échelles de pompiers - ou se sont jetées par la fenêtre. Quelque cent mille personnes suivirent le cortège funèbre. 1432 (Cf. Femmes. Travail, Économie. Mode. Capitalisme, Histoire. « Longue »)
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (38) : (5 décembre) 1911. L’abbé Mugnier [1853-1944], dans son Journal, écrit :
« Je viens d’administrer une vieille religieuse. Vieilles ou jeunes, ces femmes meurent si facilement ! Quand elles ont reçu tous les sacrements, elles ont la paix et partent de ce petit lit aux rideaux blancs pour les rivages du mystère. » 1433
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (39) : 1929. Panaït Istrati [1884-1935], dans Vers l’autre flamme, concernant la Russie soviétique, auteur de :
« Victor Serge [1890-1947] - concernant « une cinquantaine d’affaires arrivées ce matin » - met le nez dans cinq ou six d’entre elles et tombe sur deux suicides pour cause de persécution bureaucratique. ‘Dans la plupart de nos foyers, dit Koltsov [« fameux chroniqueur communiste »], les ménagères se jettent de l’eau bouillante à la figure. Il y en a qui sont des épouses d’anciens commissaires du peuple.’
Eh bien, pensais-je, elle est jolie, votre dictature. » 1434
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (40) : 1935. Louis Guilloux [1899-1980], dans Le sang noir, auteur de :
« La légende voulait que Léon eût blanchi en une seule nuit, une nuit dramatique, où l’une de ses maîtresses, une jeune fille de vingt-deux ans, s’était suicidée sous ses yeux. On l’accusait de l’avoir tuée et de ne s’en être tiré que grâce à des hautes protections, celle de la police elle-même. Il en était sûrement. Le trouble passé de Léo et, en dehors du suicide de la jeune fille, certaines histoires, dites de mœurs mystérieusement étouffées, donnait à cette suspicion un crédit qu’accroissait encore le fait que depuis la guerre il n’eut pas quitté la préfecture. 1435 (Cf. Femmes. Jeunes filles, Justice, Politique. État. Répression, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (41) : 1936. Édith Piaf [1915-1963] chante la bouleversante chanson Les mômes de la cloche, dont voici le dernier couplet :
« C’est nous les mômes, les mômes de la cloche, / Clochards qui s’en vont sans amis, sans proches. / C’est nous les paumées, les purées d’paumées / Qui s’en vont dormir dans l’horrible trou. / Derrière not’ convoi / Jamais l’on ne voit / Ni fleurs ni couronnes, / Pas même une personne / Qu’è’qu’ça fout, / On s’en fout ! / Quand la mort nous fauche, / C’est not’ plus beau jour. / Cloches, sonnez pour / Les mômes de la cloche ! » (Cf. Proxénétisme. Femmes-dites-prostituées)
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (42) : (7 novembre) 1937. Paul Claudel [1868-1955], dans son Journal, auteur de :
« Renan [Ernest. 1823-1892] au moment où il allait se mettre à raconter l’agonie de Gethsémani frappé d’un accès de fièvre qui faillit lui coûter la vie. Ce fut sa digne soeur qui mourut. […] » 1436 (Cf. Hommes. Claudel Paul)
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (43) : 1940. Chanson : La chanson de Catherine [chantée par Édith Piaf, Juliette Gréco…] :
« Te voilà mariée, Catherine, Sans joie et sans amour. / Celui que tu aimes, Catherine, / Est perdu pour toujours... /
Qu'ils étaient doux, les jours passés, / Mais à quoi bon les évoquer ? / Un oiseau noir crie dans la nuit. / Hier, Catherine, tu as dit ‘oui’ / Et maintenant, il faut danser. / Il faut danser... et oublier. /
Pourquoi pleurer, la belle enfant ? / Les violons jouent tendrement... / Te voilà mariée, Catherine, / Sans joie et sans amour. / Celui que tu aimes, Catherine, / Est perdu pour toujours... /
Il est au bout de ton jardin, / Un très vieux chêne, où un garçon / Avait jadis gravé ton nom / Dans un seul cœur, auprès du sien. /
Vois-tu, celui qui tu aimais, / Vois-tu, celui qui tant t'aimait... / Eh ! L'oiseau noir !... / Que me dis-tu ? / C'est à ce chêne qu'il s'est pendu... /
Te voilà mariée, Catherine, / Sans joie et sans amour. / Celui que tu aimes, Catherine, / Est perdu pour toujours...
Petite Catherine, demain matin, / Dans l'eau glacée de ton chagrin, / Dans l'eau étrange de la mer, / Tu flotteras, les yeux ouverts, / Les yeux ouverts sur ton destin. / Et, dans ta robe de satin, / Juste où la mer se mêle au ciel, / Tu rejoindras l'amant fidèle... / Te voilà mariée, Catherine / Mariée avec l'amour... / Celui que tu aimes, Catherine, Est à toi pour toujours... »
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (44) : 1944. Lu dans la critique par Le Canard enchaîné, du livre d’Olivier Bertrand, Les imprudents [Seuil. 2019] :
« Le 3 mars 1944, tous les habitants des Crottes, un hameau proche de La Bastide-de-Virac [Ardèche] sont tués par les SS pour avoir caché des partisans du réseau Bir-Hakem. Les femmes ont été fusillées de dos, face à leurs hommes. » 1437
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (45) : 1946. Székely János [1901-1958], dans L’enfant du Danube, auteur de :
« Elle se mit à pleurer amèrement.
- ‘Tant que tu as un toit sur la tête, sanglota-t-elle, tu peux crever de faim, tu es tout de même un être humain, mais quand tu es à la rue, il ne te reste plus que ça…’
Et elle me montrait la bouteille d’eau de Javel.
Je savais ce qu’elle voulait dire. Les pauvres de suicident en avalant de l’eau de Javel, parce que la ménagère la plus misérable en a toujours pour sa lessive. Bien des femmes, dans notre village, en avaient bu ; et mon cœur se serrait atrocement à l’idée de ce qui arriverait le jour où elle en aurait assez. » 1438 (Cf. Économie. « Pauvres Les »)
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (46) : 1965. Pierre Citron [1919-2010], dans sa préface à La femme de trente ans [1842] d’Honoré de Balzac [1799-1850], auteur de :
« La plus jeune sœur de Balzac, Laurence [1802-1825] avait épousé à dix-neuf ans un homme de quinze ans son aîné, qui s’était vite révélé un médiocre et un joueur, et avec qui elle avait été si malheureuse que son désespoir avait contribué à causer sa mort à vingt-quatre ans, en 1825. » 1439 (Cf. Femmes. Malheureuses)
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (47) : 1969. Entendu dans le film Indien Uski Roti [Mani Kaul] : « Elle s’est noyée, pourquoi ?
- Elle était veuve et son mari était toujours vivant. » (Cf. Dialogues, Femmes. Veuves)
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (48) : 1970. Alfred Döblin [1878-1957], dans Alexanderplatz, auteur de :
« L’aventure de notre Frantz Biberkopf a été quelque peu différente. Elle mourut aussi, Ida, sa bonne amie, mais au bout de cinq semaines, à l’hôpital Friederichshain [Berlin] : fracture des côtes avec complications, déchirure de la plèvre, légère déchirure du poumon, d’où empyème, suppuration de la plèvre, pneumonie, mon vieux ! et la fièvre qui [ne] veut pas baisser. […] Elle est morte, la haine de Franz au cœur. Mais cette mort n’apaisera pas sa fureur de lui : le nouvel ami d’Ida, le type de Breslau, était venu la voir… » 1440
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (49) : 1972. Jacques Prévert [1900-1977], dans Choses et autres. La femme acéphale, auteur de :
« Elle m’a donné le jour à l’instant même où la nuit lui donné la mort. » 1441
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (50) : 1975. Elsa Morante [1912-1985], dans La storia, auteure de :
« C’est là que deux jours plus tard, des gens de la campagne trouvèrent les cadavres de Mariulina et de sa mère, criblés de projectiles, fendus jusqu’au vagin, le visage, les seins et tout le corps, tailladés à coup de couteau ou de baïonnette. » 1442 (Cf. Corps. Cadavres)
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (51) : 1976. Serge Gainsbourg [1928-1989], dans Meurtre à l’extincteur, auteur de :
« Pour éteindre le feu au cul de Marilou / Un soir n'en pouvant plus de jalousie / J'ai couru au couloir de l’hôtel décrocher de son clou / L'extincteur d'incendie / Brandissant le cylindre / D’acier je frappe paf et Marilou se met à geindre / De son crâne fendu s’échappe un sang vermeil / Identique au rouge sanglant de l'appareil / Elle a sur le lino / Un dernier soubresaut / Une ultime secousse / J'appuie sur la manette / Le corps de Marilou disparaît sous la mousse. » (Cf. Relations entre êtres humains. Haine des femmes, Violences. Violences à l’encontre des femmes. Gainsbourg Serge)
Femmes. Comment meurent les femmes ? Jules Roy :
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (52) : 1989. Jules Roy [1907-2000], dans Mémoires barbares, concernant son épouse :
« Et voilà que Mirande meurt et interrompt mon travail.
Sa mort m’atteint en plein cœur, que je n’ai pas si dur que certains croient. » 1443
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (53) : 1989. Jules Roy [1907-2000], dans Mémoires barbares, concernant sa mère, auteur de :
« Elle avait demandé qu’on s’épargne la dépense d’un faire-part dans les journaux, pensant qu’elle comptait si peu qu’il n’était pas utile de signaler sa disparition. » 1444 (Cf. Femmes. Utiles)
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Comment meurent les femmes ? Jean Tulard :
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (54) : 1995. Jean Tulard, dans le Guide des Films. 1895-1995. L-Z, écrit concernant :
- Manon [1948. Henri-Georges Clouzot] : « Manon meurt dans les bras de son amant qui agonise de douleur sur sa tombe. »
- Mari de la coiffeuse (Le) [1990. Patrick Leconte] : « Leur bonheur est parfait dans le salon de coiffure, si parfait que Mathilde, de peur d’en voir la fin, se suicide. »
- Maria Candaleria [1943. Emilio Fernandez] : « Accusée d’avoir posée nue pour un peintre, elle est lapidée. »
- Maria du quartier des fourmis [1958. Heinosuke Gosho] : « Cependant, bientôt, le surmenage mine la santé de Reiko qui continuera néanmoins à aider le quartier. Matsuki lui annoncera que le quartier est sauvé des promoteurs, puis elle mourra. »
- Marie, légende hongroise [1932. Paul Fejos] : « Une jeune servante est séduite par un riche paysan dont elle a un enfant. Elle doit fuir à la ville où elle devient serveuse dans une boîte louche. Son enfant lui est enlevé et elle meurt. »
- Marie Poupée [1976. Joël Seria] : « (après une tentative de viol), elle meurt en murmurant le nom de Claude (son mari avec elle « impuissant ») qui, loin de là, est dans les bras d’une prostituée. » (Cf. Culture. Cinéma, Corps. Bras, Femmes. Servantes, Hommes. « Impuissants », Violences, Proxénétisme)
- Mes nuits avec Alice, Pénélope, Arnold, Maud et Richard [1976. Frédéric Lansac (Claude Mulot) : « Charlène, Alice et Pénélope, ayant échoué dans leurs métiers, se retrouvent à l’hôpital pour tentative de suicide. Elles y rencontrent Maud, une romancière qui se propose de les héberger et de leur fournir la plus belle des morts : la mort par la jouissance. La maison est un luxueux bordel où elles initient deux jeunes gens. Alice se suicide en s’introduisant de la dynamite dans le sexe. Pénélope meurt étouffée dans un flot de sperme. Charlène est déchirée par un sexe géant. Par-delà la mort, toutes trois engagent Maud à poursuivre sa mission. »
- Commentaire : « Un film aux références littéraires et cinématographiques évidentes, réalisé dans des décors sophistiqués, dans un style très ‘mode’ ! Mais le rapport d’Éros à Thanatos n’est pas inintéressant et il y a quelques scènes hard joliment filmées. » (Cf. Culture. Cinéma, Hommes, Politique. Tortures, Pornographie. Tortures, Proxénétisme, Violences. Violences à l’encontre des femmes, Sexes […])
- Mort, où est ta victoire ? [1963. Hervé Bromberger] : « Elle s’éprend de Jean Paleyzieux qui est marié à une infirme. Ils (sic) tuent l’épouse gênante pour se marier. »
- Né pour tuer [1947. Robert Wise] : « Elle le dénonce alors à la police. Il la tue avant d’être abattu. »
- Une vraie garce / Fedra [1956. Manuel Mur Oti] : « […] Il disparait dans la mer. Estrella se jette à l’eau pour le rejoindre et se laisse engloutir dans les flots avec le cadavre du seul homme qu’elle ait aimé. » (Cf. Corps. Cadavres)
N.B. Le titre espagnol était Fedra. 1445 (Cf. Culture. Cinéma)
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (55) : 2003. Jean Tulard, dans son Dictionnaire du cinéma. Les réalisateurs écrit concernant :
- René Cardona Jr [1933-2003]. Dans La vallée sauvage [1974] « Rarement on est allé aussi loin dans l’horreur qu’avec les images finales où trois jeunes filles nues, suspendues à des crochets par la gorge, brûlent lentement. » (Cf. Culture. Cinéma, Femmes. Nues, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
- Arthur Crabtree [1900-1975]. Dans Horrors of the black Museum [1959] « Entre autres crimes, celui-ci : une jeune femme reçoit une paire de jumelles. Pour les essayer, elle règle leur mécanisme ; deux pointes d’acier lui crèvent les yeux. » Suivi de son commentaire : « De la guillotine sur montant de lit à la cuve d’acide, Crabtree nous prouve que l’assassinat doit en effet être considéré comme l’un des beaux-arts. » (Cf. Culture. Cinéma, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
- Wes Craven [1939-2015]. « Il se dégage de ses films un charme pervers : jeunes filles kidnappées et soumises à des sévices sexuels avant d’être tuées (Last House on the left). » (Cf. Culture. Cinéma, Femmes. Jeunes filles, Violences. Violences à l’encontre des femmes) 1446
-------------
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (56) : 2009. Manil Suri, dans Mother India, auteur de :
« Je me rappelais les histoires de dévotion conjugale des épouses que Biji [sa mère] nous racontait, Savitri affrontant Yama, Satri s’immolant suite à l’injure faite à Shiva son époux. Combien de femmes s’étaient effectivement sacrifiées comme elle sur le bûcher de leur époux à travers les âges ? Combien y avaient été jetées hurlant de terreur, combien avaient été poussées de leur propre gré par l’amour ? » 1447 (Cf. Hommes. Époux)
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (57) : 2019. Concernant une critique du livre de Jean Fayard [1902-1978], Mal d’amour [Fayard. Prix Goncourt. 1931], je lis :
« L’auteur, ne sachant plus que faire de son héroïne, la fait mourir. [De façon à laisser la place aux acteurs pour lesquels il porte un véritable intérêt : les trois hommes abandonnés.] » (Cf. Langage. Féminisation du langage. Possessif)
À combien de milliers, de millions de livres ce constat ne pourrait-il s’appliquer ? 1448
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (58) : (13 janvier) 2021. Lu sur Franceinfo : « Lisa Montgomery, 52 ans, détenue dans un pénitencier fédéral à Terre-Haute, dans l'Indiana, a reçu cette nuit une injection létale. Dans l'incapacité d'avoir un enfant, elle avait tué en 2004 une femme enceinte de huit mois afin de lui voler son fœtus. Elle est la première femme exécutée depuis 68 ans. »
Pour resituer, en vérité, le règne de Donald Trump : treize hommes, avant elle, avaient été assassinés en 6 mois. (Cf. Femmes. Enceintes, Justice. Peine de mort)
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (59) : (10 juillet) 2021. Alice Ferney, auteure de :
« Cent femmes par an meurent en France [du fait d’une naissance] ; dans le monde, des millions. » 1449 (Cf. Femmes. Mères)
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (60) : (24 octobre) 2021. Maxime Le Forestier, auteur de :
« La mort, chez Brassens [Georges. 1921-1981] est presque toujours féminine. » 1450 (Cf. Femmes. « Féminin »)
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (61) : (mai) 2022. Je lis, dans la critique du Monde Diplomatique (p.2) du livre de Auõur Ava Ólaffsdóttir, La Vérité sur la lumière, le chiffre de 830 femmes mourant « par jour sur cette planète » à la suite d’un accouchement.
N.B. Comment ce chiffre a-t-il bien pu être calculé ? Il ne peut être que faux. (Cf. Économie. Statistiques)
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (62) : (21 juin) 2023. Je lis, dans Le Canard enchaîné (p.1), concernant le naufrage, dans la péninsule du Péloponnèse, du chalutier la nuit du 13 au 14 juin 2023 qui transportait 750 migrant-es, qu’ « aucune femme, aucun enfant ne figure parmi la centaine de rescapés. Que des hommes ».
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (63) : (3 septembre) 2023. J’entends sur France Culture que Violeta Parra [1917-5 février 1965], à 49 ans, s’est suicidée « suite à une déception amoureuse ». Non, ce pseudo ‘constat’ ne suffit plus, n’est plus acceptable… (Cf. Culture. Parra Violetta, Patriarcat)
Femmes (Comment meurent les femmes ?) (64) : (17 novembre) 2024. Je lis sur le site de l’Institut du Monde Arabe. Divas arabes :
« […] Asmahan [chanteuse syrienne. 1912-1944] meurt prématurément le 14 juillet 1944, à 27 ans, lorsque sa voiture fait une sortie de route et sombre dans les eaux du Nil. Son chauffeur parvient à s’extraire du véhicule avant qu’il ne coule et disparaît dans la nature. La mort de la diva demeure une grande énigme. Certains y voient un assassinat, d’autant qu’elle avait échappé à des tirs quelques jours auparavant, sur le tournage du film. Beaucoup attribuent sa mort aux services secrets britanniques, embarrassés par une espionne qui aurait pu se révéler bavarde. Pour d’autres, c’est son clan, scandalisé par sa vie dissolue, qui serait à l’origine de sa mort. L’opinion publique fait aussi porter les soupçons sur la reine Nazli, jalouse de la liaison qu’aurait entretenu Asmahan avec le chambellan Mohamed Hassanein Pacha. On met même Oum Kalthoum en cause - elle se serait sentie menacée par le talent de la jeune chanteuse. Fait troublant : une voyante aurait prédit à Asmahan, alors âgée de 16 ans, ‘qu’elle était née dans l’eau (sa mère lui avait donné naissance sur un paquebot) et mourrait dans l’eau‘, ce qui avait conduit la jeune femme à se tenir éloignée de tout élément aquatique. »
Pas vraiment rigoureux… (Cf. « Opinion publique »)
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. La Commune :
Femmes (Commune La) (1) : 1886. Jules Vallès [1832-1885], dans L’Insurgé, auteur de :
« […] Une créature de trente ans, point laide, l’air souffrant.
Elle n’a pas d’idées sur la Sociale, celle-là non plus ; mais sa sœur a été la maîtresse d’un vicaire prêtre, puis enceinte, a quitté les siens en volant leurs épargnes.
- Voilà pourquoi je suis descendue en voyant de ma croisée passer des soutanes ; pourquoi j’ai tiré la barbe à un capucin qui ressemblait à l’amant de Céline ; pourquoi, j’ai crié : ‘- À mort ! À mort !’, pourquoi mes poignets sont rouges !
Elle nous a dit aussi l’histoire de la vivandière qui a donné le signal de la tuerie.
Cette vivandière est la fille d’un homme qui a été arrêté à la fin de l’Empire sur une dénonciation d’agent provocateur et qui est mort en prison. Quand elle a entendu dire qu’il y avait des mouchards dans le tas, et qu’on allait les saigner, elle a suivi, puis commandé l’escorte. C’est elle qui a envoyé la première balle à Largilière. [Joseph, « agent de la police impériale ». 1811- fusillé le 26 mai 1871]
Femmes (Commune La) (2) : 2018. Lire Claudine Rey, Annie Gayat, Sylvie Pepino, Petit Dictionnaire des femmes de la Commune. Les oubliées de l’histoire. [Les amies et Amie de la commune de Paris. 1871. 302p.] (Cf. Histoire. Oubli. Patriarcale)
-------------
Femmes. « Communes à tous » :
Femmes (« Communes à tous ») (1) : À la genèse - plus ou moins refoulée - de toutes les pensées communistes (lesquelles n’en avaient pas pour autant l’exclusivité). Et de celles de tant d’hommes encore… (Cf. Femmes. Échange des femmes)
Par ordre chronologique. Femmes. « Communes à tous » :
Femmes (« Communes à tous ») (1) : 1976. Lu dans Les vagabonds efficaces de Fernand Deligny [1913-1996] concernant une jeune fille devenue mère après avoir ‘fait l’amour’ avec un homme de son village : « ‘Avec celle-là, il y a moyen’ : la brèche est faite, tous s’y pressent. » 1451 (Cf. Êtres humains, Corps, Femmes. Échange des femmes. Jeunes filles. Frontières, Relations entre êtres humains. Amour. « Faire l’amour », Politique. Frontières, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
-------------
Femmes (Communisme. Soviétique) : (janvier) 1935. Je lis dans La psychologie de masse du fascisme de Wilhelm Reich [1897-1957], un extrait du programme des Soviets de l’URSS :
« La tâche du Parti consiste essentiellement dans un travail intellectuel et pédagogique destiné à effacer à tout jamais l’inégalité et les préjugés du passé, notamment au niveau des couches les plus arriérés du prolétariat et de la paysannerie. Le parti qui ne se contente pas d’accorder une égalité de pure forme à la femme, s’efforce de la libérer du fardeau d’un travail ménager à l’ancienne, en créant des communautés domestiques, des restaurants publics, des laveries centralisées, des crèches, etc. » 1452 (Cf. Femmes. Travail-dit-domestique, Patriarcat, Penser. Préjugés, Politique. Égalité)
Par ordre chronologique. Femmes. Communistes :
Femmes (Communistes) (1) : 1917. 1922. En Russie en 1917, 2 % de femmes membres du parti bolchevik.
En France, en 1922, on comptait au parti communiste français : 20 femmes sur 1.100 cartes dans la Fédération du Gard, 5 sur 500 dans celle des Pyrénées Orientales, 30 sur 2500 dans le Rhône, 92 sur 1200 dans la ‘Seine-Inférieure’ et une sur 1600 dans la Corrèze, plusieurs autres fédérations n’ayant qu’un recrutement exclusivement composé d’hommes. 1453
Et l’on continue à écrire l’histoire (notamment) communiste, comme si cette réalité n’était pas politiquement fondamentale.
Femmes (Communistes) (2) : 1984. Philippe Robrieux [1936-2010], historien du parti communiste, auteur de :
« Le parti communiste français ne serait jamais devenu ce qu’il est devenu, sans les femmes et sans les institutrices. C’est d’ailleurs une surprise pour moi qu’en ces temps marqués par le féminisme, on ne rende pas hommage à ces femmes. […] Sans elles, rien n’eut été possible. » 1454
-------------
Par ordre alphabétique. Femmes. Comparaison entre femmes :
Femmes (Comparaison entre femmes. Balzac. Honoré de) (1) : 1837-1845. Honoré de Balzac [1799-1850], dans Le curé de village, auteur de :
« En se voyant compris, il essaya de frapper un dernier coup sur l’intelligence de cette femme ; il avait deviné que, chez elle, l’intelligence menait au cœur ; tandis que, chez les autres femmes, le cœur est au contraire le chemin de l’intelligence. » 1455 (Cf. Femmes. Intelligentes)
Femmes (Comparaison entre femmes. Brontë Charlotte) (2) : 1847. Charlotte Brontë [1816-1855], dans Jane Eyre, auteure de :
« Il éclata de rire et se frotta les mains.
- ‘Oh, n’est-ce pas merveilleux de la voir et de l’entendre ? N’est-elle pas originale ? N’est-elle pas piquante ? Je n’échangerai pas cette unique petite demoiselle anglaise contre tout le sérail du Grand Turc au complet, avec les yeux de gazelle, les formes de houris et tout ce qui s’en suit.’
Cette allusion orientale me cingla de nouveau.
‘Pas une seconde, dis-je, je ne vous tiendrai lieu de sérail ; ne me considérez donc point sous ce jour. Si vous avez du goût pour ce genre de plaisirs, allez-vous-en sans délai, monsieur, vers les bazars de Stamboul [Istanbul] et investissez en en vastes achats d’esclaves une partie de ces disponibilités que vous semblez ne pas savoir comment dépenser ici de façon satisfaisante.
- Et que ferez-vous, Janette, pendant que je marchanderai ces quelques tonnes de chair et ces assortiments d’yeux noirs ?
- Je me préparerai à partir comme missionnaire pour aller prêcher la liberté à celles qui sont asservies, aux habitantes de votre harem entre autres. Je m’en ferai ouvrir l’entrée et j’y susciterai la rébellion ; et vous avez beau être pacha à trois queues, Monsieur, vous vous trouverez en quelques secondes enchaîné entre nos mains, et, pour ma part, je ne consentirai point à rompre vos liens avant que vous ayez signé une chartre, la plus libérale qu’ait jamais conférée un despote. […] » (Cf. Êtres humains. Chair, Femmes. « Asservies ». Solidarité entre femmes, Patriarcat. Domination masculine)
Femmes (Comparaison entre femmes. Constant Benjamin) (3) : (18 avril) 1794. Benjamin Constant [1767-1830] écrit à Isabelle de Charrière [1740-1805] :
« […] Melle Heyne [1778-1861], prévenue sur ma visite avait eu soin de se mettre en uniforme [?]. Mais, à tout prendre (sic), elle est plus aimable et beaucoup moins ridicule que les 19/20es de ses semblables. » 1456
Femmes (Comparaison entre femmes. Dassin Jo) (4) : 1975. Refrain de la chanson de Jo Dassin [1938-1980] intitulée La fleur aux dents :
« Il y a les filles dont on rêve / Et celles avec qui l’on dort / Il y a les filles qu’on regrette / Et celles qui laissent des remords / Il y a les filles que l’on aime / Et celles qu’on aurait pu aimer / Puis un jour il y a la femme / Qu’on attendait. » (Cf. Culture. Patriarcale, Relations entre êtres humains. Remords)
Femmes (Comparaison entre femmes. David-Neel Alexandra) (5) : (26 juin) 1920. Alexandra David-Neel [1868-1969], qui revient d’une excursion de cinq jours au Tibet, écrit à son mari :
« Le but de ces excursions est de voir le pays, c’est évident, mais elles en ont une autre qui est d’éprouver mes forces. Eh bien ! je dois franchement confesser que le résultat de l’épreuve est loin de me satisfaire.
Il ne me suffit pas de me dire que peu de femmes de mon âge et peu de femmes de n’importe quel âge, seraient capables de faire ce que je fais.
Il n’est point question de concourir avec d’autres, mais d’être en état d’accomplir une chose donnée qui nécessite un effort donné, et comme, sous aucun prétexte, même si j’étais certaine d’avance que j’y resterais, je ne renoncerai à mon projet de voyage en Asie Centrale, je me chagrine un peu de me sentir un peu en dessous de ce qui est requis. [...] » 1457
La suite prouvera qu’elle fut, lors de ses futurs voyages, bien « en dessus » de ce qui fut requis.
Femmes (Comparaison entre femmes. Grossman Vassili) (6) : 1960. Vassili Grossman [1905-1964], dans Vie et destin, auteur de :
« Il eut même le temps de comparer les mérites respectifs de l’une et l’autre et de faire ce choix sans conséquence pratique que font presque toujours les hommes en regardant les femmes. » 1458 (Cf. Hommes, Patriarcat)
Femmes (Comparaison entre femmes. Marivaux) (7) : 1734. Marivaux [1688-1763], dans Le paysan parvenu, auteur de :
« Je continuai de cajoler Geneviève. Mais, depuis l’instant que je m‘étais aperçu que je n’avais pas déplu à Madame elle-même, mon inclination pour cette fille baissa de vivacité : son coeur ne me parût plus une conquête si importante, et je n’estimais plus tant l’honneur d’être souffert par elle. » 1459
Femmes (Comparaison entre femmes. Proust Marcel (8) : 1921. Marcel Proust [1871-1922], dans Sodome et Gomorrhe, auteur de :
« N’y avait-il pas un abîme ente Albertine, jeune fille d’assez bonne famille bourgeoise, et Odette, cocote vendue par sa mère, dès son enfance ? La parole de l’une ne pouvait être mise en comparaison avec celle de l’autre. » 1460 (Cf. Femmes. Achat. « Cocottes », Langage. Parole. Proust Marcel)
Femmes (Comparaison entre femmes. Revue Parents) (9) : (10 septembre) 2018. Lu dans la revue Parents :
« Adriana Karembeu affiche une silhouette de rêve après son accouchement (photo). Moins d'un mois après la naissance de sa fille, Adriana Karembeu (ex-mannequin) a déjà retrouvé la ligne, et fait des jalouses ! » 1461 (Cf. Femmes. Accouchements. Jalouses)
Femmes (Comparaison entre femmes. Rousseau Jean-Jacques) (10) : 1782. Jean-Jacques Rousseau [1712-1778], dans Les confessions, auteur de :
« Il [Denis Diderot. 1713-1784] avait une Nanette ainsi que j’avais une Thérèse ; c’était entre nous une conformité de plus. Mais la différence était que ma Thérèse aussi bien de sa figure que sa Nanette, avait une humeur douce et un caractère aimable, fait pour attacher un honnête homme, au lieu que la sienne, pigrièche et harangère ne montrait rien aux yeux des autres qui put racheter la mauvaise éduction. Il l’épousa toutefois ; ce fit fort bien fait s’il l’avait promis. Pour moi, qui n’avait rien promis de semblable, je ne pressais pas de l’imiter. » 1462
N.B. Je lis en note : « Malgré l’opposition de son père, Diderot avait épousé secrètement, le 6 novembre 1743, ‘à minuit, en l’église Saint-pierre-aux-boeufs’, Anne-Toinette Champion [1710-1795]. Un premier enfant nait l’années suivante, mais il mourut au bout de quelques semaines. » (Cf. pour la suite, Wikipédia) (Cf. Langage. Féminisation du langage)
Femmes (Comparaison entre femmes. Tolstoï Léon) (11) : (10 novembre) 1856. Léon Tolstoï [1828-1910] écrit dans son Journal :
« O[lga] Tourg [unéniev], au vrai, sans compter sa beauté, ne vaut pas V[alérie]. » 1463
Femmes (Comparaison entre femmes. Zola Émile) (12) : Émile Zola [1840-1902], dans Le ventre de Paris, auteur de :
« Elle lui faisait l’effet d’une plante saine et robuste, grandie ainsi que les légumes dans le terreau du potager ; tandis qu’il se souvenait des Lisa, des Normandes, des belles files de Halles, comme de chairs suspectes, parées à l’étalage. » 1464 (Cf. Corps. Chair, Femmes. Ornements [décoratifs]. Plantes)
Par ordre chronologique. Femmes. Comparaison entre femmes. Voltaire :
Femmes (Comparaison entre femmes. Voltaire) (1) : (26 septembre) 1724. Voltaire [1694-1778] écrit à Nicolas-Claude Thieriot [1697-1772] :
« Dites à Madame de Bernières [?-?] les choses les plus tendres de ma part. […] Je fais plus de cas de son amitié que de celle de nos bégueules titrées de la cour auxquelles je renonce de bon cœur pour jamais par la faiblesse de mon estomac et par la force de ma raison. » 1465 (Cf. Langage. Femmes. « Bégueules »)
Femmes (Comparaison entre femmes. Voltaire) (2) : (vers février) 1729. Voltaire [1694-1778] écrit à Nicolas-Claude Thieriot [1697-1772], concernant les Mémoires de la Grande Mademoiselle, duchesse de Montpensier [1627-1693], imprimés en partie en 1718, puis interdits. :
« Par dieu, les princesses de sang écrivent comme des femmes de chambre. Je n’en suis pas étonné ; je n’ai jamais fait une grande différence entre les unes et les autres. » 1466
Femmes (Comparaison entre femmes. Voltaire) (3) : (18 avril) 1729. Voltaire [1694-1778] écrit à Charlotte Clayton [?-1742] :
« Je souhaite pour l’honneur de Versailles et pour le progrès de la vertu et des lettres que nous puissions avoir ici quelques dames comme vous. Vous voyez que mes souhaits sont sans bornes. » 1467
Femmes (Comparaison entre femmes. Voltaire) (4) : (12 décembre) 1730. Voltaire [1694-1778] écrit à mademoiselle Dangeville [comédienne. 1714-1796] :
« Paraissez-y (dans son rôle) désespérée, et vous allez désespérer vos rivales. » 1468
Femmes (Comparaison entre femmes. Voltaire) (5) : (3 novembre) 1735. Voltaire [1694-1778] écrit à Nicolas-Claude Thieriot [1697-1772], concernant Émilie du Châtelet [1706-1749] :
« Ce qu’elle a fait pour moi dans l’indigne persécution que j’ai essuyée, et la manière dont elle m’a servi m’attacherait à son char pour jamais, si les lumières singulières de son esprit, et cette supériorité qu’elle a sur toutes les femmes ne m’avait déjà enchaîné. » 1469
Femmes (Comparaison entre femmes. Voltaire) (6) : (8 décembre) 1736. Voltaire [1694-1778] écrit à Pierre-Robert Le Cornier de Cideville [1693-1776] :
« Quand vous serez las de votre maîtresse, il faut venir voir l’héroïne [Émilie du Châtelet. 1706-1749] et le palais de Cirey (son lieu de résidence avec elle, de 1734 à 1747) [...]. » 1470 (Cf. Langage. Conjonction)
Femmes (Comparaison entre femmes. Voltaire) (7) : (27 octobre) 1754. Voltaire [1694-1778] écrit à Louise-Dorothée von Meinigen, duchesse de Saxe Gotha [1710-1767] :
« Votre Altesse Sérénissime daigne faire des compliments à ma nièce [Marie-Louise Mignot. 1712-1746] : elle ressent cette extrême bonté avec la plus respectueuse reconnaissance. Mais malgré tout l’héroïsme de son amitié pour moi, je lui sais mauvais gré d’être venue me consoler à Colmar. Elle y fait le bonheur de ma vie mais elle m’empêche d’être à votre cour. Elle me fait à la fois beaucoup de bien et beaucoup de mal. » 1471
Femmes (Comparaison entre femmes. Voltaire) (8) : (17 novembre) 1760. Voltaire [1694-1778] écrit à D’Alembert [1717-1783] :
« Mille respects à Madame du Deffand [1697-1780]. Comptez qu’il y a peu de femmes qui aient autant d’esprit qu’elle. » 1472
Femmes (Comparaison entre femmes. Voltaire) (9) : (16 décembre) 1760. Voltaire [1694-1778] écrit au comte [1700-1788] et à la comtesse d’Argental [1703-1774] :
« J’avoue que Madame d’Argental m’étonne toujours. Je ne crois pas qu’il y ait encore une dame dans Paris capable de faire ce qu’elle a fait […]. » 1473
Femmes (Comparaison entre femmes. Voltaire) (10) : (2 janvier) 1761. Voltaire [1694-1778] écrit à M. Ponce-Denis Écouchard Le Brun [?-?] :
« Nous prenons soin de toutes les parties de son éducation (concernant la petite nièce de Corneille, âgée de 17 ans) […] Elle apprend l’orthographe ; nous la faisons écrire ; vous voyez qu’elle forme bien ses lettres, et que ses lignes ne sont point en diagonale comme celles de quelques-unes de nos Parisiennes. » 1474 (Cf. Langage. Orthographe)
Femmes (Comparaison entre femmes. Voltaire) (11) : (15 janvier) 1761. Voltaire [1694-1778] écrit à madame du Deffand [1697-1780] :
« Je commence d’abord par vous excepter, Madame ; mais si je m’adressais à toutes les autres dames de Paris, je leur dirais, c’est bien à vous, dans votre heureuse oisiveté, à prétendre que vous n’avez pas un moment de libre ! »
La suite pour mieux vanter ses propres occupations… 1475 (Cf. Femmes. Infantilisation)
Femmes (Comparaison entre femmes. Voltaire) (12) : (16 août) 1761. Voltaire [1694-1778] écrit à Étienne de Lafargue [1728-1795], après avoir évoqué les « beaux vers » qui lui avait été envoyés par lui :
« Les belles (femmes) reçoivent froidement les cajoleries ; mais les laides y sont fort sensibles. » 1476
Femmes (Comparaison entre femmes. Voltaire) (13) : (3 juillet) 1764. Voltaire [1694-1778] écrit à Anne-Marie Cholier, baronne de Verna [?-?] :
« Bien peu de dames cherchent à s’instruire ; c’est un grand avantage que vous avez sur elles. » 1477
Femmes (Comparaison entre femmes. Voltaire) (14) : (11 août) 1764. Voltaire [1694-1778] écrit à Anne-Marie Cholier, baronne de Verna [?-?] :
« Comptez Madame, que les vraies consolations sont dans la philosophie. Une malade pleine d’esprit et de raison est infiniment supérieure à une sotte qui crève de santé. » 1478 (Cf. « Sciences » sociales. Philosophie)
Femmes (Comparaison entre femmes. Voltaire) (15) : (19 septembre) 1764. Voltaire [1694-1778] écrit à Marie-Anne Piquet du Bocage [1710-1802] :
« Je ne connaissais point vos agréables lettres sur l’Italie ; elles sont supérieures à celle de Madame de Montaigu. [1689-1762] […] »
Il la qualifie par ailleurs comme étant « la première personne de son sexe et de son siècle. » 1479 Il est vrai que Voltaire n’était pas avare de compliments…
Femmes (Comparaison entre femmes. Voltaire) (16) : (14 août) 1765. Voltaire [1694-1778] écrit à Friedrich-Melchior Grimm [1723-1807], évoquant Catherine II [1729-1749] :
« Cette souveraine qui m’a daigné écrire une lettre aussi philosophique que charmante vient de se signaler par deux actions dont aucune de nos dévotes n’est capable. » 1480 (Cf. « Sciences » sociales. Philosophie)
Femmes (Comparaison entre femmes. Voltaire) (17) : (6 mai) 1767. Voltaire [1694-1778] écrit à madame du Deffand [1697-1780] concernant Catherine II [1729-1796] qu’il nomme « ma Catherine » :
« Je m’imagine que les femmes ne sont pas fâchées qu’on loue leur espèce et qu’on les croit capables de grandes choses. […]
Il y a loin de l’impératrice de Russie à nos dames du Marais qui font des visites de quartier. J’aime tout ce qui est grand et je suis fâché que nos Velches (terme dénégateur pour Français) soient si petits. » 1481 (Cf. Femmes. « Espèce ». Infantilisation, Patriarcat. « Espèce »)
Femmes (Comparaison entre femmes. Voltaire) (18) : (8 août) 1770. Voltaire [1694-1778] écrit à madame du Deffand [1697-1780] :
« S’il y a une Providence, n’est-elle pas pour vous comme pour les plus sottes bégueules de Paris ? » 1482
Femmes (Comparaison entre femmes. Voltaire) (19) : (5 octobre) 1770. Voltaire [1694-1778] écrit à la duchesse de Choiseul [1734-1801] :
« On m’a mandé, Madame, que vous étiez jalouse d’une femme qui a je crois cinq pieds deux pouces de haut [Catherine II. 1712-1796], mais je ne vous abandonnerai pas pour elle quand même elle serait souveraine d’Athènes (dans le cadre de la guerre contre la Turquie) comme cela pourrait bien arriver […]
En attendant, Madame, vous serez toujours pour moi la première des Françaises. » 1483 (Cf. Politique. Hiérarchie. Nationalisme)
Femmes (Comparaison entre femmes. Voltaire) (20) : (21 juin) 1771. Voltaire [1694-1778] écrit à Jean-François Marmontel [1723-1799] :
« J’ai eu deux jours cette très étonnante princesse [princesse d’Aschkoff. 1743-1810] à Ferney. Cela ne ressemble point à vos dames de Paris. J’ai cru voir Tomyris qui parle français. » 1484 (Cf. Femmes. Remarquables. D’Aschkoff princesse. Tomyris)
Femmes (Comparaison entre femmes. Voltaire) (21) : (6 juillet) 1771. Voltaire [1694-1778] écrit à Catherine II [1712-1796] :
« En vérité, Madame, vous voilà la première personne de l’univers, sans contredit. […] » 1485
Femmes (Comparaison entre femmes. Voltaire) (22) : (11 novembre) 1771. Voltaire [1694-1778] écrit à Louise-Sophie d’Hornoy [1750-1807] :
« Pour vous, Madame, qui voulez nourrir votre enfant, je vous loue de ce beau dessein qui n’est pas commun chez les dames de Paris. » 1486
Femmes (Comparaison entre femmes. Voltaire) (23) : (1er février) 1772. Voltaire [1694-1778] écrit à la marquise d’Argens [?-?], dont le mari vient de mourir, :
« C’est un prodige bien singulier qu’une dame, aussi aimable que vous l’êtes, ait fait un étude particulière des deux langues savantes [le latin et le grec] qui dureront plus que toutes les autres langues de l’Europe. Vous avez la science de Mme Dacier [1645-1720] et elle n’avait point vos grâces. » 1487 (Cf. Femmes. Remarquables. Lefèvre Dacier Anne)
Femmes (Comparaison entre femmes. Voltaire) (24) : (4 mars) 1774. Voltaire [1694-1778] écrit au duc de Richelieu [1696-1788], évoquant Catherine II [1729-1796] - qu’il nomme « ma Sémiramis du Nord » :
« C’est une dame unique ; elle se joue d’un empire de deux mille lieues, et fait mouvoir cette énorme machine aussi aisément qu’une autre femme fait tourner son rouet. » 1488 (Cf. Langage. Possessif)
* Ajout. 1er septembre 2025. 1899. Pierre Kropotkine [1842-1921], enfermé dans la terrible forteresse Pierre et Paul de Saint-Pétersbourg « dans laquelle avait péri pendant les deux derniers siècles tout ce qui faisait la vraie force de la Russie » écrit que c’est là que « Catherine II fit enterrer vivants ceux qui lui reprochaient d’avoir assassiné son mari. » 1489 (Cf. Politique. État. Prison)
Femmes (Comparaison entre femmes. Voltaire) (25) : (26 mars) 1774. Voltaire [1694-1778] écrit à madame du Deffand [1697-1780] :
« On parle français à la cour de l’Impératrice [Catherine II] plus purement qu’à Versailles, parce que nos belles dames ne se piquent pas de savoir la grammaire. » 1490 (Cf. Langage. Grammaire)
Femmes (Comparaison entre femmes. Voltaire) (26) : (6 juin) 1774. Voltaire [1694-1778] écrit à madame du Deffand [1697-1780] :
« Soyez bien sûre que les sept ou huit jours que j’ai encore à vivre seront employés à vous aimer, à vous regretter, et à souhaiter qu’il y ait au moins dans Paris cinq ou six dames qui vous ressemblent. » 1491
Femmes (Comparaison entre femmes. Voltaire) (27) : (9 août) 1774. Voltaire [1694-1778] écrit à Catherine II [1729-1749], après s’être plaint d’ « être en disgrâce » :
« Vous n’avez eu aucun égard pour ma vieillesse. Passe encore si Votre Majesté était une coquette française, mais comment une impératrice victorieuse et législatrice peut-elle être si volage ? »
- Ce à quoi Catherine II, se justifiant, lui répondit :
« […] quoi qu’on vous dise, sur mon honneur, je ne suis ni volage, ni inconstante. » 1492 (Cf. Femmes. « Coquettes », Hommes. Grossiers. Voltaire)
Femmes (Comparaison entre femmes. Voltaire) (28) : (11 décembre) 1774. Voltaire [1694-1778], dans une lettre au duc de Richelieu [1696-1788], évoquant une femme accusée d’avoir contrefait l’écriture d’un autre, évoque « la sienne même [qui] était aussi mauvaise que celle de la plupart des femmes. » 1493 (Cf. Patriarcat. Voltaire)
-------------
Femmes. Compétences politiques :
Femmes (Compétences politiques) (1) : Et si les compétences politiques majeures et indépassables des femmes étaient leur connaissance des hommes ?
On comprendrait mieux alors la nécessité de les bâillonner.
Et leur exclusion du Politique… (Cf. Patriarcat, Penser. Compétences, Politique)
Femmes (Compétences politiques) (2) : L’une des compétences des femmes les plus solidairement assises, les plus unanimement partagées, mais pourtant la moins reconnue : calmer les hommes, les détourner de leurs colères, de leurs violences de toutes sortes, le plus souvent à leur encontre. (Cf. Femmes. Colère. « Politiques », Penser. Compétences, Politique)
-------------
Femmes (« Comptes ») : Alors que l’on demande si souvent des comptes aux femmes - concernant notamment la manière dont elles utilisent l’argent qu’elles doivent si souvent gérer seules, c’est si souvent - et le plus souvent - à elles d’en exiger. Mais il n’est jamais trop tard. (Cf. Patriarcat)
Par ordre chronologique. Concurrence entre femmes :
Par ordre chronologique. Concurrence entre femmes (1) : La concurrence entre femmes se dissocie mal de la comparaison entre femmes.
Par ordre chronologique. Femmes. Concurrence entre femmes :
Par ordre chronologique. Concurrence entre femmes. Honoré de Balzac :
Femmes (Concurrence entre femmes) (1) : (22 février) 1834. Honoré de Balzac [1799-1850] écrit à Ewelina Hanska [1801-1882] :
« Ne te laisse jamais mordre par une femme sans la mordre plus avant. Elles te craindront et t’estimeront. » 1494 (Cf. Violences)
Femmes (Concurrence entre femmes) (2) : 1837-1843. Honoré de Balzac [1799-1850], dans les Illusions perdues, écrit cet échange riche de réflexions sur les arcanes du fonctionnement du patriarcat :
« […] Si Lucien [de Rubempré] est gentil, dit Coralie [sa maîtresse] ; il n’ira pas chez votre comtesse. Quel besoin a-t-il de traîner sa cravate dans le monde, il s’y ennuierait.
- Voulez-vous le tenir en charte privée ? dit Blondet. Êtes-vous jalouse des femmes comme il faut ?
- Oui, s’écria Coralie, elles sont pires que nous.
- Comment le sais-tu ma petite chatte ? dit Blondet.
- Par leurs maris, répondit-elle. Vous oubliez que j’ai eu de Marsay, pendant six mois. » 1495 (Cf. Femmes, Animalisation des femmes. Conscience de classe. Jalousie, Hommes. Adultère, Langage. Verbe. Avoir, Patriarcat)
Femmes (Concurrence entre femmes) (3) : 1846. Honoré de Balzac [1799-1850], dans La cousine Bette, auteur de :
« […] Mais apprenez, sainte et digne femme, que les maris, une fois gris, racontent bien des choses de leurs épouses chez leurs maîtresses, qui en rient comme des crevées. » 1496
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Concurrence entre femmes. Gustave Flaubert :
Femmes (Concurrence entre femmes) (4) : (12 septembre) 1846. Gustave Flaubert [1821-1880] écrit à Louise Colet [1810-1876] :
« Tu es trop bonne, trop douce, trop dévouée pour être comme les autres femmes qui sont si égoïstes ! si âpres de l’homme qu’elles aiment. » 1497 (Cf. Femmes. Dévouement)
Femmes (Concurrence entre femmes) (5) : (7 août) 1876. Gustave Flaubert [1821-1880] écrit à sa nièce Caroline [1846-1931] :
« Mme Fortin a renvoyé une de ses bonnes, à l’instigation de Mme Poutrelle, parce que ladite bonne était ’trop jeune‘ pour son mari, lequel s’est épanché dans mon sein à propos de la jalousie imbécile de sa petite épouse. » 1498 (Cf. Femmes. Bonnes-à-tout-faire. Jalouses. Travail des femmes, Famille. Couple)
-------------
Femmes (Concurrence entre femmes) (6) : 1865-1869. Léon Tolstoï [1828-1910], dans La guerre et la paix, auteur de :
« Depuis son arrivée à Moscou, Anatole tournait la tête à toutes les dames, principalement parce qu’ils les négligeaient pour les bohémiennes et les actrices françaises, dont la principale, Mlle George [1787-1867] passait pour sa maîtresse. » 1499
Par ordre chronologique. Femmes. Concurrence entre femmes. Émile Zola :
Femmes (Concurrence entre femmes) (7) : 1871. Émile Zola [1840-1902], dans La curée, auteur de :
« Alors toutes les femmes de répandirent en éloges ; les bijoux étaient ravissants, divins ; puis elles en virent à parler, avec une admiration pleine d’envie, de la vente de Laure d’Aurigny, dans laquelle Saccard les avait achetés pour sa femme ; elles se plaignirent de ce que ces filles enlevaient les plus belles choses, bientôt il n’y aurait plus de diamants pour les honnêtes femmes. Et, dans leurs plaintes, perçait le désir de sentir sur leur peau nue un de ces bijoux que tout Paris avait vues aux épaules dune impure illustre et qui leur conteraient peut-être à l’oreille le scandale des alcôves où s’arrêtaient si complaisamment leurs rêves de grandes dames. » 1500 (Cf. Femmes. Honnêtes)
Femmes (Concurrence entre femmes) (8) : 1871. Émile Zola [1840-1902], dans La curée, auteur de :
« Maxime avait aussi les photographies de ces dames [...]
Alors, c’était de longues discussions sur les cheveux de l’Écrevisse, le double menton de Mme de Meinhold, les yeux de Mme de Lawrens, la gorge de Blanche Muller, le nez de la petite Sylvia, célèbre par ses lèvres trop fortes. Ils comparaient les femmes entre elles. […] » 1501 (Cf. Corps. Femmes, Femmes)
Femmes (Concurrence entre femmes) (9) : 1880. Émile Zola [1840-1902], dans Nana, auteur de :
« […] - ‘Si toutes les femmes honnêtes s’en mêlent et nous prennent nos amants !... Vrai, elles vont bien, les femmes honnêtes !’ » 1502
Femmes (Concurrence entre femmes) (10) : 1883. Émile Zola [1840-1902], dans Au bonheur des dames, auteur de :
« Moi, je ne peux pas souffrir de trouver ma robe sur les épaules de toutes les femmes. » 1503
Femmes (Concurrence entre femmes) (11) : 1883. Émile Zola [1840-1902], dans Au bonheur des dames, auteur de :
« […] Et ces dames [les clientes de grand magasin] exhalèrent leur rancune. On se dévorait devant les comptoirs, la femme y mangeait la femme, dans une rivalité aigüe d’argent et de beauté. C’était une jalousie maussade des vendeuses contre les clientes bien mises, les dames dont elles s’efforçaient de copier les allures, et une jalousie encore plus aigre des clientes mises pauvrement, de petites bourgeoises contre les vendeuses, ces filles vêtues de soie, dont elles voulaient obtenir une humilité de servante, pour un achat de dix sous.
Laissez donc ! conclut Henriette, toutes des malheureuses à vendre, comme leur marchandise. » […] 1504
Toutes deux, face à face, frémissantes, se contemplaient. Il n’y avait désormais ni dame, ni demoiselle de magasin. Elles n’étaient plus que femmes, come égalées dans leur rivalité. » (Cf. Femmes. Achat. Bourgeoises. Servantes)
-------------
Femmes (Concurrence entre femmes) (12) : 1967. Écouter Madame de Barbara [1930-1997].
Femmes (Concurrence entre femmes) (13) : (8 mars) 2015. Lu, dans Le Figaro :
« La directrice générale du F.M.I, Christine Lagarde, et la présidente du front national, Marine Le Pen arrivent en tête du palmarès des femmes politiques avec respectivement 30% et 26% de voix, selon un sondage IFOP pour le Journal du Dimanche. » 1505
La suite de la dépêche ressemble par ailleurs étrangement aux commentaires de l’arrivée du tiercé. (Cf. Femmes. Comparaison entre femmes. « Politiques », Politique. Front national. Parti. Sondages, Violences)
-------------
Femmes (Confucius) : [551 avant J.C-479 avant J.C] Attribué à Confucius :
« […] Le roi Wu a dit qu’il avait lui-même dix ministres. Confucius dit :
« […] Et le roi Wu n’avait que neuf ministres en fait, car l’un des dix était une femme. […] » 1506 (Cf. Dialogues)
Femmes (« Connasses ») : 2013. Anne-Sophie Girard et Marie-Aldine Girard, auteures d’un livre publié dans la collection de poche J’ai lu, intitulé : La femme parfaite est une connasse ! Sous-titre : Guide de survie pour les femmes ‘normales’.
Imagine-t-on un livre intitulé : « Le juif, l’arabe, parfait est un connard ! ». Sous-titre : « Guide de survie pour les juifs, les arabes ‘normaux’ » ?
Femmes. Conscience de classe :
Femmes. Conscience de classe. Aristocratie :
Femmes (Conscience de classe. Aristocratie) (1) : 1789. Talleyrand [Charles-Maurice de. 1754-1838], évêque d’Autun, député aux États Généraux, lors de la première insurrection de Paris, apprend que madame de Brionne [1734-1815] est sur le point de s’enfuir et de quitter la France. Il l’en dissuade et lui conseille « d’aller quelque temps, dans une petite ville de province où elle ne serait point connue ». La réponse de madame de Brionne fut :
« Une petite ville de province, Fi ! Monsieur de [Talleyrand] Périgord ! Paysanne tant qu’on voudra, bourgeoise, jamais. » 1507
Femmes (Conscience de classe. Aristocratie) (2) : (17 juillet) 1922. Lu dans le Journal de l’abbé Mugnier [1853-1944] :
« La comtesse d’Hinnisdäl [1878-1959], petite-fille de Sully [1559-1641] me disait à table [à l’occasion de ses noces d’or] qu’on ne trouvait plus de blanchisseuses à la campagne. Et elle blâme l’instruction que les gens de la campagne ont reçue et qu’il ne fallait pas leur donner, à quoi bon, disait-elle, leur apprendre l’histoire de France à laquelle ils ne comprennent rien. » 1508
Femmes (Conscience de classe. Aristocratie) (3) : 2001. Dans ses Mémoires, Jean-Claude Brialy [1933-2007] raconte le tournage du film, Les malheurs de Sophie [d’après le livre de la comtesse de Ségur. 1858] qui avait eu lieu dans un château où résidait la propriétaire, « très ancien régime ».
Jean-Claude Brialy présente à la propriétaire les interprètes du film suivi de la présentation du rôle qu’ils devaient interpréter : Ainsi, « Sophie Deschamps, la mère, qui joue Madame de Rênal… » Et il poursuit :
« Lorsque j’arrivais devant Annie Savarin, je dis à la châtelaine : ‘Annie Savarin, qui joue la bonne‘. Et là, elle ne bougea pas, ne lui serra pas la main parce qu’elle jouait la bonne ! Sans aucune méchanceté, instinctivement, elle ne toucha pas la main d’une domestique. J’avoue que, pendant quelques minutes, Annie et moi, restâmes confondus. » 1509 (Cf. Culture. Cinéma, Êtres humains, Corps. Domestiques)
-------------
Femmes (Conscience de classe. Bourgeoisie) : 2008. Christine Lagarde, pour valoir argument de son absence de complaisance dans l’arbitrage de la ministre de finances qu’elle était alors concernant les 400 millions accordés à Bernard Tapie, déclara :
« Est-ce que croyez que j’ai une tête à être copine de Bernard Tapie ? » 1510 (Cf. Femmes. Bourgeoises. « Politiques », Relations entre êtres humains. Complaisance, Justice)
Femmes (Conscience de classe. Ouvrière) : 1976. Domitila Barrios de Chungara [1937-2012] lors de la Conférence de l’Année internationale de la Femme à Mexico en 1976, s’adressant à la présidente de la délégation du Mexique, après que celle-ci lui ait dit :
« Nous vous avons déjà suffisamment écoutée. Il faut parler de nous, de vous et de moi… c’est à dire de la femme », auteure de :
« Eh bien, parlons donc de nous deux.
Mais si vous me permettez, je vais commencer par moi. Madame, cela fait une semaine que je vous connais. Tous les matins, vous arrivez avec une robe différente ; moi pas. Tous les matins, vous arrivez coiffée et maquillée et ça montre que vous avez le temps d’aller dans un salon de beauté élégant et de l’argent à dépenser. Moi pas. Et à voir comment vous vous présentez ici, je suis sûre que vous avez une maison très élégante, dans un quartier aussi très élégant.
Nous, les femmes de mineurs, nous n’avons qu’un petit logement prêté, et si notre mari meurt ou s’il est malade ou s’il est licencié de l’entreprise, nous avons quatre-vingt-dix jours pour quitter notre logement et nous nous retrouvons à la rue.
Et maintenant, madame, qu’est-ce que votre situation a à voir avec la mienne ? Et ma situation avec la vôtre ? Alors de quelle égalité allons-nous parler ? Si vous et moi nous ne nous ressemblons pas, si nous sommes si différentes, nous ne pourrons pas pour l’instant être égales, même en tant que femmes, vous ne croyez pas ? » 1511 (Cf. Culture. Ernaux Annie, Politique. Égalité, Patriarcat)
Femmes (Conscience de classe. Absence de) : (16 octobre) 2013. Élisabeth Badinter, auteure de :
« Il faut mettre en lumière ce qui nous unit, tous et toutes, plutôt que ce qui nous distingue. » (vérifier l’exactitude la phrase) 1512
Toutes les femmes réunies autour de (avec, derrière ?) Élisabeth Badinter ?
- Il importe ici de ne pas oublier qu’en tant que fille / héritière de Marcel Bleustein-Blanchet [1906-1996], elle est présidente du Conseil de surveillance de Publicis, à ce titre, était rémunérée, en 2012, pour la somme de 240.000 euros par an 1513, et que, d’après Wikipédia, elle fut classée par le Magazine Forbes, même année, la 13ème personne la plus riche de France. 1514 (Cf. Femmes. Bourgeoises, Féminismes. Bourgeois, Économie)
-------------
Femmes (« Consentantes ») : (4 octobre) 2016. Entendu sur France Culture, le secrétaire national du Cégom [Collectif des États généraux de l'outre-mer], David Auberbach-Chiffrin :
« Notre jeunesse actuellement... je parle principalement par de la situation Antillaise… est bouffée par une espèce de modèle culturel États-Uniens pourri, pardonnez-moi l’expression, fondé sur l’économie de la drogue, qui est fondé sur la valorisation de l’argent facile, sur la valorisation de la possession de femmes, de jeunes femmes, toutes plus consentantes les unes que les autres, excusez-moi l’expression… Actuellement notre jeunesse est victime de ça… » 1515 (Cf. Patriarcat, Penser. Consentir, Proxénétisme, Violences. Violences à l’encontre des femmes. Consentement, Économie. Argent. Drogue)
Femmes (« Contemplatives ») : 1979. Un livre, celui de Catherine Baker, Les contemplatives, des femmes entre elles, montre que l’on peut conjuguer analyses, engagements féministes et respecter, comprendre et critiquer les religieuses dites « contemplatives » interrogées. [130 dans 170 monastères]. 1516 (Cf. Femmes. Religieuses, « Sciences » sociales. Sociologie)
Femmes. « Convenances » :
Femmes (« Convenances ») : Elle avait failli aux « convenances » ; pleine d’ambitions, elle se retrouva, sans avoir bien compris comment, et encore moins pourquoi, à jouer, seule, avec un bébé, dans un triste jardin public, devant un bac à sable. (Cf. Femmes. Ambition, Relations entre êtres humains. Convenances, Femmes. Mères, Famille)
Par ordre chronologique. Femmes. « Convenances » :
Femmes (« Convenances ») (1) : 1811. Jane Austen [1775-1817], dans Raison et sentiments, auteure de :
« J’ai été trop à l’aise, trop heureuse, trop franche ! J’ai manqué aux formes habituelles des convenances. J’ai été ouverte et sincère là où j’aurais dû être réservée, sans esprit, lourde et décevante. Si je n’avais parlé que du temps et de l’état des chemins et pris la parole toutes les dis minutes, je me serais épargnée ce reproche. » 1517 (Cf. Femmes. Heureuses)
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. « Coquettes » :
Femmes (« Coquettes ») (1) : 1734. Marivaux [1688-1763], dans Le paysan parvenu, auteur de :
« Madame, chez elle, ne passait pas pour coquette ; elle ne l’était point non plus ; car elle était sans réflexion, sans le savoir ; et une femme ne dit point qu’elle est coquette quand elle ne sait pas qu’elle l’est, et qu’elle vit dans sa coquetterie comme on vivrait dans l’état le plus décent et le plus ordinaire. » 1518
Raisonnement à élargir, bien au-delà de cet item…
Femmes (« Coquettes ») (2) : 1855. Honoré de Balzac [1799-1850], dans Les paysans, auteur de :
« Catherine balançait sa jupe blanche à raies bleues avec une sorte de coquetterie perverse. » 1519
Femmes (« Coquettes ») (3) : (16 août) 1859. George Sand [1804-1876], dans une lettre à Ernest Feydeau [1862-1921], auteure de :
« J’ai 55 ans […] J’ai acquis le droit de ne plus être coquette, on m’a fait un assez grand reproche de ne l’avoir jamais été. » 1520 (Cf. Femmes. Beauté)
N.B. « Coquette » : « Qui cherche à plaire, à séduire ; Qui soigne sa tenue pour plaire ».
« Coquet » : « adjectif et non féminin ». (Cf. Langage. Féminisation du langage)
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. « Coût » :
Femmes (« Coût ») (1) : 1716. Le marquis de Franclieu [1680-1746], dans ses Mémoires, auteur de :
« (à « la cour » [d’Espagne]) M. Distouris, lieutenant général, y commandait, il prit de l’amitié pour moi et une dame de condition de la ville, qui lui coûtait fort cher, en prit avantage. » 1521
Femmes (« Coût ») (2) : 1882. Émile Zola [1840-1902], dans Pot-Bouille, auteur de :
« (concernant Bachelard) Les femmes lui avaient coûté trop d’argent ; il se flattait de s’être payé les plus belles femmes de Paris. Dans la commission, on ne marchandait pas là-dessus : histoire de monter qu’on était au-dessus de ses affaires. Maintenant il se rangeait, il voulait être aimé. » 1522
Femmes (« Coût ») (3) : 2001. « Le coût estimé pour rapatrier (de France en Moldavie) le corps d’une femme décédée coûte entre 4 et 5.000 dollars », tandis que « les femmes (Ukrainiennes) sont ‘vendues’ (en Serbie) de 400 à 15000 dollars, puis, ‘rendues’ en Serbie, elles sont à nouveau ‘vendues’ de 1.5000 à 3.000 dollars. »
Ainsi, une jeune fille - destinée à être « prostituée » - « coûte » entre deux et dix fois moins cher que, ne coûte, morte [si souvent, assassinée], le rapatriement de son cercueil. 1523 (Cf. Êtres humains. Corps, Femmes. Achat, Jeunes filles. « Valeur », Proxénétisme, Économie)
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. « Créatures » :
Femmes (« Créatures ») (1) : 1857. Jules [1830-1870] et Edmond [1822-1896] de Goncourt débutent ainsi leur livre : Sophie Arnould [1740-1802], d’après sa correspondance et ses mémoires inédits :
« De rares créatures, et semées dans le temps, à des longs intervalles, ces femmes qui, vivantes sont le scandale d’un siècle - et mortes, son sourire. » (Cf. Êtres humains. « Créatures »)
Par ordre chronologique. Femmes. « Créatures ». Émile Zola :
Femmes (« Créatures ») (2) : 1884. Émile Zola [1840-1902], dans La joie de vivre, auteur de :
« Boutigny était maintenant un gros monsieur, enrichi par la fabrication de la soude de commerce ; il avait épousé la créature qui s’était dévouée jusqu’à le suivre au fond ce pays de loups ; et elle venait d’accoucher de son troisième enfant. » 1524 (Cf. Femmes. Dévouement)
Femmes (« Créatures ») (3) : 1890. Émile Zola [1840-1902], dans La bête humaine, auteur de :
« Et il songeait à son mari Grandmorin, saisi d’une jalouse admiration : comment diable ce gaillard-là, son aîné de dix ans, avait-il eu jusqu’à sa mort des créatures pareilles, lorsque lui devait renoncer déjà ces joujoux, pour ne pas y perdre le reste de ses moelles. » 1525
N.B. « Créature » [Le Littré] : « […] Créatures. 3. Une personne. - Une femme dont on parle sans considération […] ». Le passage de la première signification à la seconde nécessiterait une recherche. (Cf. Êtres humains. « Créatures », Langage. Féminisation du langage)
-------------
Femmes (Criminelles) : Les femmes criminelles le sont devenues le plus souvent du fait des hommes. Constat primaire mais juste. Si reconnu, abaisserait considérablement le nombre de femmes en prison. (Cf. Droit, Justice, Patriarcat, Politique)
Femmes (Culpabilité) : 2006. Sabine Dardenne, dans J’avais 12 ans, j’ai pris mon vélo et je suis partie à l’école…, l’une des victimes de Marc Dutroux, auteure de :
« La culpabilité est une arme aussi efficace qu’un révolver menaçant. » 1526 (Cf. Êtres humains, Relations entre êtres humains. Culpabilité, Enfants. Conscience de soi)
Par ordre chronologique. Femmes. « de chambre » :
Femmes (« de chambre ») : 1873. Pierre Larousse [1817-1875], dans son Grand dictionnaire universel du XIXème siècle, auteur de :
« Rendons justice à la femme de chambre. […] Combien parmi les jeunes hommes élevés sous le toit paternel, ont reçu d’elles la plus douce des initiations ! […] » 1527 (Cf. Violences. Violences à l’encontre des femmes. « Droit de cuissage »)
Femmes (« de chambre ») : 1878. Le cardinal de Bernis [1715-1794] écrit dans ses Mémoires :
« […] Rien n’est si dangereux pour les mœurs et peut-être pour la santé que de laisser les enfants [les garçons] trop longtemps sous la tutelle des femmes de chambres ou même dans la société des demoiselles élevées dans les châteaux. J’ajouterai que les plus sages d’entre elles ne sont pas toujours les moins dangereuses. On ose avec un enfant ce qu’on aurait honte de risquer avec un jeune homme. J’ai eu besoin de tous les sentiments de piété que ma mère avait gravés dans mon âme pour préserver ma jeunesse d’une trop grande corruption de mœurs. » 1528 (Cf. Politique. Loi. Mœurs)
-------------
Femmes (« de pouvoir ») : Les femmes - dites de - pouvoir ne font pas, quoi qu’en pensent certain-es, rêver les jeunes filles… À juste titre.
De quelles vertus, de quelles qualités, de quelles ‘réussites’, de quels ‘suppléments d’âme’ peuvent-elles se prévaloir ? De quels modèles sont-elles porteuses ? Quelle vie, quel monde incarnent-elles ?
C’est pourtant d’elles que les médias nous parlent, elles qu’ils nous vantent, sans cesse. (Cf. Femmes. « Politiques », Politique. Médias)
* Ajout. 27 juin 2017. Wishful thinking pour celles qui…
Femmes (« Défaite historique des femmes ») : Cause première de la violence du monde : ? En tout état de cause, une analyse d’Engels [1820-1895] dont on ne tire jamais assez ni la pertinence, ni les enjeux, ni les conséquences. Ni ses limites analytiques… (Cf. Patriarcat, Penser, Histoire. Patriarcale)
Femmes (« Défense des femmes ») : (25 décembre) 2017. Plantu, caricaturiste et donc journaliste politique quasi quotidien du Monde depuis 1982, évoquant le discours d’Emmanuel Macron consacré aux violences à l’encontre des femmes, s’exprime ainsi :
« quand Macron avait parlé de la défense des femmes… ».
« La défense des femmes » ? Décidément, nous n’avons pas [eu] la même culture… (Cf. Droit. Droit des femmes. Plantu, Hommes. Journalistes, Langage, Violences. Violences à l’encontre des femmes) 1529
Femmes (« Délicates ») : 1822. Stendhal [1783-1842], dans De l’amour, auteur de :
« La délicatesse des femmes tient à cette hasardeuse position où elles se trouvent placées de si bonne heure, à cette nécessité de passer leur vie au milieu d’ennemis cruels et charmants. » 1530
Aujourd’hui, remplacer « femmes délicates » par « femmes séduisantes » et souhaiter que les tenant-es de la séduction-à-la-française-qui-fait-partie-de-notre-identité-et-que-le-monde-entier-nous-envie s’interrogent sur l’éventuelle pertinence de cette analyse de Stendhal.
* Ajout. 17 septembre 2018. (7 avril) 1805. Stendhal [1783-1842], dans son Journal, écrit :
« Il ([l’un de ses ‘amis’] nous dit que le moyen de se faire aimer d’une femme […] c’est de la foutre en cul. Le détail est charmant ; c’est d’une vérité frappante. » 1531 (Cf. Hommes. Grossiers, Violences)
Femmes (Dénis) : 1992. Colette Guillaumin [1934-2017], dans Sexe, race et pratique du pouvoir, auteure de :
« Les femmes sont, en tant que groupe social, l’objet d’un déni de réalité : dès qu’il est visé en tant que tel, il n’existe plus, il se dissout dans les particularités. »
Les femmes n’étant pas un « groupe social », la suite de l’argumentation est-elle fausse ?
Non. 1532 (Poursuivre) (Cf. Féminismes, Patriarcat)
Femmes. Dénis de grossesse :
Femmes (Dénis de grossesse) (1) : On ne comprend pas (si tant est que l’on puisse ‘comprendre’ ce qui est si complexe) le déni de grossesse, indépendamment du déni de soi, du déni des femmes, du déni, de la méconnaissance, de la crainte, de la honte de leur corps, du déni de leurs souffrances (y compris du fait de la maternité, a fortiori en dehors des liens du mariage), du déni des violences du monde. Évident ? Banal ? (Cf. Êtres humains, Corps)
Femmes (Dénis de grossesse) (2) : Pour mieux appréhender ici la radicale opposition entre les hommes et les femmes, penser à la comparaison entre les « dénis de grossesses » et « les dénis de paternité ». (Cf. Êtres humains, Corps, Patriarcat)
-------------
Femmes (Dentellières) : (23 mai) 2021. J’écoute une émission de France Culture intitulée Dentellières de la mémoire : j’avais d’abord pensé non pas consacrée à l’histoire oubliée des millions de dentellières, mais consacrée à la question :
« Comment donner envie à une jeune fille d’aujourd’hui de devenir dentelière ?». Le métier est ainsi présenté :
« Un métier de taiseuse, de solitude, de recluse… en apparence. Un métier si peu féministe car dit si féminin ? Un métier d’extrême patience quand tout va si vite. Voilà ce à quoi pense Bénédicte, penchée sur son ouvrage. Et à bien plus encore. »
Sur le fondement de ce déni, « avait fourni du travail d’appoint à des milliers de cousettes, de fermières, de veuves de la région » ce qui n’a pas été, sauf incidemment, abordé :
- un métier très, très mal payé ;
- dévalorisé, sans que personne ne leur ait jamais dit qu’elles faisaient des œuvres d’art dont la valeur ne leur a jamais été reconnue ;
- lors de journées sans fin (j’entends : 18 heures de travail) ;
- sans autre formation que celle transmise aux petites filles souvent dès 5, 6 ans par leurs mères, par d’autres femmes ;
- où les femmes se crevaient les yeux, devenaient aveugles à 30 ans ;
- dont elles ne voyaient jamais la totalité de leur ouvrage, afin notamment qu’elles ne puissent échapper au pouvoir des donneurs d’ordres des grands magasins (Bon Marché…) ;
- ne pouvaient pas bouger pendant des heures, quelque fois attachées à leur chaise en bois ;
- qui devaient travailler en silence et / ou étaient interdites de paroles ;
- qui travaillaient soit chez elles, soit dans les lieux d’enfermement (prisons, maisons de ‘redressement’, couvents, écoles…) ;
- aux fins de discipliner les femmes, pour leur apprendre l’humilité, l’habitude de baisser les yeux, et les dissuader à jamais de pouvoir s’ouvrir au monde…
Ce qui était juste dans la présentation de l’émission, c’est que le travail de ces femmes « avait bâti des fortunes ». 1533 (Cf. Femmes. « Féminin ». Jeunes filles. Travail, Histoire. Patriarcale)
Femmes (Dépendantes) : (Après avoir vu Une femme mariée [Jean-Luc Godard. 1964]) Dépendantes sont les femmes qui, en présence de leur mari et/ ou amant, ne savent plus seules agrafer leur soutien-gorge ou remonter la fermeture-éclair de leur robe. (Cf. Culture. Cinéma, Étres humains. Vêtements)
Femmes (Déportées dans les camps Staliniens) : 1939. Lu dans Déportée en Sibérie, le livre de Margaret Buber-Neumann [Après avoir été, communiste, arrêtée, avec son mari, en 1937 et déportée en Sibérie dans un camp de concentration, elle fut livrée par Staline à la Gestapo en 1940 et déportée à Ravensbrück jusqu’en avril 1945. 1901-1989] consacré aux camps Staliniens :
« [En 1939] Le nombre des ‘nouvelles’ s’accroissait de jour en jour. Des centaines de femmes arrivaient, victimes des lois récentes contre l’avortement. Elles étaient en général accueillies par des moqueries et des rires. » 1534 Peu connu. (Cf. Femmes. Avortements)
Femme. Devenir une femme :
Femme (Devenir une) (1) : Quand un enfant, une petite fille devient-elle « une femme » ? Quand elle a ses règles pour la première fois ? Quand elle fait sa première communion ? Quand elle attire des regards, relevant selon certain-es, d’un désir de séduction ? Quand sa poitrine est visible ? Quand son hymen est brisé ? Quand on mutile son sexe ? Quand elle doit cacher son visage, son corps ? Quand elle a des relations sexuelles pour la première fois ? Quand elle se marie ? Après son mariage ? Quand elle est majeure ? Quand elle est mère ? Quand elle est supposée « découvrir » le « plaisir », ses « sentiments », ses « sensations », ses « sens » ?
Ne « devient »-elle « une femme » que du seul fait de ses relations à la reproduction et / ou aux hommes, et donc niée en elle-même ? (Poursuivre)
* Ajout. 13 janvier 2019. Quand elle est « relookée », - c’est-à-dire remodelée à la demande d’un-e proche, par d’autres (coiffeur, maquilleuse, styliste) qui en jugent sa place, comme une émission [La 6] nous le montrent quotidiennement ?
* Ajout. 8 juin 2025. Quand il décide seul de « devenir une femme ». (Cf. Êtres humains. Trans[genre]. L.G.B.T)
Par ordre chronologique. Femmes. Devenir une femme :
Femmes (Devenir une femme) (1) : 1722. Daniel Defoe [1660-1731], dans Moll Flanders, auteur de :
« […] J’avais presque quatorze ans, j’étais grande pour mon âge, et j’avais déjà l’air d’une petite femme […]. » 1535
Par ordre chronologique. Femmes. Devenir une femme. Honoré de Balzac :
Femmes (Devenir une femme) (2) : 1830. Honoré de Balzac [1799-1850], dans Petites misères de la vie conjugale, auteur de :
« Généralement, une jeune personne ne découvre son vrai caractère qu’après deux ou trois années de mariage. Elle dissimule, sans le vouloir, ses défauts au milieu des premières joies, des premières fêtes. Elle va dans le monde pour y danser, elle va chez ses parents pour vous y faire triompher, elle voyage escortée des premières malices de l’amour. Elle se fait femme. […]. » 1536
Femmes (Devenir une femme) (3) : 1841. Honoré de Balzac [1799-1850], dans Mémoires de deux jeunes mariées, auteur de :
« Il y a tant de différence entre une jeune fille et une femme mariée, que la jeune fille ne peut pas plus la concevoir que la femme mariée ne peut redevenir une jeune fille. » 1537 (Cf. Famille. Mariage, Patriarcat. Hymen)
-------------
Femmes (Devenir une femme) (4) : 1833. George Sand [1804-1876] écrit dans Lélia :
« Mes sens, loin d’être appauvris, étaient donc renouvelés. […]
Je ressentis tous les aiguillions de l’inquiétude, des désirs vagues et impuissants.
Il me sembla que je devenais femme, que je reprenais à la vie, que je pourrais encore aimer et désormais sentir. » 1538 (Cf. Femmes. Désirs. Plaisirs)
Femmes (Devenir une femme) (5) : (22 juin) 1837. Jules Michelet [1798-1874], dans son Journal, écrit :
« Première communion d’Adèle [sa fille. 1824-1855], la veille du départ pour la Hollande. Merveilleuse fête. Le voile : elle ressemblait à une femme. » 1539 (Cf. Femmes. « Voilées »)
Femmes (Devenir une femme) (6) : 1850. Charles Dickens [1812-1870], dans David Copperfield, auteur de :
« Je lui demandais, non sans rougir, ce qu’était devenue la P’tite Émilie, depuis le temps où nous ramassions des galets et des coquillages sur la plage.
- ‘Mais elle devient une femme, voilà ce qu’elle devient, dit. M. Peggotty. Demandez-lui’. » 1540
Femmes (Devenir une femme) (7) : 1844. Jules Michelet [1798-1874], dans son Histoire de la révolution française, auteur, dans une comparaison avec Charlotte Corday [1768-1793] de :
« Cette prolongation d’enfance fut une singularité de Jeanne d’Arc [1412-1431], qui resta une petite fille et ne fut jamais une femme. » 1541 (Cf. Enfants, Histoire. Historiographie. Patriarcale. Michelet Jules)
Femmes. Devenir une femme. Victor Hugo :
Femmes (Devenir une femme) (8) : 1862. Victor Hugo [1802-1885], dans Les misérables, auteur de :
« (Fantine, avant de mourir, évoquant l’avenir de Cosette) Elle a sept ans. Dans cinq ans. Elle aura un voile blanc, des bas à jour, elle aura l’air d’une petite femme. O ma bonne sœur, vous ne savez pas comme je suis bête, voilà que je pense à la première communion de ma fille ! » 1542
Femmes (Devenir une femme) (9) : 1862. Victor Hugo [1802-1885], dans Les misérables, auteur de :
« [...] Il lui parut [à Marius] que ce n’était plus la même fille [Cosette].
La personne qu’il voyait maintenant était une grande et belle créature ayant toutes les formes les plus charmantes de la femme à ce moment précis où elles se combinent avec toutes les grâces les plus naïves de l’enfant ; moment fugitif et pur que peuvent seuls traduire ces deux mots : quinze ans. […]
En six mois, la petite fille était devenue une jeune fille ; voilà tout. Rien n’est plus fréquent que ce phénomène. Il y a un instant où les filles s’épanouissent en un clin d’œil et deviennent des roses tout à coup. Hier, on les a laissées enfant, aujourd’hui, on les retrouve inquiétantes. […] » 1543 (Cf. Êtres humains, Corps, Enfants. Jouets, Femmes. Jeunes filles. Naturalisation, Hommes, Patriarcat)
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Devenir une femme. Émile Zola :
Femmes (Devenir une femme) (10) : 1871. Émile Zola [1840-1902], dans La fortune des Rougon, auteur de :
« […] Toute fille qui se pend au cou d’un garçon est femme déjà, femme inconsciente qu’une caresse peut éveiller. » 1544
Terrible… (Cf. Corps. Femmes, Relations entre êtres humains. Caresses)
Femmes (Devenir une femme) (11) : 1877. Émile Zola [1840-1902], dans L’Assommoir, auteur de :
« […] Et la société parla gravement des devoirs de la vie. Boche disait que Nana et Pauline étaient des femmes maintenant qu’elles avaient communié. Poisson ajoutait qu’elles devaient désormais savoir faire la cuisine, raccommoder les chaussettes, conduire une maison. On leur parla même de leur mariage et des enfants qui leur pousseraient un jour. Les gamines écoutaient et rigolaient en dessus, se frottaient l’une contre l’autre, le cœur gonflé d’être des femmes, rouges et embarrassées dans leurs robes blanches. Mais ce qui les chatouilla les plus, ce fit lorsque Lantier les plaisanta, en leur demandant si elles n’avaient pas déjà de petits maris. […] » 1545
Femmes (Devenir une femme) (12) : 1884. Émile Zola [1840-1902], dans La joie de vivre, auteur de :
« En moins d’une année, l’enfant des formes hésitantes était devenue une jeune fille déjà robuste, les hanches solides, la poitrine large. Et les troubles de cette éclosion s’en allaient, le malaise de son corps gonflé de sève, la confusion inquiète de sa gorge plus lourde, du fin duvet plus noir sur sa peau satiné de brune. Au contraire, à cette heure, elle avait la joie de son épanouissement la sensation victorieuse des grandir et de murir au soleil. Le sang qui montait et qui crevait en pluie rouge, la rendait fière. » 1546 (Cf. Corps. Femmes, Femmes. Règles)
Femmes (Devenir une femme) (13) : 1884. Émile Zola [1840-1902], dans La joie de vivre, auteur de :
« En moins d’une année, l’enfant des formes hésitantes était devenue une jeune fille déjà robuste, les hanches solides, la poitrine large. Et les troubles de cette éclosion s’en allaient, le malaise de son corps gonflé de sève, la confusion inquiète de sa gorge plus lourde, du fin duvet plus noir sur sa peau satinée de brune. Au contraire, à cette heure, elle avait la joie de son épanouissement, la sensation victorieuse de grandir et de murir au soleil. Le sans qui montait et qui crevait en pluie rouge, la rendait fière. […] C’était la vie acceptée, la vie aimée de ses fonctions, sans dégoût ni peur […]. » 1547 (Cf. Corps. Seins, Femmes. Règles, Sexes. Femmes)
-------------
Femmes (Devenir une femme) (14) : (24 février) 1910. Sigmund Freud [1856-1939], dans une lettre adressée à Karl Abraham [1877-1925], suite à une analyse du « fétichisme des pieds et des bottes » :
« En outre, il faut souligner que le pied féminin remplace probablement le pénis de la femme, sont l’absence a été ressentie douloureusement et qui a été préhistoriquement [prähistorisch] postulé. La natte pourrait être le substitut de cette même chose [sic]. Couper la natte, c’est donc castrer des femmes, ‘faire’ des femmes, puisque c’est par la castration qu’on devient femme. » 1548 (Cf. Corps. Pieds, Femmes. « Féminin », Hommes, Langage. Verbe. Faire, « Sciences » sociales. Psychanalyse. Freud Sigmund, Sexes. Femmes)
Femmes (Devenir une femme) (15) : (4 novembre) 1924-(27 mai) 1915. Franz Kafka [1883-1924] écrit dans le Dixième cahier de son Journal :
« La jeune fille de Zizkov sensible, volubile, mais rarement capable de s’imposer, anémique, corps très quelconque, n’a pas achevé son développement, lequel n’aura jamais lieu. » 1549 (Cf. Corps. Femmes, Femmes. Jeunes filles)
Femmes (Devenir une femme) (16) : 1929. Jeannette Vermeersch [1910-2001], compagne, puis épouse de Maurice Thorez [1900-1964], secrétaire général du parti communiste français, dans ses Mémoires, La vie en rouge, raconte son premier voyage en URRS [en 1929] et sa participation à « quelques réunions de l’Internationale Communiste » :
« En arrivant en Union soviétique, je n’étais encore qu’une jeune fille timide et réservée, une petite ouvrière qui rougissait dès que l’on posait un regard sur elle, très romanesque, toute préoccupée par sa vie intérieure. Les grèves, le groupe des jeunesses communistes, m’avaient déjà un peu sortie de mon cocon, mais ce séjour en URSS me libéra vraiment.
En quelques mois, au contact de la révolution, je devins littéralement une autre personne, capable de m’extérioriser, de ‘prendre du poids’.
Et pas seulement intellectuellement, en six ou sept mois, j’ai vécu une véritable transformation physique. [...]
En fait, plus je m’épanouissais moralement, plus je m’épanouissais physiquement. Je quittais définitivement le romantisme de l’adolescence et devenais une femme. » 1550 (Cf. Femmes. Jeunes filles)
Femmes (Devenir une femme) (17) : 1946. János Székely [1901-1958], dans L’enfant du Danube, auteur de :
« […] Ses corsages remis à neuf révélaient de jeunes seins arrondis que je n’avais jamais soupçonnés, pas plus que ses jambes ou ses cheveux. Je l’avais considérée jusqu’alors comme une créature asexuée ; je voyais maintenant qu’elle était une femme. Pour quelque raison inconnue, je me sentais rempli d’une gêne étrange. Il y a bien des femmes au monde. Mais on n’a qu’une mère. Je me sentais mal à l’aise en la regardant. Une mère ne devrait pas être une femme. » 1551 (Cf. Femmes. Mères)
Femmes (Devenir une femme) (18) : 1949. Lu, dans Le palanquin des larmes, livre autobiographique de Chow Ching Lie [1936-2025], ce passage où, à Shanghai, alors fiancée contre sa volonté, à 13 ans, elle décrit sa nouvelle vie, dans l’attente du mariage :
« Pour moi, dans mon existence coutumière - l’école, le piano, les études - une seule nouveauté, j’étais censée faire mon apprentissage de femme. Les rudiments n’avaient pas changé : surveiller mon langage, ne pas rire à gorge déployée, ne pas parler fort, ni marcher à grands pas. Ces règles observées, on était déjà, paraît-il, une femme. » 1552
Femmes (Devenir une femme) (19) : 1964. Zoubeïda Bittari [1939-?], dans O mes sœurs musulmanes, pleurez ! auteure de :
- « Je devins nubile à onze ans et quatre mois. On fit pour moi une petite fête où les conseils de prudence ne me furent pas épargnés. […] Cette fête donnée en mon honneur avertissait parents, amis et voisons que j’étais bonne à marier. Je ne comprenais pas non plus pourquoi il était nécessaire d’informer tout le monde d’un fait qui, normalement n’intéressait que moi. Mais c’était la coutume et il en fut ainsi, Dès lors maman, mes sœurs et mes belles-soeurs amenèrent toujours la conversation sur une certaine partie de mon corps que je devais préserver pour mon avenir, pour l’honneur de la famille. […] » 1553
Et dans la Préface du livre, Miriam Cendrars [1919-2018] écrit :
- « […] Soudain, un vent de panique se lève au sein de la famille. Que se passe-t-il ? Zoubeïda a cessé d’être une enfant. C’est en tout cas ce que tout le monde proclame sur la foi d’un phénomène physiologique. Pubère, Zoubeïda est désormais en danger. Les jeux, les rires, les amitiés naissantes, les livres, la radio, le cinéma, tout cela devient menace et scandale. […] Comment sauve ton les petites filles pubères depuis des siècles ? Comment les soustrait-on à la calomnie et la tentation ? Comment les parents se défont-ils de ce terrible fardeau ? En le passant à d’autres. […] » (Cf. Culture, Femmes. Règles, Famille, Sexes. Femmes)
Femmes (Devenir une femme) (20) : 1969. Robert Beck (alias Iceberg Slim) [1918-1992], dans Pimp. Mémoires d’un maquereau, auteur de :
« Il traita ma mère comme une princesse. Tout ce qu’elle désirait, il le lui donnait. Elle devint une vraie gravure de mode. » 1554
Femmes (Devenir une femme) (21) : 1976. Ménie Grégoire [1919-2014], dans Telle que je suis, écrit :
« (Vers 5-6 ans) Chaque soir, avant de m’endormir, je devenais un petit garçon extraordinaire, qui s’appelait Paul. […] Paul (c’est-à-dire moi) pouvait tout : aucune barrière, aucune enceinte, aucune porte d’aucun ordre ne l’arrêtait […] Il était toujours premier, il gagnait tout et dévorait la vie.
Aujourd’hui, je peux affirmer que je n’ambitionnais nullement de devenir un homme ; je faisais quelque chose de très sain ; je me faisais libre dans l’imaginaire, petite fille déguisée en garçon, à la barbe de toutes les femmes résignées qui m’entouraient.
Paul a vécu en moi des années.
Puis un jour je n’ai pas pu me projeter en lui parce que je devenais femme et il a disparu d’un seul coup. » 1555 (Cf. Enfants, Femmes. Ambition, Patriarcat, « Sciences » sociales. Psychanalyse)
Femmes (Devenir une femme) (22) : 1976. Bruno Bettelheim [1903-1990], dans Psychanalyse des contes de fées, auteur de :
« (après avoir présenté son analyse de la Belle au bois dormant et de Perceforest [vers 1340]) La femme ne s’accomplit pas totalement quand elle a ses règles, ni quand elle devient amoureuse, ni quand elle a des rapports sexuels, ni quand elle met au monde un enfant : les héroïnes de Perceforest et de l’histoire de Basile font tout ça en dormant. Il reste nécessairement quelque pas de plus à faire sur le chemin de l’ultime maturité ; il faut encore nourrir l’être qu’on a mis au monde. Ces histoires énumèrent des expériences qui n’appartiennent qu’à la femme ; elle doit les vivre toutes avant d’atteindre le sommet de sa féminité. C’est l’enfant qui rend la vie à sa mère […] » 1556 (Cf. Êtres humains. Soi. Bettelheim Bruno, Femmes. « Héroïnes ». Mères, Règles, Patriarcat. Féminité)
Femmes (Devenir une femme) (23) : (mai) 1976. Évelyne Le Garrec [1934-2018], dans l’article De fil en aiguille et de mères en filles, publié dans Les Temps Modernes, auteure de :
« Où s’arrête la petite fille, où commence la femme ? Allez donc savoir. » 1557
Femmes (Devenir une femme) (24) : 1982. Lu dans Les enfants modèles de Paul Thorez [1940-1994] :
« […] Anita avait 15 ans, deux de plus que moi. C’était une grande fille, brune, solide. Elle était faite. Elle était femme. » 1558
Femmes (Devenir une femme) (25) : 1995. Lu dans le Guide des films. 1895-1995. L-Z de Jean Tulard, concernant Marie Poupée [1976. Joël Seria] :
« Marie, une orpheline de 17 ans épouse Claude, la trentaine, qui tient un magasin de poupées. Mais le soir des noces, il ne la touche pas, se contentant de jouer avec elle comme une poupée. Marie, frustrée, désirerait que Claude fasse d’elle réellement sa femme. […] » 1559 (Cf. Culture. Cinéma, Hommes. « Impuissants », Famille. Mariage, Langage. Verbe. Faire)
Femmes (Devenir une femme) (26) : 2004. Philippe de Gaulle [1921-2024], dans son livre De Gaulle, mon père [1890-1970], rapporte ses conseils concernant une future épouse :
« Il faut choisir quelqu’un en rapport avec ton milieu, tes buts et tes ambitions. » Puis :
« Dans le choix, il faut se souvenir que la jeune fille, c’est comme un papillon… Au départ, ses couleurs ne rayonnent pas beaucoup. C’est d’ailleurs tant mieux. Et puis, une fois qu’elle est mariée, elle devient une femme et à ce moment-là, elle s’épanouit et ça l’embellit. »
- Tandis que le jour de son mariage, en décembre 1947, sa mère [Yvonne de Gaulle. 1900-1979] lui dit :
« Il faut être bon avec une jeune femme parce que la transformation de la fiancée en épouse, en maîtresse de maison et en mère de famille se fait en peu de temps et ce n’est pas facile. Tu dois donc être indulgent. » 1560 (Cf. Femmes. Animalisation des femmes. Beauté. Épouse de. Jeunes filles. « Maîtresses de maison », Hommes. Ambition, Famille. Mariage, Patriarcat)
Femmes (Devenir une femme) (27) : 2007. Michelle Martin, épouse de Marc Dutroux, assassin, violeur, tortionnaire de petites filles, condamnée, en 2004, à 30 ans de prison, et elle aussi, responsable, complice, auteure en 2007 de :
« Je voyais bien que je partais avec un homme aux antipodes de tout ce qui avait compté pour moi, des valeurs. […] Mais il me rendait femme. » 1561 (Cf. Femmes. Épouse de)
-------------
Femmes. Dévouement :
Femmes (Dévouement) (1) : Une femme dévouée : une femme vouée au bonheur d’un-e autre qu’elle-même. (Cf. Hommes. Lige)
Par ordre chronologique. Femmes. Dévouement :
Par ordre chronologique. Femmes. Dévouement. Honoré de Balzac :
Femmes (Dévouement) (1) : 1833. Honoré de Balzac [1799-1850], dans Un médecin de campagne, auteur de :
« Pour elle, les plus violent des chagrins était de me voir désirer quelque chose qu’elle ne pouvait me donner à l’instant. Oh ! monsieur, les dévouements des femmes sont sublimes ! » 1562
Femmes (Dévouement) (2) : 1846. Honoré de Balzac [1799-1850], dans La cousine Bette, auteur de :
« Le dévouement d’Hortense est un sentiment qui, pour un mari, lui semble dû : la conscience de l’immense valeur d’un amour absolu se perd bientôt, comme le débiteur se figure, au bout de quelque temps, que le prêt est à lui. Cette loyauté sublime devient en quelque sorte le pain quotidien de l’âme, et l’infidélité séduit comme une friandise. » 1563
-------------
Femmes (Dévouement) (3) : (13 juin) 1837. George Sand [1804-1876], dans Entretiens journaliers, auteure de :
« L’homme […] méprise parfaitement le dévouement car il croit que le dévouement lui est naturellement acquis par le seul fait d’être sorti du ventre de madame sa mère. » (Lire la suite) 1564
-------------
Femmes. D’exception :
Femmes (D’exception) (1) : Cette formulation a le grand avantage de les isoler des autres femmes. Et de ne pas avoir à les comparer aux hommes.
* Ajout. 4 février 2015. Cette critique est aussi valable pour « Femme remarquable » que j’emploie.
Femmes (D’exception) (2) : Le patriarcat ne se maintient qu’en singularisant - lorsque l’on ne peut plus les dénier - les femmes qui pensent la nécessité d’une pensée politique féministe anti-patriarcale. Afin de retarder l’émergence d’une contestation globale, ce qui est aussi le fait de toute pensée politique.
Par ordre chronologique. Femmes. D’exception :
Femmes (D’exception) (1) : 1979. Phyllis Chesler, dans Les femmes et la folie, auteure de :
« Les exceptions individuelles n’ont rien à voir avec la compréhension des règles et des forces auxquelles elles font exception. Le fait de se référer sans cesse à la doctrine des ‘exceptions individuelles’ ou de s’y raccrocher est généralement le propre de la lâcheté, de l’ignorance ou d’objectifs intéressés. » 1565 Sévère et juste. (Cf. Femmes. Folie)
-------------
Femmes (Diderot Denis) : 1769. Denis Diderot [1713-1784], dans une lettre à madame de Maux [1725-après 1781], auteur de :
« S’il n’y avait point de femmes pour un méchant, il y aurait bien moins de méchants. » 1566 La simplicité de l’expression n’exclue pas la profondeur de l’analyse… (Cf. Femmes. Beauté, Relations entre êtres humains. Aimer. Diderot Denis, Patriarcat)
Par ordre chronologique. Femmes. Dignité :
Femmes (Dignité) (1) : 1889. Bertha von Suttner [1843-1914], auteure, dans son roman, féministe, pacifiste, Bas les armes, de :
« […] Je prétendais ne donner mon cœur qu’à un homme digne de lui. […] » 1567 (Cf. Femmes. Remarquables, Politique. Guerre)
Femmes (Dignité) (2) : 1888-1889. Anatole France [1844-1922], amant de madame de Caillavet [1844-1910], informé d’anciennes relations amoureuses de sa maîtresse par l’un de ses ex-amants, lui avait écrit :
« […] Ah ! s’il ne s’agissait que d’essuyer les crachats que tu as reçus, avec quelle pitié je le ferais. Quel bonheur ce serait pour moi de les effacer sous mes baisers. Mais la souillure est en toi, comment l’effacer jamais ? Voudrais-tu encore me redonner ce que tu as donné à un autre ? Voudrais-tu encore que nous soyons tous deux ce que tu étais avec ce misérable ? »
- Madame de Caillavet [Léontine Lippmann] lui répondit […] :
« Je ne puis supporter que tu me soupçonnes de faiblesse parce que tu mets en doute ma fierté - sans doute je suis souillée par ces horribles calomnies, mais la souillure est involontaire. Je ne suis pas flétrie, et je te défends, oui, je te défends de me le dire. Tu peux t’éloigner de moi, je ne te permets pas de me mépriser…Et puis, tu sais autre chose, je veux te gronder : il est mal à toi de me tenir pour moins précieuse parce que j’ai été insultée par un indigne. » 1568
Arguments, à moderniser, à réutiliser… (Cf. Relations entre êtres humains. Baiser. Pitié, Femmes. Amants, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
Femmes (Dignité) (3) : 1986. Alice Sapritch [1916-1990], dans Femme-Public. Ma vérité, concernant son ex-mari Guillaume Hanoteau, [1908-1985] auteure de :
« […] Cet homme ne m’a pas mérité. » […].
« Il « ne s’est pas montré digne de recevoir ce que je lui apportais. » 1569 (Cf. Femmes. Artistes. Orgueil)
-------------
Femmes. « Distinguées » :
Femmes (« Distinguées ») (1) : Dans sa jeunesse, il divisait les femmes en « femmes distinguées » et … les autres. En vieillissant, il eût été horrifié que l’on le lui rappelât. (Cf. Êtres humains, « Distingués »)
Par ordre chronologique. Femmes. « Distinguées » :
Femmes (« Distinguées ») (1) : 1847. Charlotte Brontë [1816-1855], dans Jane Eyre, auteure de :
« Toutes deux avaient le teint clair et la taille fine ; toutes deux avaient le visage respirant la distinction et l’intelligence. » 1570
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Dons :
Femmes (« Dons ») (1) : 1764. Je lis dans la chronologie de la vie de Beaumarchais [1732-1799] concernant l’année 1764, publiée dans La Pléiade [1988] :
« Séjour en Espagne brillant et agité. Vie commune avec la marquise de La Croix, qu’il donne au roi comme maîtresse. » 1571 (Femmes. Échange des femmes, Hommes. Remarquables, Famille. Mariage. Don, Patriarcat, Violences. Violences à l’encontre des femmes. « Droit de cuissage »)
Femmes (« Dons ») (2) : 1963. Charles Aznavour (1924-2018] chante :
« Viens, donne tes seize ans »
Femmes (« Dons ») (3) : 1982. L’abbé Pierre [1907-2012], à la mort de Lucie Coutaz [1899-1982], résistante, et co-fondatrice, gestionnaire du mouvement Emmaüs, devenue « sa secrétaire », la qualifia de « don merveilleux de dieu à ma vie. » 1572 (Cf. Langage. Possessif, Hommes. Remarquables. Abbé Pierre, Proxénétisme. « Clients ». Abbé Pierre, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
-------------
Par ordre chronologiques. Femmes. « Dures » :
Femmes (« Dures ») (1) : 1835. Honoré de Balzac [1799-1850], dans Le lys dans la vallée, auteur de :
« […] Mais n’y cédez pas [dans « les salons »] un pouce de de terrain à ma mère, qui écrase celui qui s’abandonne et admire la fierté de celui qui résiste ; elle ressemble au fer qui, battu, peut se joindre au fer, mais qui brise par son contact tout ce qui n’a pas sa dureté. » 1573
Femmes (« Dures ») (2) : 1936. Georges Bernanos [1888-1948], dans le Journal d’un curé de campagne, auteur de :
«’Ta mère était une ‘dure’, aime à répéter mon oncle Ernest. Pour les pauvres gens, je crois que cela signifie une ménagère infatigable, jamais malade et qui coûte pas cher pour mourir. »
Pour comparaison, neuf pages plus loin, Georges Bernanos évoquant « M. le comte », écrit :
« On le dit assez dur envers ses fermiers. » 1574.
Même signification ? Non. (Cf. Hommes. « Durs », Économie. « Pauvres Les »)
-------------
Femmes (Dots) : Cf. Famille. Dots
Femmes (Échange des femmes)
Par ordre chronologique. Femmes. Échange des femmes :
Par ordre chronologique. Femmes. Échange des femmes. Voltaire :
Femmes (Échange des femmes. Voltaire) (1) : (27 janvier) 1765. Voltaire [1694-1778] écrit au duc de Richelieu [1696-1788] pour lui recommander le fils d’un de ses amis, M. d’Hermanches [1722-1785] :
« Il est actuellement dans votre service, et il a désiré comme de raison être présenté au général qui a le mieux soutenu la gloire de la France. Vous pouvez d’ailleurs le faire votre aide de camp auprès de Melle d’Épinay, ou de Melle Doligny, ou de Melle de Luzy, [comédiennes, présentées comme ayant été ses maîtresses] attendu que vous ne pouvez pas tout faire par vous-même. » 1575 (Cf. Hommes. Grossiers, Patriarcat, Violences. Violences à l’encontre des femmes. « Droit de cuissage »)
Femmes (Échange des femmes. Voltaire) (2) : (2 janvier) 1770. Voltaire [1694-1778] écrit à Catherine II, [1729-1796] dont les armées sont en guerre contre la Turquie. Voltaire, qui avait nombre d’informateurs, lui écrit :
« Il paraît un manifeste des Georgiens qui déclarent net qu’ils ne veulent plus fournir des filles à Moustapha [c’est ainsi qu’il nomme le chef de l’empire Ottoman]. Je souhaite que cela soit vrai et que toutes leurs filles soient pour vos braves officiers qui le méritent bien. » Et il termine par la leçon qu’il tire de cette légitimité des femmes comme butin de guerre :
« La beauté doit être la récompense de la valeur. » 1576
N.B. Il faudrait faire des recherches concernant la véracité de ce ‘manifeste’. (Cf. Relations entre êtres humains. Récompense, Politique. Guerre, Histoire, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
Et le 2 février 1770, Voltaire lui écrit à nouveau :
« Et pour les sultanes du sérail de Moustapha, elles appartiennent de droit au vainqueur. » 1577 (Cf. Droit, Femmes. Butin, Politique. Guerre)
-------------
Femmes (Échange des femmes. Frédéric II) (3) : (10 décembre) 1773. Frédéric II [1712-1786], dans une lettre adressée à Voltaire [1694-1778], - lui écrit :
« […] Si les armes victorieuses des Russes pénètrent à [I]Stamboul, je prierai l’impératrice [Catherine II. 1729-1796] de vous envoyer la plus jolie Circassienne du sérail, elle sera escortée par un eunuque noir, qui la conduira droit au sérail de Ferney. Sur ce beau corps vous pourrez faire quelques expériences de physique, en animant par le feu de Prométhée quelque embryon qui héritera de votre beau génie. » 1578 (Cf. Corps. Femmes, Femmes. Butin, Politique. Tortures)
Femmes (Échange des femmes. Balzac Honoré de) (4) : 1833. Honoré de Balzac [1799-1850], dans Le médecin de campagne, auteur de :
« Je me suis toujours demandé pourquoi un homme, qui mourrait de honte s’il prenait une pièce d’or, vole la femme, le bonheur, la vie de son ami sans scrupule. » 1579 (Cf. Hommes. Adultère. Honnêtes. Solidarité entre hommes, Famille. Mariage, Relations entre êtres humains. Amitié, Économie. Vol)
Femmes (Échange des femmes. Dickens Charles) (5) : 1850. Charles Dickens [1872-1870], dans David Copperfield, auteur de :
« […] Et, sous prétexte d’un voyage de quelques jours, il me chargea de lui annoncer [à Émilie] que, dans l’intérêt de tout le monde, il était […] … parti. Mais M. James [le ‘séducteur’], je dois le dire, s’était conduit de la façon la plus honorable ; car il proposait à la jeune femme de lui faire épouser un homme très respectable [dont il sera précisé plus loin, qu’il était ‘son domestique’], qui était tout prêt à passer l’éponge sur le passé, et qui valait bien tous ceux auxquels elle aurait pu prétendre par une voie régulière, car elle était d’une famille très vulgaire. » 1580 (Cf. Famille. Mariage)
Femmes (Échange des femmes. Tolstoï Léon) (6) : 1865-1869. Léon Tolstoï [1828-1910], dans La guerre et la paix, évoquant, lors de l’occupation militaire de Moscou par l’armée française en 1812, une discussion entre Pierre [Bezoukhov] et un militaire français, écrit :
« Le capitaine raconta la touchante histoire de son amour pour une séduisante marquise de trente-cinq ans, doublé de celui qu’il éprouvait pour la fille de cette dame, une gracieuse et naïve fillette de dix-sept ans. La lutte de la générosité entre la mère et la fille qui se termina par le sacrifice de la mère offrant sa fille en mariage à son amant. […]
Il en vint ensuite à sa dernière aventure en Pologne. […] Il avait sauvé la vie d’un Polonais […] si bien que ce Polonais lui avait confié sa séduisante épouse, Parisienne de cœur, pendant que lui-même s’enrôlait au service de la France. Le capitaine était au comble de ses vœux, la séduisante Polonaise voulait s’enfuir avec lui : pourtant, dans un élan de générosité il rendit la femme au mari et lui dit : ‘Je vous ai sauvé la vie et je sauve votre honneur !’ » 1581 (Cf. Femmes. Généreuses. Mères. « Séduisantes », Hommes. « Honneurs »)
Femmes (Échange des femmes. Hugo Victor) (7) : 1869. Victor Hugo [1802-1885], dans L’homme qui rit, auteur de :
« En fait de femmes (sic), nous (sic) avons tous eu les restes les uns des autres. Qu’est- ce qui a eu un commencement ? » 1582 (Poursuivre) (Cf. Êtres humains. « Restes », Femmes. Vierges. Patriarcat)
Femmes (Échange des femmes. Kessel Joseph) (8) : 1918. Joseph Kessel [1898-1979], à la fin de la guerre de 1914-1918 à laquelle il avait participé comme aviateur, fait partie des premiers soldats arrivés aux États-Unis « après la victoire » ; il décrit l’enthousiasme, « l’amour », à New York puis San Francisco où il est resté six semaines et il poursuit :
« Je ne veux vraiment pas insister là-dessus parce qu’on ne me croira difficilement, mais nous avons vu des hommes, dans l’exaltation des boites de nuit et de l’alcool, nous laisser leurs femmes parce qu’ils se sentaient honorés de participer à la joie française. » 1583 « Cf. Hommes. « Honneurs »)
Femmes (Échange des femmes. Gide André) (9) : 1928. André Gide [1869-1951], auteur, dans Le retour du Tchad, de :
« Les Indigènes, d’après ce que nous dit Zigla (un des Noirs les plus intelligents que nous ayons rencontrés), auraient un plus grand nombre de femmes aujourd’hui, parce que, en cas de contestation, répudiation, ils trouvent facilement appui auprès du juge blanc pour se faire rendre la dot ; que d’autre part, ils n’ont plus à craindre les razzias ; et qu’enfin et surtout, si, pour payer l’impôt, le chef du village va trouver un indigène et lui dit : tu as plusieurs bœufs ; on va en vendre un pour parfaire la capitation, il ne peut opérer ainsi avec les femmes. Alors, il vaut mieux acheter une femme qu’un bœuf (Ajouter que l’indigène fait travailler la femme et ne fait pas travailler le bœuf.) » 1584
Écrit, sans commentaire, ni jugement d’André Gide… (Cf. Êtres humains, Femmes. Achat. Animalisation des femmes, Famille. Dot. Polygamie, Justice, Patriarcat, Politique. Colonialisme, « Sciences » sociales. Ethnologie)
Femmes (Échange des femmes. Légion espagnole) (10) : 1936. Robert Brasillach [1909-1945], dans Notre avant-guerre [1941], alors en Espagne, évoque la Légion espagnole (fasciste) en 1936 et décrit une salle de garnison de la Légion. Il écrit :
« Dans la loge de droite […] deux jeunes hommes en chemise verte, il me semble. Je regarde plus attentivement. L’un d’eux est une femme fort belle, avec des cheveux noirs et courts, et sur sa manche, deux brisques [chevrons d’ancienneté] qui signifient deux blessures.
- C’est une femme légionnaire, me renseigne-t-on. Vous n’avez pas rencontré Mathilde à la Cité universitaire ? On les tolère. Elles sont fidèles à l’homme avec qui elles sont. Quand il est tué, elles en prennent un autre. Jusque-là tout le monde respecte le camarade. » 1585 (Cf. Femmes. Épouse de. Veuves, Patriarcat)
Femmes (Échange des femmes. Grossman Vassili) (11) : 1960. Vassili Grossman [1905-1964], dans Vie et destin, auteur de :
« Elle [Katia, technicienne radio russe à Stalingrad] en avait entendu des cochonneries, pendant ces quelques mois de guerre ! […]
Il y avait une chanson que les jeunes filles chantaient à mi-voix :
‘ Et, puis, par une belle nuit d’automne
Le commandant la choya en personne
Jusqu’à l’aube elle fut colombe
Après quoi, elle fut à tout le monde.’ » (Cf. Hommes, Patriarcat, Violences à l’encontre des femmes. « Droit de cuissage »)
Femmes (Échange des femmes. Adamo Salvatore) (12) : 1965. Salvatore Adamo chante :
« Vous permettez, monsieur, que j’emprunte votre fille ? » (Cf. Famille, Patriarcat. Pères)
Femmes (Échange des femmes. Guillaumin Colette) (13) : 1978. Après avoir écrit :
« On ne prend publiquement que ce qui vous appartient », Colette Guillaumin [1934-2017] poursuit :
« Pour approprier des hommes mâles, il faut une guerre… pas pour les hommes femelles, c’est à dire les femmes. Elles sont déjà propriété. Et lorsqu’on nous parle […] d’échange des femmes, on nous signifie cette vérité-là, car ce qui s’échange est déjà possédé ; les femmes sont déjà la propriété antérieurement de qui les échange. »
Cette analyse s’avéra, pour moi, en son temps, une révélation. 1586 (Cf. Femmes. « Femelles », Féminismes. Féministes, Hommes. Concurrence entre hommes, Penser)
* Ajout. 9 mai 2019. Les hommes dominants ont accès aux femmes des dominés : esclavage, « droit de cuissage » …, les hommes dominés n’ont pas accès aux femmes des dominants, saut pendant les guerres : ? (Poursuivre) (Cf. Patriarcat)
Femmes (Échange des femmes. Sadoul Georges) (14) : 1990. Lu dans le Dictionnaire des films de Georges Sadoul [1904-1967] la présentation suivante de Sous les toits de Paris [René Clair. 1930] :
« Un chanteur des rues, après avoir été arrêté par erreur, se bat avec son meilleur ami qui lui a pris sa maîtresse et, voyant qu’elle l’aime, le [la] lui abandonne. » 1587
Simple comme bonjour… (Cf. Culture. Cinéma)
Femmes (Échange des femmes. Tulard Jean) (15) : 1995. Jean Tulard, dans le Guide des films. 1895-1995. L-Z, concernant :
- Pauvres mais beaux [1959. Dino Risi] : « Deux amis sont amoureux de la même fille. Elle leur préfère un troisième garçon. Ils découvrent qu’ils ont chacun une sœur ravissante. » (Cf. Famille. Frères et sœurs)
- Rio Verde [1972. Andrew McLaglen] : « Un hors la loi sympathique pense se retirer des affaires après un gros coup. Il lui faut une mitrailleuse. Mais le bandit qui la possède ne veut l’échanger que contre une femme. Baker enlève l’épouse du colonel Morgan. […] » 1588 (Cf. Culture. Cinéma)
Femmes (Échange des femmes. Kapuściński Ryszard) (16) : 2002. Lu, dans Ébène. Aventures africaines, de Ryszard Kapuściński [1932-2007], concernant « la culture africaine » :
« La culture africaine est une culture de l’échange. Si on me donne quelque chose, je dois le rendre. C’est un devoir, engageant ma fierté, mon honneur, ma qualité d’homme. C’est dans l’échange que les relations humaines prennent leur forme la plus noble. L’union de deux jeunes gens qui, à travers leur descendance, prolongent la présence de l’homme sur la terre et assurent sa pérennité, se fait précisément par le biais d’un échange entre deux clans : les femmes sont échangées contre des biens matériels indispensables à son clan. […] » 1589
Et c’est ainsi que la moitié de l’humanité africaine, fut, est toujours, sous couvert de description du réel, matérialisée, chosifiée. Ou plus justement, enfermée, confirmée, légitimée dans un statut d’objet ; sans interrogation, ni inquiétude. (Cf. Culture, Femmes. « Objets », Politique. Colonialisme, Patriarcat, « Sciences » sociales. Ethnologie)
Femmes (Échange des femmes) (17) : (17 mai) 2025. Entendu Jean-Louis Trintignant [1930-2022], dans une rétrospective de sa vie, à la télévision, qui lui était consacrée, concernant ses relations avec Roger Vadim [1918-2000] :
« On a eu une passation de femme. On était rivaux. »
Pour précision : il était devenu l’amant de Brigitte Bardot. (Cf. Hommes, Langage. Mots. Critique de : « On ». Sujet, Patriarcat)
NB. « « Passation » : « Action de passer (un acte) ; transmission de pouvoirs à un, à d’autres »
-------------
Femmes (Écrits de femmes, lus par des hommes) : Les écrits de femmes lus par un homme comédien : substitution, recouvrement, envahissement, mépris. Inconscience ? [Après avoir entendu Michael Lonsdale lisant une nouvelle de Virginia Woolf, dans laquelle le « je » est pourtant explicité] 1590
Vrai aussi pour les chansons évoquant la vie des femmes. Comparer Filles d’ouvriers de Jules Jouy [1855-1897] chanté par Marc Ogeret [1932-2018], par Serge Utge-royo avec l’interprétation de Michelle Bernard. (Cf. Culture. France Culture, Femmes. Artistes)
Femmes (Église catholique) : Cf. Patriarcat. Église catholique, Politique. Religion
Femmes (« Embarras intimes ») : 1989. Jules Roy [1907-2000], dans Mémoires barbares, à qui l’éditrice Françoise Verny [1928-2004] propose d’écrire un livre sur « la Chine », auteur de :
« Il y avait de quoi être emballé. À l’époque, je vivais de amours tumultueuses. […]
Je me vis sur les traces de Mao [1893-1976] à travers les montagnes et les défilés du Sseu-Tch’ouan. Comment mes embarras intimes résisteraient ils à cela ?
D’abord, je les emmènerai au Sahara, mes embarras. […]
Nous visitâmes […]. » 1591
Femmes. Embryons :
Femmes (Embryons) (1) : On lui posait la question de l’avortement pour une fillette enceinte, une femme violée, il répondait : « Statut de l’embryon » et « l’embryon est un être humain à part entière. » Y a-t-il meilleure preuve que, pour les intégristes catholiques, les femmes n’existent pas ?
- J’ai entendu ensuite, sur Radio courtoisie (radio d’extrême-droite) un autre ‘argument‘ dont on peut tirer la même conclusion :
« Les enfants mal aimés ne sont pas condamnés à être malheureux. » 1592 (Cf. Êtres humains. Heureux, Enfants, Relations entre êtres humains. Aimer, Politique. Extrême-droite)
Femmes (Embryons) (2) : Comparer, mettre en balance, hiérarchiser la vie d’une femme et celle - potentielle - d’un embryon placé en son sein est, en pure logique formelle, absurde. Et, avant tout, inhumaine. (Cf. Politique. Extrême-droite)
Femmes (Embryons) (3) : (17 mars) 2022. J’entends évoquer, sur Radio courtoisie (radio d’extrême-droite), « la dignité substantielle de l’embryon ». (Cf. Êtres humains, Politique. Extrême-droite)
-------------
Femmes (Émotions) : 1962. Doris Lessing [1919-2013], dans Le carnet d’or, auteure de :
« C’est terrible : après chaque phase de ma vie, je me retrouve seule avec quelques lieux communs - aujourd’hui, c’est que les émotions des femmes correspondent encore à un type de société qui n’existe plus. » 1593 (Cf. Relations entre êtres humains. Émotions)
Femmes (« Émouvantes ») : Mouloudji [1922-1994] et Roger Blin [1907-1984] nommaient les femmes : « les émouvantes ». 1594
Femmes. Enceintes :
Femmes (Enceintes) (1) : « Ça la calmera » ; « ça lui apprendra » ; « ça lui mettre du plomb dans la tête » ; « c’est bien fait pour elle » ; « elle l’a bien cherché »…
La préhistoire ?
Femmes (Enceintes) (2) : Déni de grossesse, déni d’enfant, déni du géniteur, déni des relations sexuelles ayant provoqué la création d’un embryon et, en conséquence, d’un enfant ;
Refus de grossesse, refus d’enfant, refus du géniteur, refus des relations sexuelles ayant provoqué la création d’un embryon et, en conséquence, d’un enfant ;
Déni de soi, déni de l’autre ; absence à soi, absence à l’autre ; refus de soi, refus de l’autre.
Ce qui obliger à penser que la grande, majeure, irréductible différence entre les hommes et les femmes est que les hommes peuvent refuser, et refusent le plus souvent, les conséquences des relations sexuelles qu’ils ont avec les femmes, et que les femmes ne le peuvent pas.
Les femmes sont seules à porter dans leurs corps un futur, possible, probable, éventuel enfant, qui leur est introduit par une personne qui n’est pas elle-même, autre qu’elle-même, extérieure à elle-même. Il est alors plus aisé à comprendre le déni, le refus de grossesse, d’enfant.
N.B. « Refus » : « Fait de refuser ce qui semble s'imposer à quelqu'un, qui le contraint d'une manière ou de l'autre. »
Femmes (Enceintes) (3) : (5 mai) 2025. Entendu au lieu et place de « fausse couche » :
« grossesse arrêtée », « spontanément arrêtée ».
Par ordre chronologique. Femmes. Enceintes :
Femmes (Enceintes) (1) : (5 juillet) 1773. Voltaire [1694-1778] écrit à Alexandre-Marie-François de Paule de Dompierre d’Hornoy [1742-1828] :
« Mon cher Picard, ceux qui se portent bien ont pu vous faire leurs compliments sur l’embryon de l’âme immortelle logée depuis deux mois entre la vessie et le rectum de Madame d’Hornoy, mais ceux qui traînent les restes d’une vie languissante [lui, en l’occurrence] n’ont pu être si diligents. Ils n’en prennent pas moins intérêt à la petite machine à peine organisée que vos deux machines ont produite sans savoir comment. Je souhaite au fœtus toutes sortes de prospérités dans le monde ridicule qu’il habitera, et que je vais bientôt quitter. Il est fort vraisemblable que je ne verrai jamais ce monsieur. […] »
N.B. Ce « monsieur » fut une fille : Charlotte-Marie-Sophie naquit le 8 janvier 1774. 1595 (Cf. Êtres humains, Corps. Machine. Vagin, Enfants, Femmes, Hommes. Grossiers. Voltaire, Relations entre êtres humains. Amour. « Faire l’amour »)
Femmes (Enceintes) (2) : 1782. Jean-Jacques Rousseau [1712-1778], dans Les confessions, auteur de :
« Tandis que j’engraissais à Chenonceau, ma pauvre Thérèse [Levasseur. 1721-1801] engraissait à Paris d’une autre manière, et quand j’y revins je trouvai l’ouvrage que j’avais mis sur le métier plus avancé que je ne l’ai cru. » (Livre 7) 1596 (Cf. Hommes. Grossiers, Patriarcat. Pères)
Par ordre chronologique. Femmes. Enceintes. Honoré de Balzac :
Femmes (Enceintes) (3) : 1830. Honoré de Balzac [1799-1850], dans Petites misères de la vie conjugale, auteur de :
« Votre fille Caroline est excessivement orgueilleuse de la forme un peu bombée de sa taille. Toutes les femmes déploient une innocente coquetterie pour leur première grossesse. Semblables au soldat qui se pomponne pour sa première bataille, elles aiment à faire la pâle, la souffrante ; elles se lèvent d’une certaine manière et marchent avec la plus jolie affectation. Encore fleurs, elles ont un fruit ; elles anticipent sur la maternité. » 1597 (Cf. Enfants. « Fruits », Femmes. « Coquettes ». Mères)
Femmes (Enceintes) (4) : 1837-1843. Honoré de Balzac [1799-1850], dans les Illusions perdues, auteur de :
- Eve : « Hélas, je suis grosse. » 1598
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Enceintes. Léon Tolstoï :
Femmes (Enceintes) (5) : 1865-1869. Léon Tolstoï [1828-1910], dans La guerre et la paix, auteur de :
« Elle ne pouvait se coucher ni sur le côté ni sur la poitrine. Toute position lui était incommode et pénible. Son fardeau la gênait. Il la gênait d’autant plus que ce soir-là, la présence d’Anatole avait ravivé en elle le souvenir d’une époque où, point encore enceinte, elle ne connaissait que plaisirs et liesse. » 1599
Femmes (Enceintes) (6) : (juillet) 1890. Léon Tolstoï [1828-1910] écrit dans son Journal :
- (6 juillet) 1890. « [Sonia. 1844-1939] est tout le temps malade et elle a peur d’une grossesse. Moi aussi j’y pense avec crainte et j’ai honte de moi. »
- (11 juillet) 1890. « S[onia] est chagriné de la crainte d’une grossesse. »
- (15 juillet) 1890. « S[onia] est venue m’annoncer qu’elle n’est pas enceinte. J’ai dit qu’il faut dormir séparément et que je ne vais pas bien. »
- (20 juillet) 1890. « Parlé avec S[onia]. Elle dit qu’elle est contente. Mais elle ne veut pas [dormir] séparés. » 1600 (Cf. Famille. Couple)
* Ajout. 30 janvier 2023. Elle-même écrivait dans son Journal, le 5 juin 1870 :
« À chaque enfant, on renonce un peu plus à vivre pour soi et on se résigne à porter le souci des alarmes et des ans. » (Cf. Femmes. Mères)
-------------
Femmes (Enceintes) (7) : (octobre) 1876. Fiodor Dostoïevski [1821-1881], dans Journal d’un écrivain, auteur de :
« Nul n’ignore que la femme pendant la grossesse (et surtout une première grossesse) est très fréquemment exposée à certaines bizarres influences et impressions auxquelles son esprit se soumet d’une manière étrange, irrationnelle. Ces influences prennent parfois - quoique d’ailleurs, dans des cas rares - des formes extraordinaires, anormales, presque grotesques. […] » 1601
Par ordre chronologique. Femmes. Enceintes. Émile Zola :
Femmes (Enceintes) (8) : 1883. Émile Zola [1840-1902], dans Au bonheur des dames, auteur de :
« Celle-ci [Pauline] était enceinte, et elle tremblait, car deux vendeuses, en quinze jours, avaient dû partir au septième mois de leur grossesses. La direction ne tolérait pas ces accidents -là, la maternité était supprimée car encombrante et indécente ; à la rigueur, on permettait le mariage, maison défendait les enfants. Pauline, sans doute avait un mari dans la maison, mais elle se méfait pourtant […] ; et afin de retarder un renvoi probable, elle se serrait à étouffer, résolue de cacher ça tant qu’elle pourrait. Une de deux vendeuses congédiées venait justement d’accoucher d’un enfant mort pour s’être torturé ainsi la taille, on désespérait de la sauver elle-même. […] » 1602 (Cf. Corps. Ventre, Femmes. Avortements. Comment meurent les femmes ? Travail, Politique. Tortures, Économie. Licenciements)
Femmes (Enceintes) (9) : 1884. Émile Zola [1840-1902], dans La joie de vivre, auteur de :
« Sa grossesse, très pénible, l’avait en effet accoutumée à de continuelles nausées, à des maux d’entrailles, dont la violence parfois la tenait pliée en deux, pendant des journées entières. Ce matin, les nausées avaient disparu, mais elle était comme bouclée d’une ceinture qui lui avait meurtri le ventre. » 1603 (Cf. Corps. Ventre)
-------------
Femmes (Enceintes) (10) : 1956. Léo Malet [1909-1996], dans Corrida aux Champs Élysées, auteur de :
« J’appris ainsi, vaille que vaille, qu’elle avait brusquement disparu de la circulation. […]
Les bonnes langues de la corporation [du cinéma] insinuaient qu’enceinte des oeuvres de Lantier, elle s’était faite avorter (sic), car avoir un enfant de ce patapouf n’entrait pas dans la catégorie des exploits dont on se vantait, même dans un but publicitaire. » 1604
Femmes (Enceintes) (11) : 1995. Lu dans Jean Tulard, Guide des films. 1895-1995. L. Z, concernant :
- Une certaine rencontre. 1964. Robert Mulligan : « Un jeune jazzman rencontre une vendeuse de Manhattan. Elle est enceinte de ses œuvres (non jazzistiques) […] » 1605
- Trois masques (Les). 1929. André Hugon : « Paolo aime Viola. Elle se retrouve enceinte. […]. » (Cf. Culture. Cinéma)
Femmes (Enceintes) (12) : 2000. Fatéma Oufkir [1935-2016], dans Les jardins du roi, écrit :
« Passant des films aux bals, je m’étourdissais et j’étais heureuse. S’il n’y avait pas eu ces incessants contretemps qu’étaient ces grossesses, tout aurait été parfait. […]
J’ai donc eu un bébé très vite, et, huit mois après l’accouchement, j’étais enceinte à nouveau… et encore, et encore… À vingt-deux ans, j’avais déjà trois enfants et une grossesse interrompue accidentellement à cinq mois ! » 1606 (Cf. Femmes. Accouchements. Heureuses)
Femmes (Enceintes) (13) : (11 septembre) 2021. Pour Serge Hefez, psychanalyste, psychiatre, « responsable de l’unité thérapie familiale dans le service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’hôpital de la Pitié Salpetrière à Paris », auteur de Transition, Réinventer le genre [2021], une femme « porte un enfant ». 1607 (Cf. Corps, Langage. Genre. Verbe, Patriarcat)
Femmes (Enceintes) (14) : (7 novembre) 2024. [1ère diffusion. 6 octobre 1992] Entendu dans l’émission de France Culture, La Roquette, Saint-Lazare, Fleury Mérogis… Quartiers de femmes (sic) pénitentes (sic), une femme dire, à deux reprises :
« Je me suis mise enceinte. »
Une formulation bouleversante.
-------------
Femmes (Enfants) : « Je ne veux pas, je ne veux plus d’enfants ».
Traduction notamment onusienne, modern-style, mais souvent reprises par des féministes :
« Les femmes doivent être informées de [et /ou : faire-valoir et / ou : exercer et/ ou lutter pour…] leurs droits reproductifs et sexuels ». (Cf. Droit, Enfants, Langage, Sexes […])
Femmes (Enfants Et) : (11 avril) 2025. Lu sur Franceinfo : « Guerre à Gaza : 36 frappes israéliennes analysées par l'ONU ‘n'ont tué que des femmes et des enfants’. » (Cf. Politique. État. Israël. Guerre)
Par ordre chronologique. Femmes. Enfermées :
Femmes (Enfermées) (1) : (2 septembre) 1762. Denis Diderot [1713-1784], dans une lettre à Sophie Volland [1716-1784], écrit :
« C’est qu’en effet, ce sont des prisons que les maisons où une moitié de l’espèce humaine renferme l’autre. »
Si Denis Diderot fait ici références aux maisons qu’il décrit à Constantinople : « murs hauts et épais, voûtes surbaissées, petites portes, petites fenêtres, hautes et grillées », son constat qui est aussi jugement : « une maison ressemble à une prison », est valide en de bien autres lieux, en de bien autres temps. 1608 (Cf. Êtres humains. « Espèce », Femmes. Maison, Patriarcat. « Espèce », Politique. Prison)
Femmes (Enfermées) (2) : (20 mai) 1774. Voltaire [1694-1778], dans une lettre à Gabriel Cramer [1723-1793], auteur de :
« La première chose qu’a fait le roi [Louis XVI. 1754-1793] a été de faire enfermer - L’ordre date du 11 mai 1774 - Mme Du Barry [1743-1793] à l’abbaye du Pont-aux-dames ». 1609
Femmes (Enfermées) (3) : (11 août) 1846. Gustave Flaubert [1821-1880] écrit à Louise Colet [1810-1876] :
« Mais aujourd’hui, je les ai reçues toutes les deux (ses lettres) et la petite fleur avec. Merci de l’idée de la mitaine. Si tu pouvais t’envoyer toi-même ! Si je pouvais te cacher dans le tiroir de mon étagère qui est là à côté de moi, comme je t’enfermerais à clef ! » 1610
Femmes (Enfermées) (4) : 1846. Alexandre Dumas [1802-1870], dans Impressions de voyage de Paris à Cadix, après avoir évoquée les « jalousies aux bureaux croisés », les « balcons aux étroites ouvertures » des maisons de Grenade, écrit :
« En effet, par une espèce de conventions, toutes les filles et les pupilles appartiennent à leurs mères et à leur tuteurs ; mais le soir venu, elles rentrent en possession d’elles-mêmes ; il est vrai que cette liberté est bien limitée, puisqu’elle ne s’étend que jusqu’au balcon et jusqu’à la jalousie. […] » 1611 (Cf. Enfants. Filles, Femmes. Jeunes filles)
Femmes (Enfermées) (5) : 1854. George Sand [1804-1876], dans Histoire de ma vie, auteure de :
« […] (Après une longue diatribe) Quand je voulus lui répondre [à Michel de Bourges. 1797-1853] […], je m’aperçus qu’il m’avait enfermée. […] J’attribuais ma captivité à une distraction. […] Au bout de trois heures, il revint me délivrer, et comme je lui signalais sa distraction : ‘Non pas, me dit-il en riant, et, voyant que je ne t’avais pas encore convaincue, je t’ai mise au secret, afin de te donner le temps de la réflexion. J’avais peur d’un coup de tête et de ne plus te retrouver à Paris ce soir. » 1612 (Cf. Hommes. Autoritaires. Remarquables. Michel de Bourges)
Par ordre chronologique. Femmes. Enfermées. Émile Zola :
Femmes (Enfermées) (6) : 1871. Émile Zola [1840-1902], dans La fortune des Rougon, auteur de :
« La stupéfaction fut si grande, l’idée que Macquart avait pu trouver une maîtresse jeune et riche reversa à tel point les croyances des commères, qu’elles furent presque douces pour Adélaïde.
‘La pauvre ! elle est devenue complètement folle, disaient-elles ; si elle avait une famille, il y a longtemps qu’elle serait enfermée. » 1613 (Cf. Famille)
Femmes (Enfermées) (7) : 1880. Émile Zola [1840-1902], dans Nana, auteur de :
« […] Il savait que, mariée à dix-sept ans, elle devait en avoir trente-quatre, et qu’elle menait, depuis son mariage une existence cloîtrée, entre son mari et sa belle-mère. Dans le monde, les uns la disaient d’une froideur de dévote, les autres la plaignaient, en rappelant ses beaux rires, ses grands yeux de flamme, avant qu’on l’enfermât au fond de ce vieil hôtel. […]
Ce salon sépulcral, exhalant une odeur d’église, disait assez sous quelle main de fer, au fond de quelle existence rigide elle restait pliée. » 1614
-------------
Femmes (Enfermées) (8) : (23 mars) 1901. La police découvre Blanche Monnier [1849-1913], fille d’un ancien doyen de la faculté des lettres de Poitier et sœur d’un notable catholique [Madame Bastian et son fils], enfermée depuis 25 ans dans une chambre aux volets cadenassés, sur un lit, couverte d’immondices, sui nommait sa chambre : « ce cher grand fond Malampia ». Débute alors l’affaire dite de La séquestrée de Poitiers.
Lire, sous ce même nom, le texte d’André Gide paru en 1930, ainsi que les récents livres, films, documentaires qui permettent notamment de mieux comprendre le rôle du frère et de la mère. Qui furent tous les deux acquittés. Une lecture féministe de ce procès serait fort utile.
Je me souviens aussi d’articles parus dans La Fronde. (Cf. Justice. Procès, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
Femmes (Enfermées) (9) : 1995. Khalida Messaoudi, dans Une Algérienne debout, évoque sa mère, sous la colonisation en Kabylie, auteure de :
« À son époque, toutes les femmes étaient analphabètes. […] À Alger, ma mère a donc eu une chance relative puisqu’elle était au moins allée à l’‘école des indigènes’ jusqu’au CM1. Elle y a appris à lire, à écrire et à compter, mais surtout à faire de la couture et à repasser ! À la puberté, vers dix ans, ses parents l’ont retirée de là pour la préparer à devenir une parfaite épouse. C’était là le seul destin des filles : être mariées et avoir des enfants. […] À Aïn-Bessem, le village où nous habitions, ma mère ne sortait pas de la maison.
- Jamais ?
- Pas une fois, en plus de trente ans. Trente ans, sans voir la rue. Elle ne connaissait du ciel que le carré sur lequel ouvrait la cour intérieure de la maison. […] » 1615 (Cf. Famille, Politique. Colonialisme)
Femmes (Enfermées) (10) : 2000. Fatéma Oufkir [1935-2016], dans Les jardins du roi, écrit :
- « Mes rapports avec Mohammed V [1909-1961] étaient parfaits. Je le respectais et lui avait l’élégance de respecter les autres. […]
Il me parlait gentiment de ma beauté, de ma jeunesse : ‘Si tu étais ma femme, je ne te laisserais pas voir la lumière’, me disait-il ». Elle écrit aussi plus loin :
- « Du jour où je suis entrée en prison jusqu’au moment où j’en suis sortie, dix-neuf ans plus tard, je n’ai jamais mis les pieds dehors. Sauf dans les moments où ils nous ont changés de résidence en pleine nuit. » 1616 (Cf. Êtres humains. Enfermés, Famille. Polygamie. Monarchie marocaine)
Femmes (Enfermées) (11) : (29 décembre) 2024. Lu sur Franceinfo : « En Afghanistan, le chef suprême des talibans a ordonné d'obstruer et de ne plus construire de fenêtres qui donnent sur des espaces résidentiels occupés par des Afghanes, estimant que cela pouvait conduire à de l'’obscénité’. D'après un communiqué publié hier soir par le porte-parole du gouvernement taliban, il faudra désormais, en cas de construction d'un nouveau bâtiment, que celui-ci soit dépourvu de fenêtres par lesquelles il est possible de voir de près ‘la cour, la cuisine, le puits des voisins et les autres endroits habituellement utilisés par des femmes’. » Précédé de :
« Actuellement, les Afghanes ne peuvent plus étudier au-delà du primaire, aller dans les parcs, les salles de sports, les salons de beauté, ni quasiment sortir de chez elles sans chaperon. Une récente loi leur interdit de chanter ou de déclamer de la poésie, en vertu, comme les autres directives, d'une application ultra-rigoriste de la loi islamique. Elle les incite aussi à ‘voiler’ leur voix et leurs corps hors de chez elles.
Femmes « enfermées » ? Non. Femmes - la moitié de la population - emprisonnées, interdites de vie [propre], condamnées de leur naissance à leur mort pour produire des enfants, des garçons qui devront, à leur tour, condamner leurs mères, leurs sœurs à ne pas vivre.
La patriarcat ‘chimiquement pur’ : tous les hommes contre toutes les femmes.
-------------
Femmes (Enterrements) : 1878. Émile Zola [1840-1902], dans Une page d’amour, auteur de : « Elle [Hélène] voulait descendre. M. Rambaud la retenait, pendant que Mme Deberle lui expliquait que cela ne se faisait pas. Mais elle jurait d’être raisonnable, de ne pas suivre l’enterrement [de Jeanne, sa petite fille]. On pouvait bien lui permettre de voir ; elle se tiendrait tranquille dans le pavillon. […]
Elle [Hélène] entendit seulement, le bruit sourd de la pierre du caveau qui retombait. C’était fini.
Cependant Pauline l’avait aperçue et la montrait à Mme Deberle. Celle-ci se fâcha presque, murmurant :
- Comment ! elle est venue ! Mais ça ne se fait pas, c’est de très mauvais goût ! » 1617
Femmes. « Entremetteuses » :
Femmes (« Entremetteuses ») (1) : (19 février) 1869. Lu dans une note de La Pléiade de La Curée du Journal des Goncourt, [tome VIII. p.177] « ce portait d’une demi-mondaine et d'une entremetteuse de haut vol :
« La Leininger, une de ces petites filles à huit ressorts, à cinq chevaux à l’écurie, à maison montée, de ces filles entretenues à trois cent mille francs et qui ont toujours besoin de cinq louis ; une Alsacienne avec un grain de beauté sur un blanche poitrine décolletée en carré. Elle est suivie d’une Allemande à rougeurs, qui a été la maquerelle de Rothschild [?-?] : semble en avoir gardé le baragouinage des banquiers allemands de Balzac [1799-1850], elle avait la spécialité de lui donner des religieuses en imitation… ; profonde et voilée sous son bredouillement, attirante comme une boutique de secrets, de scandales, d’horreurs, une de ces revendeuses de viande d’amour que le Rhin nous envoie armées de toutes les ruses et de tous les dessous de Metternichs [1773-1859] en jupons. » 1618 (Cf. Corps. Viande, Femmes. « Entretenues ». Religieuses, Langage. Patriarcal, Politique. Nationalisme, Proxénétisme)
Femmes (« Entremetteuses ») (2) : 1871. Émile Zola [1840-1902], dans La curée, auteur de :
« […] Mais le gain le plus clair était encore les confidences qu’elle recevait partout et qui le mettait sur la piste des bons coups et des bonnes aubaines. Vivant chez les autres, dans les affaires des autres, elle était un véritable répertoire vivant d’offres et de demandes. Elle savait où il y avait une fille à marier tout de suite, une famille qui avait besoin de trois mille francs, un vieux monsieur qui prêterais bien les trois mille francs, mais sur des garanties solides, et à gros intérêts. Elle savait des choses plus délicates encore : les tristesses d’une dame blonde que son mari ne comprenait pas et qui aspirait à être comprise ; le secret désir d’une bonne mère rêvant de placer sa demoiselle avantageusement ; les goûts d’un baron porté sur les petits soupers et les filles très jeunes. Et elle colportait, avec un sourire pâle, ces demandes et ces offres ; elle faisait deux lieux pour aboucher les gens ; elle envoyait le baron chez la bonne mère, décidait le vieux monsieur à prêter trois mille francs à la famille gênée, trouvait des consolations pour la dame blonde et un époux peu scrupuleux pour la fille à marier. Elle avait aussi de grandes affaires […]. »
« Ce fut Madame Sidonie qui promit au baron de traiter avec certaines gens, assez maladroits pour ne pas être honorés de l’amitié qu’un sénateur avait daigne témoigner à leur enfant, une petite fille d’une dizaine d’années. » 1619 (Cf. Êtres humains. Vies. Vies-dites-privées, Relations entre êtres humains, Langage. Zeugma, Politique. Sénateur, Économie. Offre / Demande, Proxénétisme, Violences. Violences à l’encontre des enfants)
Femmes (« Entremetteuses ») (3) : 1923. Marcel Proust [1871-1922], dans La prisonnière, évoque « les entremetteuses dans les tableaux des vieux maîtres, où à côté d’elles s’effacent presque dans l’insignifiance la maîtresse et l’amant. » 1620
-------------
Femmes (« Entretenues ») : Dans des mondes où tout est si souvent mis en œuvre pour que les femmes ne puissent vivre par leurs propres moyens, comment peut-on oser qualifier des femmes - et les critiquer de ce fait - d’ « entretenues » ? (Cf. Hommes. « Entreteneurs », Femmes. « Dépendantes »)
Femmes (« Épisodes ») : (8 juin) 2020. Selon sa biographe Catherine Sauvat, Stefan Zweig [1881-1942] nommait les femmes avec lesquelles il avait des relations à Paris ses [des?] « épisodes ». 1621
Femmes. Esclaves :
Femmes (« Esclaves ») (1) : Beaucoup croient, pour mieux signifier les situations particulièrement odieuses imposées à des femmes, bien les dénommer en qualifiant les femmes d’ « esclaves ». Mais assimiler l’esclavage en patriarcat, c’est amalgamer deux systèmes de domination qui ont chacun leur historicité, leur spécificité ; c’est s’interdire de penser le patriarcat. (Cf. Êtres Humains. Esclaves, Patriarcat, Politique, Esclavage)
Par ordre chronologique. Femmes. Esclaves :
Femmes (« Esclaves ») (1) : 1944. Chanson : « Il avait le charme slave » chanté par Andrex [1907-1989]. Paroles de Françoise Giroud [1916-2003] :
Refrain : « Il avait le charme slave / Et elle est devenue l'esclave / L'esclave de ce charme slave / Sex appealof et vampovich »
- « Mais il la battait tous les soirs / Avec une paire d'embauchoirs, / Puis rempli de désespoir / Il saisissait son rasoir / Et sautait dans la baignoire / En criant : j'veux du caviar ! / Ce tendre amour dura trois mois / Jusqu'au jour où elle le trouva / Enroulé nu comme un ver / Autour d'une femme aux yeux verts / Elle brandit un revolver / En chantant : Otchi Tchornia. »
Refrain :
- « Il lui cria sans se retourner : / "Non mais des fois, t'es pas cinglée ? / Vas-tu t'arrêter de gueuler / Et me laisser travailler ! / Sinon je te file une grande baffe / T'es prévenue ? Alors fais gaffe / Y faudrait pas me prendre pour un cave / Parce que j'ai le charme slave. / Mon vrai nom, c'est Fleur de Nave / Mais tu peux m'appeler Gustave / Va m'attendre sur le palier / Tu viendras quand je te sonnerai /
Et elle est restée l'esclave / L'esclave de ce charme slave / L'esclave du sourire suave / Du beau Gustave dit Fleur de Nave. » (Cf. Culture, Êtres humains. Esclavage, Femmes. Esclavage, Fleurs, Hommes. Violents, Patriarcat. Domination masculine. Permanence, Politique. Esclavage)
N.B. Chanson transcrite dans un deuxième temps sous l’item « Esclave » après avoir classée sous l’item « Humour » : d’abord amusée de cette chanson, entrainante et drôle, puis découvrant la réalité de ses paroles. (Cf. Penser. Réfléchir)
Femmes (Esclaves) (2) : 1975. Simone de Beauvoir [1908-1986], auteure de :
« Il me semble que, dans les siècles futurs, on regardera avec autant d’étonnement la manière dont les femmes sont traitées aujourd’hui dans notre société que nous regardons l’esclavage dans la démocratie athénienne, par exemple. » 1622
Pertinent, insuffisant. (Cf. Politique. Esclavage, Histoire. « Longue »)
Femmes (Esclaves) (3) : 2017. Après avoir évoqué le livre : La mulâtresse solitude [1972] signé de son mari, André Schwarz-Bart [1928-2006], Simone Schwarz-Bart, auteure de :
« L’Histoire de Solitude [1772-1802], c’est l’histoire de cette petite fille qui a été abandonnée par sa mère. Pourquoi ? Parce que sa mère avait été violée sur le navire qui l’emportait en Guadeloupe comme c’était la coutume. La coutume en en ces temps-là, c’était l’appareillade. Donc, les marins s’emparaient des femmes, violaient les femmes, les esclaves, qui se trouvaient dans les cales pour augmenter leur prix et qu’elles soient enceintes et qu’elles portent déjà un fruit dans leurs entrailles, un fruit qui pourrait déjà servir déjà de future main d’œuvre à l’acheteur. » 1623
Ce constat bouleversant, qui à lui seul bouleverse nombre de théories concernant l’esclavage et le patriarcat, fut - sans transition - suivi par la phrase de Martin Quenehen : « Puisqu’on est dans les paysages… »
Comment ne pas être scandalisé-e de ce qu’un responsable, producteur, journaliste de tant d’émission à France Culture puisse dire cela, sans autre conséquence…
C’est grave, très grave… (Cf. Êtres humains. Esclavage, Femmes. Enceintes. Écrivaines. Hommes. Journalistes, Politique. Esclavage, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
-------------
Femmes (« Espèce ») : Cf. Êtres humains. « Espèce », Patriarcat. « Espèce »
Femmes (Espérance) : 1932. François Mauriac [1885-1970], dans Le nœud de vipères, évoquant sa fille Janine que son mari vient de quitter, auteur de :
« […] Elle oubliera… À moins qu’elle ne meure, pensais-je ; ou quelle vive misérablement, avec une douleur toujours égale et qui échappera au temps. Peut-être Janine appartient-elle à cette race qu’un vieil avocat connaît bien : ces femmes, chez qui l’espérance est une maladie, qui ne guérissent pas d’espérer et qui, après vingt ans, regardent encore la porte avec des yeux de bête fidèle. » 1624
Femmes (Espionnes) : (6 août) 2017. Entendu sur France Culture :
« On disait jadis, qu’avec les traitres, les femmes faisaient d’excellents espionnes parce qu’elles savaient tirer les confidences, et, comme disait Béria [1898-1953], le n° 1 du NKVD, les hommes sont si petits au lit. » 1625 (Cf. Hommes. Homme. Petit, Politique. Répression, Histoire. Historiographie. Patriarcale)
Femmes (Esprit de contradiction) : (18 août) 1827. Jean-François Champollion [1790-1832], écrit à Angelica Palli [1798-?], nommée Zelmira, dont il est sans espoir amoureux, et dont il aspirera, là aussi en vain, à être le Pygmalion : après avoir évoqué son « détestable caractère », il lui écrit : « on ne sait sur quel ton vous parler » et critique : « l’esprit de contradiction, ce mobile tout puissant du beau sexe. » 1626 (Cf. Hommes. Pygmalion. Mépris des femmes, Patriarcat. Domination masculine)
Femmes (Estime) : Ce que la société pardonne le moins aux femmes, c’est qu’elles s’estiment. C’est logique : elles échappent non seulement aux jugements les concernant, mais aussi, potentiellement, à ceux portés sur toutes les femmes : dès lors, aucune critique concernant « les femmes » n’a potentiellement plus de prise. Et chacun-e sait que ce qu’un dominant - quel qu’il soit - ne peut accepter, c’est que l’on n’ait plus peur ni de lui, ni de son pouvoir ; ou, plus justement - mais là, cela nous concerne tous et toutes - c’est d’être confronté à un « soi » délesté de son, de ses pouvoir-s. Les féministes ne peuvent s’exclure, concernant les jugements qu’elles se portent entre elles, de cette réflexion.
Femmes (Et…) : Signe manifeste d’une absence de et/ou d’une insuffisante pensée féministe. 1627
Femmes (État) : (juillet) 2015. Une femme, concernant le mari dont elle souhaitait se séparer, dit :
« Il ne voulait pas s’en aller (de leur appartement). Il fallait donc que je parte. »
Une autre voulait, en septembre 2015, demander 200 euros de dommages et intérêts concernant un homme poursuivi pour avoir photographié les femmes et les jeunes filles nues (dont sa fille) dans des douches d’un camping.
Un trop grand nombre de femmes ont si peu conscience que l’État et donc la justice puisse personnellement les concerner qu’il leur est difficile de penser que l’État donc la justice puissent contribuer à régler les questions auxquelles elles sont confrontées dans leur propre vie.
Et si on ne peut que le regretter, c’est compréhensible : c’est sans elles et contre elles que l’État depuis des siècles s’est construit, et que le concept de « vie privée » qui les a politiquement juridiquement, niées, continue ses ravages. (Cf. Femmes, Politique. État)
Femmes. Êtres humains :
Femmes (Êtres humains) (1) : 1975. Une femme, n’est ni un sexe, ni un corps, ni un visage, ni un foyer, ni une plante, ni …
Toute définition d’un seule d’entre ces expressions nie sa qualité première : celle d’être, comme chaque homme, un être humain pensant.
[Après avoir vu : « Qu’est-ce qu’être une femme ? Réponses de femmes : Notre corps, notre sexe », dans le « Ciné tract » d’Agnès Varda. 1975] (Cf. Culture. Cinéma, Êtres humains, Femmes, Patriarcat. Paternalisme)
Femmes (Êtres humains) (2) : Ils ne reconnaissaient aux femmes la qualité d’ « êtres humains», qu’après qu’ils les aient définies, chacun, selon leur acception, comme « femmes ».
Ce qui, par là même, les en excluaient. (Cf. Êtres humains)
Par ordre chronologique. Femmes. Êtres humains :
Femmes (Êtres humains) (1) : (16 décembre) 1772. Voltaire [1694-1778], dans une lettre adressée à Alexandre-Marie-François de Paule de Dompierre d’Hornoy [1742-1828], écrit :
« M. de Florian nous restera : il est enchanté de sa femme et de sa maison. Mais sa maison ne vaut pas sa femme. » 1628 (Cf. Êtres humains, Femmes. Maison, Langage. Zeugma)
Femmes (Êtres humains) (2) : (5 novembre) 1906. Le chroniqueur du Journal écrivit le lendemain de la première conférence inaugurale à la Sorbonne, présentée par une femme, Marie Curie [1867-1934] :
« Si la femme est admise à donner l’enseignement supérieur aux étudiants de deux sexes, où sera désormais la prétendue supériorité de l’homme mâle ? En vérité je vous le dis : le temps est proche où les femmes deviendront des êtres humains. » 1629
À lire non pas seulement comme une aberration (jugée anachronique), mais comme une vérité (au moins partielle) afin d’enrichir la réflexion du fait des questions que cette phrase pose. (Cf. Êtres humains, Femmes, Patriarcat, « Sciences » humaines, Sexes […])
Femmes (Êtres humains) (3) : 1984. Lu dans La femme au temps de Goethe de Marie-Claire Hook-Demarle, :
« Peu à peu, entre Goethe [1749-1832] et les femmes de son temps s’est créé une osmose où les femmes réelles puisent des modèles dans une œuvre qu’elles ont souvent inspirée.
Elles se retrouvent à travers des héroïnes telles qu’elles voulaient être et non telles qu’elles furent.
Elles s’intéressaient à ses personnages féminins comme s’il y allait d’êtres humains. […] » 1630 (Cf. Êtres humains, Femmes. « Féminin ». « Héroïnes », Patriarcat. Filliation)
Femmes (Êtres humains) (4) : 1997. Françoise Barret-Ducrocq & Évelyne Pisier, dans leur livre, Femmes en tête, concernant Nicole Le Douarin, chercheuse en biologie du développement et en embryologie, écrivent :
« Sa conviction profonde acquise dès l’enfance a toujours été qu’une femme est un être humain comme un autre, indépendant, qui ne doit jamais se trouver devant l’obligation de demander de l’argent à son mari. » 1631
Un « être humain » se suffit à lui, à elle-même ; le « comme un autre » est de trop… (Cf. Êtres humains, Femmes, Patriarcat, « Sciences » humaines)
-------------
Femmes (Excréments) : 1974. Dans le film de Luis Bunel [1900-1983], Cet obscur objet du désir, repris du livre de Pierre Louÿs [1870-1925], La femme et le pantin [1898], le majordome de Mathieu Faber [André Stévenol dans le roman] « énonce cet axiome :
‘Les femmes […] ce sont des sacs d’excréments’. » 1632 (Cf. Culture. Cinéma)
Femmes (Expériences) : Les femmes ont [vécu] d’innombrables expériences dans tous les domaines : un monde de connaissances non reconnues, pas même connues, si peu échangées, encore moins partagées. (Cf. Féminisme, Patriarcat)
Femmes (« Faces cachées des hommes ») : Les femmes, la face cachée des hommes ? D’où la nécessité de les contraindre au silence, pour les y maintenir… (Cf. Femmes. Silence)
Par ordre chronologique. Femmes « Faciles » :
Femmes (« Faciles ») (1) : 1782. Dans Les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos [1741-1803], la marquise de Merteuil juge sévèrement la jeune Sophie de Volanges :
« Je me désintéresse entièrement de son compte. J’avais eu quelque envie d’en faire au moins une intrigante subalterne, et de la prendre pour jouer les seconds sous moi : mais je vois qu’il n’y a pas d’étoffe. Elle a une sotte ingénuité […] et c’est selon moi la maladie la plus dangereuse qu’une femme puisse avoir. Elle dénote surtout une faiblesse de caractère […] de sorte que, tandis que nous [Valmont et elle-même] nous occuperions de former cette petite fille pour l’intrigue, nous n’en ferions qu’une femme facile.
Or, je ne connais rien de si plat que cette facilité de bêtise, qui se rend sans savoir ni comment ni pourquoi, uniquement parce qu’on l’attaque et qu’elle ne sait pas résister. Ces sortes de femmes ne sont absolument que des machines à plaisir. » 1633 (Cf. Femmes. « Machines »)
Femmes (« Faciles ») (2) : (28 août) 2019. Lu sur Huffpost concernant le titre du film « Une fille facile » :
« [Il] semble avoir été choisi dans le but de provoquer plus que porter un jugement sur un certain type de femmes. Car en reprenant cette expression, Rebecca Zlotowski la déleste de toute la négativité qu’il a fini par contenir, au fil des siècles. Son conte moderne fait le récit d’une jeune femme qui profite de la richesse d’un homme en lui offrant ses faveurs sexuelles. Donner ce rôle à Zahia Dehar lui ajoute une dimension nouvelle, celle de la liberté. Car “aimer ça” et se donner avec complaisance n’est pas sale, c’est être libre. »
Et le tour de passe-passe, si intellectuellement malhonnête, est ainsi joué…
-------------
Femmes. « Faibles » :
Femmes (« Faibles ») (1) : Qualifier les femmes de « faibles » [pauvres, précaires, etc..] c’est, sous couvert de constat, l’entériner et permettre de faire en sorte qu’elles le deviennent un peu plus.
Aucune politique effective ne peut être fondée sur de pseudo constats qui ne sont que des conséquences de politiques mises en œuvre, légitimées par des siècles de rapports de domination.
Par ordre chronologique. Femmes. « Faibles » :
Femmes (« Faibles ») (1) : 1736. Crébillon fils [Claude-Prosper. 1707-1777], dans Les égarements du cœur et de l’esprit, auteur de :
« […] Aussi sensible, mais plus prudente, elle avait compris enfin que les femmes se perdent moins par leurs faiblesses que par le peu de ménagements qu’elles ont pour elles-mêmes […]. » 1634 (Cf. Patriarcat)
Femmes (« Faibles ») (2) : Marivaux [1688-1763], auteur de :
« Mais que les hommes aient l’audace de nous mépriser comme faibles, pendant qu’ils prennent pour eux toute la commodité des vices, et qu’ils nous laissent toute la difficulté des vertus, en vérité, cela n’est-il pas absurde ? » 1635
Par ordre chronologique. Femmes. Faibles. Jules Michelet :
Femmes (« Faibles ») (3) : (26 mai) 1849. Jules Michelet [1798-874], dans son Journal, concernant sa jeune épouse, auteur de :
« […] J’eus l’extrême bonheur de voir une métamorphose étrange et soudaine. Son cœur a failli, sa tête a penché. Elle s’est retrouvée femme et faible : mon diamant est redevenu ce qu’il devait être : une fleur. Grâce en soit rendue à Dieu. […]
Je crois profondément, tout intérêt à part, que son harmonie est en moi. »
Femmes (« Faibles ») (4) : (22 juillet) 1856, Michelet, [1798-874], toujours dans son Journal, reprend ce thème de « la femme », en l’occurrence, son épouse, qu’il enferme dans sa faiblesse, y inclue toutes les femmes et transforme en loi patriarcale ce qu’il avait vécu à son seul ‘profit’. Il écrit, enfermant le seul fœtus de sexe féminin dès trois mois, dans le sein de leurs mères, dans une terrifiante « mollesse » et ce afin qu’elle « aime », qu’elle « souhaite » à vie la domination masculine :
« Cette femme, déterminée comme telle à trois mois dans le sein de la mère, le sexe la forme, la sculpte dès lors, la fait, molle, autant qu’il faut pour qu’elle aime et souhaite le fort, pour qu’elle en reçoive l’empreinte. […] » 1636
Terrifiante et si claire justification de la domination masculine et du bien-fondé patriarcal auquel Michelet contribue ici. (Cf. Patriarcat, Sexes. Femmes)
-------------
Femmes (« Faibles ») (5) : 1854. Charles Dickens [1812-1870], dans Les temps difficiles, auteur de :
« Mrs Gradgrind, un mince et blanc petit paquet de châles aux yeux roses, d’une faiblesse mentale et corporelle sas égale, qui ne cessait de prendre des drogues, sans en ressentir aucun effet, et qui, chaque fois qu’elle montrait quelque symptôme de devoir s’animer, était invraisemblablement assommée par quelque fait pesant qui dégringolait sur elle. […]. » 1637
Femmes (« Faibles ») (6) : (20 mars) 1863. Mademoiselle Leroyer de Chantepie [1800-1888] écrit Gustave Flaubert [1821-1880] :
« J’ai vu Faust [de Gounod] qui m’a impressionnée. Marguerite soumise à un pouvoir infernal, n’est-ce pas l’histoire de toutes les femmes ? Tous les êtres faibles n’agissent que sous l’influence de volontés étrangères. La liberté morale existe, mais jamais absolue, surtout lorsqu’elle rencontre une vérité plus forte. » 1638 (Cf. Politique. Pouvoir, Histoire. Patriarcale)
Femmes (« Faibles ») (7) : 1912. Léon Tolstoï [1868-1910], dans Hadji Mourat, auteur de :
« La princesse était une femme faible, sotte et imprudente comme toutes les femmes quand elles n’en font qu’à leur tête. » 1639
-------------
Femmes (Fausses-couches) : 1871. Émile Zola [1840-1902], dans La curée, auteur de :
« Renée était alors enceinte de quatre mois ; son mari allait l’envoyer à la campagne, comptant mentir ensuite sur l’âge de l’enfant, lorsque […] elle fit une fausse-couche. Elle s’était tellement serrée pour dissimuler sa grossesse, qui d’ailleurs disparaissait sous l’ampleur des jupes, qu’elle fut obligée de garder le lit pendant quelques semaines. Il [Saccard] fut ravi de l’aventure : la fortune lui était enfin fidèle : il avait fait un marché d’or, une dot superbe, une femme belle à le faire décorer en six mois, et pas la moindre charge. On lui avait acheté deux cents mille francs son nom pour un foetus que le même ne voulut même pas voir [!] » 1640 (Cf. Corps, Enfants, Femmes. Beauté. Enceintes, Famille. Dot. Couple. Mariage, Économie)
Femmes (« Favorites » des rois) : 1789. Antoine de Rivarol [1753-1801], dans son Journal politique national, auteur de :
« On sait qu’il est de bonnes mœurs, en France, que les reines soient consolées des infidélités de leurs époux par la malveillance publique contre les favorites. » 1641
Et c’est aussi, avec ces pseudo constats, ainsi que l’on oppose les femmes entre elles, que l'on déresponsabilise les hommes et que l’on nie le patriarcat. (Cf. Femmes. Reines, Patriarcat. Rivarol, Politique. Lois. Mœurs, Histoire. Rivarol)
Par ordre chronologique. Femmes. « Femelles » :
Femmes (« Femelles ») (1) : (fin octobre) 1835. Honoré de Balzac [1799-1850] écrit à Ewelina Hanska [1801-1882], concernant Le Lys dans la vallée :
« Si Le lys n’est pas un bréviaire femelle, je ne suis rien. La vertu y est sublime et point ennuyeuse. » 1642
Femmes. « Femelles ». Victor Hugo :
Femmes (« Femelles ») (2) : 1869. Victor Hugo [1802-1885], dans L’homme qui rit, auteur de :
« Il venait de voir plus et moins qu’une femme, une femelle. » 1643
Femmes (« Femelles ») (3) : 1874. Victor Hugo [1802-1885], dans Quatre-vingt-treize, auteur de :
« […] Ce qui fait qu’une mère est sublime, c’est que c’est une espèce de bête. L’instinct maternel est divinement animal. La mère n’est plus une femme, elle est femelle. Les enfants sont des petits. » (Cf. Femmes. Animalisation des femmes)
-------------
Femmes (« Femelles ») (4) : 1891. Émile Zola [1840-1902], dans L’Argent, auteur de :
« […] Et il eut vers la baronne un geste si violente qu’elle prit peur […] Alors, ayant compris que cette nudité coupable, ainsi étalée, l’exaspérait davantage, elle recula jusqu’à la chaise, s’y assit en serrant les jambes, en remontant les genoux, de façon à cacher toute ce qu’elle pouvait. Puis, elle demeura là, sans un geste, sans un mot, la tête un peu basse, les yeux obliques et sournois sur la bataille, en femelle que les mâles se disputent et qui attend, pour être au vainqueur. » 1644
Femmes (« Femelles ») (5) : (23 février) 1908. Léon Tolstoï [1828-1910] écrit dans son Journal :
« À Annotchka [sa petite fille, âgée de 20 ans] : Comprends que tu n’es pas une femelle, mais un être humain. Et surtout, souviens-toi que ton affaire est - le perfectionnement de ton âme et non le mariage. Et par la suite si le mariage a été un échec, ou que tu t’es trompée, as fait un faux pas (sic), non seulement ne désespère pas, mais sache que dans cette réparation de ta faute (sic) est ta vie, ta félicité. Même si tu deviens une femelle, deviens humaine - je ne dirais pas plus élevé, plus humaine que l’animal. » (Cf. Êtres humains, Femmes. Animalisation des femmes, Famille. Mariage) 1645
Femmes (« Femelles ») (6) : 1993. Lu dans Édith Cresson. La femme piégée d’Élisabeth Schemla concernant les (multiples) raisons pour nommer Édith Cresson, premier ministre :
« Les conseillers en communication de Mitterrand [1916-1996] lui répètent que les valeurs d’aujourd’hui sont femelles. » 1646
À ne pas oublier lorsque quiconque évoque « les valeurs » de la République… (Cf. Femmes. « Politiques ». Cresson Édith, Politique. Communication)
* Ajout. 22 février 2018. « Mâle » n’est pas le contraire de « femelle ». (Cf. Langage)
Femmes (« Femelles ») (7) : 2011. Lu dans le Dictionnaire amoureux des Dictionnaires, d’Alain Rey [1928-2020] :
« Que dit Napoléon Landais [1804-1852] des femmes. Voici : « Femme, la femelle de l’homme, sa compagne. Plus, particulièrement et par opposition à fille, celle qui est ou a été mariée’ […] Et à femelle, ‘l’animal qui porte les petits. Ce mot ne se dit des femmes que par opposition à mâles.’ » Toujours plus de confusions.
N.B. Napoléon Landais, auteur de : « Une femme du peuple » - 1834 - et de : « La fille d’un ouvrier - 1836 -, aux titres « attirants » (mais peu lu). 1647
-------------
Femmes. « Féminin » :
Femmes (« Féminin ») (1) : Le « féminin » - et le « masculin » - sont des constructions patriarcales. Un débat construit sur les fondements de ces deux termes reproduit nécessairement les mythes liant le féminin au foyer, à la fécondité, à la nature…et le masculin, à la force, le pouvoir, la virilité…
Le seul emploi de l’un d’entre ces deux adjectifs est d’emblée signifiant ; dès lors, tout débat engagé qui entérine leur emploi, entérine aussi leurs présupposés.
* Ajout. 27 octobre 2018. 1995. Pour illustration, Cf. Jean Tulard, Guide des films. 1895-1995. L-Z, concernant Miss O’Gynie et les hommes fleurs [1973. Samy Pavel] :
« Elle joue tour à tour, la séduction, la détresse, la soumission ; elle incarne les éternels mythes féminins. » 1648 (Cf. Culture. Cinéma)
* Ajout. 31 octobre 2018. (31 octobre) 2018. Pour une position contraire, Ségolène Royal :
« La femme doit exister dans sa féminité comme l’homme existe dans sa masculinité. L’humanité est faite du masculin et du féminin et c’est cet équilibre là qu’il faut retrouver. » 1649
Femmes (« Féminin ») (2) : Pour disqualifier ce terme à tout jamais, Cf. :
- Sigmund Freud [1856-1939] à Lou Andreas Salomé [1861-1937] : « Pour la première fois, j’ai été frappé de ce qu’il y a d’exquisément féminin dans votre travail intellectuel. » 1650
- René Barjavel [1911-1985] : « La femme n’est pas un être humain, c’est un être féminin. » 1651
- Michel Houellebecq : « Je suis de plus en plus féminin. » 1652
- Jean Tulard, concernant le film : Une sale histoire [1977. Jean Eustache] évoque « les toilettes féminines [d’un café parisien]. » 1653 (Cf. Culture. Cinéma)
- Jean Tulard, concernant le film Thelma et Louise [1991. Ridley Scott], le présente comme un « ’road movie’ féminin ». 1654 (Cf. Culture. Cinéma)
- Arielle Dombasle, qualifie le Crazy Horse saloon - dont elle a été le vedette - de « monde idéal féminin » 1655
* Ajout. 27 octobre 2018. 1996. Un (gros) bémol ! : écouter les Rimes féminines de Juliette.
Femmes (« Féminin ») (3) : Quelle différence y a-t-il entre « une voix féminine » et une voix de femme ? Dans le second cas, la femme évoquée est singulière. (Poursuivre)
Par ordre chronologique. Femmes. « Féminin » :
Femmes (« Féminin ») (1) : (17 juin) 1876. Gustave Flaubert [1821-1880], dans une lettre à Marie-Sophie Leroyer de Chantepie [1800-1888], après l’enterrement de George Sand [1804-1876], auteur, la concernant, de :
« Il fallait la connaître comme je l’ai connue, pour savoir tout ce qu’il y avait de féminin dans ce grand homme. […] » (Cf. Femmes. Femmes / Hommes. Flaubert Gustave, Hommes. « Grands », Patriarcat. « Féminité »)
- Le 25 novembre 1876, il écrira à Maurice Sand [1823-1889] : « Pauvre chère grande femme ! » 1656
Femmes (« Féminin ») (2) : (23-24 août) 2015. Entendu, lu, deux jours de suite :
« Les menstrues, quelque chose de très féminin » ;
« La peur des souris, c’est féminin » ;
« Le tout féminin qu’on appelle la pudeur... »,
Mais aussi : « Son travail est féminin, agressif ; c’est un poison. » 1657
Le « féminin », après avoir relevé, nous a-t-on assuré, de la nature, de la culture, de la norme, relève, en réalité, de l’injonction, de l’arbitraire. Comme « le masculin » … (Cf. Corps. Pudeur, Femmes. Pudeur, Patriarcat. « Féminité »)
Femmes (« Féminin ») (3) : (21 septembre) 2016. À la Fête de L’Humanité, Christiane Taubira, lors d’une exposition d’une exposition des bijoux créés par Elsa Triolet [1896-1970], la qualifia comme étant l’ « un des grands esprits féminins qui ont marqué nos arts […]. »
Pour ses bijoux ? Il eut été, semble-t-il, bien de défaire le lien, de lever les ambiguïtés - si tant est que l’on puisse, au vu de l’intitulé de l’article de L’Humanité [« Les parures d’Elsa »] employer ce terme - entre les « bijoux d’Elsa » et Elsa Triolet. … 1658 (Cf. Culture, Relations entre êtres humains. Flagornerie, Femmes. Épouse de, Patriarcat. « Féminité », Politique. Médias)
Femmes (« Féminin ») (4) : (28 septembre) 2016. Lu ce matin, rue de Bièvre, apposés sur une vitrine, une affiche sur laquelle on pouvait lire : « Cherche modèles féminins ».
Pour ne pas avoir à écrire : « Cherche femmes… modèles » : ? (Cf. Patriarcat. « Féminité »)
Femme (« Féminin ») (5) : (août) 2018. Ière page du magazine Marie-Claire :
« Quand se sent-on féminine ? [Ce qu’éprouvent les femmes. Pourquoi tout a changé] » : Comment prolonger la survie du qualificatif qui, sur le dos des femmes, a fait la fortune des patrons de la presse dite « féminine », souvent liés aux pires patrons, aux marchands de canons, souvent les mêmes. (Cf. Femmes. « Salopes », Politique. Guerre)
Femmes (« Féminin ») (6) : 2020. Arundhati Roy, dans Mon coeur séditieux, en 1994, auteure de :
« Quand une femme devient le féminin, elle cesse d’être réelle. » 1659
Femmes (« Féminin ») (7) : (23 février) 2022. Lu dans Le Canard enchaîné un passage de l’entretien d’Éric Zemmour dans Elle :
« Interrogé sur ce qu’il a de féminin en lui, Zemmour est intarissable : ‘Ce qu’il y a de féminin en moi ? Beaucoup de choses : la sensibilité, une certaine fragilité, une émotivité que je ne domine pas toujours mais que j’essaie de ne pas montrer.’ »
Commentaire du Canard : « Il oublie l’amour des animaux, l’importance des hormones, les crises de larmes sans raison, l’inaptitude aux maths et une irrésistible attirance pour le repassage. » 1660
Femmes (« Féminin ») (8) : (17 mars) 2022. Emmanuel Macron, dans la présentation de son programme présidentiel, auteur de : « la santé féminine ».
Femmes (« Féminin ») (9) : (7 août) 2024. Lu dans la chronique Cinéma du Canard enchaîné (p.6) évoquer « une profonde mélancolie féminine » concernant le film « Les deux anglaises et le continent » [François Truffaut. 1971] lequel relate « l’histoire l’amour croisée entre deux soeurs galloises et un jeune français. » (Cf. Culture. Cinéma)
Femmes (« Féminin ») (10) : (6 novembre) 2026. Après avoir, dans l’émission de France Culture, Avec philosophie, entendu que le terme de « féminin » serait « polymorphe », évoquer « ce besoin de féminin […] »
-------------
Femmes (« Féminisation ») : (septembre) 2014. Élections au sénat : La Chaîne TV. Sénat se félicite de la « féminisation » du sénat, qualifiée cependant par certain-es, plus scrupuleux-ses, de « légère ».
Le résultat : 25 % de femmes. (Cf. Langage. Féminisation du langage, Politique. Parité)
Femmes (Femmelettes) : 1777. Lettre de Mirabeau [1749-1791] (en prison) à Sophie de Monnier [1754-1789] :
« J’ai si peu de préjugés ordinaires, je pense si peu comme tout le monde, qu’une femmelette, pétrie de petitesse et tyrannisées par les convenances, ne m’eût jamais convenue. Je t’ai trouvée forte, énergique, résolue, décidée. » 1661 (Cf. Femmes. « Convenances ». Fortes)
Femmes (« Figures féminines ») : (10 septembre) 2019. Olivia Gesbert, sur France Culture, interrogent les femmes de la vie d’Edgar Morin, emploie l’expression de « figures féminines ». 1662 (Cf. Femmes. « Féminin »)
Femmes (« Fil à la patte ») : (19 mars) 2022. Alain Finkielkraut dans Répliques de France Culture, dans une émission intitulée L’humanisme d’Isaac Bashevis Singer [1902-1991] évoquant la ‘découverte’ que son épouse était vivante, alors qu’il était remarié et avait en sus une maîtresse, auteur de :
« Il a ce troisième fil à la patte ».
Dans la présentation écrite de l’émission, je lis qu’il était « entre deux femmes, toujours en train de voler de l’une à l’autre, ce qui fait d’ailleurs la matrice de ses récits ». 1663
Femmes. « Filles » :
Femmes (« Filles ») (1) : L’ambition d’une « fille » : être une « femme » ? une femme-comme-il-faut ? une bourgeoise ? une dame ? libérée des hommes ? une féministe ? …
Par ordre chronologique. Femmes. « Filles » :
Femmes (« Filles ») (1) : 1869. Victor Hugo [1802-1885], dans L’homme qui rit, auteur de :
« Était-ce une fille ? Était-ce une vierge ? Les deux. » 1664 (Cf. Femmes. Vierges)
Femmes (« Filles ») (2) : 1961. Charles Aznavour [1924-2018], dans Je m’voyais déjà, auteur de :
« des trains de nuit et des filles à soldats ».
Femmes (« Filles ») (3) : 2021. Je lis dans une note de La Curée [1871] d’Émile Zola [1840-1902] de l’édition du Livre de poche. Classiques :
« Fille » : « Femme aux mœurs libres, faisant commerce de son corps. » 1665 (Cf. Proxénétisme. Femmes-dites-prostituées)
-------------
Femmes (« Filles de la charité ») : 1633. Voici comment [saint] Vincent de Paul [1581-1660] présenta la vie des femmes de la Compagnie des filles de la charité [religieuses sans uniforme, sans vœux solennels], ordre qu’il créa le 29 novembre 1633 :
« Elles auront pour monastère - les maisons des malades et celle où reste la supérieure. Pour cellule - une chambre de louage. Pour chapelle - l’église paroissiale. Pour cloître - les rues de la ville. Pour clôture - l’obéissance. Pour grille - la crainte de dieu. Pour profession - la confiance continuelle dans la Providence, l'offrande ce tout ce qu’elles sont. » 1666 (Cf. Êtres humains. Soi, Femmes. Charité. Religieuses, Patriarcat, Politique. Obéir. Religion)
Femmes (« Filles-mères ») : 2001. Françoise D’Eaubonne [1920-2005], dans Mémoires irréductibles, auteure de :
« […] La guerre n’en finit pas de ‘bientôt cesser’ et je suis enceinte. Bien que mariée pour la forme, et aussitôt séparée de Jacques, je suis traitée en fille-mère. […] On pense trouver en moi une aide-ménagère d’autant plus docile qu’humiliée. Il n’en sera rien. » 1667 (Cf. Femmes. Enceintes. Mères, Famille. Mariage)
Femmes (« Flacons ») : 1831. Alfred de Musset [1810-1857], dans La coupe aux lèvres, auteur de :
« Aimer est le grand point / Qu’importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse. »
N.B. « Flacon » : « Petit récipient de verre, fermé par un bouchon ; la forme, l’apparence (par opposition au contenu) ». Cette deuxième signification n’existe pas dans Le Littré. (Cf. Femmes. Apparence)
Par ordre chronologique. Femmes. Fleurs :
Femmes (Fleurs) (1) : 1865-1869. Léon Tolstoï [1828-1910], dans La guerre et la paix, auteur de :
« (concernant Sonia) On lui ôtera tout, on lui a déjà tout ôté. Elle me fait affreusement pitié ; j’ai toujours voulu de tout mon cœur autrefois que Nicolas [Rostov] se mariât avec elle, et pourtant, j’ai toujours eu comme un pressentiment que cela ne se ferait pas. Elle est la ‘fleur stérile’, tu sais, comme il y en a sur les fraisiers. […] On eut dit que Sonia [Rostova], au lieu d’en souffrir, s’était faite à sa destinée de ‘fleur stérile’. » 1668 (Cf. Relations entre êtres humains. Pitié)
Femmes (Fleurs) (2) : 1877. Léon Tolstoï [1828-1910], dans Anna Karénine, auteur de :
- (concernant mademoiselle Varinka) : « Elle faisait penser à une belle fleur qui, tout en conservant ses pétales, serait déjà flétrie et sans parfum. »
- (concernant Anna Karénine) : « Elle n’était plus aux yeux de Wronski qu’une fleur fanée dans laquelle il ne retrouvait plus ces marques de beauté qui l’avaient incité à la cueillir. »
- (Concernant Kitty, dans la bouche d’Anna Karénine) : « Je ne l’ai vue qu’une seule fois, mais elle m’a laissée une impression charmante : c’est une fleur, une fleur exquise. Et j’apprends qu’elle sera bientôt mère ? » 1669
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. « Folie » :
Femmes (« Folie ») (1) : 1883. Lire la remarquable analyse d’Ernest Renan [1823-1892] d’un processus menant ici, pour une femme, à ce qui fut et est encore si souvent dénommé « folie » concernant la fille du Broyeur de lin. 1670 (Cf. Femmes. Folie)
Femmes (« Folie ») (2) : Il n’était pas même nécessaire d’être jugée « folle » pour être enfermée dans un asile [psychiatrique] : il suffisait d’être dérangeante.
Femmes (« Folie ») (3) : Lire Phyllis Chesler, Les Femmes et la folie. Payot. 262p. 1979.
Par ordre chronologique. Femmes. « Folie ». Louis Guilloux :
Femmes (« Folie ») (1) : (24 novembre) 1936. Louis Guilloux [1899-1980] écrit dans ses Carnets :
« Le secrétaire général à la préfecture [de Paris] me dit que, depuis deux ans, les bruits de guerre ont eu pour conséquence que les aliénés sont devenus deux fois plus importants qu’avant. Notes prises en l’écoutant : Aliénées de la Seine, Société Abri-Foyer. Probablement succursale [?] des Aciéries de Longwy. Asile prévu pour 400 femmes. Il y en a 750. Une salle commune où les non-agitées se retrouvent, dans la journée, entassées comme du bétail à raison d’une personne par mètre carré. Personnel religieux. 30 religieuses. 25 espagnoles dont 15 ne savent pas le français. […] » (Cf. Femmes. Aliénées. Animalisation des femmes. Religieuses, Politique. Guerre)
Femmes (« Folie ») (2) : (12 avril) 1944. Louis Guilloux [1899-1980] écrit dans ses Carnets :
« Dans la cour de la gare à quatre heures de l’après-midi, prodigieux spectacle des cinq grands cars remplis de folles qu’on transbordait de Plouguernevel à Rennes. La sorcière, la dansante, la prostrée, toutes minables, pauvres, physiques misérables, etc… vrai tableau de Goya. Et cependant, je ne sais comment ce tableau ne m’inspirait ni grande pitié ni grande frayeur. Un soldat allemand de la feldgendarmerie, qui regardait cela à côté de moi, s’est mis à me dire dans un certain français que chez lui les fous on les piquaient. Et il faisait le geste d’actionner une seringue. » 1671 (Cf. Femmes. Comment meurent les femmes ? Relations entre êtres humains. Pitié, Économie. « Pauvres Les »)
-------------
Femmes (« Fonctions ») : (27 mars) 1932. Paul Claudel [1868-1955], dans son Carnet VI, auteur de :
« Cette sécurité, cette plénitude, cette certitude, cette espèce d’incroyable majesté avec laquelle les femmes accomplissent les fonctions q[ui] leur appartiennent (sic), l’amour et la maternité. » 1672
N.B. Relire l’Abécédaire pour comprendre les fonctions que j’ai conféré à ce terme, celles censées concerner les femmes et corriger.
Femmes (Fond de décor) : Les femmes, trop souvent un fond de décor.
Par ordre chronologique. Femmes. Formation :
Femmes (Formation) (1) : (septembre) 1968. Françoise Giroud [1916-2003], dans Une poignée d’eau, écrit :
« En 1960, sur les 256.000 filles qui suivaient un enseignement professionnel, 87 % apprenaient un métier de la couture. » 1673 (Cf. Femmes. Travail, Patriarcat. Division sexuelle du travail)
Femmes (Formation) (2) : 1971. Lu dans le Journal d’une assistante sociale :
« Elle était sortie avec un C.A.P [Certificat d’aptitude professionnelle : premier diplôme d’enseignement dit technique] de couturière. Malheureusement dans la région, il n’y a pas de ces usines qui récupèrent les couturières aux doigts agiles pour les mettre au montage avec un salaire d’O.S [ouvrièr-es spécialisé-es : traduire : non-qualifié-es] puisqu’elles n’ont pas le bon C.A.P de montage ou de bobinage qu’il leur faudrait pour mériter un meilleur salaire, le C.A.P qu’elles n’obtiendront jamais, puisqu’il n’existe pas, comme un fait exprès. Et du travail de couture, il n’y en a pas. » 1674 Cette politique au cœur de la division sexuelle du travail fut délibérée et se perpétue, sous divers avatars… (Cf. Femmes. Travail, Patriarcat. Division sexuelle du travail)
-------------
Femmes (« [un] Formidable moteur scénaristique et un accélérateur émotionnel ») : (16 mars) 2017. Concernant la présentation d’un film d’Arte, intitulé Pedro Almodóvar, Tout sur ses femmes, je lis :
« En près de quarante ans de carrière, Pedro Almodóvar a toujours offert à ses actrices des rôles très forts. Dans ce documentaire, Carmen Maura, Victoria Abril, Rossy de Palma, Bibiana Fernández, Emma Suárez et Adriana Ugarte brossent avec délicatesse un portrait tout en féminité du cinéaste espagnol. […]
Incarnant la femme par excellence, à l’instar d’une Ava Gardner ou d’une Rita Hayworth, Penélope Cruz, l’interprète principale de ce film, est celle pour laquelle il avoue avoir éprouvé la plus grande passion. Mais, chez Almodóvar, les femmes sont aussi imparfaites, travesties ou transsexuelles. Leur dénominateur commun : constituer un formidable moteur scénaristique et un accélérateur émotionnel. » 1675 (Cf. Culture. Cinéma, Patriarcat. « Féminité »)
Femmes. Fortes :
Femmes (Fortes) (1) : Il ne cessait de tenter de se faire reconnaître par elle - qui n’en avait cure - et avait, pour ce faire, tout essayé : l’admiration inconditionnelle, le pseudo-consensus, les tentatives d’arraisonnement, les colères, les menaces, les appels au secours. Il s’y épuisait. En vain. Elle était ailleurs.
Avec d’autres, il avait jusqu’alors obtenu que son ego-toritarisme ne soit pas contesté. Là, il perdait pied.
Pourquoi s’acharner à tenter d’imposer un rapport de forces, qui n’intéressait que lui, voué ici à une succession ininterrompue d’échecs ?
Par besoin d’attribuer à l’autre, pour tenter de s’en délester, le confus refoulé de soi ?
Parce qu’il avait été structuré par les pouvoirs dont il s’était forgé une carapace, mais qui, pour elle, dépourvus de toute légitimité, fondaient, comme neige au soleil ?
Mais, plus fondamentalement, dès lors que les rapports de pouvoir étaient, par elle, d’emblée, récusés, c’était lui-même, qui, faute de pouvoir les exprimer, faute d’alternative, s’effondrait.
Ce qui épuise, ce qui détruit les hommes de pouvoir (et au-delà tout être ‘de pouvoir’), c’est leur impuissance à être, à vivre indépendamment de ce qui les a si profondément structurés.
Et les femmes « fortes » ne sont souvent fortes que de cette conscience, et / ou de leur refus de se soumettre à eux. Ce qui n’a que peu à voir avec l’origine sociale.
Femmes (Fortes) (2) : Ce n’est pas tant des femmes « fortes » que tant d’hommes ont peur, c’est qu’elles puissent le devenir, à leur encontre. Beaucoup s’y emploient à cerveau, énergie, temps quasi plein.
Femmes (Fortes) (3) : Réhabiliter les « femmes fortes », c’est dissoudre la pensée féministe. De quelle force en effet s’agit-i1 ? Et pour en faire quoi ?
Par ordre chronologique. Femmes. Fortes :
Femmes (Fortes) (1) : 1847. Emily Brontë [1818-1848], dans Hurlevent, raconte l’arrivée d’Isabelle Linton, nouvellement mariée, à Hurlevent, découvrant le pistolet « dont le canon était pourvu d’un couteau à cran d’arrêt à double tranchant » d’Ernshaw :
« Je considérai l’engin avec curiosité. Une idée affreuse me traversa : comme je serais forte si je possédais une telle arme ! […] » 1676 (Cf. Femmes. Hommes. Forts)
Par ordre chronologique. Femmes. « Fortes ». George Sand :
Femmes (Fortes) (2) : (Date ?) George Sand [1804-1876], dans une lettre à Maurice [1823-1889] et Lina Dudevant-Sand [1841-1901], auteure de :
« J’ai besoin que vous ne soyez pas faibles car je ne suis pas si forte que vous le croyez et vos peines me font bien du mal. » 1677
Femmes (Fortes) (3) : (22 février) 1871. George Sand [1804-1876], dans une lettre à Juliette Adam [1836-1936], auteure de :
« […] Ce n’est pas le moment de vous laisser abattre. Il a besoin que vous soyez forte. La vie est si lourde pour les hommes à présent, que les femmes leur doivent de ne pas ajouter à leurs craintes et à leurs chagrins. […] » 1678 (Cf. Droits / Devoirs, Patriarcat. Pensée patriarcale. Sand George)
* Ajout. 25 octobre 2021. Juliette Adam [1836-1936] avait publié en 1858 Idées antiproudhonniennes sur l’amour, la femme et le mariage. (Cf. Féminismes, Féministes. Antiféminisme. Proudhon Pierre-Joseph)
-------------
Femmes (Fortes) (4) : 1883. Émile Zola [1840-1902], dans Au bonheur des dames, auteur de :
« […] En attendant, il [Bourdoncle] traitait la jeune fille [Denise] de puissance à puissance, car il ne la dédaignait plus, il la sentait assez forte pour le culbuter lui-même malgré ses dix ans de service, s’il perdait la partie. » 1679
-------------
Femmes (Fouque Antoinette) : (1er octobre) 2008. Antoinette Fouque [1936-2014], auteure de :
« Globalement, les femmes s’en sortent bien. » 1680
Femmes. « Au foyer » :
Femmes (« Au foyer ») (1) : Il est d’autant plus aisé au mari de la ‘femme au foyer‘ de [lui] mentir, de lui raconter n’importe quoi concernant ses rapports au monde extérieur, qu’elle n’a que peu ou pas d’éléments qui lui permettraient de confronter les paroles de son mari à la réalité. Ne pouvant voir le monde de ses propres yeux, elle ne peut le voir que par ce qu’il lui en représente ; si tant est qu’il lui parle, que peu ou prou il éprouve le besoin de lui rendre des comptes.
En soi, et sur ce seul fondement, conforte la domination masculine.
Par ordre chronologique. Femmes. « Au foyer » :
Femmes (« Au Foyer ») (1) : (2 avril) 1931. Maria Montessori [1870-1952], lors d’une conférence donnée à la Faculté de médecine de Paris, dit justement :
« Ceux qui défendent à l’enfant de se mouvoir mettent des obstacles à la construction de sa personnalité. »
Que dire alors des femmes-dites-« au foyer », si souvent enfermées, étouffées, dans le dit foyer, dans lequel si souvent les enfants, les filles d’abord et avant tout, étaient eux /elles aussi empêché-es de « se mouvoir. » 1681 (Cf. Enfants, Femmes. Enfermées)
-------------
Femmes. Fragiles et / ou vulnérables :
Femmes (Fragiles et / ou vulnérables) (1) : Remplace progressivement les « faibles femmes », trop connoté XIXème siècle. Signifie la même chose.
Les hommes les rejoignent. (Cf. Femmes. Faibles. Précaires)
Femmes (Fragiles et / ou vulnérables) (2) :
Les « femmes fragiles » : ça suffit !
Les « femmes vulnérables » : ça suffit !
Vrai aussi pour les pays …
-------------
Femmes. Françaises :
Femmes (Françaises) (1) : En France, il est ‘acquis’ que les femmes sont « libres ». Le fait qu’à l’étranger, elles sont souvent qualifiées de « faciles » est rarement posé comme sujet de réflexions sémantiques.
Femmes (Françaises) (2) : Le mépris des femmes et son cortège de violences m’apparaît progressivement avec force comme le dernier rempart de l’identité française : sans pétrole, sans idées, un PIB en berne, une croissance nulle, une dette qui explose, un État dissous dans l’Europe et la mondialisation. Mais les femmes françaises sont toujours bien cotées sur le marché mondial : une valeur sûre, à entretenir, à valoriser lorsque les autres s’effondrent.
* Ajout. 5 décembre 2022. Moins crédible ? Oui, sans doute.
Par ordre chronologique. Femmes. Françaises :
Femmes (Françaises) (1) : (31 août) 1753. Voltaire [1694-1778], dans une lettre adressée à Marie-Élisabeth de Dompierre de Fontaine [1715-1771], sœur de Marie-Louise Denis, nièces de Voltaire (concernant les vols, agressions, et l’emprisonnement dont Marie-Louise Denis [1712-1790] fut victime à Francfort, alors qu’elle était munie d’un « passeport du roi de France »), auteur de :
« Si on avait traité ainsi une anglaise, la nation ne le souffrirait pas, mais on fait aux françaises tout ce qu’on veut, et on ne s’en inquiète pas. » 1682
Femmes (Françaises) (2) : 1787. Carlo Goldoni [1707-1793], dans ses Mémoires, auteur de : « Les femmes sages en France ont plus d’amabilité que partout ailleurs, et les femmes adroites y sont moins méprisables. » 1683
Femmes (Françaises) (3) : (19 septembre) 1826. Jean François Champollion [1790-1832], amoureux d’Angelica Palli [1798-?], Italienne de Livourne, évoque les relations malheureuses avec son épouse, et lui écrit, dès sa première lettre :
« […] Séduite par les formes et le mouvement de la société, Anaïs crut que le bonheur consistait à paraître heureuse, et pensa le trouver dans les jouissances de l’amour-propre et dans les succès de salon qui ne tournent qu’au profit de la vanité. C’est là l’écueil de presque toutes nos femmes françaises. […] » 1684
Femmes (Françaises) (4) : 1887. Anton Tchékhov [1860-1904], dans Des leçons onéreuses, auteur de :
« Il regardait son cou et son dos nus, et il crut comprendre pourquoi les Françaises ont la réputation d’être des créatures légères, frivoles et qui tombent facilement ; il se noyait dans ce nuage de parfum, de beauté, de nudité, tandis qu’elle, ignorant ses pensées et ne s’y intéressant probablement pas, tournait rapidement les pages et traduisait à toute allure. » 1685
-------------
Femmes. « Frigides » :
Femmes (« Frigides ») (1) : Je lis que, dans le Dictionnaire de l’Académie [1835], le mot « Frigide » était ainsi présenté : « Terme de médecine légale. État d’un homme impuissant. » 1686 (Cf. Hommes. « Impuissants », Langage. Féminisation du langage)
Par ordre chronologique. Femmes. « Frigides » :
Femmes (« Frigides ») (1) : (17 décembre) 1894. Freud [1856-1939], dans une lettre à Wilhelm Fliess [1858-1928], auteur de :
« Il faudrait se demander comment il se fait que l’anesthésie [« absence de sentiment de volupté »] soit de façon aussi prépondérante, le trait distinctif des femmes. Un homme anesthésique renoncera bientôt au coït ; la femme, elle, on ne lui demande pas son avis. […]
Les femmes arrivent très souvent à l’acte sexué (se marient) sans amour, c.-a-d avec une excitation sexuelle somatique et une tension de l’organe terminal (sic) réduites. Elles sont ensuite frigides et le restent. » 1687 (Cf. Sexes, Violences. Tordjman Gilbert)
Femmes (« Frigides ») (2) : 1934. Lu dans un livre de médecine Le sauvetage de la femme. Essai de traitement prophylactique des maladies des femmes :
« La frigidité […] est bien souvent la réaction de défense d’une nature délicate, blessée dans sa candeur par un époux trop expéditif. […]
La persuasion, la douceur et les mille acheminements si gentiment décrits par le maître Ambroise Paré [1510-1590] arrivent à bout de cette froideur. […]
Le manque de sympathie est parfois une cause de frigidité. C’est la rançon de ces mariages de raisons, imposés par des parents bornées et autoritaires. L’adultère en est le corolaire fréquent. » 1688 (Cf. Femmes. Adultère)
Femmes (« Frigides ») (3) : 1960. Pierre Reboul [1918-1989], dans son introduction au roman Lélia [1833, 1839] de George Sand [1804-1876], auteur de :
« Ne mâchons pas les mots : Lélia est frigide. Louise Vincent, André Maurois plus récemment, bien d’autres aussi, ont estimé que la confession (sic) de George Sand s’étendait à ce comportement (sic). » 1689
Femmes (« Frigides ») (4) : 1965. Lu dans Le guide marabout de la femme. I [p.252] :
« La frigidité féminine est due le plus souvent au partenaire. » (Cf. Femmes. « Féminin », Hommes)
Femmes (« Frigides ») (5) : 1981. Luce Irigaray, dans Nietzsche, Freud et les femmes, auteure de :
« […] Quand une femme vient me trouver et me dit qu’elle est frigide, je lui dis : ‘Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne crois pas une seconde à la frigidité des femmes.’ » 1690 Bien dit. Clairement, fièrement affirmé. (Cf. Sexes […])
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. « Froides » :
Femmes (« Froides ») (1) : (avril) 1856. Edmond [1822-1896] et Jules [1830-1870] de Goncourt écrivent dans leur Journal :
« La pire débauche est celle des femmes froides. » 1691 (Cf. Hommes. Froids)
Femmes (« Froides ») (2) : 1957. Roger Vailland [1907-1965], dans La loi, auteur de :
« Les femmes froides, dit-il, se créent très jeunes des obligations de dames patronnesses. » 1692
-------------
Femmes. Frontières :
Femmes (Frontières) (1) : Pour des millions d’êtres humains - les femmes - la première frontière est celle qui sépare la porte de leur maison du monde extérieur.
Par ordre chronologique. Femmes. Frontières :
Femmes (Frontières) (1) : 1860. George Eliot [1819-1880], dans Le moulin sur la Floss, évoque « les pauvres femmes, dans les villages, qui ne vont jamais à plus de cent mètres de leur maison. » 1693 (Cf. Femmes. Enfermées. Maison, Patriarcat. Division sexuelle du travail, Économie. « Pauvres Les »)
Femmes (Frontières) (2) : 1867. Émile Zola [1840-1902], dans Thérèse Raquin, auteur de :
« Pendant trois ans, les jours se suivent et se ressemblèrent. Camille ne s’absenta pas une seule fois de son bureau ; sa mère et sa femme sortirent à peine de la boutique. » 1694
Femmes (Frontières) (3) : 1976. Benoîte Groult [1920-2016], dans Ainsi soit-elle, auteure de :
« On leur [aux femmes] ferma donc toutes les portes sur la vie, hormis quatre : celles de la chambre à coucher, de la cuisine, de la buanderie et de la chambre d’enfants. » 1695 (Cf. Femmes. Enfermées, Patriarcat)
Femmes (Frontières) (4) : 1994. Goliarda Sapienza [1924-1996], dans L’art de la joie, concernant une femme enfermée dans un couvent, auteure de :
« Le vent était fort et je n’arrivais pas à bouger. Je n’étais pas habituée à marcher sans un mur qui marque la frontière avec le monde extérieur. » 1696 (Cf. Femmes. Enfermées, Patriarcat)
Femmes (Frontières) (5) : 1995. Jean Tulard, dans le Guide des films. 1895-1995. L-Z, concernant La maison et le monde [1984. Satyajit Ray] :
« Au Bengale, au début du siècle. Un grand bourgeois, Nikhil, éclairé et éduqué à l’occidentale, vit dans un palais familial à la campagne. Sa jeune femme, Bimila, épousée selon la tradition, vit cloitrée dans les appartements des femmes et Nikhil tente de l’éduquer en lui faisant apprendre l’anglais et en l’encourageant à affirmer sa personnalité. Bimila, un jour, accepte de quitter le gynécée [le purdah] pour rencontrer un des amis de son mari. […]
Pour la première fois, Bimila franchit ‘le passage qui mène au monde extérieur’ et le cours de son existence bascule : le monde devient l’autre territoire de sa vie, un peu effrayant, enivrant […]. » 1697 (Cf. Culture. Cinéma, Êtres humains. Personnalité, Femmes. Enfermées, Politique)
* Ajout. 17 août 2022. Film écrit sur les fondements du livre du même nom - 1915 - de Rabindranath Tagore [1861-1941]. (Cf. Hommes. Féminisme. Tagore Rabindranath)
Femmes (Frontières) (6) : 2016. Lu dans Paris Match :
« Durant le deuxième débat présidentiel de 2016, le comportement de Donald Trump envers Hillary Clinton avait particulièrement marqué : le milliardaire s'était placé dans le dos de la candidate, se plaçant près d'elle, un moment qui l'avait mise ‘incroyablement mal à l'aise’. ‘Je sentais sa respiration dans mon cou. Ça m'a donné la chair de poule’, avait-elle raconté dans son livre ‘Ça s'est passé comme ça’. ‘C'était un de ces moments où on espère pouvoir faire une pause et demander aux gens autour : ‘Que feriez-vous ? Resteriez-vous calme, continueriez-vous à sourire et à poursuivre comme s'il n'envahissait pas sans cesse votre espace ? Ou vous retourneriez-vous, pour le regarder dans les yeux et dire clairement et à voix haute : 'Recule, sale type, éloigne-toi de moi'. » 1698 (Cf. Relations entre êtres humains, Hommes. « Politiques ». Trump Donald, Patriarcat. Domination masculine, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
Femmes (Frontières) (7) : (26 décembre) 2021. Le ministère de la promotion de la vertu et de la répression du crime d’Afghanistan, auteur de :
« Les femmes voyageant plus de 45 miles ne peuvent pas faire le trajet si elles ne sont pas accompagnées d’un membre proche de la famille. », un homme, va sans dire.
A fortiori, bien sûr, hors des frontières nationales. 1699 (Cf. Femmes. Enfermées, Politique. Frontières)
-------------
Femmes (Fumier) : 1960. Une ouvrière, en Belgique, l’une de celle que l’on nommait « les femmes-machines » de l’usine de Herstal - la F.N -, rapporte la phrase par laquelle les conducteurs de car faisaient le transport entre l’usine et leur domicile les qualifiaient. Ils disaient :
(Traduit du Wallon) « Je vais chercher la charrette de fumier. » 1700 (Cf. Femmes. « Machines », Famille, Mariage. « Fumier »)
Femmes. Fusil :
Femmes (Fusil) (1) : 1939-1945. [Waffen SS.] :
« Ton fusil, c’est ta femme ». 1701
Femmes (Fusil) (2) : À comparer avec : « This is my rifle / This is my gun (leur sexe). One’s for Killing / The other’s for fun » (Chanté, hurlé par les Marines américains)
Femmes (Fusil. Armes) (3) : 1965. Madeleine Riffaud [1924-2024], dans Dans les maquis Vietcong, concernant les armes vietnamiennes utilisées contre l’armée américaine, écrit :
« Toutes prises peu à peu sur l’armée américaine, les armes des compagnies étaient ainsi les ‘filles’ des uns des autres. Leurs servants les entretenaient avec des soins jaloux. » 1702 (Cf. Femmes. Remarquables. Riffaud Madeleine, Hommes. Jaloux, Politique. Guerre, Sexes […])
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. « Gentilles » :
Femmes (« Gentilles ») (1) : 1883. Émile Zola [1840-1902], dans Au bonheur des dames, auteur de :
« - Mon Dieu ! mademoiselle Denise, balbutia Deloche, pourquoi n’êtes-vous pas plus gentille ?... Moi qui vous aime tant ! » 1703 (Cf. Relations entre êtres humains. Aimer, Patriarcat)
Femmes (« Gentilles ») (2) : 2017. Lu ou entendu (je ne me souviens plus) :
« C'est pas pour dire du mal, mais être gentille à ce point..., je ne pensais pas que c'était possible. »
-------------
Femmes (Ghiliak) : 1890. Lu dans L’ile de Sakhaline d’Anton Tchékhov [1860-1904] :
« Quant aux femmes, elles sont toutes égales dans l’absence totale de droits, qu’il s’agisse de la grand-mère, de la mère ou d’une fillette au berceau ; on ne les respecte pas plus que les animaux domestiques, qu’un objet qu’on peut jeter ou vendre, ou qu’un chien qu’on chasse à coups de pieds. Encore que les chiens, les Ghiliak les caressent parfois, les femmes jamais. Ils attachent moins d’importance à une noce qu’à une banale ribote, en ne l’entourant d’aucun rite religieux ou païen.
Le Ghiliak troque un épieu, une barque ou un chien contre une jeune fille qu’il emmène dans sa iourte et avec laquelle il s’étend sur une peau d’ours - un point, c’est tout.
La polygamie est admise mais ne semble pas très répandue, bien que les femmes soient apparemment plus nombreuses que les hommes.
Le mépris du Ghiliak envers la femme, considérée comme un être inférieur, atteint un tel degré qu’il ne trouve nullement répréhensible de la réduire en esclavage au sens le plus direct et le plus dur de ce mot. Selon le témoignage de Schrenck, ils emmènent souvent des femmes aïno en captivité ; il est probable que la femme est pour eux un objet de commerce au même titre que le tabac et le calicot. » 1704 (Cf. Droit, Femmes. Jeunes filles. « Objets », Famille. Tchékhov Anton. Polygamie, Justice, Patriarcat, Politique. Esclavage. Égalité, Économie)
Femmes (« Gibier ») : Jean Tulard, dans Guide des films. 1895-1995. L-Z, écrit concernant :
- Pervers (Le) [1973. José-Maria Forque] :
« Juan […] exerce sur la domesticité et plus particulièrement sur les servantes une tyrannie perverse et parfois (sic) féroce : il fera ainsi dévorer par ses chiens une paysanne chassée comme du gibier. » (Cf. Femmes. Comment meurent les femmes ? Servantes, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
- Tombe les filles et tais-toi [1972. Herbert Rosse. Woody Allen] :
« Parce que sa compagne l’a quitté […] Alan Felix tombe dans une torpeur dépressive. Sa timidité à l’égard du sexe faible risquant de devenir incurable, un couple d’amis s’efforce en vain de rabattre dans son lit du gibier féminin. » (Cf. Culture. Cinéma, Femmes. Animalisation des femmes. « Féminin ». « Sexe faible », Hommes. Meute, Famille. Couple, Politique. Animalisation du monde, Sexes […]) 1705
Femmes (Gitanes) : (11 septembre) 2012. Avoir entendu, dans l’émission Les pieds sur terre de France Culture, celle, intitulée Les gitanes de Saint-Jacques, m’a laissée, un moment, sidérée. Et puis, le constat de l’impuissance de ces femmes - tant se révèlent dans leurs violences des siècles de domination non contestée - se fait jour. Évoquer, selon l’antienne féministe, le recours à la loi, apparaîtrait grossier, accusateur, indécent, irresponsable. Et l’on est en réduit-e à constater que si notre société n’a à ce jour rien fait pour faire cesser ces monstruosités, plus encore, elle ne fera rien à l’avenir. Que faire alors ? (Cf. Droit, Patriarcat, Violences. Violences à l’encontre les femmes)
* Ajout. 20 septembre 2023. Bien défaitiste…
Par ordre chronologique. Femmes. Gloire :
Femmes (Gloire) (1) : 1746. Émilie du Châtelet [1706-1749], dans son Discours sur le bonheur [1744-1746], publié après sa mort, auteure de :
« […] Il est certain que l’amour de l’étude est bien moins nécessaire au bonheur des hommes qu’à celui des femmes. Les hommes ont une infinité de ressources pour être aimé qui manquent entièrement aux femmes. ils ont bien d’autres moyens d’arriver à la gloire, et il est sûr que l’ambition de rendre ses talents utiles à son pays et de servir ses concitoyens, soit par son habileté dans l’art de la guerre ou par ses talents pour le gouvernement, ou les négociations, est fort au-dessus de [celle] qu’on peut proposer pour l’étude ; mais les femmes sont exclues, par leur état, de toute espèce de gloire, et quand par hasard, il s’en trouve quelqu’une qui est née avec une âme assez élevée, il ne lui reste que l’étude pour la consoler de toutes les exclusions et de toutes les dépendances auxquelles elle se trouve condamnée par état. »
Et c’est pourquoi, plusieurs siècles après, les filles réussissent mieux dans leurs « études » que les garçons… 1706 (Cf. Femmes. Ambition. Remarquables. Chatelet Émilie du. Utiles, Patriarcat. Hommes / femmes)
Femmes (Gloire) (2) : (3 août) 1880. Marie-Aimée Steck-Gichelin [1776-1821], dans ses Cahiers, écrit :
« Sans doute la carrière des talents ne doit point être fermée aux femmes : mais ce n’est jamais le désir de gloire qui doit les y entraîner. Toute espèce d’ambition, tout sentiment intéressé doit être à jamais étranger à leur caractère. […]
Cependant le développement, le perfectionnement de nos facultés, ne doit-il pas être en lui-même un devoir ? Oui, mais ce devoir ne doit pas être le premier de tous. Il est subordonné à ceux que nous imposent la place que nous occupons dans le monde, et nous ne sommes pas toujours maîtres de choisir celle qui nous convient. […] » Lire la suite… 1707 (Cf. Femmes. Ambition. Écrivaines)
-------------
Femmes (Grand-mères) : (5 janvier) 2022. Je rencontre au Luxembourg une chercheuse féministe :
« Je suis débordée, j’ai une petite fille » me dit-elle.
Par ordre chronologique. Femmes. Ménie Grégoire :
Femmes (Grégoire Ménie) (1) : 1965. Ménie Grégoire [1919-2014], dans Le métier de femme, écrit avant son rôle d’animatrice radio sur RTL, Allo Ménie ! de 1967 à 1982], auteure de :
« […] Une femme est un être sexué qui adopte, pour la réaliser, une image conforme aux normes de la société. Être une femme, c’est choisir un rôle, une place particulière, conforme aux représentations collectives de son époque et de son cadre. Les sociétés d’ailleurs sanctionnent la réussite ou l’échec de l’entreprise, disant de deux être identiques ou bien : ‘C’est une vraie femme’, ou bien : ‘ce n‘est pas une femme’. » 1708
Forte critique en 1965… (Cf. Êtres humains, Femmes. Lesbiennes)
Femmes (Grégoire Ménie) (2) : 1977. Jean-Louis Bory [1919-1979], traitant de l’homosexualité [des hommes], mais analyse valable au-delà, auteur de :
« Ne nous hâtons pas de rire de Ménie Grégoire [1919-2014]. Grâce à l’aspect rassurant qu’offre cette excellente bourgeoise d’excellente famille pour excellents quartiers, des confidences assez gratinées et des considérations d’un assez beau sang-froid ont pu passer sur les ondes de la radio à des heures de large écoute. C’est déjà ça. Ça vaut en tout cas mieux que le silence. » 1709 (Cf. Femmes. Bourgeoises. Lesbiennes. Silence, Hommes. Homosexualité. Silence, Famille, Féminismes, Politique. Médias)
-------------
Femmes (Grève) : (30 septembre) 2019. Lu : Revendications des salariées travaillant de la société STN travaillent à l’hôtel Ibis Batignolles.
- Embauche des salariés de la sous-traitant des salariées travaillant STN Groupe par l’hôtel IBIS Batignolles avec reprise de leur ancienneté.
-Passage à temps complets des temps partiels et des CDD en CDI.
-Arrêt des mutations des salariées partiellement inaptes et des mutations non justifiées de manière générale.
-Arrêt du harcèlement par Anne Marie gouvernante IBIS Batignolles.
-Versement d’une indemnité nourriture égale à 7,24 € par jour travaillé (2 Minimum Garanti) et d’une prime de lit supplémentaire de 2€ par lit.
-Installation d’une pointeuse électronique infalsifiable avec remise d’un relevé horaire hebdomadaire à chaque salarié.
-Prime de nettoyage et repassage des vêtements de travail égale à 22 € par mois (1€ par jour travaillé) et fourniture de 2 tenues de travail par an en coton.
-Classement en catégorie B de l’ensemble des salariés de STN GROUPE : Femmes de chambre, équipiers : AQS1B, AQS2B après 2 ans, AQS3B après 5 ans Gouvernantes : CE1, CE2 après 2 ans, CE3 après 5 ans
-Suppression de l’abattement illégal de 8%.
-Suppression de la clause de mobilité.
-Prime d’habillage-déshabillage 250 € par an.
-Remboursement des transports à 100%.
-Diminution cadence indicative du nombre de chambres à 2 chambres 1/ à l’heure.
-Élection de deux délégués de proximité de la société STN GROUPE au sein de l’hôtel IBIS Batignolles .
-Paiement des salaires le 1er du mois.
- Paiement des jours de grève. 1710 (Cf. Femmes. Travail, Politique. Luttes de femmes)
Femmes. « Grisettes » :
Femmes (« Grisettes ») (1) : Je lis sur Wikipédia que « la grisette a d’abord désigné un tissu bon marché. La teinture ordinaire donnait dès le premier lavage des tons grisâtres. »
Par ordre chronologique. Femmes. « Grisettes » :
Femmes (« Grisettes ») (1) : 1664. Jean de la Fontaine [1621-1695], dans Joconde, auteur de :
« Sous les cotillons des grisettes / Peut loger autant de beauté / Que sous les jupes des coquettes […] Une grisette est un trésor ; / Car sans se donner de la peine / Et sans qu'aux bals on la promène / On en vient aisément à bout ; / On lui dit ce qu'on veut, bien souvent rien du tout. » (Cf. Femmes. « Coquettes »)
Femmes (« Grisettes ») (2) : 1781-1788. Louis Sébastien Mercier [1740-1814], dans Tableau de Paris, auteur de :
« On appelle grisette la jeune fille qui, n’ayant ni naissance, ni bien, est obligée de travailler pour vivre, et n’a d’autre soutien que l’ouvrage de ses mains. Ce sont les monteuses de bonnets, les couturières, les ouvrières en linge, etc., qui forment la partie la plus nombreuse de cette classe. » 1711 (Cf. Femmes. Jeune filles)
Femmes (« Grisettes ») (3) : Sade [1740-1814], auteur de :
« Les grisettes ont une réputation de mœurs légères. » 1712 (Cf. Femmes. Réputation, Politique. Lois. Mœurs, Violences. Sade. Violences à l’encontre des femmes)
Femmes (« Grisettes ») (4) : 1830.Une statue intitulée La grisette de Jean-Bernard Descomps [1872-1948] a été érigée en 1909 à Paris ; elle existe toujours au croisement du Boulevard Jules Ferry et de la rue du Faubourg du Temple. À toutes fins utiles… (Cf. Culture. Statues)
-------------
Femmes (« Grosses ») : 1969. Je lis dans un Dictionnaire des femmes célèbres que :
- L’actrice Louise Contat [1760-1813] « gagnée par un embonpoint fâcheux, dut se restreindre aux emplois de mère »,
- Mademoiselle Gorge [1787-1867], elle aussi actrice, « longtemps d’une beauté sculpturale, qui faisait d’elle le type même de la ‘reine de la tragédie‘ prit vite un embonpoint abusif [et] quitta la scène en 1849 »
- « Les maternités incessantes de madame de Montespan [1640-1707] contribuèrent à sa ruine : son teint s’était fripé et elle avait pris ‘une grosse vilaine taille’. »
- Marguerite de Valois [1553-1615], surnommée par son frère la Reine Margot, fut, lorsqu’elle reparut à la Cour en 1605 « accueillie par des rires ; elle avait conservé les modes de sa jeunesse, [et] était devenue obèse et chauve… » 1713 (Cf. Femmes. Beauté)
Femmes (Grossesses) : (24 septembre) 2017. Je lis une publicité affichée sur la pharmacie de la rue des Écoles : un test de grossesse (américain), est vendu 0,99 euros. En décembre, il ne coutait plus que : 0,77 euros. (Cf. Femmes. Enceintes, Démographie. France. Test de grossesse, Économie. Publicité)
Femmes (« Gueuses ») : « Gueuses » : Femmes : « indigentes », « nécessiteuses », « malhonnête », « de mauvaise vie », « qui s’attire le mépris »
Mais aussi « la gueuse » : nom injurieux donné par les royalistes à la république. (Cf. Politique. République)
Femmes (Hardies) : (13 avril) 1859. George Sand [1804-1876], dans une lettre à Louise Vallory [1824-1879], auteure de :
« Vous êtes hardie, vous serez très amèrement critiquée. Tant mieux pour vous. Gardez votre individualité et dites ce que vous pensez, ce que vous croyez, ce que vous sentez. » 1714
Femmes. « Héroïnes » :
Femmes (« Héroïnes ») (1) : Non les femmes n’ont pas besoin d’héroïnes, autant de modèles imposés, inaccessibles, si souvent construits de toutes pièces.
Par ordre chronologique. Femmes. Héroïnes :
Femmes (« Héroïnes ») (1) : 2004. Juliette Gréco [1927-2020], auteure de (en réponse à la question : « Vos héros dans la vie ? ») :
« Toutes les femmes anonymes. » 1715
Dans le même sens, Sandrine Bonnaire concernant sa mère :
« une héroïne de la vie ». 1716
- Mais à féminiser le qualificatif de « héros », le fondement sur lequel celui-ci s’est construit est re-légitimé, alors qu’il devrait être détruit. Processus de pensée fréquent dans les analyses féministes. (Cf. Femmes. Mères, Hommes. « Héros », Penser, Politique)
Femmes (« Héroïnes ») (2) : (2 août) 2019. France Culture. Débat : « Les femmes peuvent-elles être des héros ? » France Culture à l’avant-garde de la pensée, notamment féministe… 1717 (Cf. Culture. Patriarcale, Hommes. « Héros », Langage)
-------------
Femmes. Heureuses.
Femmes (Heureuses) (1) : Il s’agit souvent, pour les femmes, bien plus que d’être heureuses, de paraître l’être.
Par ordre chronologique. Femmes. Heureuses.
Femmes (Heureuses) (1) : 2006. Sándor Màrai [1900-1989], dans Métamorphoses d’un mariage, auteur de :
« […] Peut-être mon mari le savait-il, oh oui ! Mais moi, je ne pouvais rien faire, j’étais obligée d’être heureuse, les dents serrées. » 1718 (Cf. Corps. Dents)
-------------
Femmes. Hiérarchie. Entre elles :
Femmes (Hiérarchie. Entre elles) (1) : 2015. Lu, dans La petite fille de la Vème, de Roselyne Bachelot, concernant l’épouse de Valéry Giscard d’Estaing :
« [1979] Invité un jour dans une de ces garden-parties élyséennes, je vis arriver Anne-Aymone Giscard d’Estaing, divinement habillée d’organdi blanc par Scherrer [Jean-Louis. 1935-2013], avec capeline et fichu à la Marie-Antoinette, escortée à 50 centimètres par Ève Barre (épouse du premier ministre). Derrière elles, trottinaient en se dandinant les épouses des ministres par ordre protocolaire : le spectacle était irrésistible. Un sénateur me glissa à l’oreille : ‘On se croirait à Versailles ! » 1719
« Irrésistible » n’est pas le bon terme, mais évite de l’écrire.
Et qu’en est-il de la hiérarchie à laquelle Roselyne Bachelot doit quotidiennement se plier ? (Cf. Femmes. Épouse de. Comparaison entre femmes, Hommes. « Politiques », Politique. Hiérarchie)
Femmes (Hiérarchie. Entre elles) (2) : 1997. Dans ses Mémoires, Mikhaïl Gorbatchev [1931-2022], nouvellement nommé en 1980 au comité central du parti communiste écrit :
« Raïssa [son épouse. 1932-1999] ne parvenait pas non plus à s’habituer à ce nouveau système de relations. En fait, elle n’a jamais pu trouver sa place dans le groupe des ’épouses du Kremlin’ et ne se lia intimement avec aucune d’entre elles. Ces réunions de femmes la frappèrent particulièrement par le climat qui y régnait, imprégné de morgue, de suspicion, de flagornerie, de sans-gêne. À quelques nuances féminines près, ce monde des ‘dames’ reflétait la hiérarchie des maris. [...] » 1720
- À équivalence ? Qu’en est-il de la hiérarchie, de la flagornerie… comme principe structurant du monde notamment soviétique ? Notamment… (Cf. Femmes. « Féminin ». Comparaison entre femmes. Épouse de, Relations entre êtres humains. Flagornerie, Patriarcat. Hiérarchie, Politique. Hiérarchie)
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. « Hommasses » :
Femmes (« Hommasses ») (1) : 1862. Victor Hugo [1802-1880], dans Les misérables, après avoir décrit madame Thénardier, comme « le type de femme-à-soldat dans tout sa disgrâce », la présente ainsi :
« C’était une minaudière hommasse. » 1721
N.B. « Hommasse » [Le Littré] « Qui a l'apparence d'un vilain homme. Des traits hommasses, une figure hommasse, en parlant de l'un et l'autre sexe.
Plus particulièrement et plus souvent, il se dit d'une femme qui a les traits, la voix, les manières d'un homme. »
Femmes (« Hommasses ») (2) : (26 avril) 2012. L’Express décrit Marie Dormoy [1886-1974] comme : « plutôt hommasse ». 1722 (Cf. Femmes. Remarquables. Dormoy Marie, Langage)
Femmes (« Hommasses ») (3) : (16 avril) 2016. Dans une émission de France Culture consacrée à Rosa Bonheur [1822-1899], l’expression d’ « hommasse » est employée. 1723 (Cf. Femmes. Artistes. Bonheur Rosa, Langage)
Femmes (« Hommasses ») (4) : (21 septembre) 2019. Dans une émission de France Culture consacrée à Sonia Delaunay [1885-1979], elle est qualifiée d’ « un peu hommasse », ce qui fut suivi de : « Elle est un homme comme les autres », ce qui fut alors interrogé comme relevant, ou non, du « féminisme ». 1724 (Cf. Femmes. Artistes, Féminismes)
Femmes (« Hommasses ») (5) : 2019. Je lis dans Ernest Kantorowicz, une vie d’historien :
« Baby avait un côté hommasse. Elle jouait au golfe et fumait le cigare. » Puis Baby est traitée de « virago ». 1725
-------------
Femmes (« Honnêtes et courageuses ») : 1960. Vassili Grossman [1905-1964], dans Vie et destin, auteur de :
« […] (Dans la Russie stalinienne) N’empêche qu’il y avait des gens - le plus souvent, de vieilles femmes, des ménagères, petites bourgeoises sans parti - qui s’arrangeaient pour faire passer des colis dans les camps. À leur adresse, on pouvait se faire expédier des colis dans les camps. Curieusement, elles n’avaient pas peur. Ces vieilles, parfois employées de maison, nourrices illettrées, bourrées de préjugés religieux, prenaient chez elles des gosses restés tous seuls après l’arrestation de leurs parents, elles les sauvaient des maisons de l’enfance et des orphelinats. Les membres du parti, eux, craignaient ces gosses comme le feu. Ces vieilles bourgeoises, ces bonnes femmes, ces nourrices ignares, étaient-elles, en fin de compte, plus honnêtes et plus courageuses que les bolchéviques-léninistes, que Mostovskoï ou Krymov ? » 1726 (Cf. Femmes. Âgées. Charité. Nourrices. Peur, Hommes. Peur, Politique. Parti politique)
Mais le plus curieux, ne serait-ce pas que la question puisse même être posée ?
Femmes (« Horizontales ») : (12 août) 2024. Jean Lebrun, sur France Culture, ose, peut sans gêne, qualifier des femmes de « grandes horizontales ».
Par ordre chronologique. Femmes. Humbles :
Femmes (Humbles) (1) : (16 octobre) 1987. Hélène Carrère d’Encausse [1929-2023], future académicienne [elle sera élue en 1990], s’adressa à M. Léopold Sedar Senghor [1906-2011], ancien président de la République du Sénégal, membre de l’académie française, en ces termes :
« Ma question est la suivante, que m’inspire d’ailleurs, je dois dire tout à fait humblement, votre propre expérience, Monsieur le Président […]. » 1727 (Cf. Langage. Académie française. Carrère d’Encausse Hélène, Patriarcat. Permanence)
Femmes (Humbles) (2) : (9 février) 2024. Lu sur Franceinfo : « L'ancienne garde des Sceaux, Christiane Taubira salue ‘l'immense statue inaccessible’ qu'a été ‘pendant longtemps’ pour elle Robert Badinter [1928-2024]. L'ancienne garde des Sceaux se souvient de son premier geste quand elle est arrivée au ministère de la Justice : ‘C'est la première personne que j'ai appelée. Pour le saluer d'une part, pour lui dire que je me plaçais évidemment en toute humilité, sous l'ombre de son œuvre’. » (Cf. Relations entre êtres humains. Flagornerie)
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Humour :
Femmes (Humour) (1) : (22 mars) 1806. Stendhal [1783-1842], après avoir évoqué comment, en société, « produire de la gaité […] par une recherche soigneuse du comique », écrit à sa sœur Pauline [Beyle 1786-1857] :
« Il faut seulement que ce comique soit excessivement fin : le comique chargé, assez bon chez un homme, est détestable chez une femme.
Le comique franc n’est pas permis à une femme ; on ne lui pardonne guère de montrer un ridicule réel, cela lui ôte toute grâce en la rendant puissante ; il faut qu’elle se borne à la plaisanterie […]. » 1728
Je comprends mieux le sérieux des femmes… ; à quoi l’on peut ajouter un certain refus de « l’humour », tant celui-ci les a pris pour cibles. (Cf. Hommes. Stendhal, Relations entre êtres humains. Pardon, Plaisanterie, Féminismes. Humour)
* Ajout. 25 janvier 2021. 1940. André Breton [1896-1966], dans son Anthologie de l’humour noir, concernant Alfred Jarry [1873-1907] - mais peut être aisément étendu -, auteur de :
« L’humour, comme processus permettant d’écarter la réalité en ce qu’elle a de trop affligeant, ne s’exerce plus ici qu’aux dépens d’autrui. » 1729
Femmes (Humour) (2) : 1871-1872. George Eliot [1819-1880], dans Midlemarch, auteure de :
« Or, Rosamond savait dire des choses justes ; car sa forme d’intelligence était celle qui attrape tous les tons sauf celui de l’humour. Heureusement, elle n’essayait jamais de plaisanter, et donnait peut-être par-là la preuve décisive de son intelligence. » 1730
Femmes (Humour) (3) : (30-31 décembre) 2002. Anne Sylvestre [1934-2020], évoquant les conditions d’écriture de ses chansons, auteure de :
« Il n’y a pas beaucoup de sujets qui font rire. » 1731
Femmes (Humour) (4) : 2004. Philippe de Gaulle [1921-2024], dans De Gaulle, mon père [1890-1970], se souvient :
« Mon père était plus incisif [que son propre père]. Mais en famille, il faisait attention de ne pas froisser. Il se rendait compte que son ironie pouvait être quelquefois ravageuse. Par conséquent, il ne s’en servait presque jamais, surtout avec les femmes, car remarquait-il (sic),’elles n’ont pas le sens de l’humour’. » 1732 (Cf. Patriarcat)
-------------
Femmes. « Hystériques » :
Femmes (« Hystériques ») (1) : Une femme hystérique ? Non, une femme épuisée, à bout, au bout du rouleau, qui n’en peut plus, qui explose à la moindre émotion, qui ne peut plus que hurler son angoisse, son impuissance ; une femme écrasée par la vie qui n’a pas (encore) pu trouver la compréhension de la nécessité de la révolte… Et le chemin de l’apaisement.
Employer ce terme, c’est, en sus, cautionner l’usage qu’en a fait - et à quels ‘coûts’ humains notamment pour les femmes - la psychanalyse et la psychiatrie. (Cf. « Sciences » sociales. Psychanalyse. Psychiatrie)
Par ordre chronologique. Femmes. « Hystériques » :
Femmes (« Hystériques ») (1) : (15 janvier) 1867. George Sand [1804-1876], en réaction à une lettre de Gustave Flaubert [1821-1880] qui se qualifiait de « vieil hystérique », lui répond :
« Qu’est-ce que c’est aussi que d’être hystérique ? Je l’ai peut-être été aussi, je le suis peut-être, je n’en sais rien, n’ayant jamais approfondi la chose et en ayant ouï parler sans l’étudier. N’est-ce pas un malaise, une angoisse, causés par le désir d’un impossible quelconque ? En ce cas nous en sommes tous atteints, de ce mal étrange, quand nous avons de l’imagination ; et pourquoi une telle maladie aurait-elle un sexe ? » 1733 (Cf. Sexes. Sand George)
Femmes (« Hystériques ») (2) : (8 février) 1893. Sigmund Freud [1856-1939], dans une lettre adressée à Wilhelm Fliess [1858-1928], lui présente sous l’intitulé Carnet B, son « étiologie des névroses ». Il écrit :
« Plus la puissance de l’homme est mauvaise, plus l’hystérie de la femme prédomine, de sorte que la neurasthénique sexuel rend sa femme, en réalité, non pas tant neurasthénique qu’hystérique. » 1734
Sur quoi, sur qui se fonde-t-il pour affirmer cela ? À la re-lecture, sur rien.
Femmes (« Hystériques ») (3) : (19 janvier) 1933. Michel Leiris [1901-1990], écrit dans L’Afrique fantôme :
« La femme du Français qui dirige le Courrier d’Éthiopie, a déclaré paraît-il que Melle Lifszyc devait être une ‘hystérique‘ pour s’en aller ainsi en mission, seule femme au milieu de tant d’hommes. » 1735
N.B. Deborah. Lifszyc [1907-1942. Ethnologue et linguiste]. Auteure, avec Denise Paulme [1909-1998], de Lettres de Sanga. [1935. Paris CNRS. 2015] (Cf. « Sciences sociales ». Ethnologie. Leiris Michel)
Femmes (« Hystériques ») (4) : 1977. Interview de Michel Foucault [1926-1984] :
- Question de G. Wajeman : « Pourriez-vous préciser ce que vous dites de Freud [1856-1939] et de Charcot [Jean-Martin. 1825-1893] ? »
- Réponse : « Freud arrive chez Charcot. Il y voit des internes qui font faire des inhalations de nitrate d’amyle à des femmes qu’ils conduisent ainsi imbibées devant Charcot. Les femmes prennent des postures, disent des choses. On les regarde, on les écoute, et puis, à un moment, Charcot déclare que ça devient très vilain. On a donc là un truc superbe, où la sexualité est effectivement extraite, suscités, incitée, titillées de mille manières, et Charcot, tout à coup, dit : ‘ Ça suffit’. Freud, lui, va dire : ‘Et pourquoi cela suffirait-il ?’ Freud n’a pas eu besoin d’aller chercher quelque chose d’autre que ce qu’il avait vu chez Charcot. La sexualité était là, sous ses yeux, présentée, manifestée, orchestrée par Charcot et ses bonshommes… »
- « Un truc superbe ! » pour Michel Foucault : des femmes droguées, photographiées, exhibées, manipulées dont la médecine provoque ce que l’on nomme l’hystérie et que l’on va nommer - et tant d’elles, après - : « des femmes hystériques »…
- G. Wajeman dit par ailleurs, sans ambiguïté, après cette réponse de Michel Foucault, que « Charcot faisait se produire des crises hystériques, par exemple la posture en arc de cercle. »
- Quant à Michel Foucault, évoquer « une sexualité extraite, suscitée, incitée, titillée de mille manières » ne lui pose lui pas de problème. Pas plus qu’une « sexualité […] présentée, manifestée, orchestrée par Charcot et ses bonshommes… » ne l’interroge, ni ne l’inquiète…
Et Michel Foucault continue à être invoqué, considéré, y compris par des féministes, comme le spécialiste de la question [!]. Quelles responsabilités ! 1736 (Cf. Hommes. « Intellectuels », Patriarcat, Sexes. Sexualité, « Sciences » sociales. Psychanalyse)
* Ajout. 16 juillet 2017. 1983. Ultérieurement, Michel Foucault évoquera « tout le tapage qui a été fait autour de l’hystérie féminine. » 1737 (Cf. Femmes. « Féminin »)
Femmes (« Hystériques ») (5) : 1985. Claude Dulong [1922-2017], historienne, dans Anne d‘Autriche, concernant Léonora Dori Galgaï [1568-1617], auteure de :
« [Elle] fut réputée sorcière. Ce n’était qu’une hystérique. » 1738
Femmes (« Hystériques ») (6) : 1997. Les Marie pas claires publient Hystériques et fières de l’être ! Parole de Lesbiennes. 1739 (Cf. Femmes. Lesbiennes)
-------------
Femmes (Identités) : (24 avril) 2017. Lu, écouté sur France Culture :
« Sœur, travailleuse, compagne, citoyenne, mère, artiste... ’la femme moderne est susceptible d'une multiplicité de définitions’. » 1740
Ne définir les femmes que par une multiplicité d’identités, c’est s’interdire d’interroger les différents pouvoirs qui les assignent ou non à ces diverses fonctions, c’est s’interdire de dévoiler les structures politiques patriarcales qui définissent ces identités ; dès lors invisibilisées, elles ne peuvent plus être nommées, différenciées, analysées, dénoncées.
En sus, poser d’emblée ces identités multiples, c’est aussi, sinon nier, du moins rendre beaucoup plus difficile la recherche de la singularité de chaque femme.
Femmes (Images d’elles-mêmes) : Dans ce que les femmes reprochent aux hommes, se trouve aussi nécessairement l’image qu’elles se sont construites d’elles-mêmes, dont elles ont été dépendantes, dont elles ont payé le prix, en les ayant suivis, aimés, admirés, respectés, quittés.
Femmes (Imaginaire) : Dominé. Notamment par Bécassine, Delly, Berthe Bernage, Christophe (La famille Fenouillard), leurs prédécesseurs/euses et leurs avatars modernes. Curieusement - ou plutôt, non, dois-je dire par honnêteté - je n’arrive pas y intégrer la comtesse de Ségur, tandis que, avec du recul, je m’interroge : Le Prince Éric (ne vivant qu’entouré de beaux jeunes hommes solidaires, et bien peu progressiste) - qui ne fut jamais oublié - s’avéra-t-il un antidote ?
* Ajout. 27 juillet 2016. Je viens de relire Les petites filles modèles de la comtesse de Ségur : Oh là, là ! Que de dévoilements, que de refoulements…
Femmes (Impuissantes) : Les femmes, la moitié de la population, politiquement, en tant que telles, impuissantes. (Cf. Hommes. « Impuissants », Politique)
* Ajout. 18 février 2018. Je lis autrement, sous l’angle de ce prisme de vue, le titre du livre [2008] de Mariette Sineau : La force du nombre. Femmes et démocratie présidentielle. 1741
Femmes (« Inactives ») : (1er avril) 1835. Lettre d’Angélique Arnaud [1797-1884] à Caroline Simon [1802-1848] :
« […] Nous voulons bien souffrir, mais souffrir à notre manière. […] Toi, Caroline, tu aurais accepté les périls de la navigation, les privations qui t’auraient escorté sur la terre d’Égypte [projet Saint-simonien], les veilles d’un hospice de charité. Et l’inaction t’abat. Tu tournes contre toi-même toute l’inactivité de ton esprit et de ton cœur. Je connais bien cette position, amie. J’ai eu des jours où j’aurais préféré les émotions de la persécution, la perspective de l’échafaud au calme plat qui m’environnait, où j’aurais changé la paix de mon existence contre la plus orageuse des destinées. » 1742
Femmes (Infantilisation) : (12 septembre) 1760. Voltaire [1694-1778] débute cette lettre à madame du Deffand [1697-1780] par cette phrase [Il a 66 ans ; elle, 63 ans] :
« Vous êtes un grand et aimable enfant, Madame. » 1743 (Cf. Langage. Féminisation du langage, Politique. Infantilisation)
Par ordre chronologique. Femmes. Infirmières :
Femmes (Infirmières) (1) : 1855. Léon Tolstoï [1828-1910], dans Les récits de Sébastopol, auteur de :
« Des infirmières dont le visage paisible exprimait non cet apitoiement futile, maladif et larmoyant qui est le fait des femmes, mais une sympathie pratique et agissante, allaient, venaient, enjambant les blessés, portant des remèdes, de l’eau, des pansements, de la charpie, parmi les capotes et les chemises sanglantes. » 1744
Femmes (Infirmières) (2) : 1954. Médecin-commandant Grauwin [1914-1989], dans J’étais médecin à Dien-Bien-Phu, auteur de :
« Appelé un jour à griffonner ‘quelque chose’ sur le livre d’or des ambulancières de Cao-Bang, j’écrivais : ‘Le combattant qui tombe, blessé, devient pour vous une sorte de demi-dieu qui a tous les droits’. » 1745 (Cf. Droit, Patriarcat, Politique, Guerre. Femmes)
-------------
Femmes (Inuits) : (mai) 2024. Je lis dans la rubrique Revues du Monde Diplomatique (p.26) que dans La chronique d’Amnesty International (N°. 449. avril 2024) :
« À la fin des années 1960, le gouvernement danois faisait poser des stérilets à des milliers de jeunes Inuites. »
Femmes. « Intellectuelles » :
Femmes (« Intellectuelles ») (1) : Pour paraphraser Jean-Jacques Rousseau [1712-1778] qui constatait, et sans doute entérinait, l’analyse selon laquelle :
« [Les femmes] sont comme des courbes dont les sages sont les asymptotes ; ils s’en rapprochent sans cesse, mais n’y touchent jamais. » 1746, on pourrait encore en France, en 2016, écrire : Les intellectuelles sont les asymptotes des intellectuels : elles s’approchent sans cesse d’eux mais ne les touchent jamais. (Cf. Hommes. « Intellectuels », Féministes. « Intellectuelles »)
* Ajout. 30 août 2023. Ou : rarement ? (Poursuivre)
Par ordre chronologique. Femmes. « Intellectuelles » :
Femmes (« Intellectuelles ») (1) : 1929. Ivy Compton-Burnett [1884-1969], dans Frères et sœurs, auteure de :
« La sœur passait pour intellectuelle et donc satisfaite de son célibat. » 1747
Femmes (« Intellectuelles ») (2) : 1999. Geneviève Fraisse, auteure de :
« Les femmes sont dans une situation d’humiliation chronique. Quand j’étais à la Délégation aux droits des femmes, on disait de moi que j’étais une universitaire ; je reprenais : ‘Non, une intellectuelle’. Cela a l’air prétentieux. Mais si c’était un homme, reconnu pour ses travaux, identifié à ses prises de position, arrivé à un poste de délégué interministériel, il serait d’emblée apparu comme un intellectuel. Tout naturellement. Comme on dit d’Emmanuel Todd ou de Pierre Bourdieu [1930-2002] qu’ils sont des intellectuels. En me qualifiant d’universitaire, avec ce que cela sous-entend de besogneux, de méritant, de bonne élève, on dit : ‘Elle a professionnellement réussi’, mais on ne dit pas : ‘Elle pense, elle sait.’ » 1748 (Cf. Hommes. « Intellectuels »)
Femmes (« Intellectuelles ») (3) : 1999. Roselyne Bachelot, auteure de :
« Une des raisons pour lesquelles on ne se bat pas suffisamment contre les violences faites aux femmes, c’est parce que les femmes les plus intellectuelles, les plus éduquées, refusent de s’emparer du dossier (sic). D’une certaine manière, elles considèrent qu’y toucher va les salir, les dévaloriser. Cela, je l’ai très souvent entendu chez des élues locales. » 1749 (Cf. Femmes. « Politiques ». Bachelot Roselyne, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Intelligentes :
Femmes (Intelligentes) (1) : (février) 1656. Pierre Costar [1603-1660], archidiacre, correspondant, ami de madame de Lafayette [1634-1693], lui écrit :
« Quelque fier que je sois naturellement, je n’aurais pas de peine à vous demander pardon d’avoir jugé si peu favorablement la force de votre esprit […]. » 1750 (Cf. Relations entre êtres humains. Pardon)
Quatre siècles après, certains pourraient s’inspirer de cet hommage…
Femmes (Intelligentes) (2) : 1859. John Stuart Mill [1806-1873], dans De la liberté, auteur de :
« Qui peut calculer ce que perd le monde dans cette multitude d’intelligences prometteuses doublées d’un caractère timide qui n’osent pas mener à terme un enchaînement d’idées hardies, vigoureux et indépendant, de peur d’aboutir à une conclusion jugée irréligieuse ou immorale ? » 1751 (Cf. Hommes. Féminisme. Stuart Mill John, Féminismes, Économie. Calcul)
Femmes (Intelligentes) (3) : 1891. Émile Zola [1840-1902], dans L’argent, présente au début du livre Mme Caroline, qui, dans le ‘couple’ qu’elle formait avec son frère bien aimé :
« Dans leur ménage, elle était un peu l’homme. »
- « Elle parlait quatre langues, elle avait lu les économistes, les philosophes, passionnée pour les théories socialistes et évolutionnistes : mais elle s’était calmée […]. » Et voici la fin du livre :
« Puis, lorsqu’elle tourna dans la rue chaussée d’Antin, elle ne raisonna même plus ; la philosophe, en elle, la savante et la lettrée, abdiquait, fatiguée de l’inutile recherche des causes ; elle n’était plus qu’une créature heureuse du beau ciel et de l’air doux goûtant l’unique jouissance de se bien porter, d’entendre ses petits pieds de femmes battre le trottoir. » 1752 (Cf. Culture. Livres, Patriarcat)
Femmes (Intelligentes) (4) : 1897. Baudelaire [1821-1867], dans Fusées, auteur de :
« L’amour des femmes intelligentes, un plaisir de pédéraste. » 1753 (Cf. Culture. Baudelaire, Hommes. Homosexuels, Patriarcat. Baudelaire)
Femmes (Intelligentes) (5) : 1921. Marcel Proust [1871-1922], dans Sodome et Gomorrhe, auteur de :
« On ne peut pas dire qu’elle [madame de Cambremer] fût bête ; elle débordait d’une intelligence que je sentais m’être complètement inutile. » 1754 (Cf. Femmes. Utiles, Penser. Utilitarisme, Patriarcat)
Femmes (Intelligentes) (6) : 1975. Jean Monnet [1888-1979], dans ses Mémoires, auteur de :
« Mlle Milliard [Berthe. 1877-1924, « fidèle secrétaire » de Léon Bourgeois [1851-1925] était une personne que la nature n’avait favorisée que pour l’intelligence qu’elle avait exceptionnelle. » 1755
N.B. Cf. la longue note, la concernant, du Musée Social. (Cf. Culture. Musées)
Femmes (Intelligentes) (7) : (12 octobre) 1993. Entendu ainsi qualifier par un professeur à la Sorbonne une paysanne :
« Elle était loin d’être sotte ». Peu après, un autre professeur à la Sorbonne évoqua « une brave femme ». 1756 (Cf. Culture. Sorbonne)
Femmes (Intelligentes) (8) : (11 décembre) 2015. Danielle Mérian, avocate, auteure de […] :
« Vous connaissez des femmes intelligentes qui ne sont pas féministes ? » 1757 (Cf. Hommes. Féminismes)
Femmes (Intelligentes) (9) : (4 mars) 2017. Lu dans Le Monde :
« Dans son ouvrage Les faiseuses d’histoire [La Découverte. 2011], la philosophe et mathématicienne, Laurence Bouquiaux raconte avec subtilité cette manière de se monter ‘soumise et docile’ pour faire oublier qu’on ne se sent pas tout à fait à sa place. Elle évoque ainsi, dans les milieux universitaires ‘les bonnes élèves, bosseuses, voire besogneuses, qui savent qu’elles sont tolérées pour autant qu’elles restent inoffensives.’
‘Nous [les femmes] laissons parler les hommes (dans les réunions, dans les colloques et même, peut-être, dans les livres) parce que beaucoup de nos collègues ne nous pardonneront d’être intelligentes que si nous renonçons à être brillantes. » 1758 (Cf. Hommes. « Intellectuels ». France. Fraisse Geneviève, Relations entre êtres humains. Pardon, « Sciences » sociales)
Femmes (Intelligentes) (10) : (3 décembre) 2020. Entendu :
« Elle devint intelligente par curiosité ».
Femmes (Intelligentes) (11) : (6 août) 2022. Entendu sur France Culture :
« Elle a très peu de choses pour elle, excepté la puissance de son intelligence. »
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. « Jalouses » :
Femmes (« Jalouses ») (1) : 1877. Anna Karénine, dans le livre du même nom de Léon Tolstoï [1828-1910], auteure de :
« Je ne suis pas jalouse, je suis insatisfaite […] » 1759 Que de vérité…
Femmes (« Jalouses ») (2) : 2000. Françoise Giroud [1916-2003], dans Arthur ou le bonheur de vivre, auteure de :
« […] Ainsi fut écrit Mon très cher amour [1994], sans aucune référence biographique, l'histoire d’une jalousie, alors que je ne suis pas jalouse, née de rien… »
Le déni - la cicatrice - d’une femme si douloureusement abandonnée qu’elle faillit en mourir. L’explication - a apriori absurde - qu’elle en donne est intéressante. 1760
Femmes (« Jalouses ») (3) : 2011. Jacqueline Kennedy [1929-1994], dans Conversations inédites avec Arthur. M. Schlesinger, auteure de :
« Je n’ai jamais été jalouse. » 1761
Que cinq petits mots peuvent cacher, et comme ils sont, d’emblée, si manifestement faux.
À moins que le terme ne veuille rien dire…
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Jeunes filles :
Femmes (Jeunes filles) (1) : 1726. Marivaux [1688-1763], dans La vie de Marianne, auteur de :
« Je n’ai de ma vie été si agitée. Je ne saurais vous définir ce que je sentais.
C’était un mélange de trouble, de plaisir et de peur ; oui, de peur, car une fille qui en est là-dessus à son apprentissage ne sait point où tout cela mène : ce sont des mouvements inconnus qui l’enveloppent, qui disposent d’elle, qu’elle ne possède point, qui la possèdent ; et la nouveauté de cet état l’alarme. Il est vrai qu’elle éprouve du plaisir, mais c’est un plaisir fait comme un danger, sa pudeur même en est effrayée ; il y là quelque chose qui la menace, qui l’étourdit et qui prend déjà sur elle. » 1762
Il est des analyses, si fines, si justes, si vraies, si neuves, qu’elles font par elles-mêmes tomber tant d’autres.
Femmes (Jeunes filles) (2) : 1783. Choderlos de Laclos [1741-1803] dans Les liaisons dangereuses - Lettre [4] du vicomte de Valmont à la marquise de Merteil - auteur de :
« Que me proposez-vous ? De séduite une jeune fille qui n’a rien vu, ne connaît rien ; qui, pour ainsi dire, me serait livrée sans défense ; qu’un premier homme ne manquera pas d’enivrer et que la curiosité mènera peut-être plus vite que l’amour. Vingt autres peuvent y réussir comme moi. »
Femmes (Jeunes filles) (3) : (18 avril) 1794. Benjamin Constant [1767-1830] écrit à Isabelle de Charrière [1740-1805], concernant Wilhelmina Heyne [1778-1861], alors âgée de 15 ans :
« Je me suis retrouvé chez Charlotte [?] avec cette différence que la personne [sus-citée] n’était point ce que cet assemblage [!] promettait, mais m’a paru assez spirituelle, et assez sensée. Il faut tours faire des allowances [« montrer des égards »] à une fille de professeur allemand. Il y a des traits distinctifs qu’elles (sic) ne manquent jamais d’avoir. Mépris pour l’endroit qu’elles habitent, plaintes sur le manque de société, sur les étudiants qu’il faut voir, sur la sphère étroite et monotone où elles se trouvent, prétentions, et teinte plus ou moins forcée de romanesquerie, voilà l’uniforme de leur esprit, et Melle Heyne, prévenue sur ma visite, avait eu soin de se mettre en uniforme. Mais, à tout prendre, elle est plus aimable et beaucoup moins ridicule que les 19/20ème de ses semblables. » 1763
Femmes (Jeunes filles) (4) : 1815. Jane Austen [1775-1817], dans Emma, auteure de :
« La nature humaine est si bien disposée envers ceux ou celles dont la situation présente quelque intérêt, qu’une jeune fille est assurée de bénéficier de l’indulgence générale pour peu qu’elle meure ou se marie. » 1764 Terrible… et sûrement vécu par l’auteure.
Femmes (Jeunes filles) (5) : 1830. Honoré de Balzac [1799-1850], dans Gobseck, auteur de :
« Écoutez, mon enfant, si vous avez confiance en ma tendresse, laissez-moi vous guider dans la vie. À dix-sept ans, l’on ne sait juger ni de l’avenir, ni du passé, ni de certaines considérations sociales. » 1765
Femmes (Jeunes filles) (6) : 1844. La comtesse Merlin [1789-1852], dans ses Souvenirs et Mémoires, auteure de :
« J’étais dans un âge trop tendre pour deviner ce qu’une jeune fille peut avoir à redouter d’un homme de mœurs légères. »
Combien de femmes sont-elles concernées par ce constat, qui ne se limite pas aux hommes « de mœurs légères » ? Toutes ? 1766 (Cf. Politique. Lois. Mœurs)
Femmes (Jeunes filles) (7) : 1860. Je lis dans la note de la page 322 du Moulin sur la Floss [1860] de George Eliot [1819-1880], ce passage - lisible sur le manuscrit mais supprimé à la publication - :
« Une jeune fille dont l’apparence n’a rien de saisissant, qui ne sera jamais une Sapho, ni une Mme Roland, ni quelqu’un d’autre de très remarquable pour le monde, peut, cependant, renfermer en elle, comme la graine d’une plante vivante, des forces qui réussiront à se frayer un chemin, souvent, d’une manière violente, fracassante. » 1767 (Cf. Femmes. Apparence. Écrivaines. Eliot George)
Femmes (Jeunes filles) (8) : 1892. Henry Gréville [1842-1902], auteur de : Instruction morale et civique des jeunes filles. [E. Weil et G. Maurice] (Lire) (Cf. Patriarcat, Politique. Morale)
Femmes (Jeunes filles) (9) : 1893. Alexis de Tocqueville [1805-1859], dans ses Souvenirs, évoque La fête de la Concorde [21 mai 1848] et écrit :
« Puis vint le char et enfin les jeunes filles vêtues de blanc. Il y en avait là au moins trois cents qui portaient leur costume virginal d’une façon si virile qu’on eût pu les prendre pour des garçons habillés en filles. […] » Puis, il évoque « des commères qui avaient des bras fort nerveux […] plus habituées, je pense, à pousser le battoir qu’à répandre des fleurs. » 1768 (Cf. Corps. Bras, Hommes. « Virils »)
Des jeunes filles ou des « commères » ?
Femmes (Jeunes filles) (10) : 1896. Anton Tchékhov [1860-1904], dans Ma vie. Récit d’un provincial, auteur de :
« Seules les jeunes filles respiraient la pureté morale ; la plupart d’entre elles avaient des aspirations élevées, l’âme honnête, pure, mais elles ne comprenaient pas la vie et croyaient que l’on donnait des pots de vin par égard pour la valeur morale et, une fois mariées, ne tardaient pas à vieillir, à se laisser aller, et s’enlisaient sans espoir dans la fange d’une existence banale et bourgeoise. » 1769
Femmes (Jeunes filles) (11) : 1925. André Gide [1869-1951] écrit dans son Voyage au Congo : « [Le sultan] nous avait laissé avec un oncle (le frère du sultan défunt) et son fils, un superbe adolescent, réservé et timide comme une jeune fille. » 1770 (Cf. Enfants)
Femmes (Jeunes filles) (12) : 1966. François Mauriac [1885-1970], dans ses Mémoires intérieurs, écrit :
« Deux jeunes filles, très belles, une claire et une sombre, nous sont arrivées un matin du pays basque. » 1771 (Elles voulaient l’interroger sur les poèmes de Francis James. [1898-1938]) (Cf. Corps, Femmes. Beauté)
Femmes (Jeunes filles) (13) : 2012. Jacqueline de Romilly [1913-2010], dans le livre Jeanne qu’elle a consacré à sa mère, évoque « les yeux souvent baissés de la jeune fille comme il faut. » 1772 (Cf. Corps. Yeux, Femmes. Remarquables. Romilly Jacqueline de)
Femmes (Jeunes filles) (14) : (24 mars) 2017. Une jeune fille interrogée par Cyril Hanouna, dans l’émission TPMP [Touche pas à mon Poste] :
« C’est quoi ton type de mec ? » répondit :
« N’importe ». 1773
* Ajout. 13 juillet 2019. Penser à l’expression : « Penser aux garçons ».
Femmes (Jeunes filles) (15) : (23 janvier) 2018. Entendu, sur Radio courtoisie (radio d’extrême-droite) dans l’émission consacrée au respect de la langue française « manipulée pour détruire la France » [concernant la distinction à établir entre « il en va » et « il y va »] proposer l’exemple suivant :
« Il en va des jeunes filles comme des roses, elles se fanent. » 1774 (Cf. Femmes. Beauté, Langage. Langue. Française)
N.B. « Se faner » : « Sécher en perdant sa couleur, sa consistance ; perdre sa fraicheur, son éclat »
Femmes (Jeunes filles) (16) : 2018. Attirée par le titre : Jeune Fille, j’achète le numéro 45 [1983] la « revue de poésie », Vagabondages. 56 poèmes - dont aucun rédigé par une jeune fille - sont publiés : je cherche en vain un vers, des vers, une strophe qui me toucherait, qui m’aiderait à mieux me remémorer, mieux ressentir, mieux comprendre…
Femmes (Jeune filles) (17) : (20 janvier) 2021. Je lis dans un article de Sorj Chalandon du Canard enchaîné :
« Elle se dit ‘garçon manqué’ (fille réussie donc ?) »
Que n’a-t-on pensé plus tôt à cette liaison, qui eut évité tant d’injures, de malaises, de recherches vaines - car mal posées - d’identités ? 1775 (Cf. Enfants, Langage. Genre)
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Jolies :
Femmes (Jolies) (1) : (22 novembre) 1895. Jules Renard [1864-1910], dans son Journal, auteur de :
« - Comme vous êtes jolie !
- Oui. Il y a des hommes qui aiment ça. » (Cf. Dialogues)
Femmes (Jolies) (2) : 2003. Lu dans Françoise Giroud [1916-2003]. Une ambition française de Christine Ockrent :
« En juillet 1950, Françoise prodigue ses conseils aux lectrices de Elle : ‘Être une jolie femme, c’est une résolution qu’il faut prendre … [Elle] s’entretient comme les muscles : par l’entrainement quotidien… […] Être jolie est un devoir. Vis-à-vis de votre mari, de vos enfants… Si vous vous sentez jolie, vous vous sentirez meilleure, vous serez meilleure. » 1776
-------------
Femmes (Jouir) : (février-avril) 1791. Je lis, dans les Lettres bougrement patriotiques de la mère Duchêne, journal de femmes « patriotes » ceci :
« Le diable ne sera pas toujours à notre porte. Nous méritons bien jouir ; car nous avons bougrement souffert… » 1777 (Cf. Hommes. Jouir, Histoire. Révolution française)
Femmes (Khmers rouges) : 2011. Entendu dans le film de Rythy Panh, Duch, le maître des forges de l’enfer, qu’au Cambodge, sous le régime des Khmers rouges au pouvoir [1975-1979], on n’employait pas le mot « femme » car il « avait une connotation sexuelle » ; on employait le mot « famille » qui, lui, « avait une connotation révolutionnaire ».
De fait, le régime Khmer tout à la fois imposait des mariages selon leur conception de « la révolution » et, en recomposant leur conception de « la famille » détruisait hommes, femmes, enfants. C’était moins « la connotation sexuelle » évoquée qui était combattue, c’était la singularité dont était aussi porteuse l’évocation de « la femme ». (Cf. Culture. Cinéma, Femmes, Famille, Penser. Concept, Sexes […])
Femmes (Lâcheté) : 1971. Doris Lessing [1919-2013], dans sa préface au Carnet d’or, auteure de :
« Ce que les femmes disent entre femmes, quand elles grommellent dans leur cuisine, se plaignent, papotent, ou ce qu’elles manifestent clairement dans leur masochisme, c’est bien souvent la dernière chose au monde qu’elles articuleraient à voix haute - un homme pourrait les entendre. Cette lâcheté des femmes s’explique par leur condition de semi esclavage qui a duré si longtemps. Le nombre de femmes prêtes à se battre pour ce que vraiment elles pensent, éprouvent, vivent auprès d’un homme qu’elles aiment est vraiment infime. La plupart des femmes s’enfuient comme des petits chiens sous un jet de pierre dès qu’un homme leur dit : ‘Tu n’es pas féminine, tu es agressive, tu menaces ma virilité’.
Je crois fermement qu’en épousant, ou même en prenant au sérieux un homme qui use de ces menaces, une femme mérite tout ce qui peut lui arriver. Car cet homme-là est une brute… […] » 1778
Critique, pertinente ; mais pour être légitime, progressiste, n’aurait-il pas fallu que les rapports de domination soient préalablement posés ? Ne pas les poser, n’est-ce pas les entériner ? (Poursuivre) (Cf. Femmes. « Féminin », Hommes. « Virils », Langage. Mots. Critique de : « Progressiste », Politique. Esclavage)
Femmes. Lesbiennes :
Femmes (Lesbiennes) (1) : Consacrer des items (comme je fais ici) aux femmes dites lesbiennes, est-ce consacrer l’hétérosexualité comme norme ? Oui.
Aborder le lesbianisme comme je le fais ici ne permet pas d’aborder l’analyse de la question de la contrainte à l’hétérosexualité. Plus encore, elle l’évacue. Mais cet Abécédaire, en sa forme actuelle, le peut-il ?
* Ajout. 4 février 2023. Pourquoi ne le pourrait-il pas ? C’est à moi d’y parvenir.
Femmes (Lesbiennes) (2) : Une femme lesbienne à une amie hétérosexuelle :
« Mais tu ne te rends pas compte de ce dont tu te prives ! »
L’évidence de cette phrase m’a souvent interrogée, à plus d’un titre…
Femmes (Lesbiennes) (3) : Elle était poétesse, épouse de procureur, mère de six enfants, féministe, délicieuse : au cours d’une discussion, elle déclara si simplement que l’un des regrets de sa vie était de n’avoir pas vécu de relation lesbienne. Un bon et beau souvenir, plein de leçons…
Femmes (Lesbiennes) (4) : Elle refusait d’être qualifiée de féministe de crainte d’être reconnue comme lesbienne. D’un autre temps ? Pourtant vécu.
Femmes (Lesbiennes) (5) : C’est en lisant la correspondance d’Élisabeth Lacoin, dite Zaza [1907-1929], et notamment ses lettres écrites à ses deux amies Geneviève de Neuville et Simone de Beauvoir [1908-1986] que je me suis mieux rendue compte à quel point qualifier quelqu’un-e d’homosexuel-el / lesbienne [ou non] était certes grossier, mais surtout si terriblement restrictif, répressif ? ; et que, concernant les relations entre Simone de Beauvoir et Élisabeth Lacoin, les supputations, certes légitimes, autour d’ « amours saphiques », à fortiori l’emploi du terme de « couple » trahissant leurs vies. 1779
Femmes (Lesbiennes) (6) : S’interroger pour ‘savoir’ si Rosa Bonheur [1822-1899] était ou non lesbienne, pouvait ou non être qualifiée comme telle, ne m’intéresse que peu. Je m’interroge même si j’oserais porter un jugement en la matière. L’interrogation en revanche me permet de réfléchir plus avant sur la nature, les raisons et les significations de la question.
Femmes (Lesbiennes) (7) : Les lesbiennes ont été politiquement détachées, dissociées, séparées des femmes et des féministes pour être intégrées dans, rattachées à absorbées par les L.G.B.T., etc…
Mais elles pouvaient aussi, dans la confusion délibérée du sigle-absorbe-tout, y être incluses.
Femmes (Lesbiennes) (8) : L’amour d’une femme pour une femme dit-il « l’homosexualité » ? Non.
Par ordre chronologique. Femmes. Lesbiennes :
Femmes (Lesbiennes) (1) : 1796. Denis Diderot [1713-1784], dans La religieuse, auteur de :
« ‘- Ah, ma chère Mère, serais-je assez heureuse pour avoir quelque chose qui vous plût et qui vous apaisât ?’
Elle baissa les yeux, rougit et soupira ; en vérité, c’était comme un amant. » 1780
Les relations entre la religieuse et sa Supérieure me sont apparues comme la partie le plus faible du livre : l’une étant par trop naïve, l’autre par trop transparente et dès lors, les deux, peu crédibles, et Diderot, par trop long et complaisant. (Cf. Culture. Livres, Femmes. Naïves, Hommes. Écrivains)
Par ordre chronologique. Femmes. Lesbiennes. Émile Zola :
Femmes (Lesbiennes) (2) : 1880. Émile Zola [1840-1902], dans Nana, auteur de :
« Et, dans le lit, elle prit tout de suite Nana entre ses bras afin de la calmer. Elle ne voulait plus entendre le nom de Fanfan ; chaque fois qu’il revenait sur ses lèves de son amie, elle l’y arrêtait d’un baiser, avec une jolie moue de colère, les cheveux dénoués, d’une beauté enfantine et noyée d’attendrissement. Alors, peu à peu, dans cette étreinte si douce, Nana essuya ses larmes. Elle était touchée, elle rendait à Satin ses caresses. Lorsque deux heures sonnèrent, la bougie brûlait encore ; toutes deux avaient de légers rires étouffés, avec des paroles d’amour. » 1781 (Cf. Relations entre êtres humains. Baiser. Caresses. Amour)
Femmes (Lesbiennes) (3) : 1880. Émile Zola [1840-1902], dans Nana, auteur de :
« Au milieu de ces messieurs, de ces grands hommes, de ces vielles honnêtetés, les deux femmes, face à face, échangeaient un regard tendre, s’imposaient et régnaient, avec le tranquille abus de leur sexe et leur mépris avoué de l’homme. » 1782 (Cf. Politique. Abus, Sexes. Femmes)
Femmes (Lesbiennes) (4) : (9 février) 1885. Émile Zola [1840-1902] écrit à René Maizeroy [1856-1918] qui venait de publier Deux amies [pour lequel il sera poursuivi et condamné pour ‘outrages aux bonnes mœurs’] :
« Je veux vous dire que la hardiesse simple et enveloppée de votre oeuvre m’a fait grand plaisir. Vous êtes allé très loin, avec une si belle assurance, que rien ne choque [l’auteur parle de ‘’vice’]. C’est pourtant à une effroyable plaie que vous avez touché, et très réelle, et sans cesse élargie. Je vous félicité de votre courage. » 1783
-------------
Femmes. Lesbiennes. Marcel Proust :
Femmes (Lesbiennes. Proust Marcel) (5) : 1921. Marcel Proust [1871-1922], dans Sodome et Gomorrhe, auteur de :
« (Jaloux des relations d’Albertine) […] Car, comme toutes les femmes qui ont plusieurs choses dans leur existence (sic), elle avait ce point d’appui qui ne faiblit jamais : le doute et la jalousie. » 1784 (Cf. Femmes, Hommes. Jaloux. Mépris des femmes, Patriarcat)
Femmes (Lesbiennes. Proust Marcel) (6) : 1921. Marcel Proust [1871-1922], dans Sodome et Gomorrhe, auteur de :
« Quant à Albertine, se mettant à causer ave moi sur le canapé où nous étions assis, elle avait tourné le dos aux deux jaunes filles de mauvais genre. » 1785 (Cf. Langage. Genre)
Femmes (Lesbiennes. Proust Marcel) (7) : 1921. Marcel Proust [1871-1922], dans Sodome et Gomorrhe, auteur de :
« Albertine incitait Andrée à des jeux qui, sans aller bien loin (sic) n’étaient peut-être pas tout à fait innocents. […] Je venais de voir Andrée dans un de ces mouvements gracieux qui lui étaient particuliers, poser câlinement sa tête sur l’épaule d’Albertien, l’embrasser dans le cou enfermant à demi les yeux. […] » 1786
Femmes (Lesbiennes. Proust Marcel) (8) : 1921. Marcel Proust [1871-1922], dans Sodome et Gomorrhe, auteur de :
« Albertine amie de Melle Vinteuil et de son amie, pratiquante professionnelle du saphisme [!] […]. » 1787
Femmes (Lesbiennes. Proust Marcel) (9) : 1921. Marcel Proust [1871-1922], dans Sodome et Gomorrhe, auteur de :
« […] Ce qui maintenant me déchirait le cœur en pensant qu’Albertine irait peut-être à Triste, c’était qu’elle y passerait la nuit de Noël avec l’amie de Melle de Vinteuil […]. » 1788
Femmes (Lesbiennes. Proust Marcel) (10) : 1921. Marcel Proust [1871-1922], dans Sodome et Gomorrhe, auteur de :
« Et alors, calculant l’avenir, pensant bien ma volonté, comprenant qu’une telle tendresse d’Albertine pour l’amie de Melle de Vinteuil et pendant si longtemps, n’avait pu être innocente, qu’Albertine avait été initiée [!], et autant que tous ses gestes me le montraient, était d’ailleurs née avec la prédestination au vice que mes inquiétudes n’avaient que trop de fois pressenti, auquel elle n’avait jamais dû cesser de se livrer […], je dis à ma mère : […] ‘il faut absolument que j’épouse Albertine [!]’. » 1789
-------------
Femmes (Lesbiennes) (11) : 1937. Les dossiers du FBI concernant Erika Mann [1905-1969] la qualifient de « perverse sexuelle ». 1790
Femmes (Lesbiennes) (12) : (30 novembre) 1959. Julien Green écrit [1900-1998], dans son Journal :
« Hier, parlé avec Anne [sa sœur. 1891-1979] de Miss H. que j’ai connue dans mon enfance. C’était une personne très virile et dont la taille eût fait honneur à un grenadier. Elle tenait à Passy, une pension de jeunes filles qui l’adoraient. Je me souviens de son rire explosif, de sa voix profonde, de ses très beaux cheveux ondulés. Elle était bonne et généreuse. Quand elle est morte, avant la première guerre mondiale, sa préférée, Mademoiselle, charmante et délicate personne, se mit en grand deuil et se plaça, à l’église, avec la famille, avouant par son effrayant chagrin tout ce qu’on avait supposé. » 1791 (Cf. Femmes. Jeunes filles, Hommes. « Virils »)
Femmes (Lesbiennes) (13) : 1962. Je lis dans Le carnet d’or de Doris Lessing [1919-2013] :
« […] Est-il possible qu’ils nous aient crues lesbiennes ?
Elle avait déjà envisagé cette possibilité et s’en était amusée. Mais elle dit : ‘Non. S’ils nous avaient crues lesbiennes, cela les aurait attirés, ils auraient grouillé tout autour de nous. Tous les hommes que j’ai connus parlaient avec délectation, consciemment ou non, des lesbiennes. C’est un aspect de leur incroyable naïveté : ils se voient comme les sauveurs de ces femelles perdues’. » 1792 (Cf. Êtres Humains. Naïveté, Femmes. « Femelles ». « Perdues »)
Femmes (Lesbiennes) (14) : 1966. Violette Leduc [1907-1972], concernant Thérèse et Isabelle [Gallimard. Folio. 120p.], dans ce supposé amour lesbien entre deux collégiennes, tout sonne faux : les personnages, les circonstances, les dialogues, les plaisirs… Et vide.
Femmes (Lesbiennes) (15) : (10 mars) 1971. Lu dans Génération MLF [1968-2008] :
« Des femmes du MLF, choquées par le thème de l’émission radiophonique de Ménie Grégoire [1919-2014], ‘L’homosexualité, ce douloureux problème’, interviennent en direct et interrompent l’émission enregistrée en public. S’insurgeant contre la réduction de l’homosexualité à ‘un douloureux problème’, elles scandent : ‘Nous ne souffrons pas ! Liberté !’ […] » 1793 (Cf. Femmes. Grégoire Ménie, Hommes. Homosexualité)
Femmes (Lesbiennes) (16) : 1980. Lu dans l’article Une femme en prison publié dans Femmes et Russie. 1980 :
« […] La moitié des femmes à peu près entretiennent d’une manière ou d’une autre, des relations amoureuses entre elles. […]
Le plus souvent, à cause du très bas niveau de développement socio-culturel dans les prisons, les relations entre femmes de la prison sont modelées sur le stéréotype connu des relations entre homme et femme. Une femme plus masculine par son caractère ou sa physiologie, ou parfois à cause de son prestige social, joue le rôle de l’homme ou du mari. On l’appelle ‘le haut’. L’autre souvent plus faible et féminine, devient l’épouse et on l’appelle ‘le bas’. Il y a d’autres adjectifs beaucoup plus grossiers et imagés ; ils ne seront pas cités ici. Elles forment un couple, une famille. Le ’mari’ défend l’autre, la protège, lui assure son prestige, la ‘femme’ dirige ‘le ménage, à l’échelle de la prison. On donne au ‘mari’ un prénom masculin : si elle s’appelle Petrova par exemple, on l’appellera Petrov, etc. » 1794 (Cf. Femmes, Hommes, Famille. Couple, Langage, Patriarcat, Sexes […])
Femmes (Lesbiennes) (17) : 1992. Lu dans un Dictionnaire des femmes célèbres concernant Djuna Barnes [1892-1982] : Concernant ses relations avec la sculptrice Thelma Wood [1901-1910], elle dit :
« Je ne suis pas lesbienne, j’aimais Thelma. » 1795
Élargit considérablement le regard porté sur les relations entre femmes.
Femmes (Lesbiennes) (18) : 1997. Lu dans le petit livre intitulé Hystériques et fières de l’être. Parole de lesbiennes, un « Questionnaire » (rédigé par Caroline, Sandra, Sarah), intitulé : « Quelle lesbienne êtes-vous », et notamment sa cinquième question intitulée : « Votre vision de l’hétérosexualité ».
Les sept alternatives étaient les suivantes : « a) : L’hétéro quoi ? / d) : un vice comme un autre / b) : de la collaboration pure et simple / f) : un déguisement qui vous colle à la peau depuis l’enfance / c) : une question personnelle, mais pas si politique que ça / e) Un homme qui couche avec une femme / g) Pour la procréation, une seule solution !» 1796
- « Vice » ; « Collaboration » ; « Question » ; « Coucher » ; « Procréation » …
Femmes (Lesbiennes) (19) : 2007. Françoise Gaspard, dans son texte intitulé Être lesbienne : invisibilité, caricatures et violences, auteure, notamment, de :
« Un couple de femmes devant nécessairement reproduire une alliance singeant l’hétérosexualité… » 1797
Des années plus tard, écrirait-elle cela ainsi ? (Cf. Famille. Couple)
Femmes (Lesbiennes) (20) : 2011. Marie-Paule Belle chante : Celles qui aiment elles.
« En secret sous leur veste / Se caressent des yeux / Sans un geste / On lit sur la photo / Où elles sourient, tranquilles / Juin 1950 à Belle-Île / C'était pas facile dans ces années-là / Et en ville on en parlait tout bas / Les mots de haine, / Ceux qu'on entend à peine / Les ont fait pleurer bien des fois / Suivre le modèle / Impossible pour celles / Qui aiment elles/ Et moi qui sais le prix/ De leurs amours rebelles/ Moi qui suis mi-voyou / mi-voyelle / Si j'ai choisi d'aimer / Un triangle isocèle/ Je peux vivre au grand jour / Grâce à elle/ C'était pas facile dans ces années-là / Et en ville on les montrait du doigt / Les mots qui glissent, / Les regards en coulisse / Les ont fait douter d'elles,… / Pour toucher le ciel / Elles avaient besoin d'elles / Besoin d'elles/ Suivre le modèle / Impossible pour celles / Qui aiment elles / Elles se tiennent la main / En secret sous leur veste / Se caressent des yeux / Sans un geste / On lit sur la photo / Où elles sourient, tranquilles / Juin 1950 à Belle-Île. »
Femmes (Lesbiennes) (21) : 2012. Thérèse Clerc [1927-2016], dans le film Les invisibles, auteure de :
« […] Comment une vie bascule à travers une main qui s’aventure… » […] 1798 (Cf. Femmes. Remarquables. Clerc Thérèse)
Femmes (Lesbiennes) (22) : 2016. Benoîte Groult [1920-2016], auteure de :
« Je n’ai jamais été douée pour être lesbienne. » 1799
Femmes (Lesbiennes) (23) : 2016. Lu sur Wikipédia concernant les relations entre Isadora Duncan [1877-1927] et Eleonora Duse [1858-1924] :
« […] Elle passe [après la mort de ses deux enfants] plusieurs semaines dans un complexe au bord de la mer à Viareggio en compagnie de l'actrice Eleonora Duse. Le fait que Duse sortait tout juste d'une relation lesbienne avec la jeune rebelle féministe Lina Polletti alimenta les spéculations quant à la nature de la relation qui unissait Isadora à Duse. Néanmoins il ne fut jamais prouvé qu'elles furent engagées dans une relation amoureuse. »
En d’autres termes, pour Wikipédia, la question non résolue - devant rester à jamais une « spéculation » - aurait été de savoir si ces deux femmes auraient couché ensemble. Alors, elles mériteraient le qualificatif d’ « amoureuses », et pourraient être qualifiées de lesbiennes, ou du moins de bisexuelles. Ignoble. (Cf. Femmes. Remarquables. Duncan Isadora. Duse Eleonora. Rebelles, Sexes […])
Femmes (Lesbiennes) (24) : (3 janvier) 2017. Marianne James, animatrice de télévision, auteure, d’après le titre de : Elle, de :
« C’est mon drame de ne pas être lesbienne ». 1800
- À la lecture de l’article publié sur le net, je lis :
« Aujourd’hui, elle reconnait même qu’elle aurait pu ‘être séduite par une femme bien dans son corps et sensuelle. […] Si j’avais été lesbienne, j’aurais pu avoir des enfants, une famille. Car je ne fais pas peur aux femmes’. » (Cf. Femmes. Peur, Famille)
Femmes (Lesbiennes) (25) : (22 avril) 2017. Entendu sur France Culture une appréciation concernant Audre Lorde [1934-1992] :
« Elle adorait les femmes ». 1801
Toutes les femmes ?
Femmes (Lesbiennes) (26) : (17 mai) 2017. La liste EF-L ANEF [« Liste Études féministes »] informe du vernissage, le 1er juin 2017, à la Mairie du 4ème arrondissement de l’exposition intitulée : « Fières archives : documents autobiographiques d’homosexuels fin de siècle ».
Il n’est, sans ambiguïté, question que des « homosexuels » et de la « communauté homosexuelle ». Je me suis demandée si cette liste dite « féministe » qui publiait avec autant d'assurance une info excluant ici formellement les femmes, ici les lesbiennes, était ou non une première…
Une série de conférence suivra, dont l’une consacrés à « la mise en patrimoine des archives L.G.B.T ».
À une question posée, même jour, concernant la présence de « documents sur les homosexuelles », la réponse fut : « À charge de regrouper les mémoires vivantes dans une commission de l'association Grey Pride, je confirme que des témoignages de femmes seniors L.G.B.T+ sont actuellement enregistrées et archivées. »
La réponse est claire : l’histoire des luttes des femmes homosexuelles - un déni de l’histoire - est indissociable de la reconnaissance des dits L.G.B.T. (Cf. Êtres humains. « L.G.B.T », Hommes. Homosexuels, Féminismes. Archives, Histoire. Archives)
* Ajout. 30 octobre 2019. Qu’en est-il aujourd’hui ? à chercher.
Femmes (Lesbiennes) (27) : (26 octobre) 2018. Juliette (l’artiste) raconte en riant la réaction de Catherine Lara, elle-même artiste, répondant à la question de Michel Denisot :
« Ce que je regarde en premier chez un homme, c’est sa femme. » 1802 (Cf. Féminismes. Humour)
Femmes (Lesbiennes) (28) : (26 juin) 2019. Entendu dans une émission de France Culture consacrée aux sportives de haut niveau dénoncer « la crainte que les sportives ne se virilisent par trop et qu’elles deviennent lesbiennes. » 1803
Décidemment, les femmes ne peuvent échapper que difficilement aux hommes. (Cf. Hommes. « Virils »)
-------------
Femmes. Lesbiennes assimilées aux ‘gays’ :
Femmes (Lesbiennes assimilées aux ‘gays’) (1) : Par quelles régressions féministes, les femmes [dites lesbiennes] qui aiment [sont plutôt attirées par] une ou des femmes ont-elles pu être assimilées aux hommes [dits gays] qui aiment [sont plutôt attirés par] - un ou des hommes ? : question à clarifier de toute urgence.
En l’état, et dans l’attente, délégitime bon nombre d’analyses d’associations gays, ainsi que les dits L.G.B.T. (Cf. Êtres humains. « L.G.B.T »)
* Ajout. 19 août 2025. Par ailleurs, mais plus fondamentalement, une évidence : les femmes disparaissent. (Cf. Femmes. Comment faire disparaître les femmes ?)
Femmes (Lesbiennes assimilées aux ‘gays’) (2) : 1977. Jean-Louis Bory [1919-1979], dans Comment nous appelez-vous déjà ? Ces hommes que l’on dit homosexuels, auteur de :
« Je suis un homme ; j’en ai. Je ne dirai donc que l’homosexualité masculine. Les caresses au masculin. Je ne me reconnais aucune compétence pour parler des femmes entre elles et je me refuse vis-à-vis d’elle à verser dans un quelconque paternalisme masculin. C’est à une femme de dire l’homosexualité féminine. » 1804 (Cf. Femmes. « Féminin », Hommes. Homosexuels, Relations entre êtres humains. Caresses, Sexes. Hommes)
-------------
Femmes (« de Lettres ») : (7 novembre) 1891. Lu dans le Journal de Jules Renard [1864-1910], une répartie, notée par lui, de Willem Byvanck [1848-1925], lors d’une visite à Maurice Barrès [1862-1923] :
« Il ne faut aimer les femmes de lettres que mortes. » (Cf. Femmes. Comment meurent les femmes ? Relations entre êtres humains. Haine des femmes, Violences)
Femmes. Licenciées :
Femmes (Licenciées) (1) : (mai) 1977. Cours d’assises de Paris, lors d’un procès intenté à un père violeur de sa fille, le responsable de la Coop où travaillait la jeune femme, par ailleurs battue, témoigne. Je lis :
« Pas de faute professionnelle. Ni retard, ni absence. Des marques sur le corps, là où les clients pouvaient les voir. Le chef de service avait remarqué des traces, plusieurs fois. ‘Pour les clients, ça faisait mauvais effet.’ C’est ce qu’il a dit quand il a témoigné. Il fallait la licencier. » 1805 (Cf. Droit, Femmes. Travail, Justice, Patriarcat, Économie, Violences)
Femmes (Licenciées) (2) : (29 novembre) 2017. Une femme, ancienne collaboratrice d’un député socialiste (non réélu) fait « une offre de service » à un député En marche. Elle est embauchée, « lui ouvre toutes les portes », lui « apprend le fonctionnement et les codes » [de l’assemblée nationale], puis il la « vire ».
Elle réagit : « J’ai l’impression qu’il me jalouse. Il m’a dit : ‘Je te vire parce que c’est moi le député’. » 1806
La question que cet instantané me pose est la suivante : Pourquoi l’explication d’un licenciement du fait de la jalousie [de l’envie, la crainte de la comparaison, le sentiment mis à nu de ne pas être à la hauteur] - tant elle est fréquente - n’est-elle pas inscrite dans le code du travail ? Parce que la hiérarchie l’en empêche et légitime, ici conforte, les rapports d’autorité, inscrits par ailleurs dans le contrat de travail.
Et si vous y ajoutez les causes de licenciements liées au harcèlement sexuel… (Cf. Femmes. Travail, Hommes. Jaloux, Politique. Hiérarchie, Patriarcat, Économie. Licenciements)
-------------
Femmes. Lits :
Femmes (Lits) (1) : « Il a eu un enfant d’un premier lit. » À comparer avec : « Il a eu un enfant d’un premier mariage », avec : « Il a eu un enfant de sa première femme », avec : « sa femme et lui ont eu un enfant ». Puis, comparer les trois expressions en remplaçant le : « Il » par « Elle ». Et enfin, en remplaçant « il » / « elle », par le nom des parents de l’enfant évoqué. (Cf. Enfants, Famille. Mariage)
Femmes (Lits) (2) : 1920. H. G Wells [1846-1966], dans La Russie telle que je viens de la voir, concernant Fédor Chaliapine [1873-1938] auteur de :
« À Petrograd, nous avons fait sa connaissance. Nous avons diné chez lui et nous eûmes, ce jour-là, un aperçu de son intérieur. Il a deux enfants d’un premier lit, presque adultes […]. » 1807 (Cf. Femmes. Comment faire disparaître les femmes ? Famille)
-------------
Femmes (Livres) : Cf. Culture. Livres
Femmes (Luttes) : Cf. Politique. Luttes
Par ordre chronologique. Femmes. « Machines » :
Femmes (« Machines ») (1) : 1830. Stendhal [1783-1842], dans Le rouge et le noir, met dans la bouche de M. Rênal, après que madame de Rênal, « se plaignit d’un affreux mal de tête » cette analyse :
« Voilà comme sont toutes les femmes. […] il y a toujours quelque chose à raccommoder à ces machines-là ! »
La même expression fut reprise un peu plus loin, toujours à l’initiative de M. de Rênal :
« Elle parla d’un mal de tête affreux :
- ‘Voilà ce que c’est que les femmes, répéta M. de Rênal, il y toujours quelque chose de dérangé à ces machines compliquées. Et il s’en alla goguenard. » 1808 (Cf. Corps. Femmes)
Femmes (« Machines ») (2) : 1841. Honoré de Balzac [1799-1850], dans Mémoires de deux jeunes mariées, auteur de :
« Au bal, une jeune personne ne compte pas, elle y est une machine à danser. » 1809
Par ordre chronologique. Femmes. « Machines ». Émile Zola :
Femmes (« Machines ») (3) : 1876. Émile Zola [1840-1902], dans Son excellence Eugène Rougon, auteur de :
« […] Sa seule préoccupation, dans ce dénouement, restait de savoir s’il la [Clorindre] connaissait enfin toute entière. Il se rappelait ses anciennes conquêtes, ses efforts inutiles pour pénétrer les rouages secrets de cette machine superbe et détraquée. La bêtise des hommes, décidément, était bien grande. » 1810 (Cf. Hommes. Bêtes)
Femmes (« Machines ») (4) : 1890. Émile Zola [1840-1902], dans La bête humaine, auteur de :
« Et c’était vrai, il [Jacques] l’aimait d’amour, sa machine [sa locomotive], depuis quatre ans qu’il la conduisait. Il en avait mené d’autres, des dociles et des rétives, des courageuses et des fainéantes ; il n’ignorait point que chacune avait son caractère, que beaucoup ne valaient pas grand-chose, comme on dit des femmes de chair et d’os ; de sorte que s’il l’aimait celle-là, c’était en vérité qu’elle avait des qualités rares de brave femme. Elle était douce, obéissante, facile au démarrage, d’une marche régulière et continue, grâce à sa bonne vaporisation. […]
Il l’aimait donc en mâle reconnaissant, la Lison [la locomotive] […] ? » 1811
-------------
Femmes (« Machines ») (5) : (16 février) 1966. En Belgique, les ouvrières de la FN d’Herstal - appelées les « femmes-machines » - se lançaient dans un mouvement de grève de douze semaines. Considérée comme la première grève d’ampleur, cette lutte entra dans l’histoire comme la première grève sur la revendication : « à travail égal, salaire égal. » Mais, comme toutes les luttes, les enjeux étaient beaucoup plus complexes, beaucoup plus larges. (Cf. Femmes. « Fumier ». Travail, Politique. Égalité. Luttes de femmes, Histoire)
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Maison :
Femmes (Maison) (1) : 1782. Jean-Jacques Rousseau [1712-1778], dans Les confessions, auteur de :
« Une maison sans femme a besoin d’une discipline un peu sévère pour y faire régner la modestie inséparable de la dignité. » 1812
Femmes (Maison) (2) : (février) 1877. Fiodor Dostoïevski [1821-1881], dans Journal d’un écrivain, auteur de :
« (concernant les excuses de russes aux soldats Serbes) Il aime tellement, sa koutcha [maison] où chacun a laissé une femme, des enfants, ou une mère, des sœurs, une fiancée, des frères, un cheval et un chien qu’il abandonne tout […] pour n’être plus bon au service et renter au plus vite dans leur cher nid ! » 1813 (Cf. Langage. Zeugma, Politique. Nationalisme. Guerre)
Femmes (Maison) (3) : 2008. Jean Frémon, auteur de Louise Bourgeois, femme maison [L’Échoppe Ed].
-------------
Femmes. « Maîtresses » :
Femmes (« Maîtresses) (1) : Pourquoi : « Elle était la maîtresse de monsieur X » est-il beaucoup plus fréquent que : « Il était l’amant de madame Y » ? Facile…
* Ajout. 3 juin 2020. Pourquoi lorsqu’il est question du « trio », il s’agit du mari, de la femme et de l’amant et non pas du mari, de la femme et de la maîtresse ? Facile…
Femmes (« Maîtresses ») (2) : Il faudrait, tant le terme de ‘maîtresse’ a été dévalué, dévalorisé, sali, tant il a été utilisé pour détruire les femmes, inventer un autre terme. Comment faire sans tout bouleverser ?
Femmes (« Maîtresses ») (3) : Le masculin de maîtresse est « maître ». La comparaison de maîtresse serait « amant » ; or, ici, les deux termes ne sont pas équivalent : l’un est généralement laudateur, l’autre généralement dénégateur et signifie si souvent : elle a couché avec lui.
* Ajout. 27 mai 2023. Remplacer « maîtresse » par « amante » ? Mais alors quid des hommes qui n’ont jamais même considéré que leur maîtresse puissent être leur amante ?
* Ajout. 12 novembre 2024. 1972. Jacques Prévert [1900-1977], dans Choses et autres, auteur de :
« L’homme dit ‘ma maîtresse, mes maîtresses !’ La femme ne dit pas ‘mon maître’. » 1814
Par ordre chronologique. Femmes. Maîtresses :
Femmes (« Maîtresses ») (1) : (19 mai) 1773. Voltaire [1694-1778], dans une lettre à lui adressée, accuse le duc de Richelieu [1696-1788] auquel il a dédié sa dernière pièce, les Lois de Minos - de « l’accable[r] de dégoût », et de le « traiter comme ses maîtresses. » 1815 (Cf. Êtres humains. Soi)
Femmes (« Maîtresses ») (2) : (29 août) 1804. Stendhal [1783-1842], écrit à sa sœur Pauline, [Beyle. 1786-1857] :
« Comme homme, j’ai la ressource d’avoir des maîtresses. Plus j’en ai, plus le scandale est grand, plus j’acquiers de réputation et de brillant dans le monde. » 1816 (Cf. Femmes. Réputation, Hommes, Patriarcat, Économie. Calcul)
Femmes (« Maîtresses ») (3) : 1831. Alfred de Musset [1810-1857], dans La coupe et les lèvres, auteur de :
« Eh, bien oui, ta maîtresse - eh bien oui, ton amante / Ta Mamette, ton bien, ta femme et ta servante […] ». (Cf. Femmes. Servantes, Hommes. Séducteurs, Famille. Mariage, Langage. Possessif, Patriarcat)
Femmes (« Maîtresses ») (4) : 1837-1843. Honoré de Balzac [1799-1850], dans les Illusions perdues, auteur de :
« Ne rencontrerez-vous pas [à Paris] Angoulême partout ? […] Il suffira qu’un seul habitant d’Angoulême qui vous aperçoive pour que votre vie soit arrêtée d’une étrange manière : vous ne seriez plus que la maîtresse de Lucien. ». […]
Du Châtelet put parler sans que madame de Bargeton l’interrompît : elle était saisie par la justesse de ces observations. » 1817
Femmes (« Maîtresses ») (5) : 1846. Honoré de Balzac [1799-1850], dans La cousine Bette, auteur de :
« Mon ami, reprit Adeline, en faisant un dernier effort, s’il te faut absolument des maîtresses, pourquoi ne prends-tu pas, comme Crevel, des femmes qui ne soient pas chères et dans une classe à se trouver longtemps heureuses de peu ? Nous y gagnerions tous. » 1818 (Cf. Femmes. Conscience de classe. Épouse de, Patriarcat, Économie)
Femmes (« Maîtresses ») (6) : (28 janvier) 1872. George Sand [1804-1876], dans une lettre à Gustave Flaubert [1821-1880], auteure de :
« Change de place, agite-toi, aie des maîtresses ou des femmes, comme tu voudras […]. » 1819
-------------
Femmes. « Maîtresses de maison » :
Femmes (« Maîtresses de maison ») (1) : À ne pas confondre avec une « maîtresse femme »
Par ordre chronologique. Femmes. « Maîtresses de maison » :
Femmes (« Maîtresses de maison ») (1) : 1787. Carlo Goldoni [1707-1793], dans ses Mémoires, auteur de :
« On cause à table, on passe en revue les nouvelles du jour, les spectacles, les découvertes, les projets, les évènements : chacun dit son mot, et il s’élève quelque discussion, la maîtresse de maison, pleine d’esprit et de connaissances, fait les frais de la conciliation. » Et il poursuit plus loin :
« La charge la plus pénible pour une maîtresse de maison est celle d’arranger les parties pour que l’amour-propre des uns ne choque pas l’amour-propre des autres. » 1820 (Cf. Êtres humains. Amour-propre)
Femmes (« Maîtresses de maison ») (2) : 1954. Dans l’introduction d’un « Petit guide de sécurité familiale », intitulé Les accidents à la maison publié par les Éditions Sociales (maison d’édition du parti communiste français), je lis, sous la présentation :
« Pour vivre heureux, vivez prudents » :
« Il suffit d’un oubli, d’une négligence, d’une seconde d’inattention pour que la maison familiale, symbole du bonheur quotidien, devienne le centre d’un drame. Une marche usée, un carreau descellé, une barre d’appui branlante et la maison trahit sa mission protectrice. Puis sont énumérés « les milles et un danger avec lesquels vous en devez prendre de risques inutiles, car votre sécurité, celle de vos enfants, se trouve entre vos mains. »
- Aussi, pour les éviter : « Il ne faut pour l’assurer, ni appareils compliqués, ni études très longues. Vous n’avez besoin que de mettre en œuvre les seules qualités qui sont les vôtres et celles de toutes les bonnes maîtresses de maison : Ordre, Propreté, Soin, Bon sens, et d’appliquer inlassablement la même consigne : Prudence. » 1821 (Cf. Corps. Mains, Famille, Patriarcat, Politique)
Femmes (« Maîtresses de maison ») (3) : 2009. Manil Suri, dans Mother India, auteur de :
« Je maintenais la tête hors de l’eau en me concentrant sur ma responsabilité de tenir une maison. Chaque fois que je me sentais aspirée par mes ténèbres, je trouvais une tâche à accomplir pour le distraire. […] Mon ingéniosité m’étonnait moi-même, car personne ne m’avait jamais appris à m’occuper de ce genre des choses. Chaque tâche me confirmait dans le nouveau rôle de femme au foyer que j’avais choisi. Chaque heure que je passais à cuisiner, à nettoyer, à faire des courses était une heure gagnée sur les sables mouvants des déceptions et des trahisons de mon existence précédente. » 1822
Femmes (« Maîtresses de maison ») (4) : (avril) 2023. Je lis dans Le Monde Diplomatique, dans la recension du livre d’Alizée Delpierre : Servir les riches [La Découverte. 2022] :
« Au quotidien, ils (sic) ont affaire aux maîtresses de maison, qui assurent du bon travail des domestiques quand les maris rapportent l’argent. » 1823 (Cf. Êtres humains. Domestiques, Famille, Penser. Pensées. Binaires)
-------------
Femmes (« Mal baisées ») : (5 juin) 2015. Denise Cacheux, auteure de :
« J’ai été traitée de ‘mal baisée’, la première fois que je suis rentrée au PS, parce que j’avais dit qu’il n’y avait que des mecs à la tribune. Je leur ai répondu : « De la faute à qui, camarades ? » 1824 Une réponse fondée et claire détruit la question. Et cloue le bec. (Cf. Femmes. Jouir)
Femmes (Malédiction) : La malédiction des femmes : la beauté ? la dot ? le mariage ? la maison ? le travail - dit - domestique ? l’intelligence ? la force ? l’indépendance ? les enfants ? un homme ? des hommes ? les hommes ? l’éducation ? le droit ? Chacun-e peut retirer, ajouter… (Cf. Patriarcat)
Par ordre chronologique. Femmes. Malheureuses :
Femmes (Malheureuses) (1) : (19 avril) 1805. Stendhal [1783-1842] écrit à sa sœur Pauline Beyle [1786-1857] :
« Combien de malheureuses périssent de langueur, faute de secours, et sans que les barbares qui les tuent s’en doutent. » 1825 (Cf. Êtres humains. Vies, Femmes. Comment meurent les femmes ? Hommes. Violents, Patriarcat, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
Femmes (Malheureuses) (2) : 1880. Émile Zola [1880-1902], dans Nana, auteur de :
« Mon dieu ! que les femmes sont malheureuses ! » 1826
-------------
Femmes (« Manager de femmes ») : (17 octobre) 2014. Maurice Lévy, « patron du Groupe Publicis », au Women’s Forum de Deauville, auteur de :
« Je n’ai jamais été un bon manager de femmes [car j’ai toujours été intimidé par elles]. »
Et il poursuit, pour récuser le principe des quotas, en se référant explicitement, positivement, à Élisabeth Badinter, « féministe », « Présidente du conseil de surveillance et deuxième actionnaire du Groupe (NDLR) » ; en d’autres termes, sa patronne. 1827.
L’expression de « manager de femmes » me fait penser à « dompteur de fauves », « gestionnaire de portefeuille », « responsable de plantation » et me fait froid dans le dos.
Par analogie : « manager de juifs », « manager d’arabes » … (Cf. Femmes. « Connasses », Penser. Pensées. Méthode. Analogie, Économie)
Femmes. Mannequins :
Femme (Mannequins) (1) : Ne pas oublier que le terme de « Mannequin » - « Nom masculin » - fut d’abord « une statue articulée pour servir de modèle aux artistes », puis « une forme humaine utilisée pour la confection, l’essayage, la présentation de modèles de vêtements », puis - « Nom » : « une personne dont le métier est de présenter sur elle-même les modèles de couturiers. »
Par ordre chronologique. Femmes. Mannequins :
Par ordre chronologique. Femmes. Mannequins. Émile Zola :
Femmes (Mannequins) (1) : 1883. Émile Zola [1840-1902], dans Au bonheur des dames, auteur de :
« La gorge ronde des mannequins gonflait l’étoffe, les hanches fortes exagéraient la finesse de la taille, la tête absente était remplacée par une grande étiquette, piquée avec une épingle dans le molleton rouge du col ; tandis que les glaces, aux deux côtés de le vitrine, par un jeu calculé, les reflétaient et les multipliaient sans fin, peuplaient la rue de ces belles femmes à vendre, et portant des prix en gros chiffres, à la place des têtes. » 1828 (Cf. Êtres humains, Corps. Têtes, Femmes. Achat. Ornements [décoratifs], Économie. « Au bonheur des dames ». Capitalisme. Publicité, Proxénétisme)
Femmes (Mannequins) (2) : 1883. Émile Zola [1840-1902], dans Au bonheur des dames, auteur de :
« - Servez à quelque chose, au moins, mettez ça sur vos épaules. […]
- Il lui fallut obéir, elle [Denise] dut laisser Marguerite draper le manteau sur elle, comme sur un mannequin.
- Tenez-vous droite, dit Mme Aurélie. […]
- Il n’est pas mal, de coupe originale… seulement, il me semble peu gracieux de la taille.
- Oh, intervient Mme Aurélie, il faudrait le voir sur madame elle-même. Vous comprenez, il ne fait aucun effet sur mademoiselle qui n’est guère étoffée. Redressez-vous donc, mademoiselle, donnez-lui toute son importance. […]
Denise avait encore pâli au milieu de toute ce monde qui se moquait. Elle se sentait violentée, mise à nu, sans défense. » 1829 (Cf. Corps, Femmes)
-------------
Femmes (Mannequins) (3) : (22 juillet) 2018. Adriana Karembeu, ancienne mannequin, auteure de :
« Mannequin… On peut tout vendre. » 1830 (Cf. Économie. Publicité)
-------------
Femmes. Maquillage :
Femmes (Maquillage) (1) : Tromperie sur l’identité. Antinomique avec la vérité [de l’être].
Femmes (Maquillage) (2) : Sinon refuser le maquillage, du moins dénoncer la fonction de masque, de cache qu’il joue.
Par ordre chronologique. Femmes. Maquillage :
Femmes (Maquillage) (1) : 1722. Daniel Defoe [1660-1731], dans Moll Flanders, auteur de :
« Je m’habillais du mieux que je pus à mon avantage, je vous l’assure, et pour la première fois j’usais d’un peu d’artifice ; pour la première fois, dis-je, car je n’avais jamais cédé à la bassesse de me peindre avant ce jour, ayant toujours eu assez de vanité pour croire que je n’en avais point besoin. » 1831
Femmes (Maquillage) (2) : 1976. Jane Fonda, interviewée dans le film de Delphine Seyrig [1932-1990], Sois belle et tais-toi [1981], raconte comment elle fut, pour la première fois, coiffée, maquillée par les maquilleurs des plus grands studios d’Hollywood…et, après avoir été ainsi transformée pour les besoins d’un film, elle conclut :
« Je me suis regardée dans la glace : Je ne savais plus qui j’étais. »
- Il importe ici de rappeler que Jane Fonda, longtemps après, est devenue l’ « égérie » de L’Oréal : Triste, inquiétant, signifiant... (Cf. Culture. Hollywood. Cinéma, Êtres humains. Soi, Corps, Femmes. Égéries. Artistes)
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. « Marchandise » :
Femmes (« Marchandise ») (1) : (22 juin) 1763. Voltaire [1694-1778], dans une lettre au duc de Richelieu [1696-1788], auteur de :
« Vous protégez donc de près Melle d’Epinay [1726-1783]. Cela dit qu’elle est buona roba [bonne marchandise], mais cela ne dit pas qu’elle soit bonne actrice. » 1832 (Cf. Êtres humains. « Marchandise », Patriarcat, Économie. Marchandise)
Femmes (« Marchandise ») (2) : 1877. Léon Tolstoï [1828-1910], dans Anna Karénine, évoque les pensées de Kitty, dans l’aristocratie russe, au bal, à 18 ans :
« Comment échapper aux abominables relations mondaines qui, lui semblait-il maintenant, font de la jeune fille une sorte de marchandise exposées aux regards des chalands. » 1833 (Cf. Êtres humains. « Marchandise », Femmes. Jeunes filles, Patriarcat, Économie. Marchandise)
-------------
Femmes (« Market women ») : (28 décembre) 2017. Libéria. Lu dans Le Monde, après l’échec d’Ellen Johnson Sirleaf aux élections présidentielles du 28 décembre 2017 :
« Les ‘market women’, qui s’étaient mobilisées pour faire élire la présidente en 2005, se sentent abandonnées par celle qui devait améliorer leur condition. »
Au lieu et place de « commerçantes » ? 1834 (Cf. Femmes. « Politiques », Langage, Économie)
Par ordre chronologique. Femmes. Masochisme :
Femmes (Masochisme) (1) : 1669. Lu dans les Lettres d’une religieuse portugaise dont l’auteur serait le chevalier de Guilleragues [1628-1685] :
« […] Adieu, je n’en puis plus. Adieu, aimez-moi toujours, et faites-moi souffrir encore plus de maux. » 1835
Femmes (Masochisme) (2) : 1857. Dans Madame Bovary de Flaubert [1821-1880], Emma Bovary, après que Rodolphe lui eut refusé les 3000 francs qu’elle lui demandait, lui dit :
« Mais, moi, je t’aurais tout donné, j’aurais tout vendu, j’aurais travaillé de mes mains, j’aurais mendié sur les routes, pour un sourire, pour un regard, pour t’entendre dire : ‘Merci !’ […] » 1836
Femmes (Masochisme) (3) : 1972. Kate Millett [1934-2017], dans La prostitution. Quator pour voix féminines [Denoël], auteure de :
« Masochisme reste un terme inexact. Si l’on oriente avec tant de vigueur vers un comportement autodestructeur, c’est parce que notre société est décidée à détruire quelque chose chez les femmes, à détruire leur Moi, le respect qu’elles doivent avoir d’elles-mêmes, leur espoir, leur imagination, leur assurance, leur volonté. Ce masochisme n’est qu’un réflexe d’adaptation tel qu’on peut en observer chez tout groupe opprimé s’il veut survivre. » 1837
Très juste. Et pourtant encore si fréquemment employé ; moins, cependant…
-------------
Femmes (« Matelas ») : (24 janvier) 2020. Jean-Paul Gaultier, couturier, commente le fait d’avoir été porté en triomphe, lors son dernier « show », par deux femmes par lui invitées, qu’il nomme en ces termes : « un joli matelas ». 1838 (Cf. Hommes. Grossiers)
Femmes (Médaille des évadés) : Il existe une « médaille des évadés » : la remettre ‘au goût du jour’ et l’instituer pour les femmes qui fuient leurs maris violents ? La « médaille de la résistance » pour celles qui les dénoncent ? Et la « croix de guerre » pour celles qui, après avoir été « occupées » par eux, les tuent ? (Cf. Justice. Légitime défense, Politique. Frontières. Guerre, Violences)
Femmes. « Même les femmes » :
Femmes (« Même les femmes ») (1) : 1891. Anton Tchékhov [1860-1904], dans Le duel, auteur de :
« Il y a deux ans, ce jeu était inconnu ici, mais à présent tout le monde y joue du matin jusqu’à une heure avancée de la nuit, même les femmes et les adolescents. » 1839 (Cf. Relations entre êtres humains. Duel)
Femmes (« Même les femmes ») (2) : 1989. Jules Roy [1907-2000], dans Mémoires barbares, lors de son voyage en Chine [1964?-1965?], en auteur, sans italique, de :
« Tous les Chinois, même les femmes, étaient prêts à verser leur sang pour la patrie. » 1840
Les femmes tout à la fois exclues du générique neutre, puis, dévaluées, dévalorisées, réintégrées, sans l’être…
-------------
Femmes (Ménagères) : 1950. Dans la Revue officielle du salon des Arts ménagers, je lis :
- « Une maison bien et vivement tenue, n’est-ce pas pour nous, femme, la liberté ? » […]
- Titre de chapitres suivants : « Ménagères mais… ‘Mimi Pinson’ » ; « Ménagère… mais ‘Artiste’ peintre » ; « Ménagère… mais toujours pressée » ; « Ménagère… mais souriante » ; « Ménagère… mais attrayante » ; « Ménagère… mais Musicienne, Poète, Fée » ; « Ménagère et… méthodique » ; « Ménagère et… Cordon bleu » ; « Ménagère et… adroite » ; « Ménagère et… économe » ; « Almanach des artistes ménagères ».
Et, en avant-propos : « Avant-première au salon des Arts ménagers. Les tablettes de Monsieur Ménage. »
Tandis que l’éditorial de Marcelle Auclair [1899-1983] s’intitule :
« Ménagères mais… Moralités ménagères ». 1841 (Cf. Femmes. Travail. « Domestique ». Maison, Politique. Morale, Économie. « Domestique »)
Femmes (Ménopause) : (30 mars) 2022. Une femme, à un kiné, auteure de :
« Depuis la ménopause, c‘est comme si ça partait en couilles dans tous les sens. » 1842 (Cf. Corps. Femmes. Règles, Sexes. Hommes)
Par ordre chronologique. Femmes. « Menteuses » :
Femmes (« Menteuses ») (1) : 1948. Nicolas Berdiaev [1876-1948], dans son Essai d’autobiographie spirituelle, écrit :
« Les femmes sont plus menteuses que les hommes : le mensonge est une autodéfense qu’a engendré l’historique privation de droits de la femme [depuis que le patriarcat a succédé au matriarcat]. » 1843
Deux erreurs, grossières par ailleurs : c’est beaucoup en une seule phrase. (Cf. Relations entre êtres humains, Mensonges, Patriarcat. Matriarcat)
Femmes (« Menteuses ») (2) : (décembre) 2016. Juliette Rennes débute ainsi son article dans Le Monde Diplomatique, intitulé Vieillir au féminin :
« Pourquoi les femmes mentent-elles davantage que les hommes sur leur âge ? Partant de cette question apparemment anodine, Susan Sontag […]. » 1844 (Cf. Femmes. « Féminin »)
-------------
Femmes (Mépris) : 1876. Émile Zola [1840-1902], dans Son excellence Eugène Rougon, auteur de :
« Dans ses moindres paroles perçait une grande indifférence, presque un mépris des hommes. » 1845 (Cf. Hommes, Patriarcat)
Par ordre chronologique. Femmes. Métier :
Femmes (Métier) (1) : 1974. Ménie Grégoire [1919-2014] publie Le métier de femme. [Plon. 313p.]
N.B. Ménie Grégoire précise en conclusion que « l’enquête relatée (sic) dans ce livre a été menée en 1962, terminée en 1963. »
Femmes (Métier) (2) : 1994. Je lis dans le livre de Françoise Basch [1930-2023], Victor Basch. De l’affaire Dreyfus au crime de la Milice [1994] :
« Le champ des activités d’Ilona [Basch.1863-10 janvier 1944] n’avait guère changé de nature. Mais le métier d’épouse, de mère et de grand-mère s’est immensément alourdi. » 1846
- Françoise Basch a publié ultérieurement : Ilona, ma mère et moi. Une famille juive sous l’Occupation. Éditions iXe. 2011. 120p. (Cf. Famille. Couple)
-------------
Femmes (Meubles) : 1871. Émile Zola [1840-1902], dans La curée, auteur de :
« Il [Aristide Rougon] arriva [à Paris] dans les premiers jours de 1852. Il amenait avec lui sa femme Angèle, une personne blonde et fade, qu’il installa dans un étroit logement de la rue Saint-Jacques, comme un meuble gênant dont il avait hâte de se débarrasser. » 1847 (Cf. Êtres humains. « Meubles »)
Femmes (Mineures. George Sand) : 1845-1850. En 1845, alors que la séparation des époux avait, en première instance, a été prononcée le 16 février 1836, George Sand [1804-1876] écrit : « Aux termes de la loi, je ne peux emprunter ni pour un autre, ni pour moi-même, ni servir de caution puisque les femmes, mêmes celles de 40 ans, sont réputées mineures. » 1848
- Il en est de même en 1846 :
« Je ne peux emprunter à un banquier à cause de ma qualité de femme mineure, c’est-à-dire de femme mariée. »
Et, en voici les conséquences concernant la propriété de ses propres écrits :
- Le 15 octobre 1845, son mari est toujours partie prenante du contrat qu’elle signa avec Giroud et Vialat pour Le péché de Saint Antoine 1849, bien qu’il soit précisé qu’elle était « épouse judiciairement séparée de corps et de biens 1850 d’avec François Casimir Dudevant. »
- En 1847, l’absence de l’autorisation de son mari concernant la publication de La mare au Diable fut cause d’un conflit avec la Société des Gens de Lettres. Avant de pouvoir défendre son droit à la propriété de son œuvre, devant les Tribunaux, elle dut préalablement demander à son mari qu’il veuille bien l’autoriser de défendre son droit. Elle fournit ladite autorisation au Tribunal le 20 août 1847. 1851
- En 1848, son mari - dans les mêmes termes - est toujours partie prenante du contrat qu’elle signe, le 15 août 1848, avec l’éditeur Paul Delavigne pour la publication de François le Champi. 1852 Il en fut de même pour le contrat qu’elle signa avec Michel Lévy Frères pour La petite fadette, le 15 novembre 1848. 1853
- Le nom de François Casimir Dudevant n’est en revanche plus cité dans le contrat qu’elle signa, le 18 et 20 octobre 1849 pour François le Champi, Le château des Désertes et La mare au diable avec Paul Delavigne éditeur. 1854
- En 1850, George Sand écrit :
« Je ne suis pas dans la position des propriétaires aisés qui peuvent toujours emprunter tant qu’ils ont un petit capital au soleil. Je suis femme, c’est-à-dire mineure, séparée de mon mari légalement, et cependant toujours sous sa dépendance pour les affaires d’argent, tant les lois protègent mon sexe ! Je ne peux pas donner d’hypothèque sur ma propriété. Forcée d’emprunter pour les autres, dans les moments difficiles, je ne l’ai pu qu’en me servant pour sauver mes amis et mes parents pauvres, de la caution d’amis moins pauvres. Mais cette caution les expose à perdre leur argent si je meurs sans avoir payé. Mon mari et mon gendre n’auraient aucun scrupule d’invoquer la loi, et de leur laisser tout perdre. » 1855
Le droit de propriété au fondement de la France bourgeoise d’après 1789 : encore un mensonge… Il n’y a pas que le suffrage qui n’était pas universel… Quant à la liberté d’expression des femmes, elle aussi, une chimère, et encore un autre mensonge. (Cf. Culture. Livres, Droit. Patriarcal, Femmes. Écrivaines, Hommes, Famille. Mariage, Justice. Patriarcale. Politique. Contrat, Économie. « Pauvres Les »)
Femmes (Miroir) : 1871. Émile Zola [1840-1902], dans La curée, auteur de :
« Renée montait, et, à chaque marche, elle grandissait dans la glace ; elle se demandait avec le doute des actrices les plus applaudies, si elle était vraiment délicieuse, comme on le lui disait. » 1856 (Cf. Êtres humains. Miroir)
Femmes (Misérables) : 1792. Mary Wollstonecraft [1759-1797], dans Défense des droits de la femme, auteure de :
« Si, quand une femme a trouvé un mari, elle considère qu’elle est arrivée à ses fins, et si, mesquine et fière, elle se contente d’une couronne aussi misérable, laissons-la se traîner, satisfaite, aux pieds de son époux dans une situation qui l’élève à peine au-dessus des animaux. » 1857
Difficile à lire, et donc à accepter, mais d’autant plus nécessaire. Peut être aisément modernisé en y incluant l’énergie mise par tant de femmes à « chercher », à « trouver » un amant, un compagnon, un homme, sans excès d’exigences, en y sacrifiant si souvent leur dignité, leur identité, leurs propres aspirations… (Cf. Femmes. Animalisation des femmes, Famille. Mariage, Féminismes. Féministes. Wollstonecraft Mary, Politique. Animalisation du monde)
Femmes (Mission) : 1869. Hermione Quinet [1821-1900], dans Mémoires d’exil, auteure de :
« […] La mission de l’homme est de lutter pour les principes, et la mission de la femme est de les mettre en pratique par des moyens modestes concentrés au foyer, d’où elles rayonnent au loin. » 1858 (Cf. Femmes. Épouse de. Modestes, Patriarcat)
Femmes (« Mission historique ») : Pas plus que le prolétariat, pas plus que quiconque, les femmes ne sont investies d’aucune « mission historique ». (Cf. Patriarcat, Histoire)
Par ordre chronologique. Femmes. « Moches » :
Femmes (« Moches ») (1) : 1977. Marie Cardinal [1928-2001], dans Autrement dit, auteure de : « Tu connais une femme vraiment moche qui a réussi à faire entendre sa voix en France ? Moi, je n’en connais pas […]. » 1859
Aujourd’hui, l’adjectif choque, mais la vérité du constat - les si rares exceptions confirment la règle - est toujours valide. (Cf. Femmes. Beauté, Langage)
* Ajout. 13 juillet 2019. Je me souviens qu’au Cours secondaire de jeunes filles de Neuilly, il existait entre nous deux différences, les jolies et les autres, ce que j’ai pu vérifier en regardant les photos de classe. Il existait aussi une différence entre celles qui mettaient des socquettes et celles qui avaient accédé aux bas.
Cette distinction ne me semble plus exister : il n’y a plus, me semble-t-il, de jeunes filles « laides ». (Cf. Femmes. Jeunes filles, Hommes. Laids)
Femmes (« Moches ») (2) : (17 octobre) 2018. Jair Bolsonaro, candidat d’extrême-droite à l’élection présidentielle Brésilienne - élu par la suite - « s’est gaussé des femmes ‘moches’ [qui] ‘ne méritent pas d’être violées’. » 1860 (Cf. Hommes. « Politiques », Patriarcat, Politique, Violences. Viols. Violences à l’encontre des femmes)
-------------
Femme. Mode :
Femmes (Mode) (1) : « La mode », l’opium des femmes [riches] ?
Facile, mais les conséquences de ces impositions - dans le monde riche - ont été désastreuses sur l’image que tant de femmes, qu’elles « suivent - ou non - la mode », ont eu d’elles-mêmes.
Par ordre chronologique. Femme. Mode :
Femmes (Mode) (1) : 1831. Honoré de Balzac [1799-1850], dans La peau de chagrin, évoque les « petites femmes [qui] se font les porte-manteaux de la mode ». 1861
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Modèles :
Femmes (Modèles) (1) : (24 octobre) 1860. Émile Zola [1840-1902], dans une lettre écrite à ses amis Baille [Jean Baptistin. 1841-1918] et Cézanne [Paul. 1839-1906], auteur de :
« Cézanne m’a donc écrit, c’est à lui que je dois répondre. La description de ta poseuse m’a fort égayé. Chacune prétend qu’ici les modèles sont potables, sans être pourtant de première fraîcheur. On les dessine de jour, et la nuit on les caresse (le mot caresse étant un peu faible). Tant pour la pose diurne, tant pour la pose nocturne ; on assure d’ailleurs qu’elles sont fort accommodantes, surtout pour les heures de nuit. […] » 1862 (Cf. Femmes. Travail, Hommes. Grossiers, Relations entre êtres humains. Caresses, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
Femmes (Modèles) (2) : 1980. Regarder le remarquable film de Frédérik Wiesman : Modèle. (Cf. Culture. Cinéma, Femmes. Beauté. Mode)
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Modestes :
Femmes (Modestes) (1) : (15 janvier) 1836. Marie d’Agoult [1805-1876] écrit à George Sand [1804-1876] :
« Vous voyez que je ne suis pas modeste ; mais la modestie est la sœur cadette de l’hypocrisie […] » 1863
Femmes (Modestes) (2) : (5 mai) 1942. Dans son Journal, André Gide [1869-1951] fait part d’une rencontre à Marseille avec Jean-Louis Barrault [1910-1994] :
« Admirable visage, respirant l’enthousiasme, la passion, le génie. » André Gide poursuit :
« Madeleine Renaud [1900-1994] s’efface avec une modestie exquise. Sa bonne grâce, son naturel, me mettent à l’aise aussitôt. » 1864 (Cf. Êtres humains. Gide André, Femmes. Artistes. Renaud Madeleine, Hommes. « Intellectuels ». Gide André, Féminismes. Renaud Madeleine, Patriarcat)
Femmes (Modestes) (3) : (10 mars) 2019. Dominique Schnapper, présentée sur France Culture, comme « sociologue », ancien membre du Conseil constitutionnel, par ailleurs fille de Raymond Aron [1905-1983], appelée à donner son avis sur la situation en Algérie, abordant incidemment une question économique, triviale par ailleurs, déclare :
« Je n’ose pas en parler devant Daniel Cohen » [1953-2023], lui, « économiste ». 1865 (Cf. Hommes. « Modestes », Politique. État. Conseil constitutionnel, « Sciences » sociales. Sociologie, Économie. Cohen Daniel)
* Ajout. 11 août 2024. Entendu un homme sur France Culture :
« Je parle sous votre contrôle »
-------------
Par ordre chronologique. « Femmes du monde » :
Femmes (« du monde ») (1) : (31 juillet) 1762. Denis Diderot [1713-1784], dans une lettre à Sophie Volland [1716-1784], évoque, décrit « cette uniformité si décente et si maussade qui donne à un cercle de femmes du monde l’air d’une douzaine de poupées tirées par des fils d‘archal. » 1866
N.B. « Le fil d’archal » : « fil de fer ou de laiton, généralement recouvert de coton et de papier et destiné aux usages les plus divers. » (Cf. Enfants. Jouets. Poupées, Femmes. Infantilisation)
Femmes (« du monde ») (2) : 1847. Honoré de Balzac [1799-1850], dans Splendeurs et misères des courtisanes, auteur de :
« Personne n’aurais pu suivre Léontine, elle volait. Un médecin expliquerait comment ces femmes du monde, dont la force est sans emploi, trouvent dans ces crises de la vie de telles ressources. » 1867 (Cf. Économie. Vol)
Femmes (« du monde ») (3) : 1865-1869. Léon Tolstoï [1828-1910], dans La guerre et la paix, auteur de :
« Elle s’adressa à Pierre, qui faisait son entrée, un aimable sourire, et avec la facilité à mentir propre aux femmes du monde… » 1868
Femmes (« du monde ») (4) : 1876. Hippolyte Taine [1828-1893], dans Les origines de la France contemporaine, concernant la société d’Ancien régime, évoque :
- « […] les sujets graves ou légers qui peuvent intéresser des hommes ou même des femmes du monde […]. »
- [des livres écrits] « pour des gens du monde et même pour des femmes du monde. »
- [une méthode philosophique avec laquelle] « on peut tout expliquer, tout faire comprendre, même à des femmes, même à des femmes du monde. » 1869 (Cf. Langage, Patriarcat, Penser. Expliquer, Histoire)
Femmes (« du monde ») (5) : 1880. Fiodor Dostoïevski [1821-1881], dans Les frères Karamazov, auteur de :
« Ces dames du grand monde, riches et capricieuses, ne se refusent rien s’il s’agit de satisfaire leurs fantaisies. » 1870
Femmes (« du monde ») (6) : 1883. Émile Zola [1840-1905], dans Au bonheur des dames, auteur de :
« Henriette, dans ses crises de jalousie […] perdait ses prudences de femme du monde, mettant son art à sauver les apparences. » 1871
-------------
Femmes (« Mulets ») : (24 avril) 2017. Sous le titre : Frontière de Ceuta : Décès dans une bousculade, je lis dans Le Figaro :
« ’Ce matin, il y a eu une bousculade du côté marocain’, a expliqué un militant local, interrogé au téléphone depuis Rabat. Une femme d'une cinquantaine d'années est décédée, et quatre autres ont été blessées’, a précisé cet activiste, Mohamed Benaïssa, de l'Observatoire du nord des droits de l'Homme [ONDH]. […]
‘Vers midi, commerçants et femmes-mulets qui traversent quotidiennement ont ensuite manifesté à Fnid'q pour dénoncer la situation’ au poste-frontière, selon Benaïssa. Fin mars, une autre ‘femme-mulet’ était décédée dans les mêmes circonstances, après avoir été piétinée. Les autorités de Ceuta avaient rénové fin février l'ancien poste-frontière, notamment pour améliorer les conditions de travail des porteurs de marchandises entre cette enclave espagnole et le Maroc, dont la très grande majorité sont des femmes. Elles avaient également annoncé un renforcement des mesures de contrôle, notamment le poids et les dimensions des colis portés par les travailleuses journalières. […] » 1872 (Cf. Êtres humains, Femmes. Animalisation des femmes. Travail, Politique. Animalisation du monde. Frontières)
Par ordre chronologique. Femmes. Muses :
Femmes (Muses) (1) : (1er janvier) 1869. Gustave Flaubert [1821-1880] écrit à Georges Sand [1804-1876] :
« La muse, si revêche qu’elle soit, donne moins de chagrins que la Femme. » Suivi de :
« Je ne peux accorder l’une avec l’autre. Il faut opter. Mon choix est fait depuis longtemps ! […]. » 1873
Femmes (Muses) (2) : (5 décembre) 1943. Jean Zay [1905-assassiné le 20 juin 1944], en prison depuis près de trois ans, écrit à sa sœur Jacqueline, sculptrice, en lui suggérant des sujets mythologiques pour un travail qui lui fut confié, nomme « les muses : Erato et sa lyre, Clio et son parchemin, Euterpe et sa flûte, Thalie et son masque, Uranie et son compas ou son globe, Calliope et son stylet… » 1874
-------------
Femmes (Naïves) : 1957. Boris Pasternak [1890-1960], dans Le docteur Jivago, auteur de :
« Sa nouvelle femme, Éléna Proklovna, est une gamine qui a quitté l’école pour être conduite à l’autel. Naturellement naïve, elle fait aussi la naïve par calcul : toute jeune, elle joue déjà à se rajeunir. Elle minaude, jacasse, pépie, prend des airs innocents, elle fait la bête, la petite alouette des champs. » 1875
Par ordre chronologique. Femmes. Nationalisme :
Femmes (Nationalisme) (1) : 1976. Ménie Grégoire [1919-2014], dans son Autobiographie, Telle que je suis, auteure de :
« Les femmes, certes ont été exclues de pas mal de choses, mais La Française possède dans son particularisme un atout majeur : une entente exceptionnelle avec l’homme qui fut toujours autre chose que son maître. » 1876
Cette phrase qu’il est difficile de ne pas juger stupide, insupportable, n’est pas révélatrice du livre, subtil, passionnant dont elle est issue. (Cf. Femmes. Françaises, Patriarcat, Politique. Nationalisme)
Femmes (Nationalisme) (2) : 1999. Lu dans Imperium de Ryszard Kapuściński [1932-2007] :
« L’Europe occidentale s’étonnait de voir à la télévision de vieilles femmes misérables faisant la queue à Moscou devant une boulangerie et renonçant soudain à acheter du pain pour rejoindre les manifestants scandant : ‘Nous ne rendrons pas les Iles Kouriles !’ Mais de quoi s’étonner ? Les Iles Kouriles font partie de l’Imperium.
L’Imperium fut bâti au prix de l’approvisionnement et de l’habillement de ces femmes, au prix de leurs bottes éculées et de leur appartement gelé, et ce qui est plus dramatique, au prix du sang et de la vie de leur mari et de leurs fils. Or, maintenant il faudrait rendre les ces îles (au Japon] ? Jamais. » 1877 (Cf. Patriarcat, Politique. Nationalisme, « Occident »)
-------------
Femmes (Naturalisation) : (12 décembre) 1841. Henry David Thoreau [1817-1862], écrit dans son Journal :
« Chaque jeune fille cache une fleur plus belle et un fruit plus succulent que n’importe quel calice des champs. » 1878 (Cf. Femmes. Jeunes filles, Politique. Écologie)
Par ordre chronologique. Femmes. Nazisme :
Femmes (Nazisme) (1) : 1925. Adolphe Hitler [1889-1945], dans Mein Kampf [p.201], auteur de :
« Dans son écrasante majorité, le peuple a une attitude et une mentalité si féminines que sa pensée et ses actes sont bien moins déterminés par la réflexion objective que par le sentiment affectif. Ce sentiment affectif n’est pas très complexe, mais simple et sommaire, il fait peu de cas des nuances, mais distingue entre positif et négatif, amour et haine, justice et injustice, vérité et mensonge ; jamais de mélanges à demi ou de dosages, etc. » 1879 (Cf. Penser, Patriarcat, Politique)
Femmes (Nazisme) (2) : 1933. Pour la fête des mères L’Angriff [L’Attaque. Journal Berlinois national-socialiste] écrivait :
« Fêtes des mères. La révolution nationale a fait table rase de toutes les mesquineries. Les idées conduisent et rapprochent enfin les hommes - famille, société, peuple. L’idée de la fête des mères est de nature à rendre hommage à ce qui symbolise le mieux l’idée allemande : la mère allemande ! C’est seulement dans la nouvelle Allemagne que la femme et la mère assume ce rôle. Elle est la gardienne de la vie familiale, pépinière de forces capables de conduite notre peuple vers les sommets. C’est elle, la mère allemande qui porte seule l’idée de la nation allemande. Être mère veut dire à tout jamais appartenir à la nation allemande - existe-t-il une pensée qui nous unisse d’avantage que l’hommage que nous rendons ensemble aux mères ? » 1880 (Cf. Femmes. Mères, Hommes, Famille, Patriarcat, Politique. Nationalisme)
Femmes (Nazisme) (3) : 1937. Margaret Goldsmith [1894-1971], dans Cinq femmes contre le monde, auteure de :
« En Allemagne, où la révolution de 1918 vint terminer favorablement, et sans heurt, la campagne en faveur de l’égalité de suffrage, et introduisit l’élément féminin au Reichstag et à la Diète Fédérale, le rôle des femmes est aujourd’hui réduit à néant.
La Terreur fut la seule des institutions allemandes qui nivela les droits masculins et féminins. Hommes et femmes furent alors traités sur le même pied et la peine de mort leur fut appliquée - reconnaissons-le-avec un totale impartialité !
Sous le régime hitlérien, la position des femmes a rétrogradé de plusieurs générations. Elles n’ont plus voix au chapitre. Les hautes études féminines sont désormais considérées avec la même réprobation qu’au début du dix-neuvième siècle.
L’Allemande aujourd’hui n’est bonne qu’à mettre au monde le plus d’enfants mâles possible, destinés à renforcer un jour les rangs de l’armée teutonne. L’Allemagne d’Adolf Hitler [1889-1945] ne va pas ‘encore’ aussi loin que Sparte et n’immole pas les filles dès lors naissance, mais l’attitude nazi est si méprisante envers elles, et leur venue si mal accueillie, qu’à ce point de vue, la république Germanique n’a presque rien envier à la Grèce antique.
Toutefois, les organisations révolutionnaires antigouvernementales, en Allemagne, comme en Autriche, comprennent un grand nombre de femmes remarquablement énergiques et influentes ; quelques-unes mêmes, d’une très haute valeur, obligées de garder l’anonymat par crainte de représailles de la dictature nazie. Le nombre considérable de sentences d’emprisonnement infligées à ces audacieuses créatures illustre leur courage. » 1881 (Cf. Femmes. « Créatures ». « Féminin ». Mères, Justice. Peine de mort, Politique. État. Égalité. Révolutions, Patriarcat. Nazisme, Histoire)
Femmes (Nazisme) (4) : (8 mai) 1942. Himmler [1900-1945] « confie qu’il a donné l’ordre secret d’élaborer un projet de Lebensborn pour 400.000 mères célibataires ‘de bon sang’ afin de compenser les pertes en vies humaines. L’édifice devra être décent, représentatif de la noble idée de l’homme et de la mère non mariée. » Le terme ‘décent’ (anständig) que Himmler et les siens affectionnent particulièrement, revient aussi dans sa correspondance, à propos de l’installation de bordels « afin de fournir (pendant la guerre) à nos hommes des conditions dignes (würding) pour leurs rapports sexuels. » [….] 1882 Lebensborn et bordels : belle cohérence. (Poursuivre pour comprendre le lien)
* Ajout. 11 mars 2014. On retrouve cette même cohérence, ce même lien (qualifiée, en 2003, d’ « idées singulières ») en France dans la présentation du livre de Restif de la Bretonne, Le pornographe ou la prostitution réformée [France. 1762]. 1883 (Cf. Êtres Humains. Himmler Heinrich, Femmes. Mères, Politique. État. Proxénétisme. Bordels)
Femmes (Nazisme) (5) : (20 septembre) 1939. Friedrich Reck-Mallenczewen [1884-1945], dans La haine et la honte. Journal d’un aristocrate allemand. 1936-1944, auteur de :
« […] Et le résultat final de cette guerre totale qui est en train de s’amorcer, c’est que le globe sera submergé par cette nouvelle génération allemande. Et si la postérité se montrait déficiente ? Oh, l’efficacité allemande a pris des mesures de prévoyance même pour ce cas : à Munich vit un jeune couple et, l’atrophie du nerf optique semblant être héréditaire dans la famille du mari, il doit se faire stériliser. Mais comme avoir des enfants est un devoir, il envoie sa femme à la ‘Fontaine de Jouvence’ [Lebensborn]. Mais cette ‘Fontaine’ est une organisation SS dont les bureaux sont logés Lenbachplatz, dans ce qui reste de la synagogue démolie. Là se trouve un album avec des photos de SS d’une blondeur garantie authentique et l’on peut choisir à discrétion ; il suffit de désigner au bureau la photo du taureau reproducteur élu. […]
La ‘Fontaine de Jouvence’, Lenbachplatz à Munich, téléphone n° X, se charge de tout cela. L’Allemagne occupera la première place dans le monde, même si elle a été conçue au bordel. » (Cf. Femmes. Mères, Famille. Couple, Politique. État, Proxénétisme. Bordels)
Le but officiel était « d’aider des familles nombreuses de haute valeur raciale et biologique. » 1884
Femmes (Nazisme) (6) : (10 mai) 2017. Dans un documentaire intitulé Une vie allemande, Brunhilde Pomsel [1911-2017], secrétaire de Joseph Goebbels [1897-1945] à partir de 1942, s’interroge :
« Dois-je me reprocher de n’avoir pas été intéressée par la politique ? » Oui.
-------------
Femmes (Nombre) : (23 octobre) 2014. Jean-Christophe Rufin, lors de son intronisation à l’académie française, auteur de :
« […] On me dira que cette prestigieuse responsabilité occulte le fait que, du point de vue quantitatif, la présence féminine reste encore très minoritaire. C’est vrai. Pourtant, cette perception comptable du problème ne reflète en rien l’état d’esprit qui règne parmi nous. Les femmes, dans cette Compagnie ne sont pas un groupe, un nombre, un quota. Elles sont des personnalités singulières, chacune unique et précieuse, et leur apport ne se mesure pas à leur importance numérique. […] » 1885 Une grossière entourloupe… (Cf. Femmes. « Féminin », Langage. Académie française, Politique. Démocratie. Parité)
Femmes (« Nounous ») : (26 juillet) 2025. Je lis dans Le Figaro. Madame, dans l’article intitulé « Plongé dans le Norland collège qui forme les nounous les plus convoitées du monde », qu’elles sont aussi nommées « nannies » et qu’elles ne sont pas des « domestiques de luxe ».
Je lis aussi : « Au-delà des exigences académiques classiques, nous demandons aux candidats d’avoir une expérience préalable dans la garde d’enfants : baby-sitting, travail de nounou, bénévolat dans des groupes d’enfants, ou aide apportée à des frères et sœurs plus jeunes. Nous recherchons des élèves qui démontrent une passion authentique pour le travail avec les enfants. Le profil idéal ? Des personnes aimantes, gentilles, résilientes, honnêtes, créatives et organisées. »
Sur la photo de première page, je ne vois que des femmes, toutes jeunes, toutes ravies, toutes blanches de peau. (Cf. Femmes. Travail)
Par ordre chronologique. Femmes. « Nourrices » :
Femmes (« Nourrices ») (1) : 1846. Jules Michelet [1898-1874], dans Le peuple, auteur de :
« Aucun peintre de mœurs, romancier, socialiste, que je sache, n’a daigné nous parler de la nourrice. Il y a pourtant là une triste histoire qu’on ne connaît pas assez. On ne sait pas combien ces pauvres femmes sont exploitées et malmenées, d’abord par les voitures qui les transportent (souvent à peine accouchées), et ensuite par les bureaux qui le reçoivent. Prise comme nourrice sur lieu, il faut qu’elles renvoient leur enfant, qui souvent en meurt. Elles n’ont aucun traité avec la famille qui les loue, et peuvent être renvoyées au premier caprice de la mère, de la garde, du médecin ; si le changement d’air et de vie leur tarit leur lait, elles sont renvoyées sans indemnité. Si elles restent, elles prennent ici les habitudes de l’aisance, et souffrent infiniment quand il faut rentrer dans leur vie pauvre ; plusieurs se font domestiques, pour ne plus quitter la ville, elles ne rejoignent plus leur mari et la famille est rompue. » 1886 (Cf. Corps. Seins, Famille, Histoire. Michelet Jules, Économie. « Pauvres Les »)
Femmes (« Nourrices ») (2) : 1866. George Sand [1804-1876] écrit concernant la nourrice de sa petite fille, Aurore, à sa belle-fille :
- 20 janvier 1866. : « L’enfant se délecte au sein d’une douce paysanne. »
- 25 janvier 1866. « La nourrice fonctionne bien. »
- 25 janvier 1866. « La petite se paie une nourrice superbe. »
- 25 janvier 1866. « La nourrice est douce. […] C’est une source de lait d’ailleurs que cette paysanne, et quand j’aurai réussi à la rendre propre, je partirai. »
- 15 février 1866. « Elle est bête comme tout cette nourrice, mais elle est bonne et douce. »
- 23 février 1866. « Je crains que le lait de la nourrice ne soit pas bon, peut être cette femme est-elle souffrante sans vouloir le dire. »
- 23 février 1866. « Camille [le médecin] croit que c’est la faute du lait et c’est la nourrice qu’il faut examiner autant que l’enfant. […] Lui est prêt à envoyer une nourrice. »
- 26 février 1866. « C’est peut-être la nourrice qu’il faudrait soigner. Ne pas la laisser manger comme elle l’entend, lui faire prendre l’air tous les jours et empêcher peut-être la fréquentation sans témoins avec le mari. Ces gens-là sont des brutes, elle est peut-être déjà enceinte. Camille dit que c’est sur la nourrice que l’attention doit se porter dès que l’enfant est malade. […] Tu devrais aussi t’informer d’une autre nourrice à prendre par intérim ou tout à fait en cas de changement nécessaire. Ici tu en auras toujours mais ce sera très cher, et sous le rapport du caractère, des soins, de la propreté, on ne sait rien, on ne peut garantir que la qualité du lait et la quantité. »
- 28 février 1866. « C’est une surveillance de tous les instants et c’est toi la vraie nourrice, puisque tu dois gouverner la dose et la qualité du lait. Il faut que la paysanne soit l’animal innocent et paisible. Il faut que tu sois le discernement, l’intelligence la prévoyance de tous les instants, la mère enfin, et qui est bien autre chose que d’être la mamelle. »
- 29 mars 1866. « Je mets ça dans le paquet destiné à la nourrice, 6 chemises et deux robes. C’est mon cadeau à ladite nourrice à la condition qu’elle se tiendra toujours très propre et qu’elle n’empestera pas le bégot [régurgitation des nourrissons après la tétée]. »
- 9 avril 1866. « Il n’y a pas en pareille circonstance de raison de convenance, d’économie ou de sentiment qui ne soit puérile ou même coupable. L’irrésolution serait coupable aussi. Changez de nourrice et soyez sûrs que si elle est meilleure, l’enfant ne souffrira pas d’un changement avantageux. Avisez vite sans donner l’éveil à la nourrice actuelle. Le chagrin ou la contrariété lui feraient du mal, à la petite par conséquent. Dites que c’est moi qui vous ait chargés de trouver une nourrice pour une dame de Paris ou de la province et ne dites la chose que quand il y aura un autre sein tout prêt. Qu’Aurore pleure ou non pour changer, ça ne fait rien du tout. D’ailleurs elle est encore trop jeune pour s’en apercevoir. »
- 12 avril 1866. « N’hésitez pas pour la nourrice ! Allez ! seulement soyez prudents pour qu’elle n’ait pas de saisissement. » (Cf. Êtres humains. Domestiques, Corps. Seins, Femmes)
Femmes (« Nourrices ») (3) : 1884. Émile Zola [1840-1902], dans La joie de vivre, auteur de :
« […] car la mère était encore au lit, et la nourrice qu’il avait fallu prendre, donnait son lait simplement, avec la stupidité docile d’une génisse. » 1887 (Cf. Femmes. « Animalisation », Langage. Verbe. Donner. Prendre)
Femmes (« Nourrices ») (4) : 1889. Léon Tolstoï [1828-1910], dans La sonate à Kreutzer, auteur de : « Une nourrice allaita l’enfant, autrement dit, nous profitâmes de la misère, de l’indigence et de l’ignorance d’une femme, nous la détournâmes de son petit pour lui confier le nôtre, et à ce titre nous lui mîmes sur la tête une coiffe avec des rubans. » 1888
Femmes (Nourrices) (5) : (19 septembre) 1895. Georges Clemenceau [1841-1929], dans l’article La joyeuse rupture paru dans La Dépêche, auteur de :
« […] Il évoque le salaire qui détourne la femme du soin de son enfant pour faire profiter une autre de sa substance et de sa tendresse achetées. […]
Cette prostitution du corps et de l’âme n’est peut-être pas moins infâme que l’autre. La société les encourage, les exploite l’une et autre pour en faire ses vertus. […] » 1889 (Cf. Corps. Seins, Femmes. Concurrence entre femmes. Salaires. Vertu, Relations entre êtres humains, Patriarcat, Penser. Économie. Profit, Proxénétisme)
Femmes (« Nourrices ») (6) : 1978. Dans le livre Entrer dans la vie. Naissances et enfances dans la France traditionnelle, je lis l’expression : « l’allaitement mercenaire ». 1890 (Cf. Corps. Seins, Femmes. Comment faire disparaître les femmes ? Économie)
Femmes (« Nourrices ») (7) : 2016. Je lis dans le Glossaire du livre de Patricia Ménissier : Être mère. XVIIIe-XXIe siècle [CNRS Éditions], trois spécificités de la fonction de « nourrice » :
« - Nourrice à emporter : Femme qui ramène chez elle, à la campagne, un enfant qu’elle aura la charge d’allaiter tout ne continuant ses travaux habituels ;
- Nourrice sèche : Femme recrutée pour s’occuper d’un nourrisson et qui le nourrit au biberon ;
- Nourrice sur lieu : Femme choisie pour vivre dans la maison du nourrisson qu’elle aura la charge d’allaiter. »
Dans la première expression, la femme est confondue avec l’enfant d’une autre ; dans la seconde, avec ses seins ; dans la troisième avec l’habitat de ses employeurs.
Dans les trois cas, la question de l’enfant de la nourrice est hors sujet. (Cf. Corps. Seins, Enfants)
Femmes (« Nourrices ») (8) : (3 février) 2023. Dans une note de 1985 de La Pléiade, je lis concernant la traduction du terme russe : ‘nania’ : « Sorte de nourrice sèche ».
Puis je lis, dans le Dictionnaire de l’académie française, que cette dernière expression s’oppose à « nourrice à sein ». 1891 (Cf. Corps. Seins)
N.B. Comparer « nourrice-à-sein » avec « homme-à-femme ».
-------------
Femmes. « Nous les femmes » :
Femmes (« Nous les femmes ») (1) : N’employer cette formulation qu’avec d’extrêmes précautions, en ayant préalablement pesé toutes les appropriations indues dont elle est porteuse et pris en compte toutes les conséquences politiques, qu’à chacun de ses usages, elle signifie et implique.
Analyse valable concernant tous les « nous » : nous sommes tous et toutes « un-e » et qui plus est nous avons tous et toutes des identités multiples, évolutives. Prenons donc garde que l’addition des innombrables « un-es » ne construise un « nous ».
* Ajout. 29 mai 2018. 1958. Pour comparaison. Simone de Beauvoir [1908-1986], évoquant ses relations avec Jean-Paul Sartre [1905-1980] dit :
« Je ne peux parler de moi sans parler de lui. Et très souvent, je dis ‘nous’, à propos de voyages, ou de choses qui nous intéressaient ensemble. […] Nous avons les mêmes souvenirs. » 1892
* Ajout. 8 novembre 2019. Peut-on ? - ou plutôt, comment peut-on ? - dire « nous » tout en se pensant et se sachant singulière ?
Femmes (« Nous les femmes ») (2) : (14 décembre) 2019. J’entends sur France Culture, sans vérification, qu’en queue de cortège de la manifestation organisé par Nous toutes du 23 novembre 2019 que certaines femmes affichaient une pancarte sur laquelle on pouvait lire :
« Vraiment nous toutes. » 1893
-------------
Femmes. Nues :
Femmes (Nues) (1) : Elle se montrait nue dans la maison de famille et jugeait sans oser l’exprimer tous et toutes les autres pudibond-es, voire plus… ; elle ne se rendait dès lors pas même compte qu’elle les mettait tous et toutes mal à l’aise.
Femmes (Nues) (2) : C’est fou, au cinéma, le nombre de femmes qui se lèvent - nues ou quasi - de leurs lits, et / ou qui entrent, sortent du bain, et / ou sont dans leurs douches, baignoires…
Par ordre chronologique. Femmes. Nues :
Femmes (Nues) (1) : (juin) 1757. Voltaire [1694-1778], dans une lettre à Marie-Élisabeth de Dompierre de Fontaine [1715-1771], auteur de :
« Votre idée, ma chère nièce de faire peindre [elle-même était peintre] de belles nudités d’après Natoire [Charles-Joseph. 1700-1777] et Boucher [François. 1703-1770] pour ragaillardir ma vieillesse est d’une âme compatissante et je suis reconnaissant de cette belle invention. »
Puis, il en donne notamment les dimensions : « 5 pieds ». 1894 (Cf. Culture. Art, Pornographie)
Femmes (Nues) (2) : (14 février) 1850. Eugène Delacroix [1798-1863], dans son Journal, écrit : « Ce même jour, jeudi, Madame P[otcka] [1852-1930] est venue avec sa sœur, la princesse de B[euavau]. La nudité de la Femme impertinente et celle de la Femme qui se peigne lui ont sauté aux yeux. ‘Que pouvez-vous trouver là de si attrayant, vous autres artistes, vous autres hommes ? Qu’est-ce que cela a de plus intéressant que tout autre objet vu dans sa nudité, dans sa crudité, une pomme par exemple ? » 1895
Femmes (Nues) (3) : 1869. Victor Hugo [1802-1885] dans L’homme qui rit, auteur de :
« La femme nue, c’est la femme armée. »
La femme nue rendrait-elle un homme prêt à se battre ?
Femmes (Nues) (4) : 1886. Émile Zola [1840-1902], dans L’œuvre, rapporte la réaction de Dubuche devant le tableau Plein air [Cf. Le déjeuner dans l’herbe. Manet] :
« Seulement ce monsieur tout habillé, là, au milieu de ces femmes nues, on n’a jamais vu ça. […] Le public ne comprendra pas … Le public trouvera ça cochon… oui. C’est cochon.’ » 1896 (Cf. Hommes. « Cochons »)
Femmes (Nues) (5) : 1995. Khalida Messaoudi, dans Une algérienne debout, rapporte ce souvenir :
« Un jour, au hammam, une fille en hijab, une militante du FIS [Font islamique du salut], a débarqué dans le vestiaire : ‘Ce que vous faites est un péché, vous êtes en train de vous dénuder, et Dieu n’aime pas ça. » L’explication qu’elle en donne est la suivante :
« Parce qu’elles pourraient décrire à leur mari le corps de l’une d’entre elles, et le mari ira à son tour le répéter à un autre homme, et tout ça amènera la discorde, transmise par une femme, fille de Satan ! » 1897 (Cf. Corps. Femmes, Patriarcat)
-------------
Femmes (« Nulles ») : 1934. Émile Gérard-Gailly [1882-1974], dans Les véhémences de Louise Colet, auteur de :
« Jusqu’ici, sa vie amoureuse [celle de Gustave Flaubert. 1821-1880], si différente de celle de Louise [Louise Colet. 1810-1876], avait été dissociée (sic) entre les femmes faciles, nulles, à qui il ne demandait qu’une chair passagère (sic), et son culte inaltérable pour la madone inaccessible, Elisa. » 1898 (Cf. Êtres humains. Chair, Femmes. « Faciles »)
Femmes. « Objets » :
Femmes (« Objets ») (1) : Avant d’être qualifiées d’ « objets sexuels », les femmes furent - notamment mais non pas exclusivement - considérées et traitées comme des « objets ».
En réalité, compte tenu de la découverte de tous les qualificatifs, toutes les dénominations dont les femmes furent affublées, qualifier les femmes d’ « objet sexuels »me parait aujourd’hui bien pauvre, bien restrictif… Mais, surtout, évacue la question du « sujet ». (Cf. Sexes, Objets sexuels)
Femmes (« Objets ») (2) : Au même titre que le fait que Karl Marx [1818-1883] ait considéré que la « force de travail » était transformée, et traitée par le capitalisme, en une « marchandise » ne transformait pas la classe ouvrière en une « marchandise », le fait que le patriarcat ait si souvent traité, selon diverses modalités, les femmes en « objets » ne les transforment en « objets ». Attention donc l’emploi du terme.
Penser, par ailleurs, que dénoncer ne permet pas de comprendre comment cette assimilation a pu être construite et ne suffit donc pas… (Poursuivre) (Cf. Êtres humains. « Marchandise »)
Par ordre chronologique. Femmes. « Objets » :
Femmes (« Objets ») (1) : 1782. Jean-Jacques Rousseau [1712-1778], dans Les confessions [1760-1765], écrit :
« Qui pourrait deviner la cause de mes larmes, et ce qui me passait par la tête en ce moment ? Je me disais : cet objet dont je dispose est le chef d’œuvre de la nature et de l’amour ; l’esprit, le corps tout est parfait ; elle est aussi bonne et généreuse qu’elle est aimable et belle. » 1899
Par ordre chronologique. Femmes. « Objets ». Émile Zola :
Femmes (« Objets ») (2) : 1871. Émile Zola [1840-1902], dans La curée, auteur de :
« M. Michelin souriait. Il emmena sa femme avec précaution, comme s’il eut tenu au bras un objet fragile et précieux. » 1900
Femmes (« Objets ») (3) : 1882. Émile Zola [1840-1902], dans Pot-Bouille, auteur de :
« Une rêverie l’envahissait [Octave] devant ces rangées profondes de femmes, il se demandait laquelle il aurait prise pour sa fortune et sa joie, si les maîtres de la maison lui avaient permis d’en emporter une. » 1901 (Cf. Femmes. Ornements [décoratifs], Hommes. Désirs)
-------------
Femmes (« Objets ») (4) : 1995. Jean Tulard, dans le Guide des films.1895-1995. L-Z, écrit concernant :
- Libre comme le vent [1958. Robert Parrish]] : « Quand un homme mûr ramène une jeune femme, ex-chanteuse de saloon, à la maison […]. »
- Lion sort ses griffes (Le) [1980. Don Siegel] : « L’inspecteur Willis veut saisir Jack Rhodes, célèbre voleur de diamants. Il lui met entre les bras une belle kleptomane chargée d’espionner Jack […]. »
- Mad dog and Glory [1991. John Mc Naughton] : « Un policier […] sauve la vie d’un gangster, qui, pour le remercier, lui envoie pour une semaine la belle Glory. [Il] en tombe amoureux et ne veut pas la rendre. »
N.B. Film qualifié de « charmante comédie. ».
- Partie d’échecs (La) [1994. Yves Hanchar] : « Un jeune joueur prodige, Max, défie le champion du monde d’échecs. Prix de la victoire : la fille de la marquise organisatrice du tournoi. » Femmes. (Cf. Échange des femmes. « Marchandise »)
- Petites Cardinal (Les) [1950. Gilles Grangier] : « Virginie et Pauline sont danseuses à l’Opéra et fort courtisées. Leur père, qui s’intéresse à la politique, les accorde ou les refuse au gré des circonstances. » (Cf. Hommes, Femmes. Échange des femmes, Famille, Patriarcat. Pères, Politique)
- Sous le signe du scorpion [1969. Paolo et Vittorio Taviani] : « Une trentaine d’hommes se sauvent d’une île que secoue une éruption volcanique. […] Ils abordent dans une autre île […] sont emprisonnés puis expulsés. Mais ils veulent emmener des femmes et réussissent à en enlever. »
- Trois femmes [1951. André Michel] : « Un paysan ramène du service une épouse noire. » 1902 (Cf. Culture. Cinéma, Femmes, Patriarcat)
-------------
Femmes (« Oies blanches ») : (8 octobre) 2022. Entendu, sur France Culture, évoquer « les oies blanches », dont le commentaire - suivi des rires - fut : « Elles ont un peu naïves ». 1903
À noter comme illustration de l’émission consacrée à ‘la couleur blanche’ - elle-même liée un temps à « l’hymen » et la robe de mariage - la reproduction d’un tableau représentant une femme nue allongée sur un lit présentée - offerte ? - au regard d’un homme, lui, habillé, fier et droit, à la fenêtre.
Femmes (ONU. Commission de la condition de la femme. Débats annuels à la) : La plus forte concentration de confusions concernant « les femmes », à ce jour jamais égalée. À l’exception des études dites « queer » ? J’ai souvent pensé démontrer cette assertion. J’ai fini par y renoncer : il faut lire ces textes et tenter de les comprendre...
* Ajout. janvier 2013. Je rectifie ici une erreur : j’avais malencontreusement jusqu’alors confondu le CEDAW - la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femme - avec la Commission de la condition de la femme (CSW) de l’ONU : « commission fonctionnelle du Conseil économique et Social (ECOSC) du Conseil économique et social consacrée exclusivement à la promotion de l’égalité des sexes et de la femme. Chaque année, des représentant(e)s des États membres se réunissent au Siège des Nations Unies à New York pour évaluer les progrès accomplis au niveau de l’égalité des sexes, identifier les défis, établir des normes mondiales et élaborer des politiques concrètes pour promouvoir l’égalité des sexes et la promotion des femmes à travers le monde. » (Cf. Droit)
Femmes (Ouvrières) : (18 juillet) 1842. Hélène Berr [1921-1945], dans son Journal écrit :
« Le peuple est admirable. Il paraît qu’il y avait beaucoup de petites ouvrières qui vivaient avec des israélites. Elles viennent toutes demander à se marier pour éviter à leurs maris la déportation. » 1904 (Cf. Femmes. Travail, Famille. Mariage)
Femmes. Orgasme :
Femmes (Orgasme) (1) : Le grand avantage des débats, très prisés dans les années 70, autour de l’orgasme vaginal et / ou clitoridien est qu’il permet d’éviter de se poser la question de son existence. (Poursuivre)
Par ordre chronologique. Femmes. Orgasme :
Femmes (Orgasme) (1) : (11 février) 2017. Brigitte Lahaie, présentée par France Culture, comme « l’icône de l’âge d’or du X français », auteure de :
« Je défie toute femme, à peu près normale, de ne pas avoir un orgasme si elle tombe sur une très bonne langue. » 1905 (Cf. Êtres humains, Corps. Langue, Hommes. Plaisir, Pornographie. Lahaie Brigitte, Sexes […])
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Orgueil :
Femmes (Orgueil) (1) : Quatre vers extraits d’un Épitre [amoureux] de madame de Montégut [1709-1752] adressée à madame de Charron, son amie, sa « chère Iris » :
« En parlant ainsi, je me loue ; / Rougirai-je d’un tel orgueil ? / Bien loin que je le désavoue / Il me suivra jusqu’au cercueil. » 1906
Femmes (Orgueil) (2) : (12 février) 1764. Voltaire [1694-1778], dans une lettre à Jacques-François-Paul Aldonce de Sade [1705-1778], cite de Virgile. L’Énéide [I, 529] :
« Non tenta superbia victis » [« Tant d’orgueil ne sied pas aux victimes »]. 1907 (Cf. Femmes. Victimes, Patriarcat)
Femmes (Orgueil) (3) : (26 novembre) 1834. Honoré de Balzac [1799-1850] écrit à Ewelina Hanska [1801-1882] :
« [D’ailleurs] vous êtes trop grande dame pour en être orgueilleuse [de ses appréciations concernant sa connai[ssance] des femmes]. » 1908
Femmes (Orgueil) (4) : (18 avril) 1835. George Sand [1804-1876], dans sa Lettre VI. À Éverard [Michel de Bourges. 1797-1853], auteure de :
« Mon orgueil se révolte contre ceux qui ne sont pas plus grands que moi et qui veulent me mettre à leurs pieds. » 1909 (Cf. Hommes. « Grands ». « Remarquables ». De Bourges Michel)
Femmes (Orgueil) (5) : 1869. Victor Hugo [1802-1885], dans L’homme qui rit, auteur de :
« D’amant, point ; de chasteté, pas d’avantage. Elle se murait dans son orgueil. Elle tenait peu à sa réputation et beaucoup à sa gloire. » 1910 (Cf. Femmes. Réputation)
Femmes (Orgueil) (6) : 1922. Marie Bashkirtseff [1858-1884] propose, à 22 ans, de son propre chef, son « amitié » à un homme. Elle en explicite les conditions et, dans la lettre qu’elle lui adresse, poursuit :
« Mais, êtes-vous digne de tout cela ? Et les choses ne tournant pas selon vos désirs, ne m’en voudrez-vous pas bêtement de m’avoir aimée ? » Suivi de :
« Je vous trouve audacieux de porter des regards à la hauteur où je me suis placée, mais le proverbe ne dit-il pas que le soldat qui aspire à devenir maréchal de France n’est qu’un mauvais soldat. Je m’aperçois, à la fin, que ce que j’exige de vous est insensé. Ce serait changer tout l’homme. » 1911
N.B. Le mépris n’est pas nécessaire à l’orgueil.
-------------
Femmes (Originales) : 1957. Boris Pasternak [1890-1960], dans Le docteur Jivago, auteur de :
« […] Mademoiselle, comme toutes les originales, aimait par-dessus tout, ses propres folies, et pour rien au monde elle en s’en fut corrigée. » 1912 (Cf. Femmes. « Folie ». Remarquables)
Par ordre chronologique. Femmes. « Ornements [décoratifs] » :
Femmes (« Ornements [décoratifs] ») (1) : 1661. Samuel Pepys [1633-1703] écrit dans son Journal :
- (13 janvier) 1661 : « Allé […] à l’église de Grenweich : bon sermon, belle église et force jolies femmes. »
- (21 avril) 1661 [lors de la cérémonie du couronnement de Charles Stuart [1720-1788] roi d’Angleterre] : « Je pénétrais dans la grande salle [de Westminster] - C’était un spectacle magnifique de tentures, de tribunes étagées l’une au-dessus de l’autre, pleines de jolies femmes. Ma femme à droite dans une petite tribune. » 1913 (Cf. Langage. Zeugma)
Femmes (« Ornements [décoratifs] ») (2) : 1727. Abbé de Choisy [1644-1724], dans Mémoires pour servir à l’histoire de Louis XIV, auteur de :
« (lors du carrousel du 29 mai 1686) […] J’oubliais de dire que les princesses y brillaient extrêmement : la magnificence des habits, les aigrettes des plumes, les perles et les diamants, faisaient paraître encore d’avantage les grâces qu’elles avaient reçus de la nature. » 1914 (Cf. Femmes. Beauté)
Femmes (« Ornements [décoratifs] ») (3) : 1829. Saint-Simon [1675-1755], dans ses Mémoires, concernent la cour de Louis XIV [1638-1715], auteur de :
« Il y avait une prière publique, tous les soirs dans la chapelle à Versailles à la fin de la journée […]. Les officiers des gardes du corps postaient les gardes d’avance dans la tribune, d’où le roi l’entendait toujours. Les dames étaient soigneuses d’y garnir les travées des tribunes, et l’hiver de s’y faire remarquer par de petites bougies qu’elles avaient pour lire dans leurs livres et qui donnaient à plein sur leur visage. La régularité était un mérite, et chacune, vieille et souvent jeunes, tâchait de l’acquérir auprès du roi et de Mme de Maintenon [1635-1719]. »
* Ajout. 18 mars 2023. « Il [Louis XIV] voyageait toujours son carrosse plein de femmes : ses maîtresses, après ses bâtardes, ses belles-filles, quelques fois Madame et des dames quand il y avait de la place. » 1915
Femmes (« Ornements [décoratifs] ») (4) : 1747. Françoise de Graffigny [1695-1758], dans ses Lettres d’une Péruvienne, concernant la situation des femmes [des milieux favorisés] mariées au XVIIIème siècle, écrit :
« […] Ses occupations sont ordinairement puériles, toujours inutiles, peut être au-dessous de l’oisiveté. On entretient son esprit tout au moins de frivolités malignes ou insipides, plus propres à la rendre méprisable que la stupidité même. Sans confiance en elle, son mari ne cherche point à la former au soin de ses affaires, de sa famille et de sa maison. Elle ne participe au tout de ce petit univers que par la représentation. C’est une figure d’ornement pour amuser les curieux […]. » 1916 (Cf. Femmes. Écrivaines. Graffigny Françoise de. Maison. Utiles, Famille. Mariage. Graffigny Françoise de, Relations entre êtres humains. Aimer. Graffigny Françoise de, Féminismes. Féministes. Graffigny Françoise de, Patriarcat. Graffigny Françoise de)
Par ordre chronologique. Femmes. « Ornements [décoratifs] ». Voltaire :
Femmes (« Ornements [décoratifs] ») (5) : (23 septembre) 1754. Voltaire [1694-1778], dans une lettre à la comtesse de Lutzelbourg [1683-1765], auteur de :
« On mande que la langueur, la misère et la consternation sont dans Paris. Il y a toujours quelques belles dames qui vont parer les loges […], mais le reste souffre et murmure. » 1917
Femmes (« Ornements [décoratifs] ») (6) : (4 mai) 1755. Voltaire [1694-1778], dans une lettre à Marie-Élisabeth de Dompierre de Fontaine [1715-1771], lui écrit :
« Je suis excédé d’ouvriers : consolez-moi et embellissez ma maison par vos ouvrages. Ils me seront un gage que vous y viendrez l’années prochaine. Vous et vos dessins, vous serez l’ornement de ma retraite. » 1918 (Cf. Hommes. Grossiers. Voltaire)
Femmes (« Ornements [décoratifs] ») (7) : (30 décembre) 1756. Voltaire [1694-1778], dans une lettre à Marie-Anne Fiquet du Boccage [1710-1802], auteur de :
« […] combien vous faites d’honneur à un art si difficile [écrire], à un siècle que vous enrichissez, et à votre sexe, dont vous étiez déjà l’ornement. » 1919
Femmes (« Ornements [décoratifs] ») (8) : (30 décembre) 1774. Voltaire [1694-1778], dans une lettre au comte d’Argental [1700-1788], auteur de :
« Nos loges [de la Comédie française] sont parées de femmes qui ne savent jamais de quoi il s’agit, à moins qu’on ne parle d’amour. » 1920
* Ajout. 28 mai 2020. Lu dans ses Lettres philosophiques. 1733 :
« Les femmes qui parent les spectacles, comme ici Paris-Londres], ne veulent plus souffrir qu’on leur parle d’autre chose que d’amour. » 1921 (Cf. Relations entre êtres humains. Amour, Patriarcat)
Femmes (« Ornements [décoratifs] ») (9) : (1er octobre) 1775. Voltaire [1694-1778], dans une lettre à Anne-Madeleine-Louise-Charlotte-Auguste de la Tour de de Saint-Julien [1730-1820], lui écrit :
« Nous travaillons toujours à force, nous bâtissons réellement une ville [Ferney] dans l’espoir que vous viendrez l’embellir quelque fois de votre présence. »
- Voltaire avait préalablement écrit, la concernant, le 21 août 1775, au comte d’Argental [1700-1788] :
« Sa maison sera très jolie et fera le plus précieux ornement de notre colonie naissante. » 1922
-------------
Femmes (« Ornements [décoratifs] ») (10) : 1787. Carlo Goldoni [1713-1793], dans ses Mémoires, auteur de :
« Il y en avait une [troupe de comédiens] à Rimini qui me parût délicieuse ; c’était pour la première fois que je voyais des femmes sur le théâtre, et je trouvais que cela décorait la scène d’une manière plus piquante. » 1923
Femmes (« Ornements [décoratifs] ») (11) : (1er avril) 1810. Lu dans les Mémoires de Fouché [1759-1820] concernant le mariage de Napoléon [1769-1821] avec Marie-Louise d’Autriche [1791-1847] :
« Le lendemain, la bénédiction nuptiale fut donnée à Napoléon et à Marie-Louise par le cardinal Fesch, dans une des salles du Louvre garnies de femmes resplendissantes de parures et de pierreries. » 1924
Par ordre chronologique. Femmes. « Ornements [décoratifs] ». Stendhal :
Femmes (« Ornements [décoratifs] ») (12) : (31 août) 1811. Stendhal [1783-1842], dans son Journal, lors de son voyage en Italie, écrit :
« […] La seconde sottise, c’est qu’en parlant avec mon compagnon de Milan des jolies femmes qui ornaient ce pays il y a dix ans, j’ai nommé Mme Gherardi. […] » 1925
Femmes (« Ornements [décoratifs] ») (13) : 1822. Stendhal [1783-1842], dans De l’amour, auteur de :
« Je n’ai de ma vie été frappé et intimidé de la présence de la beauté comme ce soir, à un concert que donnait Madame Pasta. Elle était environnée, en chantant, de trois rangs de jeunes femmes tellement belles, d’une beauté tellement pure et céleste, que je me suis senti baisser les yeux par respect, au lieu de les lever pour admirer et jouir. » 1926
-------------
Femmes (« Ornements [décoratifs] ») (14) : 1824. Lu dans le livre du Chevalier de Propriac [1760 ? -1823] Le Plutarque des jeunes demoiselle, l’épitaphe de Madeleine de Scudéry [1607-1701] « faite par M. de Vastron, historiographe du roi » ces deux vers :
« Elle fut l’ornement des deux siècles : de celui / ou elle naquit, et de celui où elle mourut. »
Le chevalier de Propriac avait préalablement écrit :
« L’hôtel de Rambouillet était alors le temple où la science et le bel esprit semblaient avoir établi leur séjour. Mademoiselle de Scudéry y fut admise, et en devint le plus bel ornement. »1927
Femmes (« Ornements [décoratifs] ») (15) : 1831. Lu dans Les lettres de Chateaubriand à Madame Récamier [1777-1849] une note concernant Delphine Gay [1804-1855] qui venait d’épouser Émile de Girardin [1806-1881] :
[Delphine Gay] « avait été l’un des ‘ornements‘ poétiques du salon de Madame Récamier [Juliette] où elle avait récité quelques-uns de ses premiers vers. » 1928 (Cf. Femmes. Salons)
Femmes (« Ornements [décoratifs] ») (16) : 1833. George Sand [1804-1876], dans Lélia, évoquant la vie de Trenmor, le décrit notamment comme « celui qui volait sur les flots de la belle Venise, entouré de femmes, de parfums et de chants, dans sa gondole rapide ! » 1929 (Cf. Langage. Zeugma)
Par ordre chronologique. Femmes. « Ornements [décoratifs] ». Honoré de Balzac :
Femmes (« Ornements [décoratifs] ») (17) : 1831. Honoré de Balzac [1799-1850], dans La peau de chagrin, auteur de :
« Riches étaient les parures, mais plus riches encore étaient ces beautés éblouissantes devant lesquelles disparaissaient toutes les merveilles de ce palais. […] Rien ne pouvait effacer l’éclat de ces figures, prestigieuses comme des fées, les couleurs agaçantes des robes faciles et la vigoureuse mollesse des formes entrelacées avec coquetterie. Le coeur brûlait, à voir les contrastes de leur coiffures mouvantes et de leurs attitudes, toutes diverses d’attraits et de caractère. C’était une haie de fleurs mêlée de rubis, de saphirs et de corail ; une ceinture de colliers noirs, sur ces cous de neiges ; des écharpes légères flottant comme les flammes d’un phare, des turbans orgueilleux, des tuniques modestement provocantes. Elles offraient des séductions pour tous les yeux, des voluptés pour tous les caprices. » 1930 (Cf. Êtres humains. Vêtements. Soi, Corps. Femmes. « Coquettes », Langage. Sujet)
Femmes (« Ornements [décoratifs] ») (18) : 1837-1843. Honoré de Balzac [1799-1850], dans les Illusions perdues, auteur de :
« Françoise était mise comme en étalage. » 1931
Femmes (« Ornements [décoratifs] ») (19) : 1842. Honoré de Balzac [1799-1850], dans La femme de trente ans, auteur de :
« L’enfant se haussa sur la pointe des pieds, et put entrevoir une foule de femmes parées qui encombraient les deux côtés de la vieille arcade en marbre par où l’empereur devait sortir. » 1932
-------------
Femmes (« Ornements [décoratifs] ») (20) : (14 juillet) 1839. Lu dans les Lettres de Russie d’Astolphe de Custine [1790-1857] concernant le mariage religieux de Nicolas 1er [1796-1855] avec la grande duchesse Marie [1819-1876] :
« Les premières dames de la cour de Russie et les femmes des ambassadeurs de toutes les Cours… garnissaient le tour de la chapelle […]. » 1933
Femmes (« Ornements [décoratifs] ») (21) : 1842. Nicolas Gogol [1809-1852], dans Les âmes mortes, auteur de :
« Nul arbuste, nulle verdure entre ces amas de poutres. Seules deux paysannes animaient le paysage : les jupes pittoresquement retroussées, de l’eau jusqu’aux genoux, elles traînaient par l’étang, à l’aide de deux bâtons, un filet déchiré […]. » 1934
Femmes (« Ornements [décoratifs] ») (22) : 1850. François-René de Chateaubriand [1768-1848], dans les Mémoires d’Outre-tombe, auteur de :
« Madame Récamier [Juliette. 1777-1849] était trop fière pour demander son rappel. Fouché [1759-1820] l’avait longtemps et inutilement pressée d’orner la cour de l’Empereur. » 1935 (Cf. Femmes. Utiles)
Femmes (« Ornements [décoratifs] ») (23) : 1853. Jules Michelet [1798-1874], dans son Histoire de la révolution française, concernant la Fête de la Fédération [14 juillet 1790], écrit :
« Partout, le vieillard à la tête du peuple, siégeant à la première place, planant sur la foule. Et autour de lui, les filles, comme une couronne de fleurs. » 1936 (Cf. Politique. Peuple)
Par ordre chronologique. Femmes. « Ornements [décoratifs] ». Émile Zola :
Femmes (« Ornements [décoratifs] ») (24) : 1871. Émile Zola [1840-1902], dans La Curée, auteur de :
« […] Les dames de la famille étaient placées [dans ce dîner ‘mondain’] entre les plus marquants de ces personnages. Saccard avait cependant réservé sa soeur Sidonie, qu’il avait mise plus loin, entre les deux entrepreneurs […] comme à un poste de confiance où il s’agissait de vaincre. […] » (Cf. Femmes. « Entremetteuses »)
Femmes (« Ornements [décoratifs] ») (25) : 1871. Émile Zola [1840-1902], dans La Curée, auteur de :
« Mais, monsieur, dit Renée d’un air de doute, si vous vous trouvez embarrassé, pourquoi m’avoir acheté cette aigrette et cette rivière qui vous ont coûté, je crois, soixante-cinq mille francs ? Je n’ai que faire de ces bijoux ; je vais être obligée de m’en défaire pour donner un acompte à Worms ?
- Gardez-en vous bien ! s’écria-t-il avec inquiétude. Si on ne vous voyait pas ces bijoux demain au bal du ministère, on ferait des cancans sur ma situation. […] Ma chère amie, nous autres spéculateurs, nous sommes comme les jolies femmes, nous avons nos roueries… Conservez, je vous prie, votre aigrette et votre rivière pour l’amour de moi. » 1937
Femmes (« Ornements [décoratifs] ») (26) : 1883. Émile Zola [1840-1902], dans Au bonheur des dames, auteur de :
« Sans exiger de filles belles, on les voulait agréables, pour la vente. » 1938 (Cf. Économie. « Au bonheur des dames »)
Femmes (« Ornements [décoratifs] ») (27) : 1891. Émile Zola [1840-1902], dans L’argent, auteur de :
« […] Le maître du logis menait un train princier, était aussi glorieux de son écurie de course que de sa galerie, appartenait à un des grands clubs, affichait les femmes les plus coûteuses, avait loge à l’Opéra, chaise à l’Hôtel Drouot et petit banc dans les lieux louches à la mode. » 1939 (Cf. Langage. Zeugma)
-------------
Femmes (« Ornements [décoratifs] ») (28) : 1871-1872. George Eliot [1819-1880], dans Middlemarch, auteure de :
« Oui, mais elle n’a pas le style que j’aime chez les femmes ; j’aime qu’une femme se mette un peu plus en frais pour nous plaire. Il faut qu’il y ait chez une femme un peu d’ornementation… un peu de coquetterie. Un homme aime qu’on le provoque un peu […]. » 1940 (Cf. Femmes. « Coquettes »)
Femmes (« Ornements [décoratifs] ») (29) : 1876. Hippolyte Taine [1823-1893], dans Les origines de la France contemporaine, concernant la société française riche et cultivée de l’Ancien régime, écrit :
« On est à table au milieu d’un luxe délicat, parmi des femmes souriantes et parées, avec des hommes instruits et aimables, dans une société choisie où l’intelligence est prompte et le commerce est sûr. » 1941
Femmes (« Ornements [décoratifs] ») (30) : 1887. Ferdinand von Saar [1833-1906], dans Le lieutenant Burda, auteur de :
« […] Les hauts dignitaires de l’empire apparaissaient, notamment les magnats hongrois et polonais dans leur costume national haut en couleur. Sans compter les dames : un ondoiement éblouissant de dentelle, de velours et de soie, de fleurs et de plumes, de diamants et de perles. » 1942
Femmes (« Ornements [décoratifs] ») (31) : (16 mai) 1901. Lu dans le Journal de l’Abbé Mugnier [1853-1944] :
« J’aime les beaux salons à boiseries dorées, à glaces, à lustres. J’aime les salles à manger parées de fleurs et de femmes. La mondanité est en moi, incorrigible. » 1943 (Cf. Langage. Zeugma, Économie. Luxe)
Femmes (« Ornements [décoratifs] ») (32) : (5 novembre) 1902. Le Matin propose un compte rendu du procès de Henri Vidal [1867-1906] nommé « le tueur de femmes » :
« En haut dans la tribune du fond de la salle, c’est une corbeille fleurie et abondante de femmes en toilettes de printemps », suivi, le lendemain, de :
« Là-haut, dans les tribunes, les toilettes sont nombreuses, plus nombreuses de jour en jour. » 1944
Femmes (« Ornements [décoratifs] ») (33) : 1923. Marcel Proust [1871-1922], dans La prisonnière, auteur de :
« […] Pendant ce temps-là, j’étais charmé. Car bien que le petit clan [le salon de madame Verdurin] comportât peu de jeunes filles, on en invitait pas mal, par compensation, les jours de grandes soirées. Il y en avait plusieurs, et de fort belles que je connaissais. Elles m’envoyaient de loin un sourire de bienvenue. L’air était ainsi décoré de moment en moment d’un beau sourire de jeunes filles. C’est l’ornement multiple et épars des soirées comme des jours. […] » 1945 (Cf. Femmes. Beauté. Jeunes filles)
Femmes (« Ornements [décoratifs] ») (34) : 1932. Edith Wharton [1862-1937], dans Les chemins parcourus. Autobiographie, se remémore sa toute petite enfance :
« C’était toujours un évènement dans la vie d’une petite fille que de faire une promenade avec son père, et plus particulièrement ce jour-là, parce qu’elle portait son nouveau bonnet d’hiver, qui était tellement beau (et tellement seyant) que, pour la première fois, elle s’éveillait à l’importance de la parure, et d’elle-même comme objet d’ornement - de sorte que je peux dater de cette heure la naissance d’un moi conscient et féminin dans l’âme confuse de la petite fille. » 1946 (Cf. Êtres humains. Âmes. Soi, Enfants, Femmes. Beauté. « Féminin ». Écrivaines. Wharton Edith)
Femmes (« Ornements [décoratifs] ») (35) : 1932. François Mauriac [1885-1970], dans Le nœud de vipères, après que Louis ait appris la mort de l’épouse, revient chez lui, il découvre « la maison drapée de noir », « les brasiers de cierges », « un monceau de fleurs ». Et François Mauriac poursuit :
« Deux religieuses immobiles avaient dû être fournies avec le reste. » 1947 (Cf. Êtres humains. « Restes », Femmes. Religieuses)
Femmes (« Ornements [décoratifs] ») (36) : 1939. Maurice Chevalier [1888-1972], dans Paris sera toujours Paris, chante pendant la guerre :
« Paris sera toujours Paris / La plus belle fille du monde / Ah ! Ah, si vous pouviez voir la corbeille de jolies femmes que nous avons ce soir / Vous n’pensez pas que c’est encore une richesse naturelle du pays, ça ? ! / Paris sera toujours Paris / On peut limiter ses dépenses / Sa distinction, son élégance / N’en ont alors que plus de prix / Paris sera toujours Paris » (Cf. Culture. Patriarcale, Politique. Nationalisme, Proxénétisme. Économie)
Femmes (« Ornements [décoratifs] ») (37) : 1957. Boris Pasternak [1890-1960], dans Le docteur Jivago, auteur de :
« Dans le salon de réception, les dames en visite formaient un tableau vivant autour de la table couverte de revues. Elles étaient debout, assises ou à demi accoudées dans les poses qu’elles avaient vu sur les illustrations, et, tout en examinant les modèles, elles discutaient des façons. » 1948 (Cf. Femmes. Mode)
Femmes (« Ornements [décoratifs] ») (38) : 1959. Dans une note de La Pléiade des Œuvres complètes de Jean-Jacques Rousseau [1712-1778], présentant madame du Deffand [1697-1780] je lis :
« La marquise du Deffand, femme d’esprit et de plaisir (elle avait été l’un des ornements du Palais-Royal sous la Régence) a entretenu, avec les grands esprits de son temps, des correspondances pleines de verve et de malice, et d’un style d’une qualité rare. » 1949 (Cf. Femmes. Remarquables, Hommes. « Grands », Langage. Style)
Femmes (« Ornements [décoratifs] ») (39) : 1970. Barbara Kostner, étudiante, citée par Daniel Cohn-Bendit, par engagement révolutionnaire, établie en usine en Allemagne en 1970, se souvient :
« C’était un monde très chaleureux. Je me sentais protégée et parfaitement à mon aise. Bien sûr, dans un atelier où les deux tiers des ouvriers étaient des hommes, j’étais confrontée au rôle toujours ambigu qu’on réserve aux femmes. D’un côté, elles améliorent le décor. C’est agréable pour les hommes, et l’ambiance s’en trouve tout de suite sexualisée. Par contre, c’était très nocif pour mon travail politique. […] » 1950 (Cf. Femmes. « Politiques », Patriarcat, Politique)
Femmes (« Ornements [décoratifs] ») (40) : 1974. Lu, cité dans La traversée d’une vie de Françoise Rosay [1891-1974] :
« La salle [de théâtre] était d’une rare élégance, constellée de jolies femmes et de célébrités parisiennes. » 1951
Femmes (« Ornements [décoratifs] ») (41) : 1980. Louise Weiss [1893-1983], dans Combats pour les femmes, auteure de :
« Un jour [en 1934] une Rolls s’arrêta devant nos vitrines [celles de La femme nouvelle]. La dame emmitouflée de zibelines qui en sortit, nous demanda timidement quelques tracts. Nous la pressâmes de souscrire à notre mouvement. Les larmes aux yeux, elle s’excusa. Son mari ne lui donnait pas d’argent. Elle ne disposait pas d’un franc. Elle n’était que sa réclame. » 1952 (Cf. Famille. Couple, Économie. Publicité)
Femmes (« Ornements [décoratifs] ») (42) : 1981. Georges Simenon [1903-1989], dans Mémoires intimes, auteur de :
« Je suis aussi invité aussi dans une université [Américaine] proche, celle-ci uniquement destinée aux jeunes étudiantes. C’est un véritable enchantement. » 1953 (Cf. Hommes. Plaisir)
Femmes (« Ornements [décoratifs] ») (43) : 1983. Raymond Aron [1905-1983], écrit dans ses Mémoires :
« Le département de langues romanes, à l’université de Cologne, en l’année 1930-1931, dirigé par Léon Spizer [1887-1960] (qu’entourait un bouquet de jeunes filles en fleur) ne manquait ni de chaleur ni d’éclat. » 1954 (Cf. Hommes. « Intellectuels »)
Femmes (« Ornements [décoratifs] ») (44) : 1992. Lu dans un Dictionnaire des femmes célèbres concernant Sophie Morny [1838-1896 :
« Elle fut l’un des plus brillants ornements de la cour des Tuileries où Napoléon III [1808-1873] […] lui réservait un accueil des plus flatteurs. » 1955
Femmes (« Ornements [décoratifs] ») (45) : (19 octobre) 1995. Discours d’Alain Juppé, premier ministre, lors de ‘l’installation’ à Matignon de l’ « Observatoire de la parité entre les hommes et les femmes » :
« Vous l’avez sûrement constaté, j’ai voulu montrer la voie en prenant (sic) douze femmes dans mon gouvernement. C’est certes un symbole, mais c’est surtout un message clair adressé au pays : il faut rompre avec les conservatismes qui nous ont trop longtemps privés de tout ce que les femmes peuvent apporter à la vie politique. Ainsi, si j’ai choisi ces femmes, ce n’est pas pour mettre des touches de couleur sur les photos prises sur les perrons des palais nationaux, mais c’est parce que j’avais besoin d’elles pour m’aider à réformer notre pays, et le rendre plus juste et solidaire. » 1956 (Cf. Femmes. Apparence, Hommes. « Politiques », Langage. Symbole. Verbe. Prendre, Politique. Conservatisme. Parité. Réformes)
N.B. Deux mois plus tard, le 7 novembre 1995, six mois après la composition de son gouvernement, le 17 mai 1995, huit d’entre elles seront évincées [licenciées ? remerciées ? renvoyées ?]
Femmes (« Ornements [décoratifs] ») (46) : (14 juin) 2017. Lu dans un article de Voici consacré à la fille de Donald Trump :
« Brillante femme d’affaires, mère de trois enfants, conseillère de son daddy : Ivanka Trump est la jolie vitrine de sa famille. » 1957 (Cf. Famille)
Femmes (« Ornements [décoratifs] ») (47) : (26 mars) 2020. Edhem Eldem, lors de son cours au Collège de France consacré à L’empire Ottoman et la Turquie face à l’Occident, les années 1820-1830, comme exemple de « transformation superficielle par le haut », auteur de :
« Jusqu’à la fin de l’empire, vous avez des dîners officiels, où les Ottomans, les dignitaires Ottomans, le grand vizir ne sont pas accompagnés, puisque les femmes ne peuvent pas participer à un dîner public, mais en revanche les ambassadrices y sont. Et par conséquent, ils se servent des étrangères comme femmes décorant la table afin d’avoir un service à l’occidental. » 1958
L’analyse peut être menée à plusieurs titres.
Femmes (« Ornements [décoratifs] ») (48) : (5 mai) 2022. Une photo représentant les quatre chefs des forces politiques censées composer la nouvelle majorité autour d’Emmanuel Macron, Richard Ferrand, Édouard Philippe, François Bayrou et Stanislas Guerini est jugée « désastreuse » pour le régime tant leurs visages exprimaient, sans fard, leur accablement. La réaction d’Emmanuel Macron, fut notamment celle-ci : « Et puis, mettre comme ça quatre hommes et aucune femme, c’est une faute. » Dans la mesure où les quatre hommes étaient nommés, connus, visibles, tel qu’exprimé, n’importe quelle femme pouvait faire fonction de femme-pot-de-fleurs. 1959
Femmes (« Ornements [décoratifs] ») (49) : (Pour comparaison)
- (7 octobre) 1762. Voltaire [1694-1778], qui avait notamment récemment reçu à Ferney le duc de Richelieu [1696-1788], dans une lettre adressée à Élie Bertrand [1713-1797], écrit :
« Ma cour a été suffisamment garnie de pairs, mon cher philosophe. »
- 1878. Le cardinal de Bernis [1715-1794] concernant le cardinal de Polignac [1661-1742] écrit, dans ses Mémoires :
« […] cet homme, si distingué par sa naissance, son esprit et ses dignités fut réduit à faire l’ornement des académies. » 1960
- 1891. Émile Zola [1840-1902], dans L’argent, auteur de :
« Il avait un nom illustre, il était extrêmement décoratif dans les conseils d’administration. » 1961
- (19 novembre) 1911. Alexandra David-Neel [1868-1969], dans une lettre adressée à son mari, évoque à Madras, une traversée en bateau « dans une barque pittoresquement garnie d’indigènes. » 1962
- 1929. Stefan Zweig [1881-1942], dans son Fouché [1759-1820], évoque « la nouvelle noblesse que Napoléon a fait naître des ruines de la révolution pour en parer sa cour. » 1963
- 1943. Lu dans À propos de la question coloniale, dans ses rapports avec le destin du peuple français de Simone Weil [1909-1943] :
« Pour des Anglais vivant en Inde, pour les Français vivant en Indochine, le milieu humain est constitué par les blancs. Les indigènes font partie du décor. » 1964 (Cf. Êtres humains)
- (3 juin) 1944. Lettre de Lynn White à Raymond Sontag aux fins de soutenir la nomination d’Ernest Kantorowicz [1895-1963] à l’Université de Berkeley : « Kantorowicz serait un ornement pour tout corps enseignant d’histoire dans le monde. » 1965
-------------
Femmes (« Parcours ») : (19 juillet) 2019. François-Xavier Bellamy, ‘tête de liste’ des Républicains aux élections européennes du 26 mai 2019, justifiant sa position concernant la loi défendue par Simone Veil [1917-2017] sur l’IVG, qu’il cautionne, affirme - en contrepoint ? - la nécessité d’ « accompagner chaque femme dans son parcours. »
Ai-je bien lu ? Être accompagnées pour, dans une décision d’IVG, par François-Xavier Bellamy ? Ai-je la berlue ? Non. Quelles régressions dramatiques pouvons-nous, devons-nous, craindre ? (Cf. Hommes. « Politiques », Langage. Verbe, Patriarcat. Permanence)
* Ajout. 23 octobre 2022. Je n’ai pas su estimer la fin programmée de ce parti et l’ai, surtout, surestimé.
Femmes (Paraître) : 1908. Malwida von Meysenburg [1816-1903], dans Le Soir de ma vie, suite des Mémoires d’une idéaliste, auteure de :
« Être est le meilleur remède au désir de paraître. » 1966
Les femmes n’étant pas seules à [être accusées de] vouloir « paraître », ce constat de bon sens est valable aussi, bien sûr, pour les hommes. (Cf. Êtres humains, Langage. Verbe. Être, « Sciences » sociales. Philosophie. Idéalisme)
Femmes (Paresseuses) : (12 septembre) 1757. Voltaire [1694-1778], dans une lettre à François de Chennevières [1699-1779], auteur de :
« Les femmes sont paresseuses ; elles sont plus longtemps à leur toilette qu’à leur secrétaire. » 1967 (Cf. Patriarcat. Voltaire)
Femmes. Paroles :
Femmes (Paroles) (1) : Si les dires des femmes dans les cabinets d’avocat-es, et, plus largement, lors des discussions entre elles, concernant leurs (ex) maris et (ex) amants, leurs collègues et patrons, leurs voisins et amis, les hommes en général, étaient publics, il y aurait largement de quoi faire exploser toutes les sociétés. Et, qui sait ? les révélations de Wikileaks ne pourraient-elles pas - à quel terme ? - apparaître comme de la roupie de sansonnet ? (Cf. Langage. Parole)
Femmes (Paroles) (2) : Les femmes causent, cancanent, pérorent, jasent, jacassent, piaillent, bavardent, bavassent, potinent, se lamentent, ragotent ; elles crient et hurlent, mais aussi se taisent et écoutent en silence.
À l’opposé, les hommes parlent, affirment, raisonnent, arguent, avancent, échangent, discutent, délibèrent. Et imposent le silence autour d’eux. (Cf. Langage. Parole, Patriarcat, Penser, Politique. Égalité)
Par ordre chronologique. Paroles :
Femmes (Paroles) (2) : (13 septembre) 1772. Concernant le pseudo-constat, effaçant l’histoire, si souvent entendu : « La parole des femmes s’est libérée », ne pas oublier, « le mot du cardinal de Mazarin [1602-1661] cité par Voltaire [1694-1778] :
« ‘Laissons-les dire et qu’ils [‘elles] nous laissent faire. » 1968 (Cf. Femmes. Silence, Justice, Hommes. « Politiques », Langage. Parole, Patriarcat, Histoire, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Partage des femmes :
Femmes (Partage des femmes) (1) : 1846. Honoré de Balzac [1799-1850], dans La cousine Bette, rapporte cet échange entre le baron Hulot et Crevel, se découvrant tous les deux « trompés » par madame Marneffe, :
« Si nous nous étions entendus, comme ces petits jeunes gens qui se cotisent pour entretenir une petite lorette à deux sous, elle nous aurait coûté beaucoup moins cher… » 1969 (Cf. Femmes. « Entretenues ». Valeur, Hommes. Connivence entre hommes, « Trompés », Économie)
Femmes (Partage des femmes) (2) : (21 octobre) 2021. Entendu sur France Culture :
« Cette femme qu’ils se sont partagés… ».
-------------
Femmes (« Partie noble de l’humanité ») : (21 novembre) 1924. Sigmund Freud [1856-1939] écrit à Karl Abraham [1877-1925] :
« Cher ami ! je vous recommande de toute urgence la personne qui vous remettra cette carte [Madame Orska. ?- ?] et que vous connaissez aussi, espérant que vous réussirez à sauver la ‘partie noble de l’humanité’. » 1970 (Cf. Femmes. Animalisation des femmes, « Sciences » sociales. Psychanalyse)
Femmes (Pas ennemies des hommes) : À force de se tuer à dire que les féministes ne sont pas les ennemies des hommes, le fait que tant d’hommes tuent tant de femmes a plus que tendance à passer à l’as...
* Ajout. 5 mars 2021. Dépassé ? Espérons-le…
Femmes (Paternité) : Lu dans un Dictionnaire des femmes célèbres concernant Anne-Marie Cornuel [« née Bigot. Française. 1605-1694 »] :
« Généreuse, elle éleva l’enfant que M. de Sourdis avait fait à sa femme de chambre : ‘Il a été fait à mon service‘. » 1971 (Cf. Enfants, Femmes. Mères, Langage. Verbe. Faire, Patriarcat. Paternité. Pères, Violences. Violences à l’encontre des femmes. « Droit de cuissage »)
Femmes (Paysannes) : 1787. 1788. 1789. Arthur Young [1740-1820], dans ses Voyages en France, auteur de :
- 22 mai 1787. « De la pauvreté et de pauvres moissons jusqu’à Amiens : les femmes labourent avec une paire de chevaux pour des semailles d’orge. La différence de coutume entre les deux nations n’est, à aucun point de vue, plus frappante que dans les travaux des femmes ; en Angleterre elles ne vont guère aux champs que pour glaner et faner : parties de maraude et de plaisir ; en France, elles labourent et chargent le fumier. » (p.27, 28)
- 10 septembre 1788. « Jour de foire à Landivisiau [Bretagne]. […] Les femmes sont ridées par la fatigue bien avant l’âge, au point de perdre la grâce de leur sexe. » (p.104)
- 12 juillet 1789. À Château-Thierry, Arthur Young discute avec « une pauvre femme » qui se plaint « des tailles et des droits qui nous écrasent ». Il poursuit : « Même vue de près, on eût donné à cette femme soixante ou soixante-dix ans, tant elle était courbée et tant son visage était ridé et durci par le travail ; elle me dit n’en avoir que vingt-huit. Un Anglais qui n’a pas voyagé ne peut s’imaginer l’aspect de la plupart des paysannes en France ; cela révèle, au premier coup d’œil, un travail plus pénible que celui des hommes ; joint à la peine, encore plus douloureuse, de mettre au monde une nouvelle génération d’esclaves, cela leur fait perdre toute régularité des traits, et toute apparence féminine. À quoi attribuerons nous cette différence des mœurs entre les basses classes dans les deux royaumes ? au gouvernement. » (p.147, 148) 1972 (Cf. Femmes. « Féminin », Économie. « Pauvres Les »)
Femmes. Mort. Peine de :
Femmes (Mort. Peine de) (1) : Au nom de l’égalité, en toute logique, que des femmes soient, comme les hommes, condamnées à mort devrait-il être considéré comme une avancée des droits des femmes ? Encore une preuve de l’inopérationnalité de « l’égalité ». (Cf. Droit. Droits des femmes, Justice. Peine de mort, Politique. Égalité, Penser)
Par ordre chronologique. Femmes. Mort. Peine de :
Femmes (Mort. Peine de) (1) : 1884. Véra Figner [1852-1942], révolutionnaire russe, condamnée à mort en 1884, puis sa peine ayant été commuée en travaux forcés à perpétuité, elle fut enfermée 20 ans dans les prisons du Tsar, dont elle fut libérée en 1905. Elle écrivit dans ses Mémoires :
« M’attendais-je à être exécutée ? Non. L’exécution de Sophie Pérovskaïa [1853-15 avril 1881], première exécution d’une femme, avait produit une déplorable impression. L’exécution des femmes n’était pas encore ‘entrée dans les mœurs’. » 1973 (Cf. Femmes. Enfermées, Justice. Peine de mort. Politique. Lois. Mœurs)
Femmes (Mort. Peine de) (2) : (6 janvier) 2025. Lu sur Franceinfo : « En 2024, l’Iran a exécuté 31 femmes annonce l'ONG Iran Human Rights. Il s'agit du chiffre le plus important depuis que l'ONG a commencé à recenser l'application de la peine capitale dans la République islamique, en 2008. ‘De nombreuses femmes exécutées pour meurtre étaient des victimes de violences domestiques ou d'abus sexuels agissant par désespoir’, souligne-t-elle. » (Cf. Politique. État, Patriarcat, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
-------------
Femmes. « Perdues » :
Femmes (« Perdues ») (1) : Elle s’était ‘donnée’ à lui ; elle devient une « femme perdue ».
Femmes (« Perdues ») (2) : Une « femme perdue » ne se retrouve pas : elle est [doit être] « sauvée », « réhabilitée », « relevée » … D’un autre siècle ?
Par ordre chronologique. Femmes. « Perdues » :
Femmes (« Perdues ») (1) : 1837-1843. Honoré de Balzac [1799-1850], dans les Illusions perdues, auteur de :
« Madame de Bargeton allait se trouver dans cette bizarre situation où se sont trouvées beaucoup de femmes qui ne se sont perdues qu’après avoir été injustement accusées. » 1974
-------------
Femmes (Perte de temps) : Calculer le temps que les hommes font perdre aux femmes, notamment en récriminations, colères, indignations, toutes aussi inutiles les unes que les autres. Un tel calcul renouvellerait les études sur les budgets temps. Et permettrait de mieux employer sa propre vie.
Parler, non seulement ne suffit pas, mais, qui plus est, laisse si souvent accroire qu’en s’exprimant, on agit, on dénonce et que l’autre va entendre, comprendre, s’amender… L’espoir alors fait vivre, mais par procuration : encore du temps perdu… (Cf. Femmes. Colère, Penser. Pensées. Indignation, Économie. Calcul, Violences)
Par ordre chronologique. Femmes. « Petites mains » :
Femmes (« Petites mains ») (1) : 1951. Vu dans le film Le plus joli péché du monde [Gilles Grangier], cette offre d’emploi affiché sur la porte d’un magasin :
« On demande un petite main experte ». (Cf. Culture. Cinéma, Femmes. Travail)
Femmes (« Petites mains ») (2) : (2 août) 1993. Sur France Culture, les femmes résistantes que Ludovic Seillier, l’interviewer de Madeleine Riffaud [1924-2024] nomme « les petites mains » sont ainsi décrites par elle :
« On peut dire que les femmes et les jeunes filles ont passé leur temps à raccommoder le filet brisé de la Résistance. Parce que quand quelqu'un était arrêté, c'est comme si une maille du filet était brisée. Et nous, nous raccommodions, nous refaisions la liaison. Beaucoup de ces femmes ont été tuées, torturées, et déportées aussi. » 1975 (Cf. Culture. Patriarcale, Êtres humains, Femmes. Résistantes, Patriarcat, Histoire. Patriarcale)
Femmes (« Petites mains ») (3) : (août) 2020. Dans les Rectificatifs et précisions du Monde Diplomatique, je lis :
« Dans l’article ‘Un village chinois en Italie’ [article de juillet 2020], le passé aurait dû être employé pour décrire les conditions de vie des petites mains du textile transalpin, car elles ne dorment plus dans l’atelier, à la suite des descentes de police. » (p.2)
Mais Le Monde Diplomatique persiste à traiter les femmes travailleuses de « petites mains ». (Cf. Corps. Mains, Femmes. Travail, Langage. Patriarcal, Penser)
* Ajout. Septembre 2020. Le mois suivant, c’est désormais un article entier du Monde Diplomatique qui est intitulé : « Les petites mains des grands hôtels ». Et si « les noms de lieux ont été modifiés ou anonymisés », il est précisé - sans doute, jugé nécessaire - que l’une des « femmes de ménages » est aussi « serveuse au bar d’une maison close espagnole. » (p.18) (Cf. Femmes. Travail, Proxénétisme, Économie. « Femmes-de-ménage »)
* Ajout. 13 août 2024. Dans ladite « haute couture », il y a les « premières mains », les « deuxièmes mains », les « petites mains ». (Cf. Politique. Hiérarchie)
------------
Par ordre chronologique. Femmes. « Pétroleuses » :
Femmes (« Pétroleuses ») (1) : 1871. En lisant, en employant ce terme, ne pas oublier que 197 femmes accusées d’avoir participé à la Commune de Paris [1871] ont été fusillées sous ce qualificatif. (Cf. Histoire)
* Ajout. 19 octobre 2016. 1929. Je lis dans le Journal de Russie. 1928-1929 de Pierre Pascal [1890-1983] que :
« 1050 femmes ont été jugées par les Conseils de guerre » (après la Commune de Paris). (Cf. Justice. Militaire. Patriarcale, Politique. Guerre. Femmes)
Il précise qu’il possédait un document présentant leur « condition sociale ». 1976
Femmes (« Pétroleuses ») (2) : 1871. Louise Michel [1830-1905], auteure de :
« Il n’y eut pas de ‘pétroleuses : les femmes se battaient comme des lionnes, mais je ne vis que moi criant : ‘Le feu ! le feu ! devant ces monstres !‘ Non pas des combattantes, mais de malheureuses mères de familles qui se croyaient protégées par quelque ustensile, faisant voir qu’elles allaient chercher de la nourriture pour leurs petits, étaient regardées comme des incendiaires, porteuses de pétrole et collées au mur ! » 1977 (Cf. Femmes. Mères. Remarquables. Michel Louise, Famille, Langage, Histoire, Violences)
-------------
Femmes. Peurs :
Femmes (Peurs) (1) : Elle découvrit subitement que sa vie avait été structurée, modelée, limitée, atrophiée du fait de sa peur de déplaire à un homme pour lequel elle n’existait pas.
Souvent vrai aussi pour les femmes qui ont été ‘heureuses’ de plaire à un homme.
Femmes (Peurs) (2) : Derrière la peur se cache souvent, innommé-es, refoulé-es, l’épouvante, la terreur, l’indignation, le chagrin, le désespoir, la confusion, l’impuissance, la résignation, la soumission, le mépris, la haine…
* Ajout. 1er novembre 2019. La révolte combat la peur. (Cf. Politique, Révoltes)
Par ordre chronologique. Femmes. Peurs :
Femmes (Peurs) (1) : 1945. Charlotte Delbo [1913-1985], en réponse à une question concernant Louis Jouvet [1887-1951], auteure de :
« […] Je suis quelqu’un d’assez brave et je n’ai jamais eu peur ni des gendarmes, ni de quoi que ce soit, mais j’ai toujours eu peur de Jouvet [Louis. 1887-1951]. Quand je suis rentrée [d’Auschwitz] je lui ai dit : ‘Eh bien savez-vous, je disais quand j’étais là-bas : ‘Si je rentre, je n’aurai plus peur de Jouvet‘. Il en a pleuré. » 1978 (Cf. Femmes. Écrivaines, Hommes, Patriarcat, Politique, Violences)
* Ajout. 27 août 2024. En relisant dans le (grand) petit livre de Georgette Elgey, La fenêtre ouverte, ce mantra : « Quand de Gaulle sera là, je n’aurai plus peur », auquel, petite fille, elle s’accrochait pour lui permettre de dépasser les terreurs qu’elle vécue pendant la guerre, j’ai repensé à Charlotte Delbo et à Louis Jouvet. 1979
Femmes (Peurs) (2) : 1958. Boris Pasternak [1890-1960], dans Le docteur Jivago, auteur de :
« Elle s’effrayait d’un rien et avait une peur mortelle des hommes. Et c’était justement la frayeur et l’affolement qui la faisaient sans cesse tomber dans leurs bras. » 1980
En y réfléchissant un peu, plus que compréhensible. (Cf. Violences. Violences à l’encontre des femmes)
Femmes (Peurs) (3) : 1960. Vassili Grossman [1905-1964], dans Vie et destin, auteur de :
« Malgré tout, elle avait une certaine habitude des bombardements, du sifflement des éclats, elle en avait moins peur maintenant, mais les lourds regards des hommes fixés sur elle éveillait toujours le même effroi. » 1981 (Cf. Patriarcat, Politique, Guerre. Femmes, Violences)
-------------
Femmes. Pionnières :
Femmes (Pionnières) (1) : Vous avez dit : pionnières ? À quel prix ? Dans quelles conditions réelles ? Plus profondément, de quelle valeur politique sont-elles les symboles ?
Femmes (Pionnières) (2) : Combien de femmes les ayant précédées, combien de femmes les ayant suivies, celles définies comme « pionnières » ont-elles caché ?
Femmes (Pionnières) (3) : Elle fut une pionnière dans… ; elle fut la première à être admise, reconnue, engagée, acceptée… ; elle fut une précurseuse en matière de… ; elle fut à l’avant-garde de…
Ou comment l’exception cache la norme, comment une seule femme parvient à cacher des millions et des millions d’autres…
-------------
Femmes (« Pipelettes ») : Même dans l’étroite sphère dans laquelle les femmes étaient confinées, elles étaient encore accusées de parler trop et mal.
N.B. En tapant « Pipelette » sur Google, je suis renvoyé, dans le dictionnaire Robert, à « Pipelet » ; je lis alors que « le mot est féminin », tandis que l’exemple donné est : « ce garçon est une pipelette. ». Tandis que, dans le dictionnaire Larousse, à « Pipelette », je lis : « Personne qui a le goût des commérages et parle sans arrêt (le masculin Pipelet est rare). » (Cf. Langage. Féminisation du langage)
Femmes (« Pisseuses ») : (21 août) 2016. Lors d’un reportage de France Culture consacré aux dangers de l’extraction du sable, on entend évoquer des femmes pêcheuses dans la baie de Lannion, dont le bateau était nommé « la barque des pisseuses ». 1982
« Par dérision » affirme son auteur.
- Au mot « dérision », je lis : « Mépris mêlée de moquerie ». « Le mépris », faute d’être dénoncé, n’est-il pas cautionné ? Et que ‘pèse’ alors « la moquerie » ? (Cf. Relations entre êtres humains. Dérision. Mépris)
* Ajout. 7 décembre 2024. 1877. Émile Zola [1840-1902], dans L’assommoir, auteur de :
« Juste au moment où elle [Gervaise] secouait une couche d’enfant, qu’elle ne reconnaissait pas, tant elle était pisseuse, Coupeau entra. » 1983
Femmes. « Plafond de verre » :
Femmes (« Plafond de verre ») (1) : Terme - très à la mode, puis passé de mode - qui ne veut rien dire, mais qui a l’immense avantage de permettre de ne pas aborder, concernant les femmes, les coups bas, le harcèlement sexuel, les licenciements pour maternité, les temps partiels, les refus si souvent violents des remises en cause de l’identité masculine induites par le fait d’être commandé par une femme, tout l’arsenal qui permet de dénigrer ses concurrent-es au nom de l’éternel pousse-toi-de-là-que-je-m’y-mette. Modus vivendi dans lequel les hommes ont une nette avance sur les femmes.
- Et si on disait plutôt : ‘Les femmes sont maintenues au bas de l’échelle par les hommes’ : ou : ‘Les hommes ne tolèrent pas que les femmes soient supérieures à eux’ ne serait-ce pas plus simple, plus clair, plus compréhensible ?
Et, que, pour ce faire, des hommes les dévalueront, les dégraderont, les rétrograderont, et discréditeront celles qui ne plieront point, pour mieux promouvoir les femmes qui ne les gêneront pas (du moins, le croient-ils), celles qui sont, pour eux, un risque, celles dont ils peuvent tirer profit et qui peuvent en sus jouer un rôle, une fonction de ‘soupape de sûreté’.
- Je me souviens d’avoir entendu une universitaire, du temps où la parité (ou plutôt ce qui était présenté comme tel) était de mode, dire, concernant ses collègues hommes : « Ils sont en train de constituer leur harem. »
- En son temps, Maria Deraismes [1828-1894] écrivait :
« L’homme s’étant approprié les hautes positions est maître ; et toute femme qui veut parvenir doit lui céder ou renoncer. » 1984 (Cf. Politique. Égalité. ENA [École nationale d’administration]. Sciences-po. Parité)
* Ajout. 2 octobre 2016. (mai) 1850. Victor Hugo [1802-1885], dans Choses vues, auteur de :
« Bourgeois parvenus qui tirent l’échelle après eux et ne veulent pas laisser monter le peuple. » 1985
* Ajout. 18 novembre 2023. Expression passée de mode.
Femmes (« Plafond de verre ») (2) : Cette formulation du « plafond de verre », outre l’immense avantage de renvoyer la responsabilité de rester « en dessous » à celles qui y sont et qui n’auraient pas la force de le briser, et en sus, de renvoyer aux calendes Grecques et de transformer en mythe, l’espoir de ce que l’on appelait autrefois : ‘monter dans l’échelle sociale’.
Dorénavant efficacement testé sur les femmes, l’expression peut s’universaliser.
Femmes (« Plafond de verre ») (3) : Focaliser l’attention sur le « plafond de verre » a pour fâcheuse conséquence d’oublier le plancher sur lequel il est construit et sans lequel il n’existerait pas.
Par ordre chronologique. Femmes. « Plafond de verre » :
Femmes (« Plafond de verre ») (1) : 2015. Gloria Steinem, dans Ma vie sur la route. Mémoires d’une icône féministe concernant la situation des femmes dans la presse aux États-Unis, à la fin des années 1970, écrit :
« Ce n’était pas de plafond de verre qu’il fallait parler, mais plutôt de cage. » 1986
Femmes (« Plafond de verre ») (2) : 2016. L’image du « plafond de verre » n’était pas suffisante : il lui fut adjointe une autre, entendue par moi pour la première fois en 2016, de
: « semelles de plomb » …
* Ajout. 26 juin 2018. J’entends employer par une députée LREM l’expression de « plancher gluant » - ce qui signifierait que « la planche a été bien savonnée » … 1987
Il est difficile, avec de tels outils d’analyse, de responsabiliser, de critiquer quiconque, d’interroger quoi que ce soit…
Femmes (« Plafond de verre ») (3) : (3 août) 2017. Marlène Schiappa, secrétaire d’état à l’égalité entre les hommes et les femmes, devant la délégation aux droits des femmes du sénat, évoque à deux reprises « le plafond de mère ».
- À crever, par chaque femme, lui aussi ? (Cf. Femmes. « Politiques ». Schiappa Marlène) 1988
-------------
Femmes. Plaisir :
Femmes (Plaisir) (1) : [Après mûres réflexions] Seules les femmes peuvent en parler. Que tant d’hommes aient pu [eux qui, si souvent, ne les écoutaient même pas, encore moins souvent ne les entendaient, ne répondaient à leurs questions, et si souvent, ne les voyaient pas non plus], depuis si longtemps, se sentir légitimement à même de se substituer à leur parole, en la matière, donne la vraie valeur qu’ils leur accordaient. De la valeur qu’ils s’accordaient à eux-mêmes. Et de leur interprétation du plaisir… (Cf. Patriarcat, Penser)
Femmes (Plaisir) (2) : Si l’on ne parle bien que de ce que l’on connaît, pour ne pas évoquer ce que l’on a vécu, que reste-t-il de ce que les hommes - et les femmes qui en furent si souvent dépendantes - ont pu écrire sur le sujet ? Rien ? Pas grand’ chose ? Quoi alors ? (Cf. Penser)
Par ordre chronologique. Femmes. Plaisirs :
Femmes (Plaisir) (1) : 1880. Fiodor Dostoïevski [1821-1881], dans Les frères Karamazov, auteur de :
« Une jeune fille d’une vingtaine d’années […] vient se confesser à un vieux Père. Une beauté, un corps à en avoir l‘eau à la bouche. Elle se penche, murmure son péché à travers la lucarne : - ‘Comment, ma fille, vous êtes de nouveau retombée !‘ s’exclame le Père. ‘ Oh ! Santa Maria, qu’entends-je ? C’est avec un autre ! Jusques à quand cela continuera-t-il ? Et comment n’avez-vous pas honte’ ? - ‘Ah, mon Père, répond la pécheresse tout en pleurs : ‘ça lui fait tant de plaisir et à moi si peu de peine ! »
N.B. En note du traducteur, la dernière phrase : « En français, dans le texte ». 1989 (Cf. Relations entre êtres humains. Aimer. « Faire l’amour »)
Femmes (Plaisir) (2) : 1949. Jacques Prévert [1900-1977], dans Spectacle. Un homme et un chien, auteur de :
« Le matin, l’homme se lève, s’habille, met l’argent sur la cheminée, cependant que la femme dort encore ou feint de dormir, rêvant de vrais plaisirs. » 1990
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. dites « à-plateaux » :
Femmes (dites « à-plateaux ») : 1926. André Gide [1869-1951], écrit dans Le retour du Tchad :
- le 24 février 1926 : « Un village extrêmement misérable (Cameroun) où vivent accidentellement des gens engagés ou venant de Moosgoum pour la saison de pêche. Toutes les femmes, même les plus jeunes, ont des plateaux aux deux lèvres - non de bois, mais d’argent (ou métal blanc), ainsi qu’aux oreilles. Encore que ces plateaux ne soient pas plus larges qu’un cul de bouteille, l’aspect est hideux. »
- le 26 ou 17 février 1926 : « Petit village en formation, sans nom encore sur aucune carte. […] Des femmes qui ne seraient pas laides, sans ces terribles plateaux qui distendent les lèvres ; c’est bien un des plus déconcertantes aberrations, et que rien n’excuse ou n’explique - car les théories qu’on sort à ce sujet (dépréciation des femmes pour leur permettre d’échapper aux razzias) ne tiennent pas debout. Ces pauvres femmes, aux lèvres toujours ruisselantes, ont l’air stupides, mais nullement malheureuses ; elles rient, chantent, se trémoussent et ne semblent pas se douter qu’on ne puisse pas les trouver ravissantes. Il n’en est pas une seule au-dessus de quatorze ou quinze ans qui ne soit ainsi défigurée. [En note : Les plateaux sont néanmoins beaucoup moins larges que ceux de certaines autres tribus, des Sara en particulier. »]
- « La race des Massa est une des plus belles de l’Afrique centrale. […] Les femmes vivent nues, quel que soit leur âge ; car je ne peux appeler vêtements les colliers de perles dont elles se parent. Il n’est pas une d’entre elles, dont les lèvres ne soient affreusement distendues par des disques de métal. Les vieilles ont presque toutes une pipe à la bouche, là où le permettent le plateau, c’est-à-dire à la commissure des lèvres. Ajoutons que le port des plateaux entraine un continuel ruissellement de salive. » 1991 (Cf. Êtres humains. Vêtements, Corps. Lèvres, Femmes. Beauté, Patriarcat)
Femmes (dites « à-plateaux ») (2) : 1929. Albert Londres [1884-1932] dans Terre d’ébène. La traite des Noirs, auteur de :
« […] Je regardais furibond les femmes à plateaux. Plutôt, ce n’était pas des plateaux. Un gros morceau de quartz bouchant un trou déformait la lèvre inférieure. Le quartz enlevé, on voyait soit la langue, soit la salive glisser par l’orifice. C’était dégoûtant. […] » 1992 (Cf. Corps. Lèvres, Femmes. Beauté, Patriarcat)
-------------
Femmes (Plantes) : 1802. Lu, écrit, concernant Mary Robinson [1758-1800] :
« Si cette superbe plante, ensevelie maintenant dans une terre obscure avait été cultivée, transplantée dans un sol plus heureux où elle aurait pu déployer tout l’orgueil de ses rameaux, et s’abriter contre le ver rongeur qui s’attacha à ses racines pour ternir l’éclat qui devait la distinguer d’une manière si brillante, elle eut étendu ses racines, développé ses fleurs, exhalé ses parfums et fut devenue la gloire et l’ornement de sa contrée. » 1993 (Cf. Femmes. Ornements [décoratifs], Patriarcat. Robinson Mary)
Par ordre chronologique. Femmes. Pleurs [Larmes] :
Femmes (Pleurs) (1) : 1722. Daniel Defoe [1660-1731], dans Moll Flanders, auteur de :
« J’usai de mes efforts extrêmes pour le persuader, et j’y joignis l’éloquence connue d’une femme, je veux dire, celle des larmes. » 1994
Femmes (Pleurs) (2) : 1727. Marivaux [1688-1763], dans La vie de Marianne, auteur de :
« […] Les larmes que j’aurais pu répandre, qui souvent nous dégrade aux yeux mêmes de l’amant que nous pleurons et qui peuvent jeter du moins un air de disgrâce sur nos charmes. » 1995
Femmes (Pleurs) (3) : 1785. Sade [1740-1814], dans Les cent-vingt journées de Sodome, auteur de :
« Adélaïde pleura, c’était là toutes ses armes, et se laissa faire. » 1996 (Cf. Hommes. Pleurs, Violences. Sade. Viols)
Femmes (Pleurs) (4) : 1787. Carlo Goldoni [1707-1793], dans ses Mémoires, auteur de :
« Quel spectacle frappant, intéressant ! Une jolie femme qui pleure a des droits sur un cœur sensible. […] » 1997
Femmes (Pleurs) (5) : (9 décembre) 1792. Lettre de Beaumarchais [1732-1799], publiée à Londres : « À ma famille […]
Sèche tes larmes, ma douce et tendre fille ; elles troublent la sérénité dont ton père a besoin pour éclairer la Convention nationale sur de graves objets qu’il lui importer de connaître, et faire rentrer avec opprobre toutes ces lâches calomnies dans l’enfer qui les enfanta. […]
Mais, au nom de dieu, chère femme, si tu veux que je garde toute ma tête, défends à ta fille de pleurer ! » 1998
Femmes (Pleurs) (6) : 1811. Je lis dans la préface du livre Dix ans d’exil de Germaine de Staël [1766-1817] : En juin 1811 lorsque l’ordre fut donné par la police de Napoléon [1769-1821] à Mathieu de Montmorency [1727-1866], tuteur de ses enfants, et à Juliette Récamier [1777-1849] de quitter Coppet [résidence de Germaine de Staël], Germaine de Staël « les vit partir, épuisée de larmes qui firent le plus grand plaisir au Préfet. » 1999 (Cf. Politique. État)
* Ajout. 1er février 2020. Dans l’émission Concordance des temps de France Culture, Jean-Noël Jeanneney, auteur de :
« Napoléon est exaspéré par Madame de Staël ». 2000
Ou : comment le sentiment personnel d’un historien se substitue à un jugement politique.
Femmes (Pleurs) (7) : 1831. Victor Hugo [1802-1885], dans Notre-Dame de Paris, auteur de :
- (Concernant Esméralda, après avoir été enlevée par Quasimodo, réfugiée dans Notre-Dame, devenue son « asile », retrouvant Djali, sa chèvre) « En même temps, comme si une main invisible eût soulevé le poids qui comprimait ses larmes dans son cœur depuis si longtemps, elle se mit à pleurer ; et à mesure que les larmes coulaient, elle sentait s’en aller avec elles ce qu’il y avait de plus âcre et de plus amer dans sa douleur. »
- (Concernant l’archidiacre Claude Frollo qui entend une fois encore la haine qu’Esméralda lui porte, qui découvre qu’il a « pleuré », qu’elle l’a « regardé froidement pleurer ») : « Enfant sais-tu que ces larmes sont des laves’ ? » lui dit-il.
- (Concernant « la recluse » qui découvre d’Esméralda est sa fille) 2001 « Elle pleurait à torrents, en silence, dans l’ombre, comme une pluie de nuit. La pauvre mère vidait par flots sur cette main adorée le noir et profond puit de larmes qui était au-dedans d’elle, et où toute sa douleur avait filtré goutte à goutte depuis quinze années. »
- (Concernant Quasimodo découvrant Esméralda au gibet) « Il était immobile et muet comme un homme foudroyé, et un long ruisseau de pleurs coulait en silence de cet œil qui jusqu’alors n’avait encore versé qu’une seule larme. »
Femmes (Pleurs) (12) : (18 mars) 1846. Gustave Flaubert [1821-1880], dans une lettre à Maxime du camp [1822-1894], auteur de :
« Ma mère est une statue qui pleure. » 2002
Femmes (Pleurs) (13) : 1853. Jules Michelet [1798-1874], dans son Histoire de la révolution française, dans le chapitre intitulé Le prêtre, la femme et la Vendée, auteur de :
« À mesure que la Révolution, provoquée par les résistances, était obligée de frapper un coup, elle en recevait un autre : la réaction des pleurs, le soupir, le sanglot, le cri de la femme, plus perçant que les poignards. » 2003 (Cf. Patriarcat, Histoire. Révolution française)
Femmes (Pleurs) (14) : (24 octobre) 1864. George Sand [1804-1876], dans une lettre à sa belle-fille, Lina Dudevant-Sand [1842-1901], auteure de :
« […] Et ne te retiens pas de pleurer, puisque le bon Dieu a fait les larmes pour nous empêcher d’étouffer. » 2004
Femmes (Pleurs) (15) : 1865-1869. Léon Tolstoï [1828-1910], dans La guerre et la paix, auteur de :
- « (Concernant Sonia) « Décidément, toutes les femmes ne sont que des pleurnicheuses, déclara Pétia, qui arpentait sa chambre d’un pas résolu. » (p.294. Livre 1)
- « (Concernant Natacha) « Qu’elle se mit à rire ou qu’elle essayât sa voix, les larmes aussitôt l’étouffaient : larmes de repentir, larmes versées au souvenir de son innocent passé à jamais aboli, larmes de dépit d’avoir sottement gâché sa jeune existence, qui aurait pu être si heureuse. » (p.848. Livre 3)
- « […] De nouveau les femmes, et parmi les hommes ceux qui avaient l’attendrissement facile - « Pétia [Rostov] était du nombre - versèrent des larmes de joie. » (p.882. Livre 3)
- « La comtesse Marie, qui était laide, embellissait toujours quand elle pleurait. Jamais elle ne pleurait à cause d’une douleur physique ou d’un ennui, mais toujours par chagrin ou par pitié. Et alors ses yeux lumineux prenaient un charme inexprimable. » 2005 (p.1511. Épilogue) (Cf. Relations entre êtres humains. Pitié)
Par ordre chronologique. Femmes. Pleurs. Émile Zola :
Femmes (Pleurs) (16) : 1867. Émile Zola [1840-1902], dans Thérèse Raquin, auteur de :
« Il pouvait la faire pleurer à volonté, la briser d’une émotion qui lui ôtait la vue nette des choses, et il abusait de son pouvoir pour la tenir toujours souple et endolorie dans sa main. » 2006 (Cf. Corps. Mains, Hommes, Patriarcat, Penser)
Femmes (Pleurs) (17) : 1886. Émile Zola [1840-1902], dans L’œuvre, auteur de :
« Et les yeux, au loin […], elle retenait les larmes dont se gonflait son coeur, réduite à cette misère de ne pouvoir même pleurer. » 2007
-------------
Femmes (Pleurs) (18) : 1880. La comtesse d’Agoult [Daniel Stern. 1805-1876], auteure de :
« Il me déplait que les femmes pleurent si abondamment. […]
Pleurez moins, ô mes chères contemporaines. La vertu ne se nourrit points de larmes. Quittez ces gestes, ces attitudes, ces accents de suppliantes. Redressez-vous et marchez : marchez d’un pas ferme vers la vérité. Osez une fois la regarder en face et vous aurez honte de vos gémissements. Vous comprendrez que la nature ne veut point de votre immolation stérile, mais qu’elle convie tous ses enfants à une libre expansion de la vie. Elle ne se sert de la douleur que comme d’un aiguillon du progrès. Votre inerte mélancolie, vos vains soupirs et vos douleurs futiles sont contraires à l’énergie de ses desseins. Encore une fois, séchez vos larmes. Prenez part de la science un peu amère et du travail compliqué de ce siècle. La société qui se transforme a besoin de votre concours. […] » 2008 Puissant. (Cf. Hommes. Pleurs, Féminismes, Langage. Accent)
Par ordre chronologique. Femmes. Pleurs. Anton Tchékhov :
Femmes (Pleurs) (19) : 1889. Anton Tchékhov [1860-1904], dans La princesse, auteur de :
« Quand on dérangeait la princesse, qu’elle se sentait incomprise, blessée, et qu’elle ne savait que dire ni que faire, elle se mettait à pleurer. » 2009
Femmes (Pleurs) (20) : 1893. Anton Tchékhov [1860-1904], dans Récit d’un inconnu, auteur de :
« Ces pleurs silencieux, réguliers, ces pleurs de femmes, exempts de toute hystérie, exprimaient l’offense, la fierté humiliée, le dépit et le sentiment d’une situation sans issue, sans espoir, que l’on ne saurait redresser et à laquelle on ne saurait se faire. » 2010
-------------
Femmes (Pleurs) (21) : 1907-1908. Jack London [1874-1916], dans le Journal de bord du ‘Snark’, auteur de :
« ‘Car l’homme est fait pour travailler et la femme pour pleurer’, tel est le chant de la mer pour toutes les femmes, les Blanches, les brunes, les Noires, les épouses comme les amantes, sur toute l’étendue du globe, selon la vieille, très vieille coutume de toujours. » 2011 (Cf. Histoire)
Femmes (Pleurs) (22) : 1930. Marie-Madeleine Clemenceau [1886-1931], « à la veille des années 30 », auteure de :
« Si la femme doit jouer un rôle politique, c’est bien quand il s’agit de combattre la guerre et de travailler à assurer la paix et la fraternité internationale.
Si les femmes avaient su… si les femmes avaient voulu…
Ah ! puissent-elles enfin savoir et vouloir !
Privée de moyens effectifs, devant l’homicide concerté, la femme, pendant des siècles, n’a eu que des larmes. Mais les pleurs ont le tort d’être sans efficacité, et le fleuve des larmes n’empêche pas le fleuve de sang. » (Cf. Féminismes, Patriarcat, Politique. Guerre)
Puissant, là encore. 2012
Femmes (Pleurs) (23) : 1951. Jacques Prévert [1900-1977], dans Intermède, auteur de :
« Une pluie de larmes ne peut rien contre la sécheresse du cœur… » 2013
Femmes (Pleurs) (24) : 1974. Anne Sylvestre [1934-2020] chante :
« Je cherche un mur pour pleurer ».
Femmes (Pleurs) (25) : 1983. Extrait de la chanson Désirée de Gilbert Bécaud [1927-2001] :
« Désirée / Comme je t'aim'rais / Si tu savais pleurer ». (Cf. Hommes. Pleurs)
Femmes (Pleurs) (26) : 1987. Marie Métrailler [1901-1979], dans La poudre de sourire, auteure de :
« Dans tous les pays ultra catholiques, Valaisans, Fribourgeois [Suisse] et autres, la femme a été ramenée à cette forme de passivité, d’obéissance à laquelle on la pliait, à laquelle elle devait se plier. Chaque fois que je rencontre ces vieilles paysannes de mon espèce - pour les jeunes, tout a changé, je crois - j’ai un grand élan de compassion que je ne manifeste pas. Si je l’exprimais, je les ferais pleurer ; toute leur misère sortirait d’un coup comme un eau trop longtemps contenue. [...] » 2014 (Cf. Femmes. « Espèce », Relations entre êtres humains. Compassion, Patriarcat. « Espèce »)
Femmes (Pleurs) (27) : 1947. Ivy Compton-Burnett [1888-1969], dans Serviteur et servante, auteure de :
« - Pourquoi Sarah pleure-telle ? demanda Avery.
- Parce qu’elle a été émue par ce que nous avons dit, répondit la nurse en clignant des yeux.
- Qu’est-ce que ça veut dire ‘émue’ ?
- Ça veut dire que son cœur a été touché.
- Que d’histoires, mon dieu ! dit Horace d’une voix sèche. On ne va tout de même pas s’apitoyer sur elle parce qu’elle vient s’entendre dire quelques paroles aimables.
- Ça ne lui arrive pas souvent dit Avery. » 2015 (Cf. Dialogues)
Femmes (Pleurs) (28) : 2017. Kevyn O’Leray, candidat richissime à la direction du parti conservateur Canadien (considéré comme le Donald Trump Canadien) déclara à une femme en pleurs :
« Vos larmes n’ont aucune valeur [marchande ?] » 2016 (Cf. Économie)
-------------
Femmes. Plus de femmes :
Femmes (Plus de femmes) (1) : Politiquement, revendiquer ‘plus de femmes’ dans les instances de pouvoir ne peut relever d’une pensée féministe ; ce serait confondre les systèmes de domination patriarcaux et les luttes des femmes pour s’en libérer. Ce serait confondre l’accès au pouvoir de quelques femmes avec la liberté de toutes les femmes. En sus, « + zéro », « + un », ne signifie rien. C’est « zéro », ou « un ». Enfin, c’est considérer les femmes en fonction d’une quantité ; c’est les nier singulièrement. (Cf. Femmes. Quantité, Féminismes, Politique. Luttes des femmes)
Femmes (Plus de femmes) (2) : « Plus de femmes » au pouvoir dans un monde de plus en plus inhumain, c’est déshumaniser plus de femmes et, qui plus est, rendre plus de femmes responsables de cette inhumanité. En conséquence, revendiquer ‘plus de femmes’ dans les instances de pouvoir, c’est interdire à tout jamais toute possibilité de liens entre éthique, morale et féminisme. (Cf. Femmes. « Politiques ». Quantité)
Par ordre chronologique. Femmes. Plus de femmes :
Femmes (Plus de femmes) (1) : (28 janvier) 1762. Avant de « s’engager en politique », une femme (ou un homme) pourrait réfléchir à ce que Rousseau [1712-1778] écrivait à Chrétien-Guillaume de Malesherbes [1721-1794] concernant « les foules de petits intrigants dont Paris est plein, qui tous aspirent à l’honneur d’être des fripons en place. » 2017 (Cf. Politique. État)
-------------
Femmes (Potentiel) : 2003. Hillary Clinton, dans Mon Histoire, auteure de :
« Les femmes représentent un potentiel. Et l’accès au crédit est non seulement un moyen efficace de combattre la pauvreté, mais aussi un droit fondamental. » 2018 (Cf. Économie. Crédit)
Par ordre chronologique. Femmes. Pour Le Monde :
Femmes (Pour Le Monde) (1) : 1995. Découvrir que la personne chargée, pour Le Monde, de ‘couvrir’ la conférence de l’ONU de 1995 « sur les femmes » était celle chargée de « la mode » - pour moi, une révélation dont l’onde de choc n’a jamais cessé de produire ses effets. Cette découverte m’a permis de mieux comprendre ce qui est politiquement signifiant pour la presse patriarcale et donc la validité à accorder à ses ‘analyses’. (Cf. Êtres humains. Mode)
Femmes (Pour Le Monde) (2) : 2016. Mettre un acte politique, même fondamental, au crédit des féministes [sauf s’il a plus de 40 ans, et encore !], alors même que la plus élémentaire vérité historique l’exigerait, est insupportable pour ce journal : cela n’a donc - tout simplement - pas lieu.
Une vie ne suffirait pas à relever la persistance de ses analyses de dénis, de mépris des femmes, des féministes, de caricatures.
- Hier, 5 mai 2016, j’ai entendu sur Radio Libertaire, nommer Le Monde, « la Pravda du capitalisme ». Comment le qualifier concernant ses postulats patriarcaux ? (Cf. Culture. Censure, Penser. Postulat, Patriarcat. Penser le patriarcat)
-------------
Femmes (Pour Libération) : (7 avril) 2012. Titre de Libération :
« En banlieue, Hollande compte sur les femmes », suivi de :
« Le candidat socialiste à l’Élysée marche dans les pas de Ségolène Royal en faisant des mères de famille le cœur de son message envers les banlieues. »
- Commentaire d’un-e lecteur/trice :
« En résumé, femme = mère de famille. On est en 2012 et vous êtes sur Libé ! » 2019 (Cf. Famille, Patriarcat)
Femmes (« Poussette ») : (30 août) 2016. Titre d’article de 20 Minutes : « Bois-Colombes : Un chauffeur de VTC [exploitant ou conducteur de voiture avec chauffeur] fauche deux femmes et une poussette. »
- Puis, il est écrit, dans le corps de l’article, sous l’intitulé :
« Le nourrisson s’en sort indemne » : « La mère du nourrisson a été amputée des jambes. Le petit s’en sort, lui, indemne. Quant à la femme enceinte de six mois, elle a été transportée en urgence absolue à l’hôpital de La Salpêtrière, ses jours ne sont plus en danger. »
- Et, enfin : « Le conducteur a été mis en examen et placé en détention provisoire pour blessures involontaires aggravées et écroué dans la foulée. Les premiers dépistages de stupéfiants se sont révélés positifs. » 2020
Femmes. Pouvoir sur les hommes :
Femmes (Pouvoir sur les hommes) (1) : Invoquer le pouvoir des femmes (sur les hommes) pour relativiser, récuser la réalité du droit [patriarcal] est absurde : le pouvoir des hommes sur les femmes est au fondement du droit. Nécessite donc, encore et toujours, une critique fondamentale du terme - en aucun cas un concept - de « pouvoir ». (Cf. Penser. Pensées. Binaires)
Par ordre chronologique. Femmes. Pouvoir sur les hommes :
Femmes (Pouvoir sur les hommes) (1) : 1842. Honoré de Balzac [1799-1850], dans La femme de trente ans, auteur de :
« Je vais aller prendre des leçons près d’elle : elle a su faire d’un mari bien médiocre un pair de France, d’un homme nul une capacité politique. » 2021 (Poursuivre)
-------------
Femmes (« Précaires ») : « Précaires » évite d’avoir à employer d’autres termes, tels que : pauvres, mal payé-es, sous-payé-es, chomeurs-ses, intérimaires, intermittent-es, dépendant-es, bénévoles, misérables, exploité-es, handicapé-es, sans logis, affamé-es… sans avoir à en expliciter ni les raisons, ni les causes, ni les explications… Liste sans cesse enrichie. (Cf. Êtres humains. Handicapés, Femmes. Faibles, Fragiles. Vulnérables, Économie. « Pauvres Les »)
* Ajout. 22 octobre 2020. Entendu ce jour, sur C. News, concernant les enseignant-es, à la suite de l’assassinat de Samuel Paty : « être en situation de précarité ». (Cf. Femmes. Vulnérables, Langage. Verbe. Être)
Femmes (« Préférées ») : Pourquoi tant de femmes se contentent-elles, certaines s’en glorifiant, d’être « la préférée », justifiant dès lors tous les abandons ? Et cela, si souvent, sans autre ‘preuve’ que le fait d’être ainsi qualifiée…
- Une permanence du statut de « favorites » [des rois] ? (Cf. Femmes. « Favorites » des rois)
N.B. Les femmes ne sont pas les seules concernées par la question.
Femmes (Priorité) : 2018. Elena Ferrante, dans L’enfant perdue, auteure de :
« J’avais tendance à donner la priorité non pas à ce qui m’arrangeait, mais à ce que lui était susceptible d’apprécier. » 2022 (Cf. Patriarcat)
Par ordre chronologique. Femmes. Propriété des hommes :
Femmes (Propriété des hommes) (1) : 1835. Honoré de Balzac [1799-1850], dans Le père Goriot, auteur de :
- « Je voudrais que vous fussiez toute à moi, dit Eugène. Vous êtes charmante.
- Vous auriez une triste propriété, dit-elle en souriant avec amertume. » 2023 (Cf. Dialogues)
Femmes (Propriété des hommes) (2) : 1973. Roland Barthes [1915-1980], dans Le plaisir du texte, concernant Le Mariage de Figaro [1778] de Beaumarchais [1732-1799], écrit :
« […] Dans cette pièce […] l’ancien seigneur, témoin anachronique d’un âge passé, menace encore de déposséder l’homme nouveau d’une propriété imprescriptible : sa femme. » 2024
Ne pas relever, ne pas critiquer, y compris lorsque Beaumarchais lui-même est concerné, n’est-ce pas prendre pour acquis et donc cautionner ? (Cf. Hommes. « Intellectuels », Violences. Violences à l’encontre des femmes. « Droit de cuissage »)
-------------
Femmes (« Propriété morale des femmes ») : 2015. Lu :
« La pilule RU 486 tire son nom des lettres RU, acronyme du laboratoire Roussel-Uclaf qui l’a mise sur le marché, et les trois chiffres 4-8-6 (numéro d’ordre de la synthèse de la molécule). Devant les oppositions religieuses et politiques de la fin des années 1980, le laboratoire Roussel-Uclaf renonce en 1988 à l’AMM [autorisation de mise sur le marché] qu’elle venait d’obtenir pour le RU 486. Il fallut l’intervention personnelle du Ministre de la Santé de l’époque, Claude Évin, affirmant que : ‘Le RU est la propriété morale des femmes’, et proposant de le confier à un autre laboratoire, pour que Roussel-Uclaf décide finalement d’assumer et d’exploiter son produit. »
Expression à diffuser ? sans doute trop confuse ? 2025
Femmes. Protéger :
Femmes (Protéger) (1) : Que l’on cesse à tout jamais d’employer ce terme, en deçà même de toute idée de droit. Et lorsque l’on en entend l’usage, que l’on sache que ce ne sont pas les femmes qui ne seraient pas protégées (de quoi ? de qui ? par quoi ? pourquoi ? comment ? quand ?), mais bien, depuis des siècles, les hommes qui sont protégés de toute condamnation des violences qu’ils commettent à l’encontre des femmes. (Cf. Langage. Mots. Critique de mots : « Protéger »)
Par ordre chronologique. Femmes. Protéger :
Femmes (Protéger) (1) : 1850. Charles Dickens [1812-1870], dans David Copperfield, auteur de :
« Je [Dora] ne sais pas à quoi papa peut avoir pensé d’aller prendre quelqu’un d’aussi insupportable pour me tenir compagnie. Qui a besoin d’être protégé ? Pas moi, en tout cas. » 2026
Femmes (Protéger) (2) : 1958. Charles de Gaulle [1890-1970], dans ses Mémoires, concernant les relations entre l’Europe de l’Ouest et l’OTAN, auteur de :
« Dès lors que l’efficacité de la protection est douteuse, pourquoi confierait-on son destin au protecteur ? » 2027
Forte et juste pensée… (Cf. Politique. Guerre. Protéger)
Femmes (Protéger) (3) : 1974. Lu dans L’Archipel du Goulag, d’Alexandre Soljenitsyne [1918-2008] :
« S’il [un homme menacé par la police] n’avait craint que pour lui-même, il n’aurait pas faibli. Mais il se représentait sa femme, sa fille dans les conditions des camps, dans ces baraques où la fornication ne se cache même pas derrière les rideaux, et où rien ne peut protéger une femme de moins de soixante ans. Et il fut ébranlé. » 2028 Qu’en penser ?
Femmes (Protéger) (4) : (23 janvier) 2008. Jacques Attali, digne successeur du Napoléon [1769-1821] de l’infâme Code civil de 1804, évoqua la nécessité de « protéger les faibles, les minorités, les femmes ». 2029
Aujourd’hui, affirmer vouloir ‘protéger les femmes’ ne choque pas grand monde, pas même les femmes ministres et/ou candidates à l’élection présidentielle.
- Protéger : à l’origine, pouvoir garder son bien des incursions extérieures et être à même de démontrer la réalité de son pouvoir à le faire.
Progressivement, la notion de « protection » - antithèse de la notion même de sujet [de droit], interdisant toute autonomie de l’être - s’est universalisée et tend à devenir aujourd’hui la norme pour tous et toutes.
Puis, de fil en aiguille, on en est même venu à justifier des guerres au nom de l’argument selon lequel un chef d’État, l’OTAN, une milice, une armée, etc.… ne ‘protégeait’ pas sa population…
- Entendre le terme de « protection des femmes », me fait penser à cette question lisible sur une pancarte lors d’une manifestation anticapitaliste (sans date) : « Qui protège les banquiers ? » Ne relève pas d’une critique justifiée, mais remet les questions sur de meilleurs rails… (Cf. Droit. Protéger, Femmes. Faibles, Hommes. « Intellectuels ». Attali Jacques, Langage. Critique de mots : « Protéger ». Zeugma, Politique. Minorités, Patriarcat)
Femmes (Protéger) (5) : (31 août) 2017. Entendu Marlène Schiappa, secrétaire d’état à l’égalité entre les hommes et les femmes, devant la délégation aux droits des femmes du sénat, évoquer, comme relevant de l’évidence, avec une assurance révélatrice de l’inconscience de la signification des mots employés, le besoin de « protéger les femmes les plus fragiles économiquement ». 2030 (Cf. Femmes. « Politiques ». Schiappa Marlène, Langage. Protéger, Politique. Protéger)
-------------
Femmes (Pudeur) : 1831. Victor Hugo (1802-1885], dans Notre-Dame de Paris, décrit Esméralda menée au gibet :
« Les spectateurs placés aux fenêtres pouvaient apercevoir au fond du tombereau ses jambes nues qu’elle tâchait de dérober sous elle comme par un dernier instinct de femme. […]
La condamnée retenait avec ses dents sa chemise mal attachée.
On eût dit qu’elle souffrait encore dans sa misère d’être ainsi livrée presque nue à tous les yeux.
Hélas ! ce n’est pas pour de pareils frémissements que la pudeur est faite. » 2031 (Cf. Êtres humains. Pudeur, Corps. Dents)
Femmes. « Puritaines » :
Femmes (« Puritaines ») (1) : Terme historiquement employé essentiellement pour les femmes, signifiant qu’elles étaient « frigides », « frustrées », « mal baisées », qualificatifs employés pendant des siècles sans que les hommes se sentent le moins du monde concernés. Ce terme, progressivement, s’est universalisé.
Aujourd’hui, traiter une personne - homme et femme - de « puritaine », c’est vouloir signifier qu’elle est contre-le-sexe, et donc pour «la prostitution » : voici l’un des niveaux d’analyse où nous sommes tombées grâce notamment aux défenseurs si zélés, si écoutés, si publiés, si choyés du système proxénète.
Et le processus d’inversion des valeurs et des normes mis en œuvre à l’encontre des abolitionnistes se poursuit et s’élargit : les personnes qualifiées de « puritain-es » sont assimilé-es, entre autres manifestations, aux « bien-pensants que veulent [nous] rééduquer ». Comment peut-on écrire de telles absurdités ? Malgré de nombreux et constants efforts, j’ai toujours beaucoup de mal à le comprendre. Néanmoins, ce que je comprends, c’est qu’il faut refuser la première assignation. Après, c’est trop tard… 2032
Par ordre chronologiques. Femmes. « Puritaines » :
Femmes (« Puritaines ») (1) : 1990. Françoise Verny [1928-2004], dans Le plus beau métier, évoquant sa jeunesse, notamment communiste, écrit :
« […] Puritaine comme les communistes de l’époque, je méconnais toutes les questions relatives au sexe. Comme eux, je n’envisage que des inégalités économiques et sociales. » 2033
Ne pas savoir, occulter, ignorer, oublier, refouler que son corps inclut aussi un sexe, c’est ne pas « être puritaine », c’est avoir une vision tronquée de soi. (Poursuivre) (Cf. Êtres humains, Corps, Langage. Critique de mot : « Puritain-e », Sexes […])
-------------
Femmes (Quantité) : (4 octobre) 2017. Dans un article faisant état du « récit recueilli » par un journaliste, Arnaud Ardouin, à savoir celui de Daniel Le Conte - « son dernier compagnon de route » - je lis :
« Les femmes, justement. Elles étaient l’une des passions de Jacques Chirac, grand coureur de jupons. Arnaud Ardoin revient sur ces infidélités à répétition, si nombreuses que la quantité a pris le pas sur la qualité. Il invite dans son avion une femme tout juste croisée lors d’un voyage à la Réunion ; rejoint chaque semaine une conquête rue de la Convention ; se rend régulièrement dans une garçonnière dans le même immeuble que le siège départemental parisien du RPR. » 2034 (Cf. Femmes. Plus de femmes, Hommes. « Politiques ». Chirac Jacques, Proxénétisme)
Femmes (« Quantité négligeable ») : 1989. Jules Roy [1907-2000], dans Mémoires barbares, auteur de :
« Les femmes, pour lui quantité négligeable, n’existaient que si elles avaient épousé un as ou un héros, alors il les voulait à genoux. » 2035 (Cf. Hommes. « Héros »)
Femmes (Quartiers populaires aux périphéries des villes) : Dans la grande majorité de ces quartiers - pudiquement qualifiés par certain-es de ‘sensibles’ (pour qui ?) et même, pour d’autres, de ‘compliqués’ (Plantu) - les initiatives constructives, innovantes, originales, solidaires ayant lieu - seules - ou quasiment - des femmes sont présentes. (Cf. Politique. Démocratie)
Femmes. Quitter un homme :
Femmes (Quitter un homme) (1) : La décision de quitter un homme est d’autant plus aisée à prendre que l’estimation de sa propre vie est jugée de plus de valeur que celle qui lui avait été antérieurement attribuée.
Par ordre chronologique. Femmes. Quitter un homme :
Femmes (Quitter un homme) (1) : À la question suivante lui demandant de réagir à l’une de ses affirmations anciennes :
« On ne reste pas avec un homme qu’on n’aime pas », Colette [1873-1954], évoquant sa vie avec Willy [1859-1931], répondit :
« J’aurais bien voulu, mais comment faire ? » 2036 (Cf. Femmes. Écrivaines. Colette et Willy, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
-------------
Femmes (Rebelles) : L’expression de « femmes rebelles » permet d’éviter d’avoir à employer le qualificatif de féministe et d’en dissoudre la signification ; et ce au profit d’un terme qui peut signifier tout et son contraire : la révolution et la contre révolution, le modernisme et le refus du modernisme, les avancées et les réactions, et peut même être utilisé pour qualifier des personnes, que certain-es qualifient de terroristes...
Efficace pour son effet de confusion intellectuelle. (Cf. Langage. Adjectif, Politique. « Terrorismes »)
* Ajout. 3 décembre 2018. (décembre) 2018. Lu dans une critique parue dans Le Monde Diplomatique du livre (pas lu) de Linda M. Heywood, Njinga. Histoire d’une reine guerrière [La Découverte. 2018. 336 p.] :
« […] Scandaleuse, car rebelle aux rôles sexués importés, elle entretient un harem d’hommes et de femmes. » 2037 (Cf. Politique. Égalité. Guerre, Proxénétisme)
Femmes (« Rebuts ») : (19 mars) 2020. Edhem Eldem, dans son cours (passionnant) au Collège de France consacré à L’empire Ottoman et la Turquie face à l’Occident dans les années 1820-1830, commentant une carte d’Istanbul vers 1840, auteur de :
« Là, vous avez l’ancien sérail, qui est en général utilisé comme rebut du précédant sérail… les anciennes femmes du précédent sultan, etc… »
Le lendemain, le 20 mars 2020, il l’évoque à nouveau « l’ancien palais, l’ancien sérail qui servait en quelque sorte de remise aux femmes et aux eunuques et aux serviteurs du sultan précédant … Donc, c’était une sorte de dépôt, de hangar pour des gens qui avaient terminé leur carrière et dont l’on ne sait plus quoi faire. » 2038 (Cf. Êtres humains)
Femmes (Regards) : Les femmes doivent regarder droit devant elles, ou, plus justement, loin au-delà d’elles-mêmes, a fortiori loin au-delà des hommes. Ou, plus justement, loin au-delà du patriarcat. Question : comment le dépasser en se remettant en cause et sans se renier ? (Cf. Corps. Yeux)
Femmes. Règles :
Femmes. Règles (1) : J’ai toujours détesté, je n’aime toujours pas entendre un homme parler des règles des femmes. Je n’aime, à vrai dire, pas non plus en parler.
Par ordre chronologique. Femmes. Règles :
Femmes (Règles) (1) : (5 janvier) 1754. Voltaire [1694-1778], dans une lettre à Marie-Louise Denis [1712-1790], lui écrit :
« Il se pourrait que votre maladie dégénérât en une suppression totale de règles. En ce cas, le régime continu et austère vous assurera une vie longue, mais peut être triste. » 2039
Femmes (Règles) (2) : (14 février) 1762. Voltaire [1694-1778] écrivit à la comtesse de Lutzelbourg [1683-1765], évoque, en plaisantant, une femme suisse âgée de 104 ans dont les « règles lui sont revenues à 102 ans ».
- Une note de La Pléiade [1980] précise que « le mot ‘règle’ a été remplacé par l’éditeur [non précisé] par des points », puis « restitué par Beuchot, LX, 177. » [éditeur des Œuvres de Voltaire. 1834] 2040
Femmes (Règles) (3) : 1772. Voltaire [1694-1778], dans la rubrique Femme de L’Encyclopédie, auteur de :
« Les femmes sont la seule espèce femelle qui répande du sang tous les mois. On a voulu attribuer la même évacuation à quelques autres espèces, et surtout aux guenons ; mais le fait ne s'est pas trouvé vrai. Ces émissions périodiques de sang qui les affaiblissent toujours pendant cette perte, les maladies qui naissent de la suppression, les temps de grossesse, la nécessité d'allaiter les enfants et de veiller continuellement sur eux, la délicatesse de leurs membres les rendent peu propres aux fatigues de la guerre et à la fureur des combats. » 2041 (Cf. Femmes. Animalisation des femmes, « Espèce », « Femelles », Patriarcat. « Espèce »)
Femmes (Règles) (4) : 1797-1799. Lu dans le Journal parisien. 1797-1799 de Wilhelm von Humboldt [1767-1835] :
« Au nombre des mauvais traitements infligés à la famille royale (pendant la révolution) s’ajoutent les coups que le Dauphin eut souvent à subir et la faim infligée à la reine [Marie-Antoinette. 1755-16 octobre 1793] pour l’affaiblir et la fatiguer au terme de son procès. Le jour de son exécution, elle eut une hémorragie. On ne lui donna point même de linge pour la diminuer quelque peu, de sorte qu’on pût voir qu’elle perdait du sang. On cherchait ainsi à affaiblir la reine encore davantage. » 2042 Autres sources ?
* Ajout. 3 janvier 2018. Je lis, concernant Marie-Antoinette, le jour de son exécution, dans un texte daté de 1794, intitulé : La marche à l’échafaud. Impression d’un témoin oculaire :
« […] Sa figure était pâle et très abattue, par la suite d’une perte qu’elle a eu dans sa prison […]. » 2043
Femmes (Règles) (5) : (14 septembre) 1799. Joseph-Marie de Gérando [1772-1842], auteur de Considérations sur les diverses méthodes à suivre dans l’observation des peuples sauvages, parmi les nombreuses questions qu’il suggère de poser à ceux qui vont à leur « découverte », nomme celle-ci :
« Est-ce un usage parmi les sauvages, que celui de faire cesser toute communication avec le sexe, pendant l’époque de ses incommodités ordinaires ? » 2044
Femmes (Règles) (6) : 1832. Honoré de Balzac [1799-1850], dans Le message, évoque les « indispositions naturelles à la femme. » 2045
Femmes (Règles) (7) : 1833. Jules Michelet [1798-1874], dans son Histoire de France, concernant Jeanne d’Arc [1412-1431], auteur de :
« Elle eut, d’âme et de corps, ce don divin de rester enfant. Elle grandit, devint très forte et belle, mais ignora toujours les misères physiques de la femme. Elles lui furent épargnées, au profit de la pensée et de l’inspiration religieuse. » Et cela, avec pour preuve « la déposition de son vieil écuyer ». 2046
Pour Michelet, Jeanne d’Arc n’avait pas de règles, sans doute comme la mère de jésus était vierge… (Cf. Êtres humains. Âmes, Femmes. Devenir une femme)
Par ordre chronologique. Femmes. Règles. George Sand :
Femmes (Règles) (8) : 1854. George Sand [1804-1876], dans Histoire de ma vie, évoque les « petites filles » qui « approchent d’une certaine crise de développement physique ». 2047
Femmes (Règles) (9) : (21 novembre) 1858. George Sand [1804-1876], dans une lettre à Jean Pichon [?-?], concernant une jeune fille de 14 ans, auteure de :
« La santé est revenue merveilleusement. Pourtant les accidents nerveux reparaissent aux époques où la jeune fille devrait avoir des accidents naturels qui ne se sont pas encore produits. Vergne [William, médecin] espère et croit que le rétablissement de l’état général amènera ce qui doit être et chassera les crises de nerfs qui les remplacent fâcheusement. » 2048 (Cf. Femmes. Jeunes filles)
Femmes (Règles) (10) : (3 mars) 1863. George Sand [1804-1876], dans une lettre à Maurice [1823-1889] et Lina Dudevant-Sand [1842-1901], auteure de :
« J’ai vu madame Calamatta [la mère de Lina] aujourd’hui […], elle ne sait pas au juste si elle partira avec moi la semaine prochaine pour des raisons de santé dont elle ne peut fixer l’époque. C’est-à-dire qu’elle a trois ou quatre jours par mois où le voyage lui est impossible, [et] […] elle ne veut pas que je l’attende si elle n’est pas délivrée de cette fatigue. » 2049
Femmes (Règles) (11) : (8 juin) 1871. George Sand [1804-1876], dans une lettre à Alexandre Dumas fils [1824-1895], auteure de :
« Mon fils, j’ai reçu votre bonne grande lettre. Vous avez raison, mais je ne suis pas si forte que vous, je suis femme. J’ai connu mal à mes entrailles de femme quand le sang coule ou quand la flamme étouffe des êtres de mon espèce. » (Cf. Femmes « Espèce », Patriarcat « Espèce »)
* Ajout. 5 octobre 2021. (16 juillet) 1871. George Sand à Gustave Flaubert [1821-1880] :
« Je suis femme, j’ai des tendresses, des pitiés et des colères. Je ne serai jamais ni un sage ni un savant. » 2050 (Cf. Femmes)
-------------
Femmes (Règles) (12) : (3 juin) 1856. Léon Tolstoï [1828-1910] écrit dans ses Carnets :
« À vivre au village, on sait bon gré mal gré tout ce qui se passe à l’entour. Je sais même que Mme G[uimbout] a ses règles, et quand elles prennent fin. » 2051
Femmes (Règles) (13) : 1885. Émile Zola [1840-1902], dans Germinal, auteur de :
« Elle s’était imaginée un instant que sa fille [Catherine], elle aussi, lui revenait avec une balle dans le ventre, car la chemise avait de larges taches de sang. Mais elle comprit bientôt, c’était le flot de la puberté qui crevait enfin, dans la secousse de cette journée abominable. Ah ! une chance encore, cette blessure ! un beau cadeau, de pouvoir faire ses enfants, que les gendarmes, ensuite égorgeraient ! » 2052 (Cf. Femmes. Mères, Politique, Guerre. Femmes)
Femmes (Règles) (14) : 1880. Lu, dans Mes souvenirs, de la comtesse Marie d’Agoult (Daniel Stern) [1805-1876] :
« Depuis deux ans déjà, la nature avait opéré en moi la crise par laquelle la constitution des jeunes filles achève de se former pour la maternité. À partir du moment où je quittais la maison maternelle, sa douce liberté, ses soins exquis, il se fit en moi un arrêt subit de ce mouvement régulier de la circulation. […] » 2053
Plus raffiné, plus juste (dans le contexte de l’époque) que l’expression : ‘avoir ses règles’. (Cf. Femmes. Jeunes filles)
Femmes (Règles) (15) : 1884. Friedrich Nietzsche [1844-1900], dans Contribution à l’histoire naturelle de la morale, sous la présentation Nous autres artistes !, auteur de :
« Quand nous aimons une femme, il nous arrive de haïr la nature en songeant à tous les phénomènes naturels répugnants auxquels toute femme est assujettie. » 2054 (Cf. Êtres humains, Corps, Relations entre êtres humains. Haïr, Patriarcat, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
Femmes (Règles) (16) : (26 octobre-24 novembre) 1911. Franz Kafka [1883-1924], dans le Troisième cahier de son Journal, auteur de :
« Le bain de purification juif que possède chaque communauté juive en Russie […]. La femme vient y purifier ses règles, le scribe de la Torah s’y purifie de toutes ses pensées pécheresses avant de recopier la dernière phrase d’un verset. » 2055 (Corps. Femmes, Penser, Patriarcat)
Femmes (Règles) (17) : (21 juin) 1918. Alexandra David-Neel [1868-1969], après avoir décrit dans une lettre à son mari ses conditions de transport, de vie, dans une Chine en pleine guerre civile, poursuit :
« Où sont les beaux faiseurs de discours sur la fragilité féminine, ‘l’éternelle blessée’ de ce bon M. Michelet [1798-1874]. Quelles âneries ! Comme si la santé était une affaire de sexe. Est-ce que certains n’ont pas prétendu qu’une femme était incapable d’être député à cause de ses périodes mensuelles… » 2056 (Cf. Femmes. « Féminin », Sexes […])
Femmes (Règles) (18) : 1931. Emma Goldman [1869-1940], dans Vivre ma vie, se souvient :
« Un jour d’été, une douleur atroce me réveilla très tôt. Ma tête, mon dos et mes jambes me faisaient mal comme si on les écartelait. J’appelais Mère. Elle retira mes couvertures et soudain, je sentis sur mon visage une douleur cuisante. Elle m’avait giflée. Je poussais un cri, la fixant avec des yeux terrifiés. ‘Quand une fille devient femme, c’est nécessaire pour la protéger du déshonneur’ dit-elle. Elle essaya ensuite de me prendre dans ses bras, mais je la repoussais. […] » Quelques années plus tard :
« Depuis quelques temps, je ne me sentais pas très en forme, en particulier pendant mes règles dont les douleurs insoutenables m’obligeaient à m’aliter des jours durant. Ces maux dataient du grand traumatisme que Mère avait provoqué en me giflant. Ils s’étaient aggravés par la suite. […]. » 2057
Femmes (Règles) (19) : (3, 30 octobre) 1931. Michel Leiris [1901-1990], dans L’Afrique fantôme, évoque, sans plus s’y attarder, à deux reprises, « les cases spéciales aux femmes en règles », « la maison des femmes en règles ». 2058 (Cf. Patriarcat, « Sciences » sociales. Ethnologie)
Femmes (Règles) (20) : (13 août) 1932. Paul Léautaud [1872-1956], dans son Journal littéraire, évoquant les difficultés à rencontrer une femme qui accepterait (aimerait) « les façons [qu’il] aime dans l’amour », poursuit :
« Les trouver ? Pas sûr ! Ensuite, avec une jeune femme, la question des règles, pour lesquelles j’ai une telle répugnance. » 2059
Par ordre chronologique. Femmes. Règles. Doris Lessing :
Femmes (Règles) (21) : 1953. Doris Lessing [1919-2013], dans Les enfants de la violence (1), concernant Matty, nouvellement mariée :
« Jusqu’à ces deux dernières semaines, son corps était libre ; il lui appartenait sans aucun doute possible. Elle aurait même trouvé méprisable de s’apitoyer sur son sort, ou même de prêter attention à l’abondance de ses règles ou à leur absence. Et maintenant, cette intimité, cette indépendance si récemment remportée sur les interrogations furtives de sa mère, se trouvait menacée par un étranger impertinent. » 2060
Femmes (Règles) (22) : 1958. Doris Lessing [1919-2013], dans La cité promise, Les enfants de la violence (3), auteure de :
« (Sur le pont du bateau) Olive Prentiss […] ne vit pas la vieille dame et, s’accroupissant à demi, glissa une main sous sa courte jupe blanche, en tira un petit tampon ensanglanté et le jeta par-dessus bord. […] Madame Quest suffoquait d’émotion. Elle y décela par la suite un sentiment d’outrage : c’était la désinvolture de la jeune femme qui l’avait choquée. […] Mme Quest souffrit mille rages. Lorsqu’elle était jeune… mais elle ne put, brusquement, supporter le souvenir de ce qui lui apparaissait uniquement, désormais, comme une longue histoire d’humiliation et de furtivité, de grands linges sanguinolents et détrempés qui grattaient et sentaient mauvais, et que l’on s’efforçait sans cesse de laver en secret, de dissimuler, ou même de brûler ; de migraines, de douleurs dans le dos et de toutes sortes de petits mensonges nécessaires à l’intention de frères et de père obtus ; […]. » 2061
-------------
Femmes (Règles) (23) : 1969. Nina Berberova [1901-1993], dans C’est moi qui souligne, auteure de : « Le docteur m’ausculta consciencieusement.
- Qu’en est-il de vos organes génitaux ?
Ils ont à leur place.
- Et votre cycle ?
Tant qu’il était là, cela me rendait la vie très agréable : à chaque fois, j’avais le sentiment de renaître. Quand ça a cessé, ce ne fut pas mal non plus ; j’ai eu moins de soucis. » 2062
Femmes (Règles) (24) : 1974. Elsa Morante [1912-1985], dans La storia, auteure de :
« À ce moment-là, elle ressentit dans les reins un petit spasme chaud qui semblait lui dissoudre avec douceur les jointures, relâchant vers le bas le poids du corps. Et brusquement, elle rougit, serrant étroitement les cuisses et jetant un coup d’œil sur ses pieds qu’un flux soudain et violent de sang menstruel salissait déjà. Devant cet incident qui la surprenait, imprévu, en présence de tous ces jeunes gens, de la honte se mêla à sa peur. Et balançant entre la honte et sa peur, essayant de cacher ses pieds, et en même temps de nettoyer le sol mouillé avec la semelle de ses godasses, tremblant toute entière comme un roseau, elle dit tout ce qu’elle savait. » 2063
Femmes (Règles) (25) : 1976. Bruno Bettelheim [1903-1990], dans Psychanalyse des contes de fées, écrit dans le chapitre consacré à La belle au bois dormant :
« Pendant les mois qui précèdent les premières règles, et souvent pendant la période qui les suit immédiatement, les fillettes sont passives, comme endormies, et se replient sur elles-mêmes. » 2064 (Cf. Enfants. Bettelheim Bruno, Femmes. Devenir une femme, « Sciences » sociales. Psychanalyse)
Femmes (Règles) (26) : 1980. Lu dans l’article Une femme en prison publié dans Femmes et Russie. 1980, au paragraphe Les soins médicaux :
« Une infirmière passe dans les cellules tous les trois jours pour distribuer aux femmes un peu de coton. Les femmes doivent donner une preuve visible qu’elles en ont besoin. » 2065
Femmes (Règles) (27) : 1984. Dominique Desanti [1914-2011], dans La femme au temps des années folles, auteure de :
« Un an avant la guerre - 1938 - le Dr Montreuil-Strauss [Germaine. 1873-1970 (vérifier)], avait parlé aux élèves du lycée [de filles] de Versailles, celles des grandes classes, d’un sujet qui les touchait intimement : la menstruation. Amie de Germaine, la directrice a été submergée de lettres indignées : en voilà un sujet à aborder devant des jeunes filles !
‘Le sang menstruel se subit mais ne se commente pas’ écrivait une mère. Et une autre : ‘Votre conférence, en expliquant la menstruation par la seule biologie, met en cause la notion même de péché originel.’ » 2066
N.B. Germaine Montreuil-Strauss est l’auteure de : Avant la maternité. 1923 ; Maman, dis-moi. 1926 ; La jeunesse devant la vie sexuelle. 1959…
Femmes (Règles) (28) : 1988. Barbara Kostner, ‘établie’ en usine en Allemagne se remémorant en 1985 « le travail très dur et même insoutenable pour les femmes », poursuit :
« […] Je me souviendrai toute ma vie de ces femmes qui avaient leurs règles et dont le sang coulait sur les jambes sans qu’elles puissent se nettoyer parce qu’il leur était interdit de quitter leur poste (de travail) ne serait-ce qu’une minute. […] » 2067 (Cf. Êtres humains, Corps, Femmes, Patriarcat. Division sexuelle du travail)
Femmes (Règles) (29) : 1999. Roselyne Bachelot, auteure de :
« La maternité est évidemment au coeur de la vie des femmes. On ne peut pas imaginer, quand on est un homme, à quel point le corps rythme la vie des femmes. Cette façon dont les choses (sic) se répètent de manière cyclique, dans une sorte de mouvement circulatoire. Ce qui fait que nous n’appréhendons pas la vie, la mort, le pouvoir de la même façon. […] » 2068 (Cf. Corps. Femmes, Femmes « Politiques ». Bachelot Roselyne)
Femmes (Règles) (30) : 2001. Françoise d’Eaubonne [1920-2005], dans Mémoires irréductibles, auteure de :
- « Je viens d’avoir mes règles et ma mère me dit, avec une force terrible, en me fixant de ses yeux noirs qui me font si peur que ‘personne ne doit se douter de rien quand une femme est dans cet état, tu-en-tends ?’comme si elle montait un escalier de trois marches. Il m’est donc interdit, ai-je conclu, de demander un linge de rechange. Pendant huit jours je serrerai les dents, suppliciée par la serviette durcie de sang qui m’entaille à chaque pas l’intérieur des cuisses. L’offrir à Dieu. »
- « Nous faisons l’amour encore une foi, une seule. J’aurais un retard de quinze jours, ce qui ne m’était jamais arrivé ; cependant je ne m’inquiète pas ; aucun symptôme odieusement familier n’accompagne ce trouble. […] Je saurai qu’il ne s’agit pas d’une ultime grossesse, mais des premiers ratés du moteur. » 2069 (Cf. Corps. Femmes, Femmes. Mères, Relations entre êtres humains. Amour. « Faire l’amour »)
Femmes (Règles) (31) : 2008. Judith C., dans Génération MLF, évoque « la puberté vécue comme une révoltante amputation de [son] individualité. » 2070 (Cf. Corps. Femmes)
Femmes (Règles) (32) : 2010. Lu, dans un livre publié dans la collection Folio. Classique de Gallimard, les règles des femmes qualifiée d’ « incommodités mensuelles féminines ». 2071 (Cf. Êtres humains, Corps, Femmes. « Féminin »)
Femmes (Règles) (33) : 2012. Elena Ferrante, dans Le nouveau nom, auteure de :
« Je vécus une semaine de pure angoisse parce que mes règles ne revenaient pas.
Je craignis que Sarratore ne m’ait mise enceinte et fus au désespoir - j’étais pleine de bonnes manières à l’extérieur et de noirceur à l’intérieur. Je passais des nuits blanches mais ne cherchais le conseil ni le réconfort de personne, gardant tout pour moi.
Enfin, un après-midi où j’étais à la librairie, j’allais dans les toilettes immondes du magasin et découvris que je saignais.
Ce fut un de mes rares moments de bien-être pendant cette période.
J’eus l’impression que mes règles effaçaient de manière symbolique et définitive, l’irruption de Sarratore dans mon corps. » 2072 (Cf. Femmes. Enceintes)
Femmes (Règles) (34) : (5 mars) 2016. Lu : « Une entreprise britannique autorise les congés pour règles douloureuses ». 2073
Juste réaction d’une féministe : « […] On nous renvoie à nos ovaires ».
Femmes (Règles) (35) : (7 juin) 2017. Vladimir Poutine, en réaction à la question d’Oliver Stone :
« Est-ce qu’il vous arrive de vous énerver ? Vous n’êtes jamais dans un mauvais jour ? » répondit :
« Je ne suis pas une femme, je n’ai pas de mauvais jours. » […] « Je ne veux insulter personne. La nature est ainsi faite […]. » 2074 (Cf. Hommes. « Politiques »)
Femmes (Règles) (36) : (15 janvier) 2018. Lu sur France Culture :
« Il aura fallu attendre la fin du XXème siècle - et encore - pour casser cette idée reçue selon laquelle, avoir mal au ventre pendant ses règles, c’est ‘normal’. Si des douleurs abdominales ne sont pas systématiquement synonymes d’endométriose, cette maladie chronique, pourtant diagnostiquée dès 1860, commence enfin à être reconnue, et prise en considération. L’endométriose toucherait jusqu’à une femme en âge de procréer sur 10. Elle est encore diagnostiquée très tardivement, jusqu’à 7 voire 10 ans après les premiers symptômes et la recherche biomédicale bute encore sur un traitement efficace et définitif. » 2075
Femmes (Règles) (37) : (28 mai) 2019. France Culture évoque « la précarité menstruelle » [des femmes] 2076
* Ajout. 5 juin 2019. Je découvre de fait que « la précarité menstruelle » est la formulation officielle, celle employée par Marlène Schiappa, mais de concert avec celle d’ « hygiène menstruelle ». En effet, le 28 mai 2019 un communiqué de presse émane du secrétariat d’état : « Le gouvernement lève le tabou de l’hygiène menstruelle, lequel qualifie cette question de « sujet politique et éminemment interministériel ». Et, à la lecture dudit communiqué, je comprends mieux l’emploi de l’expression de « précarité menstruelle ». Il est en effet question d’ « une expérimentation visant à distribuer gratuitement dans plusieurs lieux (écoles, hôpitaux, lieux de privation de libertés, …) des produits menstruels pour les femmes en situation précaire. » (Cf. Corps, Femmes. « Politiques ». Schiappa Marlène, Langage, Penser. « Tabous »)
Femmes (Règles) (38) : (27-28 septembre) 2019. Gisèle Halimi [1927-2020] évoque son enfance de petite fille en Tunisie :
« Le jour où j’ai eu mes règles, [ma mère] m’a prévenue : ‘Maintenant, c’est fini - Qu’est-ce qui est fini ? - Tu ne joues plus du tout avec les garçons. ‘J’étais sidérée. Moi qui jouais au foot avec eux, courais pieds nus dans les rues, nageais à perte de souffle, avec une bande de copains, j’aurais dû tout arrêter ? - ‘Mais pourquoi ?’ - C’est comme ça’. » 2077 (Cf. Dialogues, Femmes. Mères)
Femmes (Règles) (39) : (14 novembre) 2019. Lu sur un tract diffusé devant la Sorbonne appelant à une « AG étudiante féministe », même date :
« En tant qu’étudiant-e-s, nous sommes concernée-e-s par la charge mentale, les tâches ménagères, la précarité menstruelle, la parentalité, mais aussi le travail précaire. » (Cf. Féminismes, Langage. Précarité, Penser. Confusion)
Femmes (Règles) (40) : (4 décembre) 2020. Sur Brut. France, Emmanuel Macron, interrogé sur la « gratuité des protections hygiéniques [pour les femmes sans domicile], comme voté en Écosse », répondit : « J'ai demandé qu'on avance, je veux qu'avec les associations compétentes et pour toutes les femmes qui sont dans cette situation, on puisse avoir une réponse », puis il a promis pour 2021 : « une réponse très concrète ». Il a ensuite poursuivi :
« Parce que, quand on voit des femmes qui sont dans la très grande précarité, qui sont à la rue, elles vivent tout ce que vit un homme, d'épuisement physique, de réduction de votre durée de vie, de maladies qu'on contracte, d'humiliation, et elles vivent en plus deux choses : en effet la précarité menstruelle, le fait d'avoir des règles dans la rue et de ne pas pouvoir acheter de quoi se protéger et de quoi être digne dans la journée, et puis le viol. »
Ainsi, pour Emmanuel Macron, que les femmes perdent du sang tous les mois et qu’elles soient violées par des hommes relèvent de la même logique : être femme.
À réfléchir, notamment par les féministes qui pensent expliquer les violences patriarcales par le fait que les victimes « sont des femmes. » (Cf. Hommes. « Politiques ». Macron Emmanuel, Penser. Expliquer, Économie. Gratuité. « Pauvres Les », Violences. Violences à l’encontre des femmes. Patriarcales)
* Ajout. 24 novembre 2022. Qu’Emmanuel Macron ait cru bon, nécessaire, de donner son opinion, sa position sur la gratuité des serviettes hygiéniques est sans doute le plus signifiant. (Cf. Hommes. « Politiques ». Macron Emmanuel)
* Ajout. 18 juin 2023. J’avais pensé relever certains des innombrables sujets - dans une liste à la Prévert - sur lesquels Emmanuel Macron a pris position. Et puis, il m’a semblé que cet exemple se suffisait à lui-seul.
Mais l’essentiel - le plus grave, le plus inquiétant, le plus honteux - n’est-il pas que cela lui fut si peu interrogé par lui, si aisé ?
* Ajout. 14 mai 2024. Emmanuel Macron, dans Elle, prend position sur « la ménopause ».
Femmes (Règles) (41) : (23 février) 2021. Annonce de Frédérique Vidal, ministre de l’enseignement supérieur :
« La précarité menstruelle est un enjeu collectif et une véritable question de dignité, de solidarité et de santé. Il est inacceptable qu’en 2021, on doive choisir entre se nourrir et pouvoir se protéger. […] On vise 1.500 distributeurs de protections hygiéniques et une gratuité complète à la rentrée ».
Et à l’appui de cette nouvelle nécessité - à défaut de cesser de détruire l’Université - elle a cru légitimer son action en s’appuyant sur « une étude menée par l’Association fédérative des étudiants de Poitiers et l’Association nationale des étudiants sages-femmes en février, un tiers des étudiantes aurait besoin d’aide pour pouvoir acheter des protections périodiques. » 2078 (Cf. Corps, Femmes. Infantilisation. Mépris, Langage. Verbe. Protéger, Politique. « Islamo-gauchisme », Économie. « Pauvres Les »)
Femmes (Règles) (42) : (13 août) 2021. Entendu sur France Culture, dans l’émission consacrée à Ignace Philippe Semmelweis [1818-1865], l’expression d’ « intimité féminine ». (Cf. Hommes. Remarquables. Semmelweis Ignace Philippe)
Femmes (Règles) (43) : (11 septembre) 2021. Serge Hefez, psychanalyste, psychiatre, dans Transitions, réinventer le genre, auteur de :
« […] Le corps féminin va avoir des menstrues ». 2079 (Cf. Corps, Femmes. « Féminin », Langage. Genre. Sujet. Verbe. Avoir, Patriarcat)
Femmes (Règles) (44) : (15 novembre) 2021. Entendu sur Radio courtoisie (radio d’extrême-droite) l’expression de : [dérèglement] de « l’horlogerie féminine ». (Cf. Corps, Femmes. « Féminin »)
Femmes (Règles) (45) : (24 mars) 2022. Entendu sur Radio courtoisie (radio d’extrême-droite) :
« Une femme entière avec son cycle » ; « Il faut en parler aussi car c’est une histoire de fertilité ».
Femmes (Règles) (46) : (28 novembre) 2023. Je lis dans le hall de la bibliothèque de la Sorbonne une affiche « Je vote UNEF », dont la seule revendication est : « Un congé menstruel » fondé sur « l’égalité menstruelle ».
De régressions en régressions…
Femmes (Règles) (47) : (15 décembre) 2023. A l’entrée de Monoprix, deux jeunes femmes, dont l’une me demande de donner [de l’argent] « contre la précarité menstruelle ». Abasourdie, je refuse. Puis je demande le tract diffus.
Je lis : « Collecte nationale de protections périodiques. Quels produits donner ? : en priorité des serviettes hygiéniques (dessin à l’appui) - suivi d’un astérisque : « Plus de 90 % des personnes bénéficiaires utilisent des serviettes » - des « protège-slips, lingettes, gels anti-bactériens » (dessins à l’appui).
Je lis au recto que « la précarité menstruelle » est associée au « tabou des règles », et que cette « collecte est à destination des femmes les plus démunies ».
Je lis que « les protections périodiques collectées sont récupérées par nos partenaires redistributeurs agissant conte la précarité et le mal-logement pour être distribuées au plus grand nombre. »
Je lis qu’ « au cours de sa vie, une femme dépense en moyenne 1500 euros en protections hygiéniques ». Et qu’en conséquence :
« Les serviettes, coupes menstruelles et tampons représentent donc une dépense non négligeable pour les personnes menstruées, ce qui les rend parfois inaccessibles aux plus précaires. Pourtant, ces produits de première nécessité sont rarement collectés et intégrés dans les kits d’hygiène que les associations distribuent. »
Je lis que cette collecte est à l’initiative de la « Fondation des femmes » et de « Règles élémentaires », en « partenariat avec la fondation Monoprix » et avec « Le soutien de la fondation BNP Paribas. » (Cf. Femmes. Précaires, Féminismes. Associations. Fondation des femmes)
Voilà quelle déchéance le féminisme peut en être réduit…
* Ajout. 7 novembre 2024. Aujourd’hui, en payant à Monoprix avec ma carte bleue, je devais appuyer sur un bouton vert signifier que j’acceptais que ma note soit arrondie à l’unité pour être transférée à la lutte conte « la précarité menstruelle. »
Une grande avancée du féminisme, ‘grâce’ à la « Fondation des femmes ».
Quelle honte…
Femmes (Règles) (48) : 2022-2023. Louis-Ferdinand Céline [1894-1961], dans Londres, auteur de :
« On aurait dit toujours qu’elle choisissait le moment de ses règles pour venir me voir. Comme une excuse pour ne baiser qu’à peine […]. » 2080
Femmes (Règles) (49) : (23 octobre) 2024. Lu sur Franceinfo : « Sciences Po Lyon annonce mettre en place ‘un dispositif d'absence pour règles incapacitantes’. L'institut d'études politiques précise que cette mesure entre en vigueur ‘maintenant’. Concrètement, les étudiantes concernées pourront justifier ‘jusqu'à 15 jours d'absence par an’. Elles devront ‘fournir une attestation délivrée par un professionnel de santé agréé, que ce soit un médecin, une sage-femme ou un service de santé universitaire ou une déclaration sur l'honneur certifiant leur situation’, précise l'IEP de Lyon. »
Femmes (Règles) (50) : (11 décembre) 2024. Lu dans Le Canard enchaîné (p.8) :
« Des femmes chinoises reçoivent de coups de fil intrusifs de la part des autorités, dans le but de relancer la natalité, en déclin, peut-on lire dans Le Monde [6 décembre]. ‘Ils se prennent pour la police menstruelle ?‘ s’insurge une enseignante après avoir reçu un appel d’un fonctionnaire lui demandant ‘quand elle [avait] eu se dernières règles.’ Un virage à 180 degrés, alors que les agents du planning familial semaient la terreur pour limiter les naissances. »
Femmes. Règles. Ekaterina Olitskaïa :
Femmes (Règles) (51) : 2024. Ekaterina Olitskaïa, dans Le sablier, auteure de :
(à Verkhneouralsk) « Évidemment, nous nous languissions de nos livres et vivre sans nos affaires était difficile - ni savon, ni serviettes, ni linge, ni literie. Cela faisait un mois que nous ne nous étions lavés, un mois que nous n’avions pas changé de linge. C’était particulièrement pénible pour les femmes. » 2081
Femmes (Règles) (52) : 2024. Ekaterina Olitskaïa, dans Le sablier, auteure de :
« J’étais enfermée depuis près de cinq mois. Mon linge de corps et mes vêtements étaient complètement usés. On ne fournissait pas de linge pour femme à la prison de Boutykri. »
Après une grève de la faim, elle obtient ce qui était demandé par les grévistes, dont : « La prison ne disposant pas de linge féminin, c’est La Croix-rouge qui vous le fera parvenir. »
Elle reçoit « deux rechanges de linges et une robe », mais après deux ou trois semaines, elle est transférée à la Loubianka-.2. 2082
Femmes (Règles) (53) : 2024. Ekaterina Olitskaïa, dans Le sablier, auteure de :
« Nous étions parties depuis bientôt un mois. Toutes, nous étions titubantes, la tête nous tournait. Quand nos règles commençaient, elles ne s’arrêtaient plus. Nous manquions d’eau, nous ne pouvions nous changer. Pas le moindre bout de chiffon. Les chemises, les soutiens-gorges, tout était transformées en bandes. » 2083
-------------
Femmes (Reines) : Certaines sont reines de France, d’autres « reines des fourneaux ».
Femmes. Religieuses :
Femmes (Religieuses) (1) : Les religieuses, retirées du monde, à des rares exceptions près, furent, pendant des siècles, maintenues dans l’infantilisation, dans l’enfermement, dans l’obéissance, dans le devoir, dans la soumission, dans l’abêtissement.
Femmes (Religieuses) (2) : Combien de souffrances, de violences, les couvents ont-elles cachées ?
Combien de souffrance, de violences les couvents ont-elles été la cause ?
Combien de souffrances, de violences ont-elles imposées à ces femmes qui n’avaient commis aucune faute, et pour tant, les ont aggravées ?
Et ce, des vies entières, enfermées, sans recours, sans justice, sans appel, contraintes quotidiennement à la hiérarchie, aux codes, aux normes, souvent inchangées pendant des siècles, sans possibilité de sortir de ces prisons, et pour certaines de ces bagnes. Dans la peur ; la terreur perpétuelle d’un enfer dans l’au-delà, dont l’hypothèse qu’il n’existait pas ne faisait pas partie du monde mental qui leur fut façonné.
Par ordre chronologique. Femmes. Religieuses :
Femmes (Religieuses) (1) : Sélection des « Avis » de Thérèse d’Avila [1515-1582] « à ses religieuses » :
III. Quand vous serez avec plusieurs, parlez toujours peu.
IV. Conduisez-vous avec une grande modestie dans toutes vos actions, dans tous vos rapports avec les autres.
V. Ne contestez jamais beaucoup, principalement en des choses importantes.
VIII. Ne reprenez jamais personne qu’avec discrétion et humilité, et avec une confusion secrète de vos propres défauts.
IX. Accommodez-vous à l’humeur des personnes avec qui vous traiterez : soyez joyeuses avec celles qui sont dans la joie et tristes avec ceux qui sont dans la tristesse ; enfin, faites-vous tout à tous pour les gagner tous.
XI. Ne vous excusez jamais, à moins qu’il n’y ait une grande raison de le faire.
XII. Ne parlez jamais de ce qui peut vous attirer quelque louange, comme de votre savoir, de vos vertus, de votre naissance, à moins que vous n’ayez sujet d’espérer que cela pourra être utile ; et alors il faut le faire avec humilité, et en vous souvenant que c’est de la main de Dieu que vous tenez ces dons.
XVI. Ne vous mêlez jamais de donner votre avis sur quoi que ce soit, à moins qu’on ne vous le demande ou que la charité ne l’exige.
XIX. Gardez fidèlement votre cellule, et n’en sortez point sans sujet ; et lorsque vous serez obligées d’en sortir, demandez à Dieu de ne point l’offenser.
XXII. N’écoutez jamais dire du mal de personne et n’en dites jamais, si ce n’est de vous-même ; lorsque vous prendrez plaisir à agir de la sorte, vous avancerez beaucoup.
XXIV. Lorsque vous serez dans la joie, ne vous laissez pas aller à des ris immodérés ; mais que votre joie soit humble, modeste, affable et édifiante.
XXVI. Soyez toujours prête à obéir, comme si Jésus-Christ lui-même vous commandait par l’organe de votre supérieur.
XXXIII. Fuyez toujours la singularité, autant qu’il vous sera possible, parce que c’est un grand mal dans une communauté.
XXXIV. Lisez souvent les constitutions et la règle de votre ordre et gardez-les fidèlement.
XL. Lorsque vous êtes à table, ne parlez à personne et tenez les yeux modestement baissés sans regardez qui que ce soit […].
XLII. Ne faites jamais rien que vous en puissiez faire en présence de tout le monde.
XLIII. Ne faites point de comparaison entre les personnes parce que les comparaisons sont odieuses.
XLIV. Quand on vous reprend sur quelque point, recevez la correction avec une vraie humilité intérieure et extérieure, et priez Dieu pour la personne qui vous l’a faite.
XLV. Quand un supérieur vous commande une chose, ne dites pas qu’un autre a commandé le contraire ; mais pensez qu’ils ont tous de saintes intentions, et faites ce que l’on vous ordonne.
XLVI. Évitez de parler ou de vous informer avec curiosité, des choses qui ne vous regardent point.
L. Ne cessez jamais de vous humilier, et de vous mortifier en toutes choses, jusqu’à la mort.
LIV. Soyez douce à l’égard de tout le monde, et sévère avec vous-même.
LVIII. Quand vous serez à la tête d’une maison, ne reprenez jamais personne avec colère, mais attendez qu’elle soit passée ; et, de cette manière, la correction sera utile.
LXVII. Ne parlez point de vos tentations et de vos fautes à celles de vos sœurs qui sont les moins avancées, parce que cela leur nuirait ainsi qu’à vous ; mais n’en parlez qu’aux plus parfaites.
LXVII. Souvenez-vous que vous n’avez qu’une âme ; que vous ne devez mourir qu’une fois ; que vous n’avez qu’une vie, qui est courte ; et qu’il n’y a qu’une gloire, qui est éternelle ; et vous vous détacherez ainsi de bien des choses.
LXVIII. Que votre désir soit de voir Dieu ; votre crainte de le perdre ; votre douleur, de ne pas le posséder encore ; votre joie, de ce qui peut conduire à lui, et vous vivez dans une grande paix. » 2084
Des sources et des justifications de l’autoritarisme et des limites de sa spiritualité… (Cf. Êtres humains. Âmes, Femmes. Remarquables. Thérèse d’Avila. Stein Édith. Religieuses. Silence, Patriarcat)
Femmes (Religieuses) (2) : 1727. Marivaux [1688-1763], dans La vie de Marianne, auteur de :
« […] Il n’y a rien de plus imprudent, et peut-être rien de moins pardonnable, que ces petites séductions qu’on emploie en pareil cas pour faire venir à une jeune fille l’envie d’être religieuse. Ce n’est pas en agir de bonne foi avec elle ; et il vaudrait encore mieux lui exagérer les conséquences de l’engagements qu’elle prendra, que de l’empêcher de les voir ou de les lui déguiser si bien qu’elle ne les connait pas. »
N.B. Je lis en note : « Allusion satirique aux vocations forcées. […] »
Où est la « satire » ? N’est-ce pas plutôt : honnête, sage, féministe ? 2085 (Cf. Femmes. Enfermées. Jeunes filles)
Femmes (Religieuses) (3) : (8 juillet) 1768. Voltaire [1694-1778], dans une lettre à François-Louis Allamand [1709-1784], évoque « les jolies filles qu’on craint de voir s’enfermer toutes vivantes dans un cloître. » 2086 (Cf. Femmes. Enfermées)
Par ordre chronologique. Femmes. Religieuses. Honoré de Balzac :
Femmes (Religieuses) (4) : 1834. Honoré de Balzac [1799-1850], dans La duchesse de Langeais, évoque « de tristes femmes dont l’âme, dépouillée de tous liens humains, soupirait après ce long suicide accompli dans le sein de Dieu », puis « la tombe religieuse où s’ensevelissent les femmes pour renaître épouses du Christ. » 2087
Femmes (Religieuses) (5) : 1841. Honoré de Balzac [1799-1850], dans Mémoires de deux jeunes mariées, auteur de :
« Cette vie monotone où chaque heure amène un devoir, une prière, un travail si exactement les mêmes, qu’en tous lieux on peut dire ce que fait une carmélite à telle ou telle heure du jour ou de la nuit ; cette horrible existence où il est indifférent que les choses qui nous entourent soient ou ne soient pas […] »
- « […] Je devenais ce qu’est une carmélite à nos yeux, une Danaïde moderne qui, au lieu de chercher à remplir un tonneau sans fond, tire tous les jours, de je ne sais quel puits, un sceau vide, espérant l’amener plein. » 2088
-------------
Femmes (Religieuses) (6) : 1862. Victor Hugo [1802-1885], dans Les misérables, auteur de :
« La sœur Perpétue [qui, avec la sœur Simplice, « faisai[en]t le service de l’infirmerie »] était la première villageoise venue, grossièrement soeur de charité, entrée chez Dieu, comme on entre en place. Elle était religieuse comme on est cuisinière. Ce type n’est point rare. Les ordres monastiques acceptent volontiers cette lourde poterie paysanne, aisément façonnée en capucin ou en Ursuline. Ces rusticités s’utilisent pour les grosses besognes de la dévotion. »
Et Victor Hugo poursuit, en l’enrichissant, concernant les moines, cette forte et si rare analyse :
« La transition d’un bouvier à un carme n’a rien de heurté ; l’un devient l’autre sans grand travail ; le fond commun d’ignorance du village et du cloître est une préparation toute faite, et met tout de suite le campagnard de plein pied avec le moine. Un peu d’ampleur au sarrau, et voilà un froc. » 2089 (Cf. Êtres humains. Vêtements, Femmes. Charité. Servantes, Politique. Religion)
N.B. « Sarrau » : « Blouse de travail en grosse toile, courte et ample » ; « Froc » : « Habit de moine »
Femmes (Religieuses) (7) : 1862. Victor Hugo [1802-1885], dans Les misérables, auteur de :
« Vincent de Paul [1581-1660] a divinement fixé la figure de la soeur de charité dans ces admirables paroles où il mêle tant de liberté à tant de servitude :
‘ Elles n’auront pour monastère que la maison des malades, pour cellule qu’une chambre de louage, pour chapelle que l’église de leur paroisse, pour cloître que les rues de la ville ou les salles d’hôpitaux, pour clôture que l’obéissance, pour grille que la crainte de Dieu, pour voile que la modestie. » 2090
Femmes (Religieuses) (8) : (11 novembre) 1928. L’abbé Mugnier [1853-1944] écrit dans son Journal :
« […] Voici dix-huit ans que je côtoie de près ces femmes héroïques, et je n’ai pas l’air de m’en douter. Entré ici par la volonté une archevêque qui ne m’a pas laissé un bon souvenir, j’ai juxtaposé à mes devoirs professionnels (sic) des lectures, des relations, toute une existence tellement différente de celle qui se déroulait sous mes yeux ! Je n’ai su observer de près ces âmes de saintes femmes, ni m’attendrir sur elles. Et je n’ai eu qu’à me louer d’elles, tant leur bienveillance à mon égard a été aveugle ! ». 2091 (Cf. Femmes. Bienveillantes, Hommes. Regrets, Relations entre êtres humains. Bienveillance)
Femmes (Religieuses) (9) : (3 juin) 1952. Paul Claudel [1868-1955], écrit dans son Cahier X :
« Il y a en France cent cinquante couvents de carmélites. » 2092
Aujourd’hui : ?
Femmes (Religieuses) (10) : 1976. Ménie Grégoire [1919-2014], dans Telle que je suis, évoque son enfance et son éducation chez les religieuses et écrit :
« […] Parmi nos douces religieuses, il n’y avait pas le moindre maître. Toutes étaient encore terrorisées par le savoir, ce piège à foi. […].
J’ai eu tout de même, en première, un excellent professeur de lettres. Dans ce couvent traditionnel, ô miracle, une religieuse avait une licence ! On disait d’elle avec un respect mélangé d’un vague effroi : ‘Vous savez, c’est un puit de science’ !
C’était un ‘puit’ en effet, pas une ‘source’ : elle n’avait lu de la littérature que ce qui était autorisé. Elle ignorait tous les romans. Elle pouvait nous faire aimer Racine ou Victor Hugo, mais pas Musset.
Au couvent, il n’y avait pas de bibliothèque du tout. Nous avions nos livres de classe : ‘Morceaux choisis’ par Mgr Calvet, de l’Institut catholique de Paris. Toute la littérature française y tenait en trois cent pages d’extraits, soigneusement châtrées à l’intention de jeunes filles dévotes. […]
Dans les livres, comme au couvent, comme chez moi, je ne pouvais m’identifier à aucune femme.
Les religieuses n’en étaient pas. Entre elles et moi, le fossé était sans fond. Ces épouses du Dieu invisible et jaloux étaient des réfugiées avec lesquelles je n’avais rien de commun. Elles avaient choisi tout ce que je refusais : l’exclusion d’un monde que je désirais furieusement, le mariage mystique avec un Dieu que je n’avais jamais rencontré, l’obéissance la plus aveugle à des assertions absurdes, contredites par le réel. […]
Comme elles étaient honnêtes dans leur démission ! Leur manque d’expérience était si flagrant, qu’à dix, douze ans, nous en rions entre nous.
Elles étaient entrées en religion vers seize ou dix-huit ans, après avoir vécu dans des familles bien convenables, et n’avaient jamais remis les pieds hors des couvents.
Comment auraient-elles pu offrir une morale, un idéal, une image utile à de futures femmes ? » 2093 (Cf. Culture. Bibliothèques. Livres. Patriarcale, Enfants. Éducation, Femmes. Enfermées. Jeunes filles, Patriarcat, Penser. Morale, Politique. Religion)
-------------
Femmes (Renard Jules) : Lu dans le Journal de Jules Renard [1864-1910] :
Par ordre chronologique.
- Sans date. 1887. : « Vous avez vos nerfs, madame. Moi, je n’en ai qu’un, mais il est de bœuf. »
- « Variété de femmes : il faut voir avec quelle mélancolie elle avale un pot de confitures. »
- « La vertu des femmes, au contraire des lattes de boulanger, a d’autant moins de valeur qu’on y fait plus d’entailles. »
- « Aussi navrant que le ‘attendez que je mouille’ d’une vierge. »
- « Une femme a l’importance d’un nid entre deux branches. »
- « Comme avec des ciseaux, la femme, avec ses cuisses qui s’ouvrent, coupe les gerbes de nos désirs. »
- « Appelons la femme un bel animal sans fourrure dont la peau est très recherchée. »
- 18 juillet 1887. « Dites à une femme deux ou trois mots qu’elle ne comprenne pas, d’aspect profond. Ils le déroutent, l’inquiètent, la rende anxieuse, la force à réfléchir, et vous la ramènent consciente de son infériorité, sans défense. Car le reste est jeu d’enfant.
Il n’est, bien entendu, pas nécessaire, que vous les compreniez vous-même. »
- 22 juillet 1887. « L’amour d’une vierge est aussi assommant qu’un appartement neuf. Il semble qu’on essuie les plâtres. Il est vrai qu’on n’a pas à redouter les germes maladifs, pestilentiels, d’un autre locataire. »
- 25 juillet 1887. « Que ne peut-elle, cette femme ardente, épouser un cheval ! »
- 29 octobre 1887. « Elle m’a fait les honneurs de son corps. »
- 30 octobre 1887. « Il y a des moments où l’en veut à mort à toutes les jeunes filles qu’on rencontre, parce qu’elles ne vous jettent pas leur coeur et 20.00 livres de rente. »
- 1er novembre 1887. « À toi, femme que j’ai tant fait souffrir, je dédie le meilleur de ma vie qui va se continuer et qui, quoi que lamentable, aura peut-être quelque douceur.
Je t’en offre hommage très affectueux. »
- 5 novembre 1887. « Les descriptions des femmes ressemblent à des vitrines de bijoutier. On y voit des cheveux d’or, des yeux émeraude, des dents perles, des lèvres de corail. Qu’est-ce, si l’on va plus loin dans l’intime ! […]. »
- 10 novembre 1888. « Avec une femme, l’amitié ne peut être que le clair de lune de l’amour. »
- 23 novembre 1888. « Tu travailles tous les jours. Tu prends la vie au sérieux. Tu crois en ton art avec ferveur. Tu ne te sers de la femme qu’avec réserve, Mais tu ne seras rien. »
- 17 janvier 1889. « La mère a senti les premières douleurs. […] Cela se passe bien. La mère ne fait pas plus de manières qu’une vache. »
- 9 juillet 1889. « Toute femme contient une belle-mère. »
- 30 août 1889. « On a beau faire : jusqu’à un certain âge- et je ne sais pas lequel- on n’éprouve aucun plaisir à causer avec une femme qui ne pourrait pas être une maîtresse. »
- 5 septembre 1889. « [...] Mais cette femme est une belle imbécile. Elle n’a pas une idée, J’aimeras à coucher avec elle si elle était muette. »
- 6 octobre 1889. « Une femme très bien, une femme de bonne tenue, qui ferait son possible pour ne pas avoir l’air trop cochon. »
- 10 octobre 1889. « Femme pareille à une cheminée. Il est temps de lever ta robe : le feu doit être pris. »
- 21 octobre 1889. « Une jolie femme doit être propre et coquette dès le matin en faisant son manage, et briller comme une pièce d’argent dans un tas d’ordures. »
- 19 novembre 1889. « […] Ce n’est donc pas fini d’avoir des théories sur la femme ? Imbécile ! Tu fais comme les autres quand. Tu es sur une femme. Tu dis : je t’aime, je jouis et tu lui bois sa salive simplement, comme un homme. À moins que tu ne sois pas un homme. »
- 19 février 1890. « Une femme hautaine et majestueuse dans l’exercice de sa vertu. »
- 4 mars 1890. « Quand il voyait une jolie femme au teint animé par une course, embellie par une agitation quelconque, il ne manquait pas de se dire qu’en ce moment même, elle devait avoir le derrière suant, et cela l’en dégoûtait tout de suite. »
- 17 mars 1890. « […] J’ai une femme qui est un fort et doux être plein de vie, un bébé qui illustrerait un concours, et je n’ai aucune espèce de force pour jouir de tout cela. »
- 18 mars 1890. « […] Franchement, je ne vois pas quelle lecture peuvent s’interdire les femmes mariées qui font, ou ont le droit de faire la bête à deux dos toutes les nuits. »
- 5 janvier 1891. « […] Il est plein d’une grande pitié pour les pauvres honnêtes, pour les femmes qui savent résister aux besoins de l’entre-cuisses. »
- 20 mars 1891. « […] Lui :’Moi j’ai peur de la bêtise de la femme. J’ai pour maîtresse une toute petite fille qui est bien bête, mais si gentiment !’ »
- 2 novembre 1891. « Schwob [Marcel. 1867-1905] […] : Je vais peut-être faire souffrir, pour cette grue que je n’aime pas, une autre petite femme que j’aime qui est simple, bonne, et se contente du peu que je lui donne. Ce n’est pourtant pas sa chair qui m’attire. Qu’est-ce que c’est ? Je vais redevenir ce que j’ai été : quelque chose de pas propre. »
- 7 novembre 1891. « Byvanck [Willem-Gertrud-Cornelis. 1848-1925] : Il ne faut aimer les femmes de lettres que mortes. »
- 23 décembre 1891. « […] des actrices qui remuent des poings comme des lapins. »
- 2 janvier 1892. « Un poète symboliste lit à un de ses amis la description d’une maîtresse.
Est-il possible, s’écrie l’ami, de massacrer ainsi une femme ! »
- 6 janvier 1892. « Chaudes, chaudes, les petites femmes. »
- 15 janvier 1892. « Il y a des cafés où l’on ne sert rien aux femmes seules. Elles ont obligée de dire qu’elles attendent un homme, et les pauvres grues sont même gênées. Hier une actrice du Théâtre d’Art, au café Weber, qui attendait depuis des heures sur sa banquette avec une autre femme, a profité de notre sortie pour sortir aussi, et elle a prié Schwob [Marcel. 1867-1905] de faire le simulacre de la reconduire à une vague voiture. »
- 22 janvier 1892. « Ah ! les grands jours de petits ennuis ! […] Je n’ai plus que le plaisir de dire des paroles dures à Marinette [son épouse] qui, de peur de m’agacer, n’ose pas faire un mouvement. »
- 26 janvier 1892. « Devant moi, sur un balcon, une vilaine petite négresse qui secoue des tapis. Pourquoi ne retourne-t-elle pas sa peau, sa peau de soulier mouillé qui ne veut pas reluire ? »
- 12 mai 1892. « Les vieux qui ont leurs filles pour maîtresses. Et ces grues ! »
- 19 mai 1892. « Les affaires avant tout, lui dit-elle. »
- 11 juin 1892. « À une bonne : ‘Vous dormez trop, ma fille. Vous dormez autant que moi. »
- 12 juillet 1892. « Quand elle avait pris ses belles résolutions d’économie, elle commençait tout de suite par refuser aux pauvres. »
- 26 mai 1894. « Fantec [son fils, 5 ans], n’étudie qu’une femme, mais fouille la bien et tu connaîtras la femme. »
- 28 décembre 1896. « Oh ! madame, mon ambition n’a pas de borne. Pour arriver, je vous passerai sur le ventre. »
- « Une bonne grosse dame qui donne des baisers, comme si elle collait des timbres. »
- « Bonne fille, elle donne des coups de poing comme si elle avait appris l’amour avec les béliers. »
- « Jeune fille, ta feuille de vigne a le phyllozera. »
- 22 janvier 1897. « Une femme intelligente doit nous laisser nos rêves. Je garde le droit d’aimer une femme comme de désirer un voyage à Florence. […]. »
- 24 février 1897. « Je n’ai été heureux d’avoir une jolie femme, dit-il, que quand je ne l’ai plus aimée. Alors, je l’ai regardée et je me suis dit :’Tiens ? Il vaut toute de même mieux avoir une jolie femme comme ça qu’un vieux meuble. »
- 30 mars 1897. « Ce qui condamne la littérature des femmes, comme Mme. J. Marini, c’est qu’un homme pourrai en faire autant. »
- 8 avril 1897. « Les hommes de lettres ont fait le tour des idées, et ils finissent par se marier avec de pauvres petits bouts de femmes laides. »
- 13 mai 1897. « Et ces vieilles femmes, je les ai connues jeunes filles. Suis-je donc vieux ? Comment ont-elles fait pour vieillir ainsi ? »
- 9 juin 1897. « Jeanne d’Arc. Son plus beau mot :’Je n’ai jamais tué personne.’ »
- 9 juillet 1897. « Il me suffit de voir au bord du lac une grosse fille - si rouge que si on lui donnait un coup d’aiguille, il en sortirait en abondance de l’eau rougie -, pour que je rêve de vivre avec cette fille au bord de cet étang. »
- 13 août 1897. « Elle oublie sa misère à force de bavardage. Elle fait vivre sa famille avec 9 francs par mois. Elle paie 500 francs de dettes par an sans que les siens le sachent. Ruinée par son frère, elle reste pleine d’admiration pour lui. Comme elle a une excellente vue, elle fait des ouvrages de broderies très fins, et le se les fait payer dix sous parce que ça ne se voit pas. Tous profitent de sa bêtise, de sa bonté. »
- 1er octobre 1897. « Oh ! n’importe quelle femme, ça m’est égal. On a beau être deux : l’amour reste solitaire. »
- 13 octobre 1897. « Une de ces dames dont il vaut mieux interroger la concierge que la conscience. »
- 16 novembre 1897. « À une dame : ‘vous devriez prendre quelques amants.’ »
« Ce sont des dames qu’on ne salue pas
Oui, mais on se découvrirait bien tout entier devant elles. »
- 29 novembre 1897. « Ah ! Ah ! Qui est-ce qui, grâce à moi, va aller tout de suite à la postérité ? C’est ma petite femme. »
- 1er décembre 1897. « C’est au doux climat de cette femme que je voudrais vivre et mourir. »
- 1er janvier 1898. « Pas assez sensuel pour courir après les femmes, je sens toujours que la première venue ferait de moi ce qu’elle voudrait. »
- 16 janvier 1898. « Ces jeunes gens si occupés par la femme, je les trouve un peu niais. » - 2 février 1898. « Posséder une femme par le bout du doigt. »
« Je ne suis pas de ceux qui croient que rien n’est plus mystérieux comme une âme de jeune fille. »
« ‘La plus belle fille du monde…’. Mais la plus belle donne plus. »
- 22 février 1898. « Elle s’est éloignée d’un petit derrière pincé. »
- 8 mars 1898. « Si mignonne que, si vous vouliez vous pendre, vous n’auriez pas le poids. »
- 21 mars 1898. « Et son âme de grue a des yeux de pervenche. »
- 31 mars 1898. « Jamais les femmes ne m’ont paru aussi bêtes. »
- 29 avril 1898. « Ne dites pas à une femme qu’elle est jolie. Dites-lui seulement qu’elle ne ressemble pas aux autres, et toutes ses carrières vous seront ouvertes. »
« Quand une femme vous dit : ’Un homme comme vous…’, c’est une façon de dire : ‘Quand vous voudrez, monsieur.’ ».
« Si vous voulez plaire aux femmes, dites-leur ce que vous ne voudriez pas qu’on dît à la vôtre. » ;
- 22 mars 1902. « Femmes de lettres, leur laideur, leur ridicules petits chapeaux verts. Les plus jeunes ont de allures masculines : on dirait qu’elles font de la littérature pour faire l’homme. »
- 6 mai 1902. « Aux deux salons. Des portraits de femmes qui dégoûteraient de la femme si ce n’était déjà fait […] »
- 11 juin 1902. « Les libres penseurs qui se convertissent me font l’effet de ces hommes chastes qui méprisent la femme jusqu’à ce qu’ils se fassent engluer par la première peau venue. »
- 12 juillet 1902. « Une femme allait mentir, comme d’habitude ; elle s’est retenue, parce qu’elle est en deuil. »
- 1er février 1903. « Il n’y a malheureusement pas de remède de bonne femme contre les mauvaises. »
- 8 février 1905. « On voit de pauvres petites femmes bien laides qui sont tout de même enceintes. »
- 24 février 1905. « Je la regarde. Comment lui reviendrait-il ? Elle a l’air d’un pauvre parapluie. C’est très joli une compagne intelligente, mais il faut que ce soit une femme, avec tout de même, qui diable ! un peu de ce qui est nécessaire pour faire l’amour. »
- 6 mars 1905. « Les femmes cherchent un féminin à ‘auteur’ : il y a ‘bas-bleu’. C’est joli et ça dit tout. À moins qu’elles n’aiment mieux : ‘plagiaire ou ‘écrivaine’ : la rime n’aurait rien d’excessif.
Je veux faire rire : les femmes ont plus de talent que nous. Je propose de dire’ madame’, afin qu’elle garde quelque chose de leur sexe. »
- 30 juillet 1908. « Première apparition d’Augustine [comme ‘bonne’] qui va se mêler à notre vie. L’aspect d’une bonne fille de ferme. […] On s’étonne qu’elle ne soit pas venue avec sa vache. »
- 21 septembre 1908. « Femme auteur abondante : elle donne le bon à traire. »
N.B. La finalité de cette recension (non exhaustive, non terminée) qui porte certes un jugement de valeur concernant l’homme et donne une toute autre image que celle qui est généralement présentée de Jules Renard, permet aussi d’interroger ses jugements dont on peut penser qu’ils forment le fond commun de la cuture patriarcale française.
Femmes (Réparations dues aux femmes) : Oui, comme les esclaves, les femmes, toutes les femmes doivent obtenir réparation. La différence d’importance avec l’esclavage, c’est que le patriarcat n’a jamais encore été reconnu comme criminel. (Cf. Hommes, Patriarcat, Politique. Esclavage, Violences. Criminels de paix)
Femmes (« Repos du guerrier ») : Territoire légitimement occupé ? À occuper ? Champ : d’action ? d’expression ? de défoulement ? (Cf. Êtres humains, Corps, Femmes. Frontières, Hommes, Politique. Frontières. Guerre)
Femmes (« Repoussoir ») : 2017. À la recherche d’un synonyme de « repoussoir », j’ai lu ceci : « Personne ou chose qui en fait valoir une autre par le contraste » et dont le premier exemple présenté (repris du Dictionnaire de l’Académie française) est :
« Une femme laide sert de repoussoir à sa voisine. »
- On peut noter que cette définition (et son exemple) n’existait dans Le Dictionnaire de l’Académie française ni en 1762, ni dans celui de 1798, pas plus que dans celui de 1835. Il apparaît dans celui de 1932 et, depuis lors, n’a pas été modifié. 2094
Par ordre chronologique. Femmes. « Réputation » :
Femmes (« Réputation ») (1) : Stendhal [1783-1842] écrit à sa sœur Pauline Beyle [1786-1857] :
- (11 mai) 1804. « […] Prend cette habitude ; tu seras tout étonnée de te trouver un jour en état de comprendre les plus grands hommes, Bacon, Montesquieu, Lancelin, Vauvenargues, Pascal, etc. Mais rappelle-toi que le premier bien d’une femme est la réputation, et que si tu choques la vanité des autres, ils te puniront en te diffamant : cache donc ta science et sois plus douce qu’une autre pour racheter les moments d’oubli où tu aurais montré tout ce que tu sais. »
- (12 juillet) 1804. « Quant à la liberté, elle n’est pas l’apanage des femmes dans nos mœurs ; jusqu’à quarante ans, elles doivent ménager les sots qui font la majorité du public et qui dispensent la réputation, le bien le plus précieux des femmes.
Ces animaux-là sont très vaniteux et c’est leur caractère décisif : ménage donc leur vanité. Tu dois comprendre à quel point ils détestent une femme plus instruite qu’eux, puisqu’ils abhorrent déjà un homme sage. » 2095 (Cf. Femmes. Intelligentes, Patriarcat, Politique. Lois. Moeurs)
Femmes (« Réputation ») (2) : 1981. Françoise Giroud [1916-2003], dans Une femme honorable, considère que la « réputation » des femmes est « le seul bien qu’on leur reconnaisse en propre ». 2096 Un bien curieux « bien » qui dépend du jugement que d’autres portent sur elles, selon des critères qu’elles n’ont pas été autorisées à décider, mais auxquels elles doivent s’adapter, fusse au sacrifice de leur vie.
-------------
Femmes. Résistantes :
Femmes (Résistantes) (1) : (28 mai) 1943. Début du Journal de ma mère, Bernadette Louis (née Bernadette Mallet, après avoir été nommée Bernadette Gentot, du nom de son mari dont elle était veuve) :
« Roger [Louis, mon père] revient du village - Gordes - et m'annonce qu'il s'occupera désormais activement de la Résistance en organisant avec Roure et Nouveau des camps pour abriter les jeunes réfractaires au STO. J'en suis heureuse car les professions de foi familialistes ne suffisent pas. Il est si facile de parler et vos adversaires peuvent toujours vous demander ce que vous faites pour cette cause que vous soutenez. Mais j'aurais aimé être consultée - m'engager librement et après réflexion dans cette organisation qui compromet peut-être notre vie - celle de nos enfants. Je me trouve engagée sans avoir eu le mérite de choisir cette route.
Cette décision aura pour résultat de nous forcer à plus de prudence dans nos paroles. Nous ne sommes plus seuls, mais en nous compromettant sans nécessité absolue, nous entraînerions désormais nos compagnons.
Plus de ces protestations pendant le passage des actualités, qui ont déjà plus d'une fois failli tourner mal, à Lyon ou à Avignon. Plus de ces discours incendiaires en public comme celui que Roger a prononcé en pleine place de Gordes (Roger raconte)
Donc demain nous arrivent les trois premiers éléments du camp. 3 paysans, plus Maurice (Jankélévitch), un juif. Nous les installerons provisoirement dans la maison de Blanchi. Ce qui complique le cas pour Maurice, c'est que sa maîtresse, Nénette, habite à 400 mètres et qu'on juge utile (c'est un peu ridicule) de le lui cacher. Or, elle a distinctement, par des lunettes, vue sur la chambre où habite Maurice ! Un (???) pour elle vient me voir avec une amie. Avait-elle l'intention de me parler ouvertement, ou n'a-t-elle pas osé ? Après un échange de banalités, elle est partie, mais se retournait sans cesse pour regarder la fenêtre derrière laquelle se tenait Maurice. »
N.B. Ce fut ma mère qui, après la fuite de mon père par la fenêtre pour rejoindre le maquis (au double sens du mot), et après avoir informé les enfants les plus âgés de ce qu’ils devaient répondre, fut menacée et torturée par les Allemands.
*Ajout. 5 août 2024. Non. Ils étaient Français. Elle fut alors contrainte de quitter Les Grangiers, de « placer » avec plus ou moins de bonheur ses cinq enfants car ils avaient dit qu’ils reviendraient pour brûler la maison.
J’ai réfléchi aussi qu’elle n’en faisait pas état. C’était un des nombreux épisodes de sa vie. Mais je ne veux pas parler en son nom. (Cf. Femmes. Épouse de)
Femmes (Résistantes) (2) : (avril) 1945. Neuf jeunes femmes déportées, poussées sur les routes allemandes par les SS à l’approche des Américains, s’échappent du convoi qui les menaient à la mort. Au terme de neuf jours d’errance, elles parviennent saines et sauves à retrouver les Américains et la liberté.
Suzanne Maudet, l’une d’entre elles, écrit ce récit, Neuf filles jeunes qui ne voulaient pas mourir (rédigé sans doute en 1946, publié en 2004). J’y ai notamment lu ceci :
« […] Il ne semble pas très nécessaire d’insister sur le fait que la plupart d’entre nous avaient une part active dans la Résistance (Renseignements, transferts d’armes, de faux papiers, etc..). Ces paysans du fond de la Saxe n’y croiraient pas, n’en comprendrait pas l’utilité et notre apparence actuelle ne rend guère les choses plausibles. (Ce sera d’ailleurs toujours la réaction des prisonniers de guerre français que nous rencontrerons ; les plus aimables se moqueront gentiment de nous, et les autres sous-entendront très nettement que nous avons été plus ou moins volontaires pour équiper les bordels des travailleurs libres ou même des SS). Bien sûr, ce n’est pas de leur faute ; rien ne peut leur prouver que nous avons presque toutes risqué plusieurs fois la mort en transportant des armes, en décodant des messages, en logeant et en ravitaillant des suspects, ou même seulement en ‘patinant’ dans notre soutien-gorge des papiers d’identité trop neufs - seul point croustillant de l’histoire. Mais cette réaction des PG [prisonniers de guerre français] sera sûrement la plus grande honte que nous ayons subie en Allemagne. » 2097 (Cf. Femmes. Apparence, Proxénétisme, Histoire)
Femmes (Résistantes) (3) : 1974. Lu, dans Mille Visages, un seul combat. Les femmes dans la Résistance :
« Voici quelques titres de journaux féminins, nés des Comités Féminins, ou de l’initiative de tel ou tel groupe, et conservés jusqu’aujourd’hui comme des reliques : Femmes Françaises et Assistance Française, Zone Nord ; La Voix des femmes, Zone Sud ; La Voix des Lilas, région parisienne ; Les Mariannes, Nord et Pas de Calais ; Femmes, de l’Eure et Loir ; Le Trait d’union, Voix des femmes, de Normandie ; La Commune de Paris ; Femmes Varoises ; Femmes du Loir-et-Cher ; Le Journal des Marraines de[s] FTP ; Espérance, de l‘Allier ; Femmes d’Auvergne ; L’Appel des Femmes de Toulouse ; La Ménagère de Villejuif ; La Ménagère de l’Aisne ; Femmes à l’action, de l’Hérault ; La Vivandière ; Quatre-vingt-treize ; Le Carnet de la Ménagère, région parisienne ; La Ménagère de Gentilly ; La Patriote Française ; La Ménagère de Paris ; La Voix des Femmes de la Seine ; La Parisienne Patriote ; Le Cri d’Alarme, région Parisienne… Et sortis des prisons :
Le Trait d’union des Beaumettes, Marseille ; La Patriote Enchaînée de la Roquette et La Vie à la Roquette, à Paris ; Le patriote de Romainville… […] » 2098 (Cf. Femmes. « Féminin », Politique. Prison, Histoire)
-------------
Femmes (Respect) : 2003. Samira Bellil [1972-2004], dans L’enfer des tournantes, concernant certains jeunes des banlieues, auteure de :
« C’est seulement quand ils voient qu’ils n’ont aucune chance qu’ils te respectent. Maintenant j’ai de l’entrainement, je ne me laisse plus faire. […]
J’ai compris le comportement à avoir pour être respectée, ce n’est pas ma nature, mais j’y excelle. Je suis dure, sans pitié, grande gueule. J’attaque la première pour qu’on me foute la paix. J’ai compris qu’il faut faire à l’autre, ce que l’on ne veut pas qu’il vous fasse […]. » 2099 Dur, dur… (Cf. Femmes. Remarquables. Bellil Samira, Relations entre êtres humains. Pitié, Langage. Critique de mot : « Tournantes », Violences)
Femmes (Retraites) : Cf. Économie. Retraites. Femmes
Par ordre chronologique. Femmes. Revanches :
Femmes (Revanches) (1) : 1960. Lu, dans Le guide des jeunes ménages, dans le chapitre intitulé : ‘Rapports sociaux. Loisirs’, à la rubrique : ‘Invitations’, dans la sous rubrique : ‘Tenue’, ceci :
« Afin de permettre à la plus modeste des invitées, de faire son petit effet, il faudra avoir une tenue aussi simple que possible, sans toutefois être négligée. Vous prendrez votre revanche lorsque vous serez invitée à votre tour. » 2100 (Cf. Êtres humains, Patriarcat. Sororité)
Femmes (Revanches) (2) : 2001. Françoise d’Eaubonne [1920-2005], dans Mémoires irréductibles, auteure de :
« […] Dépendance [des femmes], du reste qui, vécue dans la rancune et la frustration, engendre bien d’horribles revanches ; rien n’est plus facile que de rendre la vie impossible à celui qui vous fait vivre’. » 2101
Femmes (Revanches) (3) : (7 août) 2017. Agnès Varda [1928-2019], évoquant l’un de ses derniers documentaires consacrés aux veuves de Noirmoutier, raconte qu’elle leur avait posé la question suivante :
« Comment dormez-vous dans le lit depuis que vous êtes veuve ? » L’une d’elle lui répond :
« Comme lui [à sa place attirée] était en face d’une petite fenêtre, il voyait un arbre. Maintenant, c’est moi qui vois l’arbre. »
La (malheureuse) réaction d’Agnès Varda fut qu’ « elle était un peu revancharde. » 2102 (Cf. Femmes. Artistes. Varda Agnès. Veuves)
-------------
Femmes (Révolution française) : Cf. Histoire. Femmes. Révolution française. Notamment, Gouges (Olympe de) ; Lacombe Claire (2) ; Legros (Madame) (2) ; Méricourt Théroigne de (2), Roland (Madame) (3) …
Femmes (Rideaux) : 1862. Victor Hugo [1802-1885], dans Les misérables, auteur de :
« La maison était effet occupée. Les fenêtres avaient ‘des petits rideaux‘, signe qu’il y avait une femme. » 2103 (Cf. Femmes. Maison)
Femme. « Rien » :
Femme (« Rien ») (1) : Lorsqu’un homme aspirant à, espérant se justifier d’avoir « trompé » sa compagne, lui déclare : « Mais ce n’était rien » ou : « Mais, cela ne signifiait rien pour moi », que les femmes soient solidaires de la femme ainsi lâchement évoquée. Toutes les femmes, sont aussi, alors, ce « rien ».
Par ordre chronologique. Femme. « Rien » :
Femme (« Rien ») (1) : 1865-1869. Léon Tolstoï [1828-1910], dans La guerre et la paix, auteur de : (Le prince André à son père, qui lui avait déclaré que Melle Bourienne était « la seule personne qui [lui] soit vraiment dévouée », lui répond :
« Je ne vous dirai qu’une chose : le malentendu, si malentendu il y a, provient uniquement de cette femme de rien qui ne devrait pas être la compagne de ma sœur [Sonia]. 2104 (Cf. Femmes. Dévouement)
Femme (« Rien ») (2) : (3 février) 2014. Annie Ernaux, à qui l’on demandait pourquoi, elle qui avait écrit L’évènement, n’avait pas signé le Manifeste des 343 [femmes ayant déclaré avoir avorté], répondit :
« En 1971, il était pour moi, hors de question de le faire. C’était impensable. Je n’étais rien. De plus, j’étais mariée à un cadre et déclarer publiquement avoir avorté aurait eu l’effet d’une bombe. » 2105
N.B. Ces explications ne sont pas comparables. (Cf. Êtres humains, Femmes. Écrivaines. Ernaux Annie, Penser. Pensées. Binaires)
* Ajout. 28 février 2016. (Aux fins de comparaison) 1946. En réponse à une question concernant son silence de l’occupation française de l’Indochine, Raymond Aron [1905-1983], dans Le spectateur engagé, répondit :
« Ce n’était pas tellement difficile, c’était surtout tout à fait inefficace. En 1946 ou en 1947, je n’étais rien. […] » 2106
Le contraire de « rien », c’est « quelque chose », et non pas quelqu’un-e. (Cf. Êtres humains, Histoire)
Femme (« Rien ») (3) : 2004. Elisabeth Schwarzkopf [1915-2006], dans Les autres soirs. Mémoires, auteure de :
« En quittant Berlin, où l’on m’a prêté tant de protection [nazie], je n’étais pas avancée : sur le marché mondial, je n’étais rien. »
Elle s’interroge après sur « sa valeur marchande sur le marché du disque. » (Cf. Économie. Marché) 2107
Femmes (« Rien ») (4) : (11 novembre) 2019. Sur France Culture, dans l’émission de Matthieu Garrigou-Lagrange, La compagnie des œuvres, consacrée à George Simenon [1903-1989], lors d’une présentation - odieuse - des rapports de Simenon avec les femmes, Michel Carly, spécialiste de Simenon, son invité, après avoir rappelé les « 10.000 femmes » qu’a « eu » Simenon, présente son analyse : « Le chiffre ne représente rien. »
Matthieu Garrigou-Lagrange - que rien n’a choqué - pour sa part, clôt l’émission par :
« On se perd un peu dans toutes les femmes [légitimes, les autres comptant pour « rien »] de Simenon. » 2108 (Cf. Culture, Êtres humains, Femmes, Comment faire disparaître les femmes ? Hommes. Grossiers. Journalistes, Proxénétisme, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
-------------
Femmes (Rousseau Jean-Jacques) : 1761. Jean-Jacques Rousseau [1712-1778], dans La Nouvelle Héloïse, auteur de :
« On ne saurait dire, à quel point, dans ce pays si galant, les femmes sont tyrannisées par les lois. Faut-il s’étonner qu’elles s’en vengent si cruellement par leurs mœurs ? » 2109
Une analyse (bien courte, certes) de Rousseau, laquelle n’efface ni Émile, ni Sophie… (Cf. Culture. Française, Droit, Êtres humains, Enfants. Rousseau Jean-Jacques, Hommes. « Galants », Relations entre êtres humains. Galanterie, Patriarcat, Politique. Lois. Mœurs)
Femmes (Russie. 1928) : 1928. John Dos Passos [1896-1970], dans Sur toute la terre. Union soviétique, Mexique, Espagne, etc… rencontre à Léningrad un ouvrier métallurgiste Kirghiz et lui demande :
« Quelle était la situation des femmes ? » ; celui-ci lui répond :
« Chez eux, c’était très compliqué, toute une histoire d’argent ou de bétail ; pour fonder une famille, aucun des deux n’était libre ; mais ici, parmi les travailleurs des usines de Léningrad, vous pouviez faire à peu près ce que vous vouliez de votre vie individuelle ; si un garçon et une fille s’aimaient assez ou si elle attendait un bébé, ils faisaient enregistrer leur mariage. La police ne s’en mêlait que si l’un ou l’autre des conjoints cherchait à se défiler pour l’entretien d’un enfant. » 2110
N.B. J’aimerais beaucoup, et depuis longtemps, lire une présentation rigoureuse en droit, comme de fait, de la politique des Soviets concernant les femmes, la famille, au début de la révolution russe, puis de son évolution.
Par ordre chronologique. Femmes. Salaires :
Femmes (Salaires) (1) : 1961. Catherine Paysan [1926-2020], dans Nous autres, les Sanchez, auteure de :
« Alors que nous vivions sur le salaire de notre maman, car papa ne gagnait que des sommes irrégulières, elle s’adressait toujours à lui pour les dépenses, comme s’il eut pourvu aux besoins du ménage. Elle lui demandait la permission d’acheter et elle le faisait avec la grâce, la timidité, la coquetterie d’une épouse qui dépend de son mari…, tant elle l’aimait, désirait qu’il se sentît son maître. » 2111 (Cf. Femmes. « Coquettes ». Épouse de, Patriarcat. Division sexuelle du travail, Économie. Salaires, Histoire)
Femmes (Salaires) (2) : (12 mai) 2016. Entendu lors d’un reportage d’Arte concernant les jardins du prince von Pückler-Muskau [situés à la frontière germano-Polonaise, désigné « patrimoine mondial » de l’UNESCO] détruits pendant la seconde guerre mondiale, dans la bouche du jardinier qui les avaient fait travailler, qu’ils avaient été reconstruits en grande partie par le travail de femmes. Son analyse :
« Elles avaient besoin de mettre un peu d’argent de côté pour survivre. » 2112
Aujourd’hui, dans le reportage, on ne voit plus dans ce film que des hommes jardiniers. (Cf. Patriarcat. Division sexuelle du travail, Économie. Salaires, Histoire)
-------------
Femmes (Salons) : 1890. Ferdinand Brunetière [1849-1906], dans Évolution des genres dans l’histoire de la littérature, auteur de :
« Si vous voulez savoir pourquoi Racine et Molière, par exemple, n’ont pas toujours atteint cette profondeur de pensée que nous trouvons dans un Shakespeare, ou dans un Goethe, pourquoi certaines questions, comme celle de la destinée, qui sont enveloppées dans un Hamlet ou dans un Faust, semblent leur être demeurées étrangères, ‘cherchez la femme’, et vous trouverez que la faute en est à l’influence des salons et des femmes. Ils ont voulu plaire ; et pour plaire, ils se sont efforcés de s’accommoder au monde. Ils ont accordé, ils ont concédé quelque chose à la mode […]. » 2113 (Cf. Culture, Êtres humains. Mode, Femmes. Comment faire disparaître les femmes ? Féminismes. Antiféminisme, Langage. Zeugma)
* Ajout. 31 décembre 2021. Voltaire [1694-1778], dans une lettre au comte d’Argental [1700-1788], auteur de :
« Ce n’est pas le bon qui plait, c’est ce qui flatte le goût dominant. » 2114
Par ordre chronologique. Femmes. « Salopes » :
Femmes (« Salopes ») (1) : 1962. Dans L’éclipse [Michelangelo Antonioni], Alain Delon à la téléphoniste :
« Si je n’ai pas Milan tout de suite, alors vous êtes une salope. » (Cf. Culture. Cinéma)
Femmes (« Salopes ») (2) : (mars) 2016. Lu dans Marie-Claire l’interview d’une jeune actrice. Voici l’une des questions à laquelle elle dut répondre :
« Vous avez l’air de quelqu’un de chouette. Vous avez dit que si l’on vous demandait de jouer la pire des salopes, il faudrait que vous trouviez un peu de cela en vous. Vous avez déjà agi comme une salope ? » 2115 (Cf. Culture. Cinéma, Femmes. « Féminin », Relations entre êtres humains. Injures)
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. George Sand :
Femmes (Sand George) (1) : (25 juin) 1837. George Sand [1804-1876], dans Entretiens journaliers, auteur de : « Quelle femme réclamerait la vie de l’esprit, si on lui accordait celle du cœur ? Il est si doux d’être aimée ! Mais on les maltraite, on leur reproche l’idiotie où on les laisse, on méprise leur ignorance, on raille leur savoir. En amour, on les traite comme des courtisanes, en amitié conjugale comme des servantes. On ne les aime pas, on s’en sert, on les exploite, et on espère les assujettir à la loi de la fidélité ? » 2116 (Cf. Famille, Relations entre êtres humains. Aimer, Patriarcat. Penser le patriarcat)
Femmes (Sand George) (2) : (23 décembre) 1864. George Sand [1804-1876], dans une lettre à Édouard de Pompéry [1812-1895], concernant son livre : La femme dans l’humanité, sa nature, son rôle et sa valeur sociale - 1864 -, auteure de :
« Je pense comme vous sur le rôle que la logique et le cœur imposent à la femme. Celles qui prétendent qu’elles auraient le temps d’être députés et d’élever leurs enfants ne les ont pas élevées elles-mêmes ; sans cela, elles sauraient que c’est impossible. Beaucoup de femmes de mérite, excellentes mères, sont forcées par le travail de confier leurs petits à des étrangères ; mais c’est le vice d’un état social, qui à chaque instant, méconnait et contrarie la nature.
La femme peut bien, à un moment donné, remplir d’inspiration un rôle social et politique, mais non une fonction qui la prive de sa mission naturelle : l’amour de la famille. On m’a dit souvent que j’étais arriérée dans mon idéal de progrès, et il est certain qu’en fait de progrès, l’imagination peut tout admettre. Mais le cœur est-il destiné à changer ? Je ne le crois pas et je vois la femme à jamais esclave de son propre cœur et de ses entrailles. J’ai écrit cela maintes fois et je le pense toujours. » 2117 (Cf. Êtres humains, Corps, Femmes. Mères. « Politiques », Famille, Féminismes. Antiféminisme, Patriarcat)
Par ordre chronologique. Femmes. Saoudiennes :
Femmes (Saoudiennes) (1) : (octobre) 2013. Toujours (notamment) interdites de conduite, et d’enregistrement sur les listes électorales aux élections municipales, et donc de droit de vote, dans un pays considéré comme le principal allié au Moyen Orient des États-Unis et, plus largement, de l’ « occident ». Toute comparaison avec la déploration « occidentale » du statut des femmes Afghanes est la bienvenue. 2118 (Cf. Culture. Accord Franco-saoudien, Patriarcat. Femmes. Afghanes, Politique. « Occident »)
Femmes (Saoudiennes) (2) : (11 mars) 2017. Le « conseil des femmes » Saoudiennes de la province d’Al-Qassim a été installé ce jour. Je lis dans Le Canard enchaîné :
« Face à la presse, le gouverneur était entouré de douze hommes, tandis que les membres du futur conseil étaient relégué-es dans une pièce voisine, reliée par vidéo, à l’abri des regards. » 2119 (Cf. Femmes. « Politiques ». Lagarde Christine, Famille. Polygamie)
-------------
Femmes (Scientifiques) : (février) 1888. Jules Renard [1864-1910] écrit dans son Journal :
« À quoi bon tant de science pour une cervelle de femme ! Que vous jetiez l'Océan ou un verre d'eau sur le trou d'une aiguille, il n'y passera toujours qu'une goutte d'eau. » 2120 (Cf. Êtres humains, Corps, Femmes. Intelligentes. Renard Jules, Féminismes. Antiféminisme)
Femmes (Secrétaires) : (4 mai) 1844. Eugénie Scriwanek [?-?] écrit à Alexandre Dumas fils [1824-1895] :
« Votre père [1802-1870] me fait beaucoup travailler, j’écris sous sa dictée, je suis bien fière, bien heureuse de servir de secrétaire à lui, à l’homme universel. » 2121 (Cf. Femmes. Aliénées. Heureuses)
Femmes (« Séduisantes ») : Des femmes pensent encore que les hommes les aiment séduisantes. Mais n’est-ce pas d’abord l’image d’hommes séducteurs que leur supposée séduction leur renvoie qu’ils aiment et la dépendance des femmes à leur égard qu’elle révèle et confirme. C’est dans ce jeu de miroirs que les si nombreuses manifestations du patriarcat et son cortège de violences se perpétue. Que gagnent les femmes ? De perpétuer leur aliénation ? Pas uniquement… (Cf. Femmes. Miroir. Séduisantes, Hommes. Séduisants. Séducteurs)
Par ordre chronologiques. Femmes. Sensibles :
Femmes (Sensibles) (1) : 1782. Jean-Jacques Rousseau [1712-1778], dans Les confessions, évoquant l’une de ses « écolières dans la Bourgeoisie », auteur de :
« Son indolence, sa froideur, son insensibilité allaient à un point incroyable. Il était également impossible de lui plaire et de la fâcher, et je suis persuadé que si l’on eût fait sur elle quelque entreprise, elle aurait laissé faire, non par goût, mais par stupidité. Sa mère qui n’en voulait pas courir le risque ne la quittait pas d’un pas. » 2122 (Cf. Femmes. Stupides, Violences. Viols)
Femmes (Sensibles) (2) : 1882. Émile Zola [1840-1902], dans Au bonheur des dames, auteur de :
« Toujours elle [Denise] avait cédé ainsi au premier excès de sa sensibilité : des larmes la suffoquaient, sa passion doublait ses tourments ; puis, elle rentrait dans sa raison, elle retrouvait un beau courage calme, une force de volonté douce et inexorable. Maintenant, les yeux limpides, le teint pâle, elle était sans un frisson, toute à sa besogne, résolue à s’écraser les coeur et à ne faire que son vouloir. » 2123
-------------
Femmes (Sentiments) : Il a souvent été reproché aux femmes - tout en les accusant d’être sentimentales - de travestir leurs propres sentiments : mais comment, sauf exceptions- pouvaient-elles l’être, alors que toute leur éduction était focalisée sur la nécessaire adaptation à l’autre, auquel elles devront « obéir » ? (Cf. Famille. Mariage)
Par ordre chronologique. Femmes. Servantes :
Femmes (Servantes) (1) : 1946. János Székely [1901-1958], dans L’enfant du Danube, auteur de :
« Je ne veux ni l’accuser ni la défendre. Elle était ma mère et c’est ainsi qu’elle était. Elle n’avait pas demandé à naître et n’avait pas non plus créé le monde où le destin l’obligeait à vivre. Qui pourrait dire les réactions physiques et sentimentales de cette infortunée petite servante, exploitée jusqu’à l’os, au cours de ces huit années interminables [où elle fut séparée de lui], à travers l’inflation, la déflation, les folies politiques, les chagrins, les conditions de travail inhumaines, les misères du chômage ? » 2124 (Cf. Femmes. Mères. Travail des femmes, Politique, Économie. « Pauvres Les »)
Femmes (Servantes) (2) : 2003. Je lis dans le livre de Marcel Bernos Femmes et gens d’Église dans la France classique. XVII-XVIIème siècle, dans le chapitre intitulé De quelques emplois féminins, dans le paragraphe consacré aux Domestiques :
« Les conditions d’exercice du métier peuvent induire des péchés particuliers aux domestiques : si elles s’habillent de façon ‘immodeste’, si elles ne se gardent pas des discours trop libres de leurs collègues hommes (« quelles se retirent, plutôt que de demeurer dans une maison où ces mauvaises libertés seraient autorisées »). […]
Le clergé a encore à connaitre des servantes en situation de détresse, en particulier, celles qui, hors mariage, se retrouvent enceintes. » 2125 (Cf. Êtres humains. Domestiques, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
Femmes (Servantes) (3) : (16 janvier) 2022. Entendu sur France Culture, Roger Planchon [1931-2001] concernant Nadedja Mandelstam [1899-1980], épouse d’Ossip Mandelstam [1891-1938], laquelle craignant la répression concernant les poèmes de son mari, les avaient enterrés, cachés dans des boites de conserve, auteur de :
« C’est une façon véritable d’être une vraie servante de la poésie. » 2126 (Cf. Culture. Poésie)
-------------
Femmes. « Seules » :
Femmes (« Seules ») (1) : Une « femme seule » : une femme dépourvue d’homme-s à ses côtés…
Femmes (« Seules ») (2) : Une « femme seule ». Non : Une femme.
Femmes (« Seules ») (3) : Une femme qui a eu deux arrière-grands-pères, deux grands-pères, un père, quantité de cousins et de neveux, des frères, un ou des maris, un ou des amants, des amis, des patrons, des collègues, des voisins, des enfants - sans même évoquer les femmes ayant partagé sa vie - peut être qualifie de femme « seule » …
Variante : « Elle vit sans homme » …, dans l’attente qu’elle « refasse sa vie ».
Femmes (« Seules ») (4) : Elle disait ne pas vouloir rompre, de crainte d’être « seule » ; elle ne pouvait / voulait pas voir que rompre était justement la condition pour ne pas l’être. Ou, plus justement, que la question n’était pas celle de la solitude, mais celle de la dépendance.
Femmes (« Seules ») (5) : Une femme - jugée - « seule », devient souvent marginale, isolée, exclue, pour finir par ne compter, croit-elle, pour rien. La seule réalité : elle est : elle.
Femme (« Seule ») (6) : Je ne suis pas seule ; je suis moi.
Par ordre chronologique. Femmes. « Seules » :
Femmes (« Seules ») (1) : 1682. Corneille [1606-1684], dans Médée, auteur de :
« - Nérine : « Dans un si grand revers, que vous reste-t-il ? »
- Médée : « Moi.
Moi, dis-je, et c’est assez. » [Acte I. Scène V] (Cf. Dialogues, Êtres humains. Soi)
Femmes (« Seules ») (2) : 1833. Lu dans Lélia de George Sand [1804-1876] :
« Cruelle Lélia ! Que vous êtes heureuse d’avoir ainsi l’âme libre et de pouvoir rêver seule, aimer seule, vivre seule ! » 2127 (Cf. Êtres humains. Âmes, Femmes. Heureuses)
Femmes (« Seules ») (3) : 1862. Victor Hugo [1802-1885], dans Les misérables, auteur de :
« Cette femme [Fantine] n’avait au monde que cet enfant, et cet enfant [Cosette] n’avait au monde que cette femme. » 2128
Femmes (« Seules ») (4) : 1865-1869. Léon Tolstoï [1828-1910], dans La guerre et la paix, auteur de :
« Comme il est de règle pour les femmes seules, longtemps privées de toute société masculine, les trois jeunes femmes de Lyssyia Gory sentirent, à l’apparition d’Anatole, que la vie qu’elles avaient menée jusqu’alors n’étaient pas une vie. Le pouvoir de penser, de sentir, d’observer se décupla aussitôt en elles, et leur vie, jusqu’alors ensevelie dans l’ombre se para d’un nouvel et puissant éclat. » 2129
Cette analyse de Léon Tolstoï m’a fait penser, sans invalider la ponctuelle justesse de ce constat, à ce slogan féministe des années 1970 :
« Une femme sans homme, c’est comme un poisson sans bicyclette »
Par ordre chronologique. Femmes. « Seules ». Émile Zola :
Femmes (« Seules ») (5) : 1882. Émile Zola [1840-1902], dans Au bonheur des dames, auteur de :
« Certes, elle ne jalousait pas ces demoiselles, elle était heureuse de sa solitude, de cette sauvagerie où elle vivait enfermée, comme au fond d’un refuge ; mais son imagination l’emportait… » 2130 (Cf. Femmes. Enfermées. Heureuses)
Femmes (« Seules ») (6) : 1883. Émile Zola [1840-1902], dans L’œuvre, auteur de :
« - Non, non, je n’ai pas besoin de vous… Si vous voulez être aimable, laissez-moi m’en aller toute seule. » 2131
-------------
Femmes (« Seules ») (7) : (25 février) 1917. Camille Claudel [1864-1943], in : Lettre de l’Asile, auteure de :
« On me reproche, (ô crime épouvantable) d’avoir vécu toute seule… » 2132 (Cf. Femmes. Artistes. Claudel Camille, Justice)
Femmes (« Seules ») (8) : 1929. Ivy Compton-Burnett [1884-1969], dans Frères et sœurs, auteure de :
« Ah, tu ne sauras jamais tout ce que je peux faire, dit Sophia dont les yeux lancèrent un éclair. C’est une découverte inépuisable pour toi, Je m’extasie parfois sur la profondeur du gouffre qui me sépare d’une personne ordinaire.
- Il doit exister de pires formes de solitude dit Christian. » (Cf. Dialogues, Femmes. Orgueil)
Femmes (« Seules ») (9) : 1969. Nina Berberova [1901-1993], dans C’est moi qui souligne, auteure de :
« Je sais aujourd’hui ce que j’ignorais alors, qu’il m’est impossible, sous peine de me mutiler, de passer ma vie entière avec un seul être, de le placer toujours au centre du monde et de n’appartenir qu’à lui. […]
Chaque fois que je me retrouvais seule, j’éprouvais de plus en plus intensément une ‘folle ivresse’ d’être sans lui, libre, forte, avec à ma disposition un temps illimité, une vie frémissante, de nouveaux amis que je m’étais choisis moi-même. » 2133
Femmes (« Seules ») (10) : Femmes seules ... au pluriel : douze participantes à la Marche - non mixte - de nuit des femmes ont entendu :
« Qu’est-ce que vous faites ici seules le soir ? » 2134
-------------
Femmes (Sexes) : Cf. Sexes. Femmes. Hommes. « Sexualité »
Femmes (Shakespeare) : 1611. Hermione, dans Le conte d’hiver de Shakespeare [1564-1616], s’exprime en ces termes :
« Rassasiez-moi d’éloges, et engraissez m’en comme un oiseau domestique ; une bonne action qu’on laisse mourir, sans en parler, en tue mille autres qui seraient venues à la suite ; les louanges sont notre salaire : vous pouvez avec un seul doux baiser nous faire avancer plus de cent lieues, tandis qu’avec l’aiguillon vous ne nous feriez pas parcourir une seul acre. » 2135 (Cf. Êtres humains. Relations entre êtres humains. Flatterie. Louanges)
Femmes (Sicile. Années [19] 50) : 1951. Éric Hobsbawm [1917-2012], historien marxiste britannique, lors d’un séjour en Sicile, à Piana Degali Albanesi, auteur de :
« Je m’aperçus, ce que tout le monde considérait comme normal, que les femmes silencieuses vêtues de noir qui étaient assises dans la rue restent toujours tournées vers l’intérieur de leur maison. »
- 1954. Il note, quatre ans plus tard :
« Les choses changent, me dit-on. Nous sommes en train de copier de plus en plus ceux du Nord ; par exemple, nous laissons les femmes sortir toutes seules. Je pense qu’un jour nous serons comme eux. » 2136 (Cf. Femmes. Assises. Maison, Patriarcat, Histoire. Historiographie. Patriarcale)
Par ordre chronologique. Femmes. Sida :
Femmes (Sida) (1) : (28 novembre) 1992. Dans un reportage de France Culture consacré aux soignant-es du service accueillant les malades du sida de l’hôpital Béclère de Clamart, il est présenté de ces termes : « 60 % des sidéens, dont 40 % de toxicomanes et 30 % des femmes. » 2137
Femmes (Sida) (2) : (2 décembre) 1992. Denise Cacheux, députée socialiste, membre de la Commission d’enquête sur l’état des connaissances scientifiques et les actions menées à l’égard de la transmission du sida interpelle Monsieur Luc Montagnier [qui reçut d’innombrables prix, décorations depuis lors…] :
- « Chaque fois que vous évoquez les groupes à risques, vous citez les hémophiles, les toxicomanes et les homosexuels. Ni vous, ni personne, ne parlez jamais des prostituées. Cela signifie-il qu’elles ne constituent pas un groupe à risque ou qu’elles sont un groupe sur lequel il n’y a ni observation, ni recherche. Ou, cela signifie-t-il que ce problème est occulté et si oui, pourquoi ? »
- M. Luc Montagnier : « Tout d’abord, une précision : la notion de groupe à risque est aujourd’hui remplacée par celles de ‘pratiques sexuelles à risque’ ; On sait par exemple que la pratique ano-génitale est une pratique à haut risque, quelle que soit la personne qui s’y livre.
Très peu d’études sont faites sur les prostituées, puisqu’elles ne font plus l’objet en France, d’aucun contrôle sanitaire. Comme vous le savez, au niveau de la loi, les prostituées n’existent pas. »
- Madame Denise Cacheux : « Elles n’existent que pour le fisc ! »
- M. Luc Montagnier : « Effectivement ». Puis après avoir affirmé que « dans les pays développés leur taux d’infection est faible, sauf pour celle qui sont toxicomanes », il conclut :
« On constate [en outre] une tradition de ‘professionnalisme’ chez les prostituées européennes ou américaines pour éviter les maladies sexuellement transmissibles, ce qui fait qu’elles échappent également au sida. Mais enfin, tout est relatif ; certaines sont infectées, mais nous ne disposons pas d’études épidémiologiques les concernant. » 2138 (Cf. Êtres humains, Relations entre êtres humains. Sida. Transmission, Proxénétisme. Personnes-dites-prostituées, Sexes. Préservatif)
Femmes (Sida) (3) : 1994. Michèle Barzach, ministre de la santé et de la famille de 1986 à 1988, dans Vérités et tabous, auteure de :
« Il a fallu attendre 1990 pour que la Journée mondiale du sida soit consacrée aux femmes séropositives ou malades. Dix ans de silence, de complicité, de honte. Il a fallu attendre que des millions de femmes soient malades, que des centaines de femmes soient mortes avant de s’émouvoir. Il a fallu attendre que des millions d’entre elles vivent l’horreur de la grossesse coupable de donner la vie et la mort en même temps. Dix ans pour comprendre que la politique à travers le monde était faite une fois de plus par les hommes et pour les hommes. [...]
C’est tout cela qu’évoquait pour moi le regard soumis et inquiet des femmes africaines aperçues au fond de leurs cases sombres. C’est tout cela que leur mutisme angoissant me transmettait. » 2139 (Cf. Êtres humains, Relations entre êtres humains. Sida. Transmission, Femmes. Silence, Sexes. Préservatif)
Femmes (Sida) (4) : 2014. Lu dans 10 femmes contre le sida :
« La première campagne de prévention à destination des femmes date de 1997. Pourtant, dès 1984, elles faisaient bien partie des malades ! Quand on constate que de plus en plus de femmes nouvellement contaminées ont plus de cinquante ans, il y a de quoi être en colère ; elles sont passées à travers tous les messages de prévention par ce qu’ils ne leur étaient pas destinées ! Si aujourd’hui, après un divorce ou une séparation, elles sont contaminées, c’est aussi par ce qu’elles ne se sont pas senties concernées par le sujet et c’est aussi une conséquence directe de la politique irresponsable de prévention qui n’a raisonné et communiqué qu’en termes de ‘population à risques’. » 2140
« Pas senties concernées » ? (Cf. Êtres humains, Relations entre êtres humains. Sida. Transmission, Sexes. Préservatif)
Femmes (Sida) (5) : 2014. Lu dans le même livre, 10 femmes contre le sida, concernant les trithérapies :
« Le problème vient de ce que ces traitements sont très mal supportés par un grand nombre de femmes…parce qu’elles ne sont pas des hommes. C’est une réalité, les femmes ne représentent en moyenne que 5 à 10 % des sujets inclus dans les essais thérapeutiques, et nous ne disposons donc que de très peu de données d’efficacité et de tolérance sur leur organisme. […] Parce qu’elles supportent mal leurs médicaments, les femmes changent plusieurs fois de ligne de traitement et l’observance est moins bonne chez elles que chez les hommes. Quand on sait que ces traitements doivent être pris à vie, il est aisé de comprendre que ces obstacles constituent réellement un frein aux soins. » 2141
Il faudrait poursuivre et notamment savoir si les industries pharmaceutiques ont depuis lors changé leurs essais ; mais cela n’efface pas leur responsabilité d’avoir mis sur le marché pendant des dizaines d’années des médicaments inappropriés pour les femmes. (Cf. Êtres humains. Relations entre êtres humains. Sida. Transmission, Sexes. Préservatif)
Femmes (Sida) (6) : 2014. Daniel Defert, président fondateur de Aides de 1984 à 1991, dans Une vie politique, écrit concernant l’année 1985 :
« Surtout observé chez les hommes, les symptômes (du sida) ne seront pris en compte qu’à partir de 1987, date de la conférence de Washington. » Il précise plus loin que « le virus s’était implanté en France, au milieu de la décennie 1970, peut-être même avant ». Il avait enfin préalablement insisté sur la volonté, dès sa création, que Aides soit un « mouvement de santé publique et non pas un mouvement gay »
Quant au fait qu’ « un avocat de Aides a défendu un homme qui avait contaminé ses compagnes, il se contente en guise de justification, d’écrire : « Je pense qu’en tant qu’association (ici non qualifiée) et pour une saine justice (sic), Aides aurait dû offrir (sic) un avocat aux jeunes femmes (et non pas aux victimes). Les deux positions concernaient l’association ». Oui, mais elles étaient antagoniques et leur clarification aurait nécessité de régler - politiquement - la question de la responsabilité personnelle, pénale, en matière de transfert du sida à d’autres. 2142
Femmes (Sida) (7) : (1er décembre) 2019. Entendu sur Franceinfo, un reportage, sur « la transmission du sida aux enfants par l’allaitement », en Afrique bien sûr…. 2143 Mais qui a transmis le sida aux mères ? Le simple fait de ne pas se poser la question en transfert aux femmes l’exclusive responsabilité. (Cf. Hommes)
-------------
Femmes (Sida. Risques) : « Groupes à risques », « pratiques à risques », « partenaires à risques » : dans tous ces appellations qui ont fondé - et fondent encore - les politiques publiques, les femmes, à l’exception de quelques femmes dites prostituées [souvent transformées en dispensatrices de préservatifs (avec un café chaud et des paroles compréhensives…)], mais a fortiori concernant les femmes mariées, ont été et sont exclues. 2144 (Cf. Sexes. Préservatif)
Femmes. Silence :
Femmes (Silence) (1) : Si, si souvent, les femmes se taisent, c’est qu’elles savent bien que, si souvent, la plainte est inutile, stérile et inefficace. Sur tant et tant de fondements si efficacement mis en œuvre par la « Justice ». (Poursuivre)
Femmes (Silence) (2) : Apprendre - car cela s’apprend - à comprendre le silence des femmes, de chaque femme, c’est aussi comprendre le silence gêné de tant d’hommes du fait de la conscience plus ou moins refoulée de la culpabilité à leur encontre que tant ressentent sans pouvoir l’exprimer.
Femmes (Silence) (3) : Que l’on se satisfasse que les femmes, des femmes « brisent le silence » juge une société et son histoire.
Femmes (Silence) (4) : Combien d’hommes dont la vie ne tient que par le silence de ‘leurs’ épouses / compagnes ? (Cf. Êtres humains. Vies. Vies / Morts, Femmes. Fortes, Langage. Possessif, Justice, Patriarcat)
Femmes (Silence) (5) : De combien de silences de femmes, les gloires de tant d’hommes sont-ils redevables ?
Par ordre chronologique. Femmes. Silence :
Femmes (Silence) (1) : Jacques-Bénigne Bossuet [1627-1704], évêque de Meaux dans un sermon aux Visitandines de Meaux, auteur de :
« Mes filles, gardez toujours le silence : de prudence dans la conversation, de patience dans la contestation. » 2145 (Cf. Féminismes, Patriarcat, Politique. Luttes de femmes)
Femmes (Silence) (2) : 1768. Nicolas Bricaire de la Dixmerie [1731-1791], dans Le danger des épreuves, auteur de :
« […] Sophie vous dira…
- Sophie ne me dira rien. Vous voyez que son silence parle pour elle. Une jeune fille n’a pas d’autre moyens d’approuver. » 2146 (Cf. Dialogues)
Femmes (Silence) (3) : (13 février) 1849. George Sand [1804-1876], auteure de :
« J’ai assez de vertu pour me taire, je n’en aurais pas assez pour parler toujours avec douceur et charité. […] » 2147 (Cf. Femmes. Charité. Vertu, Penser, Patriarcat)
Femmes (Silence) (4) : (15 mars) 1957. Albert Camus [1913-1960], dénonçant l’entrée de l’armée soviétique en Hongrie, évoque les écrivains Hongrois qui « préfèrent se taire aujourd’hui plutôt que de mentir sur ordre. »
Cette analyse m’a ouvert un plus large regard sur le silence des femmes, que j’avais, par facilité, par habitude, par paresse, tendance à d’abord considérer comme relevant de leur devoir d’obéissance à l’ordre, cautionné par le droit. 2148
Femmes (Silence) (5) : 1985. Svetlana Alexievitch, dans La guerre n’a pas un visage de femme, écrit :
« C’est encore à Moscou, le jour de la victoire [1945] que j’ai rencontré Olga Iakovlevna Omeltchenko. Toutes les femmes étaient vêtues de robes printanières, fichus de couleurs claires sur la tête, mais elle, elle arborait l’uniforme et le béret militaires. Elle était grande, robuste. Elle ne parlait pas, ne pleurait pas. Elle gardait constamment le silence, mais son silence était singulier, il portait en lui beaucoup plus que des mots. Elle paraissait entretenir tout le temps une sorte de dialogue intérieur avec elle-même. Elle n’avait besoin de personne. […] Lire la suite. » 2149 (Cf. Dialogues, Langage. Mots, Politique. Guerre. Femmes)
-------------
Femmes. Solidaires :
Femmes (Solidaires) (1) : La solidarité des femmes entre elles, aussi nécessaire soit-elle, ne détruit par le patriarcat : elle le bouleverse.
Par ordre chronologique. Femmes solidaires :
Femmes (Solidaires) (1) : (4 décembre) 1649. Élisabeth de Bohème [1618-1680], dans une lettre à René Descartes [1596-1650], auteure de :
« Ne croyez pas toutefois qu'une description si avantageuse [de la Reine de Suède] me donne matière de jalousie, mais plutôt de m'estimer un peu plus que je ne faisais avant qu'elle m'ait fait avoir l’idée d'une personne si accomplie qui affranchit notre sexe de l'imputation d'imbécillité et de faiblesse que MM. les pédants lui voulaient donner. » 2150
Si chacun-e pouvait penser en ces termes… (Cf. Femmes. Remarquables. Élisabeth de Bohème)
Femmes (Solidaires) (2) : (20 septembre) 1806. Lettre de Germaine de Staël [1766-1817] à Juliette Récamier [1777-1849] :
« Me voici à Rouen, chère Juliette, aussi tristement que partout ailleurs dans l’exil ; Pais c’est moins loin de Paris. […] Vous me dite que vous m’écrivez plus souvent maintenant que vous voyez plus souvent Pr[osper de Barante. 1782-1866]. Je crains, je vous l’avoue, que vous ne vous ne vous laissiez aimer par lui, et ce serait pour moi, une peine mortelle, car deux de mes premiers sentiments en seraient troublés. Ne le faites pas, Juliette. Proscrite que je suis, me confiant à vous et si prodigieusement inférieure à vos charmes, la générosité vous défend de vous permettre avec lui la moindre coquetterie. Ce n’est pas que je crois beaucoup à son affection pour moi ; j’ai le malheur affreux d’en douter sans cesse. Mais réunir ce malheur à l’idée qu’il vient de vous me serait odieux ; je ne me sentirais pas la force de le supporter (ceci entre nous). Répondez-moi tout de suite à cette lettre, où je mets toute mon âme à votre merci. » 2151 (Cf. Êtres humains. Âmes, Femmes. « Coquettes », Penser. Douter. Vérité)
* Ajout. 9 juillet 2019. (3 mars) 1815. Je lis dans le Journal intime de Benjamin Constant [1767-1830] :
« Diné chez Mde de Sta[ël]. Elle me dit qu’elle avait eu une longue conversation avec Juliette [Récamier. 1777-1849, dont Benjamin Constant est dorénavant amoureux]. Elles ont eu une scène à mon sujet. » (Cf. Femmes. Concurrence entre femmes)
Et le 4 mars 1815 : « Diné chez Juliette. Mad de St[ael] la déchire tellement qu’il lui est impossible de continuer notre relation sur ce canon [mode]-là. » 2152
N.B. Je maintiens néanmoins - sans en pouvoir clairement expliciter les raisons : maintenir la franchise exprimée comme condition de toute solidarité ? - la lettre du 20 septembre 1806 sous l’item : Femmes Solidaires.
Femmes (Solidaires) (3) : 1977. Une magnifique et drôle…traduction [en chanson] de la solidarité entre femmes : « Petit bonhomme » d’Anne Sylvestre [1934-2020] ? Un joyau.
Mais tant d’elle est à savourer. (Cf. Femmes. Remarquables. Sylvestre Anne, Hommes. Homme. « Petit »)
Femmes (Solidaires) (4) : (février) 2008. Entendu dans un restaurant : Une femme parle de contacts avec l’association : « Femmes solidaires ». Un homme : « Femmes solidaires ou femmes solitaires ? » Une autre femme : « À mon avis, dans : ‘Femmes solidaires’, il y a beaucoup de femmes solitaires. » (Cf. Dialogues)
De l’importance du regard de sa fenêtre sur la validité d’un jugement fortuit…
Femmes (Solidaires) (5) : (23 août) 2017. Sophie Fontanel raconte que, jeune journaliste débutante, elle avait accompagné un journaliste « en majesté », qui connaissant Marguerite Duras [1914-1996] pour l’interviewer. Chez elle, celui-ci l’avait « complètement oubliée » et « n’a parlé qu’à Marguerite Duras. »
- Sophie Fontanel poursuit :
« Elle tout de suite vu... À chaque fois qu’il lui posait une question, elle se tournait vers moi et disait : ‘Je [ne] sais pas… J’ai dit ça ?... ‘Qu’est-ce que t’en penses, toi ?’ Et toutes les questions, toutes les foutues questions, elle les a retournées vers moi.’ C’est un truc que j’ai jamais oublié de ce qu’une femme est capable de faire pour une autre femme. » 2153 (Cf. Hommes. Journalistes)
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. « Sorcières » :
Femmes (« Sorcières ») (1) : 1986. Nonobstant le plaisir qui explique que je puisse écouter sans cesse la si belle chanson d’Anne Sylvestre [1934-2020]
« Une sorcière comme les autres », elle ne justifie pas, pour moi, de cautionner l’emploi de ce terme ; ce qui ne m’empêche pas comprendre comment l’effet politique de rupture que ce terme a pu jouer.
Femmes (« Sorcières ») (2) : 2000. Au lieu et place de « sorcières » penser à la formulation employée par et explicitée par Michèle Le Dœuff, dans Le sexe du savoir :
« Les sorciers, les vieilles femmes et les imposteurs » - qu’elle oppose à « la médecine officielle » à la Renaissance. 2154
-------------
Femmes. Sororité :
Femmes (Sororité) (1) : La « sororité » n’est ni le complément, ni le substitut, ni le contraire de la « fraternité ».
Femmes (Sororité) (2) : Dans les années 19[70], terme trop systématiquement employé, puis trop vite oublié.
Femmes (Sororité) (3) : Aussi ambition, généreux soit « la sororité », il importe, sans le jeter aux orties, de vite en sortir.
Par ordre chronologique. Femmes. Sororité :
Femmes (Sororité) (1) : (2 mars) 1849. Terme employé [pour la première fois ?], à ma connaissance, en 1849, par George Sand [1804-1876], dans une lettre à Eugénie Duvernet [1816-1882]. 2155
Femmes (Sororité) (2) : 2001. Évelyne Bloch-Dano, dans Flora Tristan. Une femme libre, cite une lettre de Flora Tristan [1803-1844] de 1843 à Agricol Perdiguier [1805-1875] - « admiré par George Sand » - qu’elle termine par :
« Je vous serre la main et suis votre sœur en l’humanité. » 2156
Femmes (Sororité) (3) : (15-16 avril) 2018. Rossy de Palma, à la question :
« Croyez-vous en la solidarité des femmes ? », répond :
« Mieux que cela : je crois en la sororité ! J’en vois la force et l’incroyable beauté. Entre les femmes, pas de besoin de masques, d’artifices, de mensonges. On est transparentes. Spirituellement connectées. Et ça donne une merveilleuse liberté. Je me suis toujours méfiée des femmes qui disaient : ‘Je n’ai pas trop de copines, je m’entends mieux avec les mecs.’ Moi, mes copines sont essentielles et viennent à mon secours au bout du monde. Il faut développer ce lien entre femmes. La sororité nous donne des ailes. » 2157 (Cf. Féminismes. Féministes. De Palma Rossy)
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. « Sottes » :
Par ordre chronologique. Femmes. « Sottes ». Stendhal :
Femmes (« Sottes ») (1) : 1830. Stendhal [1783-1842], dans Le rouge et le noir, auteur de :
« Nous ne dissimulerons pas qu’elle [Mme de Rênal] passait pour sotte aux yeux de leurs dames [des notables de Verrières] parce que sans nulle politique à l’égard de son mari, elle laissait échapper les plus belles occasions de se faire acheter de beaux chapeaux de Paris ou de Besançon. […] » 2158 (Cf. Femmes. « Bêtes », Politique)
Femmes (« Sottes ») (2) : 1830. Stendhal [1783-1842], dans Le rouge et le noir, auteur de :
« Vous parlez là comme une sotte que vous êtes s’écria M. de Rênal d’une voix terrible. Quel bon sens peut-on espérer d’une femme ? Jamais vous ne prêtez attention à ce qui est raisonnable ; Comment sauriez-vous quelque chose ? Votre nonchalance, votre paresse ne vous donnent d’activité que pour la chasse aux papillons, êtres faibles et que nous sommes heureux d’avoir dans nos familles !
Mme de Rênal le laissait dire, et il dit longtemps : il passait sa colère, c’était le mot du pays. » 2159 (Cf. Femmes. « Bêtes », Famille, Patriarcat, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
-------------
Femmes (« Sottes ») (3) : 1835. Nicolas Gogol [1809-1852], dans La perspective Nevsky, auteur de :
« Mais il faut dire que la femme de Schiller, tout en étant fort jolie, était très sotte. D’ailleurs la sottise ajoute un charme de plus, à une jolie femme. Je connaissais en effet de nombreux maris qui étaient extrêmement satisfaits de la sottise de leur épouse : il y voyait l’indice d’une sorte d’innocence enfantine. […] » 2160 (Cf. Enfants)
-------------
Femmes. Souffrances :
Femmes (Souffrances) (1) : La souffrance des femmes est si souvent incommensurable. À l’instar de leur force de caractère. Sur ce point, je refuse d’avoir à expliciter cette assertion : à chacun-e de regarder autour de soi et donc de réfléchir.
Femmes (Souffrances) (2) : Comment ne pas penser que les femmes ont infiniment plus souffert des hommes que les hommes n’ont souffert de leur fait, dès lors que l’on admet que leur culture, leur vie, était construite sur la réalisation d’elles-mêmes par les hommes. Et que le poids de la maternité leur incombait ?
Par ordre chronologique. Femmes. Souffrances :
Femmes (Souffrances) (1) : Évoquer sa souffrance à celui qui en est la cause, est-ce le conforter dans son pouvoir de la prolonger ? On peut, pour mieux y réfléchir, penser à cette phrase de Julie de Lespinasse [1732-1776] :
« Il y a de la bassesse à vouloir être plainte et soulagée par celui qui vient de vous frapper. » 2161 (Cf. Femmes. Remarquables. Lespinasse Julie de, Relations entre êtres humains. Plainte, Patriarcat, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
Femmes (Souffrances) (2) : Germaine de Staël [1766-1817], auteure de :
« Les femmes ont tant souffert qu’elles s’entendent toujours à la douleur et la peignent avec vérité. » 2162 (Cf. Culture. Gide : ‘On ne fait pas de bonne littérature avec de bons sentiments’)
-------------
Femmes (Statut) : (15 octobre) 2019. Entendu évoquer « le sous-statut des femmes en pays musulmans ».
Encore une formulation qui fige les normes et interdit de les penser... (Cf. Droit. Musulman, Hommes. Musulmans, Patriarcat, Politique, Religion. Islam)
Femmes (Stendhal) : Stendhal [1783-1842], auteur de :
- « Les femmes aiment les amants qui les battent. » ;
- « Ce n’est pas dans ma nature d’être aimable pour les femmes » ;
- « Je n’ai nulle sensibilité à ce qui fait le plaisir des autres. »
- Quelle signification alors accorder à cette phrase :
« Il n’y a que les femmes à grand caractère qui puissent faire mon bonheur. » ? 2163 (Cf. Hommes. Remarquables, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
Femmes (S.T.O) [Service du Travail Obligatoire] : (4 septembre) 1942. Je découvre que, contrairement à ce que je pensais, le S.T.O concernait aussi les femmes.
Le décret du 4 septembre 1942 stipulait en effet que :
« Tous les hommes âgés de 18 à 52 ans et les femmes célibataires âgées de 21 à 35 ans étaient mobilisables pour effectuer tous les travaux que le gouvernement [de Vichy] jugera utiles dans l’intérêt supérieur de la nation (c’est à dire des Allemands). » 2164
Qu’en fut-il ? Je ne sais. (Cf. Femmes. Utiles)
Femmes (« Supérieures ») : 1727. Marivaux [1688-1723], dans La vie de Marianne, auteur de :
« Pour moi, je me revenais toute émue de ma petite expédition, mais je dis agréablement émue : cette dignité de sentiments que je venais de montrer à mon infidèle, cette honte et cette humiliation que je laissais dans son coeur, cet étonnement où il devait être de la noblesse de mon procédé, enfin cette supériorité que mon âme venait de prendre sur la sienne, supériorité plus attendrissante que fâcheuse, plus aimable que superbe, tout cela me remuait intérieurement d’un sentiment doux et flatteur ; je me trouvais trop respectable pour n’être pas regrettée. » 2165
Par ordre chronologique. Femmes. Symboles :
Femmes (Symboles) (1) : 1941. Dans ses Mémoires, Charles de Gaulle [1890-1970], emploie à deux reprises l’expression de « notre dame la France ». 2166
Un autre symbole de femme, ici fortement teinté de religion chrétienne…
Femmes (Symboles) (2) : 1959. Voici, dans ses Mémoires de Guerre, comment Charles de Gaulle [1890-1970] présente l’Allemagne hitlérisée, nazifiée comme une femme amoureuse, séduite - qui se donne mais à un homme qui s’était préalablement offert - soumise … et vaincue :
« Cet homme [Adolf Hitler. 1889-1945], parti de rien, s’était offert [!] à l’Allemagne au moment où elle éprouvait le désir d’un amant nouveau. Lasse de l’empereur tombé, des généraux vaincus, des politiciens dérisoires, elle s’était donnée [!] au passant inconnu qui représentait l’aventure, promettait la domination et dont la voix passionnée remuait ses instincts secrets. D’ailleurs, en dépit de la défaite enregistrée naguère à Versailles, la carrière s’ouvrait largement à ce couple entreprenant. […]
Hitler, s’il était fort, ne laissait pas d’être habile. Il savait leurrer et caresser. L’Allemagne, séduite [!] au plus profond d’elle-même, suivit son Führer d’un élan. Jusqu’à la fin, elle lui fut soumise, le servant de plus d’efforts qu’aucun peuple, jamais, n’en offrit à aucun peuple. […] » Et j’ajoute à cette extraordinaire analyse symbolique, cette conclusion :
« L’entreprise d’Hitler fut surhumaine et inhumaine. » 2167 (Cf. Femmes, Hommes, Famille. Couple, Langage. Symbole. Zeugma, Patriarcat, Politique. Démocratie. Peuple, Histoire. Patriarcale)
Femmes (Symboles) (3) : 2017. George Valence, biographe de Raymond Poincaré, [1860-1934], le concernant, auteur de :
« Poincaré a aimé la France comme une femme. » 2168 (Cf. Langage. Symbole. Zeugma, Patriarcat, Politique. Guerre)
-------------
Femmes (Syndicalistes) : 1977. Jeannette Laot, conseillère de François Mitterrand [1916-1996] - de 1981 à 1986, dans Stratégie pour les femmes, évoquant son passé de femme syndicaliste, écrit :
« Pour nous, le plus pénible était que les militants s’appuyaient sur les arguments de leur femme pour nous contredire. Certains auraient même voulu qu’elles viennent donner leur point de vue à la commission féminine, ce qui est très significatif : sur les problèmes des femmes, ils estimaient que l’avis individuel de leur épouse valait bien celui des responsables syndicales élues par les travailleurs et les travailleuses pour défendre leurs intérêts collectifs… » 2169 (Cf. Femmes. « Féminin ». Travail)
Femmes (Syphilis) : 1905. 2000. Jean-Marie Déguignet [1834-190], dans ses Mémoires d’un paysan Bas-Breton, soldat, à l’hôpital militaire, concernant « la salle militaire » où il se trouve, écrit :
« La plupart, notamment ces sous-offs, étaient là pour le malé muliérum cupides venusis […]. »
Dans une note du livre datant donc de 2000, à cette expression, on peut lire : « Male milieu cupides venusis : c’est un mal qui vient des femmes lorsque l’on est trop avide de Vénus. » 2170 (Cf. Sexes. Syphilis)
Femmes (Tabliers) : Il est des femmes sans tabliers comme des ministres sans portefeuilles.
Par ordre chronologique. Femmes. Tact :
Femmes (Tact) (1) : 1837-1843. Honoré de Balzac [1799-1850], dans les Illusions perdues, auteur de :
« Ève avec le tact particulier aux femmes, eut bientôt deviné les deux frères. » 2171
Femmes (Tact) (2) : 1877. Léon Tolstoï [1828-1910], dans Anna Karénine, employa l’expression de « tact de femme ». 2172
-------------
Femmes (« Taxi girls ») : (21 juillet) 2024. Entendu, sur France Culture [1ère diffusion. 21 mars 1995] dans l’émission : « L’album indochinois. Quand les français se souviennent du Tonkin » un colon :
« Les taxis girls - dans « les boîtes de nuit » ouvertes par la colonisation - étaient des filles - pas des prostituées attention ! - que l’on louait pour une danse, avec des tickets. » (Cf. Femmes. Location, Proxénétisme. Femmes-dites-prostituées, Économie)
Par ordre chronologique. Femmes. Tempérament. Émile Zola :
Femmes (Tempérament) (1) : 1871. Émile Zola [1840-1902], dans La fortune des Rougon, auteur de :
- « Elle [Adélaïde] semblait vouloir s’afficher, chercher méchamment à ce que tout, chez elle, allât de mal en pis, lorsqu’elle obéissait avec une grande naïveté aux seules poussées de son tempérament. »
- « […] Seulement, la pauvre petite [Ursule], née la seconde, à l’heure où les tendresses d’Adélaïde dominaient l’amour déjà plus calme de Macquart, semblait avoir reçu de son sexe l’empreinte plus profonde du tempérament de sa mère. » 2173
N.B.1. En note, référence au livre du docteur Posper Lucas [1808-1885], L’hérédité naturelle [1847-1850].
N.B.2. « Tempérament » : « Constitution physiologique de l'individu et traits de caractère résultant de cette constitution ; Avoir du tempérament ; avoir des appétits sexuels. » (Cf. Corps. Chair, Sexes. Femmes)
Femmes (Tempérament) (2) : 1882. Émile Zola [1840-1902], dans Pot-bouille, auteur de :
« Ils étaient restés quelques minutes à échanger des politesses. Enfin, il espérait, la fois prochaine, pénétrer dans l’appartement. Le reste allait tout seul, avec une femme d’un tempérament pareil. » 2174
-------------
Femmes (« Terrain ») : (23 novembre) 2020. Élisabeth Badinter, sur France Culture, auteure de :
« L’Islam politique gagne du terrain et notamment celui des femmes. » (Cf. Langage, Patriarcat, Politique. Religion)
Femmes (« Thés de femmes ») : 1952. Doris Lessing [1919-2013], dans Les enfants de la violence, concernant la Rhodésie coloniale, décrit les « les thés de femmes » comme « des orgies quotidiennes de lamentations partagées ». 2175
Femmes (« Tire-bottes ») : 1844. William Makepeace Thackeray [1811-1863], dans Barry Lyndon, auteur de :
« […] Elles aiment cela, monsieur, les femmes. Elles sont nées pour notre plus grande consolation, pour notre plus grande commodité ; elles sont… elles sont, moralement parlant, nos tire-bottes ; et pour des hommes de notre genre de vie, croyez-moi, une personne de cette espèce serait inappréciable. » 2176
Femmes (Tocqueville Alexis de) : 1835. Alexis de Tocqueville [1805-1859], dans De la démocratie en Amérique [Tome II. p.292], auteur de :
« […] De là vient que les Américaines restent toujours des femmes. […] » 2177
Femmes (« Tombées ») : Dans l’attirance de certains hommes pour les « femmes tombées », peut entrer en ligne de compte le fait que, par le statut social qu’ils étaient à même de leur conférer, ils pouvaient aisément se rehausser à leurs propre yeux…Du moins, un temps… (Cf. Femmes « Perdues », Langage. Verbe. Tomber)
* Ajout. 20 janvier 2018. La loi de la chute des corps a en sus l’avantage de ne pas avoir à être explicitée. Nul besoin de chercher des causes, des analyses, des responsables, des réparations…
Femmes. « Tondues » à la Libération :
Femmes (« Tondues » à la Libération) (1) : Le jour où plus aucune analyse ne pourra dissocier les violences dont elles ont été les victimes et celles des hommes, français et allemands, avec lesquelles elles ont été (ou non) en relation - un pan du patriarcat sera tombé.
Femmes (« Tondues » à la Libération) (2) : Combien de viols, de violences sexuelles, de tortures à l’encontre des femmes ont-ils/elles été masqué-es et donc occulté-es, cautionné-es par la focalisation quasi exclusive sous la formulation de : « femmes tondues » ?
Femmes (« Tondues » à la Libération) (3) : Et que dire de cette monstrueuses expression elle-même ? On ne « tond » en effet que les moutons.
Femmes (« Tondues » à la Libération) (4) : Combien de ces femmes étaient-elles [considérées comme] des femmes-dites-prostituées, enfermées dans des bordels ? Signifiant silence. (Cf. Proxénétisme)
Par ordre chronologique. Femmes. « Tondues » à la Libération :
Femmes (« Tondues » à la Libération) (1) : 1944. Cf. le poème de Paul Éluard [1895-1952] intitulé « Comprenne qui voudra » dont l’exergue était :
« En ce temps-là, pour ne pas châtier les coupables, on maltraitait les filles. On allait même jusqu’à les tondre. » 2178 (Cf. Patriarcat. Éluard Paul)
Femmes (« Tondues » à la Libération) (2) : (25 août) 1944. Paul Léautaud [1872-1956] cite dans son Journal littéraire les propos de « sa crémière » qui lui rapporte ce qu’elle venait de voir à Fontenay [aux roses] :
« Ce sont quelques femmes qui ont dénoncé des gens aux Allemands. On les connaissait. Quelques-unes aussi qui ont eu des relations, vous comprenez ? Avec eux. On a été les prendre chez elles. Aujourd’hui, place de la mairie, en public, on leur a tondu la tête, et marqué à la peinture, une croix gammée sur le front, ou sur les joues. Un vrai spectacle. Vous jugez si les gens rigolaient. » 2179
Femmes (« Tondues » à la Libération) (3) : (26 août) 1944. Michel Leiris [1901-1990], écrit dans son Journal :
« C’est un peu ou avant ce déjeuner [chez « les Salacrou »] que nous avons vu du balcon, une femme qu’on promenait, tondue et sans souliers, quai des Grands-Augustins. Des insurgés en armes l’entouraient, la raillant, mais sans la bousculer ; sans arrêt, la femme remuait la tête de gauche à droite et de droite à gauche, comme pour dire non, avec un air obsédé. (Spectacle presque aussi pénible que celui des premières étoiles jaunes, du temps de l’occupation allemande ; il en paraissait, en tout cas, comme une espèce de réplique.) » 2180
Femmes (« Tondues » à la Libération) (4) : 1945. Je lis dans Un promeneur dans un Paris Insurgé de Jean-Paul Sartre [1905-1980], sous la présentation : « Ce qu’il ne faut pas faire » :
« C’est vers le bas du boulevard Saint Michel que j’ai rencontré le triste cortège. La femme avait environ cinquante ans, on ne l’avait pas tout à fait tondue. Quelques mèches pendaient autour de son visage boursouflé ; elle était sans souliers, une jambe recouverte d’un bas et l’autre nue ; elle marchait lentement, elle secouait la tête de droite à gauche, en répétant très bas : ‘Non, non, non !’
Autour d’elle quelques femmes jeunes et jolies chantaient et riaient très fort, mais il m’a semblé que les visages des hommes qui l’escortaient étaient sans gaité : une espèce de fatigue honteuse pesait sur eux.
La victime était-elle coupable ? L’était-elle plus que ceux qui l’avaient dénoncée, que ceux qui l’insultaient ?
Eût-elle été criminelle, ce sadisme moyenâgeux n’en eût pas moins mérité le dégoût. Et, sans doute, la foule ne mesurait pas tout à fait la cruauté de pareils actes (plusieurs tondues se sont tuées, celle que j’ai vu paraissait folle) ; mais il est regrettable qu’elle ait choisi souvent d’exprimer sa joie et son zèle patriotique en assouvissant étourdiment de basses vengeances. » 2181
« Étourdiment » ? « Vengeance » ? (Cf. Corps. Visage, Langage. Patriarcal. Patriarcat, Histoire, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
Femmes (« Tondues » à la Libération) (5) : 1945. Lu, sous la plume d’une femme qui signe de son prénom, Charlotte :
« À la Libération, les beaux résistants de la 25ème heure, ceux qui ne s’étaient jamais manifestés pendant quatre ans, sont venues arrêter les deux grandes sœurs de mon amie qui était alsacienne et qui habitait dans la même cité ouvrière que nous. Ses sœurs avaient des cousins alsaciens qui avaient été enrôlés de force dans l’armée allemande et qui étaient venus les voir plusieurs fois pendant la guerre. […]
Elles devaient avoir entre dix-huit et vingt ans… Ils les ont traînées jusqu’à Épinay sur Seine sur la place de l’Église ; ils les ont fait monter sur une estrade, leur ont rasé la tête, leur ont dessiné des croix gammées sur le corps et les ont fait défiler. » 2182
Femmes (« Tondues » à la Libération) (6) : 1945. Jean Rochefort [1930-2017] se souvient de la Libération, - il avait alors 15 ans - à Nantes :
« L’horreur, l’horreur de ces gens qui se vengeaient sur les femmes, sur les faibles, avec une violence absolument atroce. Et, en général, c’étaient ceux qui avaient besoin de devenir héros en 48 heures. Lapider des jeunes femmes de 16 ans, et les tuer à coups de cailloux et uriner ensuite sur leurs cadavres. Porter un nourrisson par la jambe, comme un poulet, et le montrer à la foule qui hurle ; derrière la femme est nue, enchaînée, et couverte de crachats. […] Je me suis fait une idée de l’espèce à laquelle j’appartenais. Terrifiante… Moi-même, parce que je ne veux pas passer pour un héros […]. » 2183 (Cf. Êtres humains. « Espèce », Corps. Cadavres, Hommes. « Héros »)
Femmes (« Tondues » à la Libération) (7) : 1973. Georgette Elgey [1919-2029] dans La fenêtre ouverte, auteure de :
« Un choc : sur la place de l’Église, un attroupement. Je vais voir, une femme, d’un village voisin, agenouillée, tondue. Elle aurait ‘collaboré’, partagé la couche d’un Allemand. On jette des pierres. Je suis horrifiée. Le curé intervient. Je m’éloigne. Au bout d’une heure, la femme a été emmenée. J’ai haï cette scène. Elle a, un temps, gâché mon bonheur. » 2184
Femmes (« Tondues » à la Libération) (8) : (19 décembre) 2021. Sur France Culture, Charles Dantzig, responsable de l’émission Personnages en personne, évoquant le rôle joué par Josiane Balasko, « une punaise qui couche avec un allemand », dans le film Papy fait de la résistance [1983] affirme que « l’on n’espère qu’une chose, c’est qu’elle soit tondue à Libération. » Rire de Xavier Mauduit, « historien ». 2185 (Cf. Culture. Cinéma, Femmes. Animalisation des femmes)
-------------
Femmes (Traitées de « putes ») : Une femme, n’importe laquelle, peut toujours être traitée de, considérée comme une « pute » ; un homme n’est pas - assurément, pas à l’équivalent de signifiant - traité de « micheton », ni de « proxo » ni de « gigolo », ni de « client ». « Fils ou fille de pute » en revanche est la norme. Connu, mais peut être rappelé. (Cf. Proxénétisme. Personnes-dites-prostituées)
Femmes (Traitées grossièrement) : 1897. Léon Bloy [1846-1917], dans La femme pauvre, auteur de :
« La vieille » (p.29), « la vieille poison » (p.30), « la bougresse de fille » (p.30), « une salope » (p.30), « la doucereuse mégère » (p.30), « un soupir de colombe sépulcrale » (p.32), « la sacrée garce » (p.31), « l’orgueil imbécile des femmes » (p.33), « la gueuse minaudière » (p.33), « cet ‘os surnuméraire’, suivant l’expression de Bossuet » (p.34), « ses hauteurs de chipie » (p.34), « la quinquagénaire faisandée » (p.34), « cette sacrilège farceuse » (p.37), « l’odieuse créature » (p.37), « le repoussoir angélique [de sa mère] » (p.38), « la papelarde sinistre » (p.40), « de la chair à palette » (p.41), « comme toute vraie guenon bourgeoise » (p.44), « l’horrible vieille » (p.45), « des filles crapuleuses » (p.51), « les traînées » (p.61) …
N.B. Je lis dans la présentation du live par Babelio : « Ce roman se distingue par sa stupéfiante splendeur verbale. »
Femmes. Travail :
Femmes (Travail (1) : (Souvenir d’enfance) : Lorsque le fil mis dans le chat de l’aiguille était jugé trop long, on appelait cela des « aiguillées de paresseuses ». Présenté, sous ce terme - lu sur internet - comme un « ralentissant le rythme de la couture », en réalité, cela diminuait la nécessité d’avoir à renfiler l’aiguille. Une économie de temps.
Par ordre chronologique. Femmes. Travail :
Femmes (Travail) (1) : 1837-1843. Honoré de Balzac [1799-1850], dans les Illusions perdues, auteur de :
« David s’amouracha de la grosse Marion, en découvrant chez elle toutes les qualités qu’un homme de sa classe demande à une femme : cette santé vigoureuse qui brunit les joues, cette force masculine qui permettait à Marion de soulever une forme de caractères avec aisance, cette probité religieuse à laquelle tiennent les Alsaciens, ce dévouement à ses maîtres qui révèle un bon caractère, et enfin, cette économie à laquelle elle devait une petite somme de 1000 francs, du linge, des robes et des effets de propreté provinciale. » 2186
Femmes (Travail) (2) : 1840. Louis-René Villermé [1782-1863], dans Tableau de l’état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton de laine et de soie, auteur de :
« Les manufactures de soie ne présentent des causes d’insalubrité que dans les opérations du cardage de la filoselle et du tirage des cocons.
Les pauvres femmes qui, assises toute la journée, dans la saison des fortes chaleurs, auprès d’un fourneau et d’une bassine d’eau bouillante, tirent la soie des cocons au milieu des émanations infectes de la chrysalide, et les tourneuses encore plus misérables, qui les aident en faisant marcher à bras leurs dévidoirs, devaient être regardées par les médecins comme placées sous l’influence dangereuse, quoique momentanée, de leur profession. Aussi faut-il lire dans le meilleur ouvrage, je crois, où l’on ait traité du sujet la liste effrayante des toutes les maladies auxquelles on assure que ces ouvrières sont plus spécialement exposées. »
Et en note, je lis : « Je demande la permission de la copier ici presque textuellement. Ce sont, pour les femmes qui tirent la soie des cocons, les fièvres putrides, les catarrhes, les congestions humorales dans les organes de la respiration, une espèce de bouffissure du visage, les clous, les panaris, des tumeurs qui approchent de l’anthrax ; et, pour les tourneuses de leurs dévidoirs, les mêmes maladies et en outre, le vomissement, les tournoiements de tête, le crachement de sang, les enflures des jambes et des pieds, les douleurs dans les bras et les articulations. […] » 2187 (Cf. Femmes. Assises. Économie. « Pauvres Les »)
Femmes (Travail) (3) : 1859. En 1859, George Sand [1804-1876] était payée par Hachette et Michel Lévy, ses éditeurs, 30 centimes (par ?) alors que Prosper Mérimée et Octave Feuillet recevaient 50 centimes. 2188
Femmes (Travail) (4) : 1862. Victor Hugo [1802-1885], dans Les misérables, auteur de :
« (Champmathieu, à son procès) […] Avec ça, j’avais ma fille qui était blanchisseuse à la rivière. Elle gagnait un peu de son côté. Á nous deux, cela allait. Elle avait de la peine aussi. Toute la journée dans un baquet jusqu’à mi-corps, à la pluie, à la neige, avec le vent qui vous coupe la figure ; quand il gèle, c’est tout de même, il faut laver. […] Les planches sont mal jointes et il vous tombe des gouttes d’eau partout. On a ses jupes toutes mouillées, dessus et dessous. Ça pénètre. Elle a aussi travaillé au lavoir des Enfants Rouges, où l’eau arrivait par des robinets. […] Comme c’est fermé on a moins froid au corps. Mais il y a une buée d’eau chaude qui est terrible et qui vous perd les yeux. […] » 2189 (Cf. Corps. Femmes)
Femmes (Travail) (5) : 1871. J’ai relevé, dans le Petit dictionnaire des femmes de la Commune. Les oubliées de l’histoire, lorsque précisés, les métiers, professions des femmes : blanchisseuse (14), cardeuse de matelas, confectionneuse (3), femme de ménage, négociante, marchande de fritures, couturière (3), marchande des quatre-saisons, polisseuse, marchande de chaussures, nourrice puis cuisinière, polisseuse en or, régleuse, chanteuse populaire, culottière (2), fabricante de bijoux, marchande de vins, limonadière, passementière (5), concierge (8), marchande de légumes, journalière puis servante d’auberge, mercière, giletière (4), garde-malade, actrice, fabricante de casquettes, couturière (20), ouvrière mécanicienne (2), brossière, institutrice (4), cartonnière, libraire, piqueuse, tireuse de cartes, balayeuse municipale, ouvrière plumassière, relieuse, domestique, lingère (6), cartonnière, fruitière, ouvrière (2), ouvre un débit de café et de boissons, confectionneuse pour dame, fleuriste, cuisinière (2), tient un petit café, artiste lyrique (3), tailleuse d’habits, boutonnière, couturière en ombrelles, journalière (7), blanchisseuse au lavoir, chaussonière, apprêteuse de neuf, crémière, ouvrière en couture, cuisinière puis vends des journaux, chiffonnière (2), repasseuse, ouvrière en boutons, ravaudeuse de bas, sage-femme, accusée de vivre de la prostitution, professeur de modelage, fabricante d’images, couturière à la mécanique, apprentie couturière, porteuse de pain, piqueuse de bottines (2), ouvrière giletière, logeuse et marchande de vins, tient un débit de vins, figure comme ‘voleuse, receleuse’, chamareuse, fabricante de parapluies, ouvrière de fabrique, cartonnière, chemisière, coiffeuse, chapelière, tient un débit de vins avec son mari, ouvrière en jouets, cuisinière en maison bourgeoise, brodeuse d’étoffes… 2190 (Cf. Langage. Féminisation du langage)
Par ordre chronologique. Femmes. Travail. Émile Zola :
Femmes (Travail) (6) : 1886. Émile Zola [1840-1902], dans L’œuvre, auteur de :
« La misère […] s’abattit […]. Christine, qui voulut chercher du travail, ne savait rien faire, pas même coudre : elle se désolait, les mains inertes, s’irritait contre son éducation imbécile de demoiselle, qui lui laissait la seule ressource de se placer un jour domestique, si leur vie continuait de se gâter. » 2191 (Cf. Enfants. Filles, Corps. Mains, Femmes. Domestiques)
Femmes (Travail) (7) : 1887. Émile Zola [1840-1902], dans La terre, auteur de :
« La mère, assise près de la table […] tricotait de ses mains machinales. »
- « Les femmes, autour de l’unique chandelle, tricotaient, filaient, travaillaient à des ouvrages qu’elles ne regardaient même pas. »
- « […] Les doigts rapides des femmes, activant les aiguilles rapides de leur tricot, semblaient faire courir des pattes d’araignées géantes, au milieu de tout ce noir. »
- « Les femmes, pliées sur leurs aiguilles […] » 2192 (Cf. Corps. Doigts. Dos, Mains. Yeux, Femmes. Aiguilles. Animalisation des femmes. Tricot)
Femmes (Travail) (8) : 1887. Émile Zola [1840-1902], dans La terre, auteur de :
« La misérable [Palmyre] soulevait trois, quatre javelles, tant que ses bras maigres pouvaient en contenir, puis avec un lien tout prêt, elle nouait sa gerbe fortement. Ce liage, cette besogne si dure que les hommes d’habitude se réservent, l’épuisait, la poitrine écrasée des continuelles charges, les bras cassés d’avoir à étreindre de telles masses et de tirer sur les liens de paille. Elle avait apporté le matin une bouteille, qu’elle allait remplir, d’heure en heure, à une mare voisine, croupie et empestée, buvant goulument, malgré la diarrhée qui l’achevait depuis les chaleurs, dans le délabrement de son continuel excès de travail. » 2193 (Cf. Corps. Femmes. Patriarcat. Division sexuelle du travail)
N.B. « Javelle » : « Brassées de céréales, coupées et non liées, qu’on laisse sur le sillon avant de les mettre en gerbe. »
-------------
Femmes (Travail) (9) : 1887. Anton Tchékhov [1860-1904], dans La vieille maison, auteur de :
« Seule, de tout l’appartement, la vieille femme n’a pas perdu courage. Elle s’est souvenue de l’ancien temps et fait les gros travaux. Le vendredi elle lave le plancher chez les juifs du Mont-de-piété, le samedi elle va faire la lessive des marchands et le dimanche, du matin au soir, elle court la ville en quête de bienfaitrices. Tous les jours elle a du travail. Elle fait du blanchissage, lave les parquets, garde des bébés, marie les gens, mendie. […] En Russie, il y a beaucoup de robustes vieilles comme ça, et que de bien-être repose sur elles ! » 2194 (Cf. Femmes. Âgées. Maison)
Femmes (Travail) (10) : (28 mars) 1889. Léon Tolstoï [1828-1910] écrit dans son Journal :
« 3.000 femmes, qui se lèvent à 4 et quittent le travail à 8, et qui se débauchent, et qui abrègent leur vie, et qui mutilent leur progéniture, vivent misérables (parmi les tentations) [!], dans cette usine pour qu’un calicot dont nul n’a besoin revienne à bon marché, et pour que Knop ait encore plus d’argent, alors que sa préoccupation est de ne pas savoir que faire de celui qu’il a déjà. » 2195 (Cf. Économie. Argent. Capitalisme. Morale)
Femmes (Travail) (11) : (8 décembre) 1895. Jules Renard [1864-1910], dans son Journal, auteur de :
« La mère François va tous les jours à Corbigny. Elle se lève à quatre heures, fait cuire son petit café et part un quart d’heure avant les autres, parce qu’elle marche moins vite. Elle rentre à huit heures du soir. Elle gagne ses quinze sous par jour. » 2196
Femmes (Travail) (12) : (4 janvier-8 avril) 1912. Franz Kafka [1883-1924], dans le Cinquième cahier de son Journal, auteur de :
« Hier à la fabrique. Les filles dans leurs robes dénouées d’une saleté en soi insoutenable, les cheveux hirsutes comme au saut du lit, le visage figé par le bruit incessant des transmissions et par leur machine certes automatique mais qui se bloque inopinément, ne sont pas des êtres humains, on ne leur dit pas bonjour, on ne s’excuse pas quand on les bouscule, dès qu’on les appelle pour un petit travail, elles l’effectuent et retournent aussitôt à leur machine, on leur montre d’un signe de tête l‘endroit où elles doivent intervenir, et elles restent là, en jupon, à la merci du moindre pouvoir, sans même avoir assez de bon sens, pour reconnaître placidement ce pouvoir d’un regard ou d’une courbette et se le concilier. Mais il est six heures, elles se le crient, dénouent les foulards qu’elles ont autour du cou et sur les cheveux, s’époussettent à l’aide d’une brosse qui fait le tour de la salle, réclamé par des impatientes, passent leurs jupes au-dessus de leur tête et se décrassent les mains tant bien que mal, car après tout ce sont quand même des femmes, elles arrivent à sourire malgré leur pâleur et leurs mauvaises dents, secouent leur corps engourdi, on ne peut plus les bousculer, les regarder, ni les ignorer, on se fait tout petit contre les caisses poisseuses pour leur céder le passage, on garde son chapeau à la main quand elles vous disent bonsoir, et on ne sait pas comment le prendre, quand l’une d’elle nous présente notre gros manteau pour que nous l’enfilions. »
En note : « Dans les ateliers de l’époque, l’énergie, produite par une source qui n’est pas toujours électrique, est transmise aux différentes machines par un réseau de courroies et de poulies extrêmement bruyant. » 2197 (Êtres humains. Vêtements, Corps. Dents. Visage, Économie. Capitalisme)
Par ordre chronologique. Femmes. Travail. André Gide :
Femmes (Travail) (13) : (9 juillet) 1923. Lu dans le Journal d’André Gide [1869-1951] : alors qu’il « félicite Édouard Champion [1882-1938] sur l’excellent déjeuner qu’il [nous] avait servi l’autre jour », ce dernier lui répond :
« Il est vrai que notre cuisinière n’est pas mauvaise. Pendant longtemps nous avons eu un chef ; mais vraiment il ne cuisinait pas mieux ; et avec cette femme, c’est mille francs d’économie par mois. » 2198 (Économie. Argent. Salaires)
Femmes (Travail) (14) : 1925. André Gide [1869-1951], dans son Voyage au Congo, écrit :
- le 29 octobre 1925, qu’il « rencontre un groupe de femmes en train de travailler à la réfection de la route. » Et il poursuit :
« Ce pauvre bétail ruisselait sous l’averse. Nombre d’entre elles allaitaient tout en travaillant. Tous les vingt mètres environ, aux côtés de la route, un vaste trou, profond de trois mètres le plus souvent ; c’est là que, sans outils appropriés, ces misérables travailleuses avaient extrait la terre sablonneuse pour les remblais. Il était arrivé plus d’une fois que le sol sans consistance s’effondrât, ensevelissant les femmes et les enfants qui travaillent au fond du trou. Ceci nous fut redit par plusieurs.
Travaillant le plus souvent trop loin de leur village pour pouvoir y retourner le soir, ces femmes se sont construites dans la forêt des huttes provisoires, perméables abris de branches et de roseaux. Nous avons appris que le milicien qui les surveille les avaient fait travailler toute la nuit pour réparer les dégâts d’un récent orage et permettre notre passage. »
[En note : « Cette route, qui fut particulièrement difficile à établir (en raison de la nature du sol) et meurtrière, ne sert exclusivement qu’à l’auto qui mène une fois par mois au marché de Bambiol, M. M. représentant de la Forestière [CFSO. Compagnie Forestière. Samba-Oubangui] accompagné de l’administrateur Pacha. »
Gide recopie et reproduit « un rapport officiel » qui précise :
« Ce travail, considéré comme prestation, n’est pas payé et ces travailleuses ne sont pas nourries. »
- le 12 novembre 1925 : « Nous constatons que les quatre nouveaux porteurs sont des femmes, tous les hommes valides, nous dit le garde, s’étant esquivés dans la brousse au dernier moment pour échapper à la réquisition. Ce qui ajoute à notre indignation (sic), c’est que les charges laissées aux femmes par nos autres porteurs sont de beaucoup les plus lourdes. Souvent les types les plus costauds s’emparent ainsi des charges légères et partent vite de l’avant, pour éviter le contrôle. Nous donnons à chaque femme un billet de cents sous, espérant pas notre générosité provoquer le regret des hommes (re-sic) - espoir bien vain, car, sitôt le retour dans leur village, les femmes remettront aux hommes ces billets. » 2199 (Cf. Femmes. Animalisation des femmes. « Bonnes-à-tout faire », Patriarcat. Colonialisme, Division sexuelle du travail, Politique. Colonialisme)
Femmes (Travail) (15) : (9 mai) 1927. André Gide [1869-1951], écrit, de Zurich, dans son Journal :
« Ma logeuse - femme de 36 ans environ - travaille de 8 heures du matin à minuit (Elle doit même arriver dès 7 h 1/2 si elle veut bénéficier du breakfast des domestiques). Un jour de repos par semaine (la loi l’exige, parait-il, mais par contre un autre jour, elle travaille de 4 heures du matin à minuit (dans quelques jours, pour une semaine ses heures seront de 4 h 1/2 à 9.)
Deux heures de repos par jour, qu’elle occupe à faire les chambres (son logis est à 10 minutes de la station). Et une demi-heure dans le courant de la journée pour souffler, s’asseoir, se laver.
Elle fait ce métier depuis cinq ans, mais déclare qu’elle n’en peut plus. Pourtant elle compte continuer encore jusqu’au printemps prochain - si elle ne tombe pas malade.
Les employés de restaurant ne sont pas payés, mais avec les ‘bonnes-mains’ [pourboire] se font d’assez jolies journées.
Ajoutons à ce travail de cette pauvre excellente femme, le blanchissage du linge - du sien et de celui de son fils de 19 ans, apprenti pâtissier à Genève, qui ne gagne encore que 100 francs par mois.
Je n’ai inscrit ici aucun chiffre dont elle ne m’ait certifié l’exactitude - et que j’ai pu contrôler, car chaque nuit, je l’entends rentrer à minuit et quart - et partir vers 7 h ¼ du matin.
J’ai proposé de faire mon lit, mais j’ai vu que cela la désobligeait, et qu’elle trouve certain contentement à nettoyer et ranger elle-même les quatre pièces dont elle dispose.
J’apprends par le Dr Fischer qui occupait avant moi ces deux chambres et avec qui j’ai dîné à Lucerne hier soir - qu’elle avait épousé, par pitié, un aveugle. Cet homme peu honnête lui avait caché qu’il était criblé de dettes, et les huissiers, par saisies successives, lui avaient pris tous les meubles de se première installation. À la suite de quoi, elle avait divorcé.
On n’imagine pas de créature plus douce plus obligeante, plus patiente, plus sereinement résignée ? ‘Il le faut bien’. C’est tout ce qu’elle trouve à dire quand elle parle de sa servitude. » 2200
-------------
Femmes (Travail) (16) : 1924. Clara Malraux [1897-1982], dans Nos vingt ans [2006] se souvient dans le port de Saïgon colonial, du regard qu’elle portait du bateau qui, après sa grève de la faim, la ramène en France :
« Je me suis trainée sur le pont, j’ai regardé les femmes qui, dans des couffins placés sur leurs têtes, transportent le charbon. Elles montent en file sur une planche inclinée, déversent leur charge à l’intérieur du transatlantique, puis redescendent, choéphores allégées qui reviendront quelques minutes plus tard, alourdies, mais, toujours avec les gestes étroits que commandent la tunique collante. Je suis l’une de ces femmes qui montent puis redescendent, épuisées, tout en maintenant droite la tête sur laquelle repose la justification de leur effort […]. » 2201 (Cf. Patriarcat. Colonialisme. Division sexuelle du travail, Politique. Colonialisme)
Femmes (Travail) (17) : (30 juin) 1928. Dans son Journal littéraire, Paul Léautaud [1872-1956], alors employé au Mercure de France, rapporte l’évènement suivant. Le petit commis Paulo, « qui s’occupe des abonnements » ce qui implique notamment le « maniement de la machine à adresse, un vrai travail de manœuvre », annonce au directeur, Alfred Valette [1858-1935] qu’il quitte Le Mercure. Il était payé 835 francs par mois ; on lui propose un autre emploi payé 1000, puis ensuite 1200 francs. Réaction d’Alfred Valette :
« Un ‘employé’ voudrait-il faire [ce travail] ? Valette pense alors à remplacer Paulo par une femme et à prendre un gamin pour la machine à adresses. ‘Le moins d’argent possible, surtout ! c’est là son principal objectif. » 2202 (Cf. Économie. Argent, Patriarcat. Division sexuelle du travail)
Femmes (Travail) (18) : 1931. Louis Roubaud [1884-1941], dans La prison de velours, rapporte ses souvenirs, notamment de « client », 2203 à Fort de France (Martinique) :
« J’avais, avec quelque étonnement, constaté cette abondance (« de femmes ») dès l’entrée du port, lorsque trois ou quatre cents filles noires, le torse nu, les seins nus, s’étaient accrochées au flan du Sinnamary (nom du bateau), pour y jeter dans les soutes un énorme ‘couffin’ de charbon qu’elle tenait en équilibre sur sa tête. Sur la passerelle, au bas de l’échelle de coupée, chacune tendait une baguette, avec un numéro d’ordre, à un contremaître qui pointait le travail et représentait une paie de vingt centimes. Elles se disputaient pour aller plus vite et gagner plus de sous. Parfois, l’une d’elles, épuisée, s’écroulait sur les planches, laissant échapper sa charge. Les suivantes s’écartaient à peine pour ne pas le piétiner. Sauf quelques vieilles très maigres, les petites charbonnières maritimes de Fort de France sont jeunes, quinze, seize, dix-sept ans.
Lorsqu’elles se sont baignées dans la mer et qu’elles ont remplacé leurs oripeaux en toile de sac par des vêtements propres, elles peuvent encore, la nuit, rôder sur les quais, parmi les débardeurs, pour augmenter leur salaire quotidien. » 2204 (Cf. Êtres humains. Vêtements, Corps. Seins, Patriarcat. Division sexuelle du travail, Colonialisme, Politique. Colonialisme, Proxénétisme, Histoire)
Femmes (Travail) (19) : (8 août) 1938. Lire l’article circonstancié, précis, de Magdeleine Paz [1889-1973], dans Le Populaire concernant le travail des servantes de ferme Polonaises dans l’agriculture en France [5.000 femmes environ de 1921 à 1931]. Elle écrit notamment :
« Là où l’exploitation dépasse toutes les bornes concevables, c’est dans la somme de travail imposé à ces malheureuses. […] Il n’est malheureusement pas rare que la jeune fille soit l’objet des pires violences de la part du patron ou d’hommes travaillant à la ferme. » (Cf. Femmes. Remarquables. Paz Magdeleine. Jeunes filles. Servantes, Violences. Violences à l’encontre des femmes. « Droit de cuissage »)
Femmes (Travail) (20) : 1949. Riz amer [Guiseppe de Santis]. (Cf. Culture. Cinéma)
Femmes (Travail) (21) : 1956. Édith Piaf [1915-1963] chante - Les amants d’un jour - :
« Moi, j’essuie les verres au fond du café.
J’ai bien trop à faire pour pouvoir rêver /
[…] Dans ce décor banal à pleurer. »
Femmes (Travail) (22) : 1960. Je lis dans la Notice de présentation de Polikouchka de Léon Tolstoï [1828-1910], publiée par La Pléiade :
« Le 23 septembre [1862], il [Tolstoï Léon] épouse Sofia Andréievna Bers ; et une des premières collaborations conjugales (sic) qu’il lui demandera sera justement, dès octobre, de recopier Polikouchka [1853] en vue de l’impression. » 2205 (Cf. Femmes. Épouse de. Tolstoï Sophie)
Femmes (Travail) (23) : 1971. Lu dans le long article consacré à la grève à Ugéco à Nantes dans le n°3 de Le torchon brûle, concernant la question de la qualification et de l’âge des femmes ouvrières :
- « Même si une fille a deux CAP de couturière et trois ans d’apprentissage, elle est payée 3.10 F de l’heure, si c’est le salaire de son poste. »
- « Pour le même travail, 2 ouvrières gagneront, l’une 3.06 F, l’autre 4.13 F, simplement parce qu’elles n’ont pas le même âge. » (Mais tout est à lire…) (Cf. Politique. Luttes de femmes)
Femmes (Travail) (24) : (novembre) 1988. Après un interview de Mikhaïl Gorbatchev [1931-2022], Christine Ockrent, à Moscou, note « dans la cour du Kremlin couverte de neige fondue que les femmes poussent leurs balais de chiffon, les pieds enveloppés dans du papier journal. » 2206 (Cf. Femmes. Journalistes. Ockrent Christine)
Femmes (Travail) (25) : 1992. Lu dans Race. Histoires orales d’une obsession américaine de Studs Terkel [1912-2008] :
« Beaucoup de familles noires se sont défaites parce que c’était plus facile pour une femme de trouver du travail. Du coup, elle était en position de force. [Mais] Non seulement elle devait apaiser la fierté de son mari qui souffrait de se retrouver sans travail, mais elle voulait aussi que ses enfants soient fiers, qu’ils soient éduqués, qu’ils réussissent dans la vie. Tout ça était transmis aux filles noires. » 2207 (Cf. Enfants, Famille, Patriarcat)
Femmes (Travail) (26) : 1995. Françoise Baranne, dans Le couloir. Une infirmière au pays du sida, auteure de :
- « […] Pas un instant, ceux qui nous gouvernent dans cet hôpital ne songent, par exemple, à nous proposer de prendre une journée de repos au lendemain de la mort d’un de nos patients. ‘Ce n’est pas vous qui êtes en deuil !‘ a dit la surveillante chez à Geneviève. Si ! Nous le sommes justement, et c’est ce deuil que nous devons apprendre à gérer, puisque personne ne nous l’enseigne. Aucune réunion d’équipe. Nos surveillantes ne jugent pas opportun de nous autoriser à participer, le jeudi matin, au staff des médecins, ce qui nous permettraient de parler des malades, autrement que debout, dans le couloir, entre deux portes. »
- « […] J’ignore comment les autres hôpitaux traitent leurs infirmières du sida, mais, dans le nôtre, nous constatons qu’elles sont corvéables à merci. Soignantes, accompagnatrices, laveuses de parquets, que sais-je encore, nous n’avons droit, pour toutes ces besognes auxquelles les circonstances nous contraignent, à aucun remerciement, à aucune considération, à aucune reconnaissance. »2208 (Cf. Femmes. Sida, Relations entre êtres humains. Remerciements)
Femmes (Travail) (27) : (26 octobre) 2017. Dans un supermarché, avant d’accéder à la caisse, j’entends une femme, qui venait de prendre place dans la queue [une seule personne devant elle : moi] dire, mécontente des caissières :
« Il faut toujours qu’elles discutent ! »
Je n’ai pas réussi à trouver une réaction adéquate.
Ce qui triste, c’est que, sans doute, c’était sa seule occasion de tenter une discussion. (Cf. Relations entre êtres humains)
Femmes (Travail) (28) : 2024. Ekaterina Olitskaïa, dans Le sablier, auteure de :
« (Russie. Années 1930) Le directeur [de Guiz, édition d’État] était un personnage particulièrement odieux.
Il considérait les employés du haut de sa grandeur et ceux-ci n’étaient, devant lui, qu’obséquiosité. Il traitait la femme de service comme sa bonne, la contraignant à le servir aussi bien à l’intérieur de l’établissement qu’à l’extérieur. Il essaya d’établir avec moi un type de relations un peu particulier, et même d’entamer des discussions, mais il comprit rapidement que je n’étais pas la personne qui convenait. » 2209 (Cf. Êtres humains. Frontières. Vie privée / vie publique, Femmes. « Bonnes à tout faire ». Travail-dit-ménager [ou domestique]), Patriarcat, Économie, Salariat. Violences. Violences à l’encontre des femmes)
-------------
Femmes. Travail-dit-ménager [ou domestique]) :
Femmes (Travail-dit-ménager [ou domestique]) (1) : Pour paraphraser le vocabulaire marxiste, ne pourrait-on plutôt le qualifier comme étant « l’appropriation directe par les hommes des produits du surtravail des femmes » ?
Femmes (Travail-dit-ménager [ou domestique]) (2) : Il est facile - logique ? inacceptable ? - dès lors qu’elle avait été enfermée dans son ‘intérieur’ - de lui reprocher de s’y laisser engloutir.
Femmes (Travail-dit-ménager [ou domestique]) (3) : Pourquoi l’expression : « travail de Sisyphe » a-t-elle été si peu employée concernant le travail-dit-ménager ?
Femmes (Travail-dit-ménager [ou domestique]) (4) : De la cuisine ‘au bout du couloir’ à la cuisine au centre de la pièce-à-vivre, on peut lire une évolution essentielle du statut des femmes dans la famille, dans le travail-dit-ménager.
Par ordre chronologique. Femmes. Travail-dit-ménager [ou domestique] :
Femmes (Travail-dit-ménager [ou domestique]) (1) : 1847. Charlotte Brontë [1816-1855], dans Jane Eyre, auteure de :
« On engagea trois auxiliaires ; et l’on se mit à récurer par ici, à brosser par-là, à laver les peintures et à battre les tapis, à décrocher et à raccrocher les tableaux, à faire briller les miroirs et les lustres, à allumer du feu dans les chambres, à mettre à l’air draps et lits de plume devant les cheminées ; tout cela sur une échelle supérieure à tout ce que j’avais vu avant ou après cette époque. » 2210
Femmes (Travail-dit-ménager [ou domestique]) (2) : 1855. Honoré de Balzac [1799-1850], dans Les paysans, auteur de :
« Sur une table carrée, éblouissante de linge, car peu soucieux de la peine de sa femme et d’Annette [la servante], Rigou voulait du linge blanc tous les jours. » 2211
Femmes (Travail-dit-ménager [ou domestique]) (3) : 1900. Jack London [1876-1916], dans Martin Eden, auteur de :
« […] ‘Je vous fait grâce des intérêts, à condition que vous dépensiez ces trente-cinq dollars par mois, pour le blanchissage, le ménage et la cuisine. Ces sept mille dollars sont à vous, si vous vous engagez à laisser Gertrude se reposer. Acceptez-vous ?’
M. Higginbotham avait la gorge contractée. De songer que sa femme ne ferait plus le ménage, remplissait d’amertume son âme sordide. Le don magnifique dorait une pilule bien dire à avaler. Sa femme ne travaillerait plus ! Ça le mettait en boule.
- Parfait ! alors dit Martin. C’est moi qui paierais les trente-cinq dollars par mois et…
- Il fit un mouvement pour reprendre le chèque. Mais Bernard Higginbotham s’en empara précipitamment en s’écriant :
- ‘ J’accepte ! J’accepte !
Quand Martin prit le tram, il était fatigué, écœuré. Il leva les yeux vers l’enseigne du commerçant.
- Le cochon ! gronda-t-il, le cochon ! le cochon ! » 2212 (Cf. Famille. Mariage. London Jack)
Femmes (Travail-dit-ménager [ou domestique]) (4) : 1939. Richard Llewellyn [1906-1983], dans Qu’elle était verte ma vallée, auteur de :
« Laver, essuyer, laver, essuyer, assiettes, plats, couteaux, fourchettes, cuillères, soucoupes, tasses. Remplir les bouilloires, chauffer de l’eau. Vapeur, cristaux. Et, de nouveau, laver, essuyer, éponger l’eau par terre. Laver, essuyer. Bonté divine, comme j’étais heureux, ce soir-là, de n’être pas une fille. Jamais un homme ne connaîtra vraiment une femme tant qu’il n’aura pas goûté de son ouvrage. Laver, essuyer, eaux bouillantes, cristaux, bouilloires, vaisselle, chaleur, vapeur et toujours, sans cesse, de l’eau. » 2213
Femmes (Travail-dit-ménager [ou domestique]) (5) : 1999. Écouter Clémence en vacances d’Anne Sylvestre [1934-2020].
Femmes (Travail-dit-ménager [ou domestique]) (6) : 2018. Elena Ferrante, dans L’enfant perdue, auteure de :
« Puis, en un éclair, toute pensée vola en éclair, brisée par une sorte de signal d’alarme domestique : j’avais oublié d’acheter des couches pour Irma.
Très souvent le quotidien surgissait ainsi comme une claque, rendant insignifiant, pour ne pas dire ridicule, le moindre de mes efforts d’inventivité. » 2214
Femmes (Travail-dit-ménager [ou domestique]) (7) : 2020. Anthony Galluzzo, dans La fabrique du consommateur. Une histoire de la société marchande. [Zones. 269p.], auteur de :
« C‘est la productivité de la femme au foyer qui augmente et non pas son temps de travail qui diminue. »
Non…ou, du moins, mal posé. 2215 (Cf. Économie. Productivité)
-------------
Femmes (Tricot) : 1984. Marlène Dietrich [1901-1992], dans Marlène D., auteure de :
« Comme nous [les écolières] étions incapables de faire un pansement, nous tricotions. Assises, la lumière du jour éclairant à peine la salle de classe, nous tricotions afin de réchauffer les soldats qui creusaient des tranchées en terre étrangère. On nous faisait tricoter pour que nous nous sentions utiles, pour combler le vide béant provoqué par la guerre. La laine étant couleur ‘gris champ’ rêche et collante. » 2216 (Cf. Enfants. Filles, Femmes. Utiles, Patriarcat, Politique. Guerre)
Par ordre chronologique. Femmes. « Trompées » :
Femmes (« Trompées ») (1) : 1667. Racine [1639-1699], dans Andromaque, auteur de :
Hermione : « Je t’aimais inconstant, qu’aurais-je fait fidèle ? » [Acte IV. Scène V].
Femmes (« Trompées ») (2) : 1727. Marivaux [1688-1763], dans La vie de Marianne, auteur de :
« Voyons, me dit cette amie, de quoi vous désespérez-vous ? de l’accident du monde le plus fréquent et qui tire le moins à conséquence pour vous. Vous aimiez un homme qui vous aimait et qui vous quitte, qui s’attache ailleurs : et vous appelez cela un grand malheur ? Mais est-il bien vrai que c’en soit un, et ne pourrait-il pas que ce fût le contraire ? Que savez-vous s’il n'est pas avantageux pour vous que cet homme-là ait cessé de vous aimer, si vous ne vous seriez pas repentie de l’avoir épousé, si sa jalousie, son humeur, son libertinage, si mille défauts essentiels qu’il peut avoir et que vous ne connaissiez point, ne vous auraient pas fait gémir le reste de votre vie ? Vous ne regardez que le moment présent, jetez votre vue un peu plus loin. Son infidélité est peut-être une grâce que le ciel vous a faite […] et vous pleurez aujourd’hui ce qui sera peut-être dans peu de temps le sujet de votre joie. […]. » 2217
Peut-on mieux dire ? Quand je pense à tout ce qui a été écrit, vécu sur ce thème depuis près de trois siècles …
Femmes (« Trompées ») (3) : (28 juin) 1825. Céleste de Chateaubriand [1774-1847] écrit à M. Le Moine :
« Venez diner, je vous en prie : je suis malade et noire à mourir. Je suis seule. M de Chateaubriand dîne chez une de ses amantes. » 2218 (Cf. Femmes. Épouse de)
Femmes (« Trompées ») (4) : 1839. Stendhal [1783-1842], dans La chartreuse de Parme, auteur de :
« La duchesse Sanseverina fut présentée à la triste princesse de Parme, Clara-Paolina, qui, parce que son mari avait une maîtresse (une assez jolie femme, la marquise Balbi), se croyait la plus malheureuse personne de l’univers, ce qui l’en avait rendue peut-être la plus ennuyeuse. » 2219
Femmes (« Trompées ») (5) : 1841. Honoré de Balzac [1799-1850], dans Mémoires de deux jeunes mariées, auteur de :
« […] ‘Ma fille, madame de Staël est morte’, m’a dit la duchesse avec douceur.
- ‘Comment une femme peut-elle être trompée’ ai-je dit à miss Griffith en terminant Adolphe [Benjamin Constant. 18016]
- ‘Mais quand elle aime’ m’a dit miss Griffith. » 2220
Femmes (« Trompées ») (6) : (26 octobre) 1871. George Sand [1804-1876], dans une lettre à Pauline Villot [1812-1875] (dont le mari était « parti » - puis reviendra - avec la princesse de Bauffremont), auteure de :
« J’avais sujet de m’inquiéter de vous, puisque la cause de vos chagrins dure toujours. J’en comprends l’amertume ; j’ai beaucoup bu ce genre de calice. » 2221
Femmes (« Trompées ») (7) : 1935. Louis Guilloux [1899-1980], dans Le sang noir, auteur de :
« D’habitude, quand il rentre, il va trouver son épouse et il l’embrasse sur le front. Elle lui rend son baiser sur la joue. Histoire sans paroles. Une fois par semaine régulièrement, Mme Point tressaille à l’approche de son lion, roule des yeux de folle et s’écrie : ‘Tu sens encore la femme !’. Il hausse les épaules. Depuis tant d’années qu’il va au bordel, il a beau varier les jours comme on bat les cartes, elle ne se trompe pas une seule fois. » 2222 (Cf. Femmes, Relations entre êtres humains. Baiser, Famille. Couple, Proxénétisme. Bordels. Personnes-dites-prostituées)
Femmes (« Trompées ») (8) : 1990. Lu dans le livre de Henri Pierre, La vie quotidienne à la Maison Blanche au temps de Reagan et de George Bush :
Lady Bird Johnson [1912-2007] qualifiait la liaison de Franklin Delano Roosevelt [1842-1945] avec Lucy Mercer [1891-1948] ainsi :
« Une petite mouche sur le gâteau de mariage ». 2223
Femmes (« Trompées ») (9) : (23 mai) 1999. Françoise Giroud [1916-2003], dans La rumeur du monde, auteure de :
« Lu La première épouse de Françoise Chandernagor. Si toutes les femmes plaquées par leur mari après trente ans de mariage lisent ce livre, comme il est probable, l’auteur [e] va faire un tabac. C’est une population souffrante (sic), dont la blessure est longue à se refermer. Elle se reconnaîtra dans l’interminable douleur, la rage, la fureur, l’humiliation exhalées par Française Chandernagor, impudique et pitoyable. Le mari volage ? Un mufle. »
« Impudique et pitoyable »
Non. Novatrice et courageuse. 2224 (Cf. Hommes. « Trompés »)
Femmes (« Trompées ») (10) : 2018. Elena Ferrante, dans L’enfant perdue, auteure de :
« Vous m’avez laissée cuisiner et servir des personnes avec lesquelles il m’avait trompée la veille ou avec lesquelles il me tromperait le lendemain. J’ai mangé avec des femmes à qui il touchait le pied, le genou ou que sais-je encore sous la table. J’ai confié mes enfants à une fille sur laquelle il sautait dès que j’avais le dos tourné. » 2225
Femmes (« Trompées ») (11) : (2 octobre) 2019. Lu dans Gala : Bernadette Chirac, auteure de :
« Je me suis dit que c’était la règle et qu’il fallait la subir avec autant de dignité que possible. » Tant et tant de femmes ont pensé, vécu ainsi.
-------------
Femmes (Trotsky Léon) : (14 août) 1923. Léon Trotsky [1879-1940], dans La Pravda, auteur de :
« Pour changer les conditions de vie, il faut apprendre à les voir par les yeux d’une femme. » 2226
Pas vraiment mis en pratique… (Cf. Politique. Panégyrique)
Femmes (Utiles) : 1847. Honoré de Balzac [1799-1850], dans Splendeurs et misères des courtisanes, auteur de :
« On ne se figure pas de quelle utilité sont les femmes de Paris pour les ambitieux en tout genre ; elles ont aussi nécessaires dans le grand monde que dans le monde des voleurs, où, comme on vient de le voir, elles jouent un rôle énorme. » 2227 (Cf. Hommes. Ambitieux)
Par ordre chronologique. Femmes. Valeur :
Femmes (Valeur) (1) : 1947. Louis Jouvet [1887-1951], dans Copie conforme [Jean Dréville], auteur de :
« Les femmes ne valent que par les désirs qu’elles nous inspirent. »
Formulation excessive dans sa généralité, mais encore tristement trop souvent juste. (Cf. Culture. Cinéma, Hommes. Désir)
Femmes (Valeur) (2) : 2018. Arundhati Roy, dans Le Ministère du Bonheur Suprême, auteure de :
« C’est ainsi que l’insurrection avait commencé. La mort était partout. La mort était tout. […]
« Les touristes disparurent. Les journalistes accoururent. Les jeunes mariés en voyage de noce disparurent. Les soldats accoururent. Les femmes s’attroupèrent devant les postes de police et les bases militaires, levant une forêt de photos de taille passeport, écornées, froissées, adoucies par les larmes : ‘S’il vous plait, Sir, avez-vous vu mon garçon quelque part ? Avez-vous vu mon mari ? Mon frère est-il, par hasard passé entre vos mains ?’ Les sir bombaient le torse, frisaient leurs moustache, jouaient avec leurs médailles en plissant le nez pour évaluer les femmes, repérer celle dont le désespoir valait le coup d’être converti en espoir corrosif (Je vais voir ce que je peux faire) et cet espoir en retombées intéressantes (Du blé ? Une bonne bouffe ? Une baise ? Un camion de noix, un panier de fraises ?) » 2228
-------------
Femmes (Validité des jugements) : « Singes des hommes » ? « Dépendantes » ? « Capricieuses » ? « Aliénées » ? « Lâches » ? « Séductrices » ? « Superficielles » ? « Naïves » ? « Manipulatrices » ? « Faire-valoir » ? « Courageuses » ? « Solidaires » ? « Innocentes » ? « Irresponsables » ? « Dépensières » ? « Idiotes utiles » ? etc., etc…
Dans l’abstraction de l’analyse et sans référence à une analyse féministe, tous ces jugements - qui peuvent être et sont si souvent justes - ne valent que l’opinion de leur auteur-e. (Poursuivre) (Cf. Femmes. Lâcheté, Penser. Pensées. Abstraction)
Femmes (« Valises ») : (20 septembre) 2017. « Les ‘femmes valises’, un trait entre l’Angola et le Brésil » : qui sont les femmes ainsi dénommées ? :
« Il s'agit de commerçantes qui font la navette Luanda-Rio de Janeiro pour rapporter des produits en tout genre, mais surtout les derniers vêtements à la mode. » 2229 (Cf. Êtres humains. Vêtements, Femmes. « Objets »)
Femmes (Variables d’ajustement) : (2 juin) 2023. Anne Ong, sur France Culture, auteure de : « On est toujours les variables d’ajustement. » 2230 (Cf. Femmes. Travail)
N.B. Le présentateur de l’émission interroge Anne Ong sur l’importance du temps, du manque de temps « pour les agricultrices », celle-ci le reprend pour préciser que cela ne concerne pas qu’elles.
Par ordre chronologique. Femmes. « Vénales » :
Femmes (« Vénales ») (1) : (1er mars) 1768. Voltaire [1694-1778], dans une lettre écrite à Alexandre-Marie-François de Paule de Dompierre d’Hornoy [1742-1828], auteur de :
« Maman [Marie-Louise Denis. 1712-1790] qui a beaucoup vécu avec lui [le duc de Richelieu], se fera mieux payer qu’un sergent à verge. Il est vrai qu’elle n’est plus dans l’âge qui ouvre la bourse des ducs et des pairs ; mais une ancienne liaison est toujours respectée. » 2231 (Cf. Femmes. Remarquables. Denis Marie-Louise, Voltaire. Patriarcat)
Femmes (« Vénales ») (2) : (12 novembre) 1773. Voltaire [1694-1778], dans une lettre écrite à un « destinataire inconnu », évoque une jeune femme en ces termes : :
« Elle est assez jolie, elle est jeune, elle est femme, elle peut trouver des ressources. » 2232
Est-ce elle qui serait vénale ou Voltaire qui la juge telle ? Mais, plus justement, le qualificatif que j’emploie est-il approprié ? Non. (Cf. Voltaire. Patriarcat)
Femmes (« Vénales ») (3) : 1935. Un modèle de femme présentée comme « vénale » dans la chanson :
« Faut-il que je vous fasse un petit dessin ? » chantée par Mireille [1906-1996]. (Cf. Culture)
-------------
Femmes. Vengeances :
Femmes (Vengeances) (1) : Si l’on considère que le privé est politique, que toute distinction privée / publique est non seulement absurde car schizophrène - ou l’inverse -, alors comment perpétuer la distinction entre le recours au droit qui serait légitime - le seul en réalité - et la vengeance qui serait à bannir ?
Femmes (Vengeances) (2) : Bien évidemment, les femmes qui dénoncent les hommes, veulent, consciemment ou non, se venger des hommes, d’un homme singulier, de quelques autres hommes, de tous les hommes. Il faut véritablement vouloir blinder sa conscience, se fermer à toute intelligence, s’interdire toute vérité, pour refuser de voir, c’est-à-dire de comprendre.
Femmes (Vengeances) (3) : Les femmes du monde entier ont, a minima, des siècles de vengeances irréalisées, inassouvies.
Par ordre chronologique. Femmes. Vengeances :
Femmes (Vengeances) (1) : 1829-1830. Une femme « de qualité », sans doute la comtesse de Cayla [1785-1852], raconte qu’elle reçut, un jour, nouvellement mariée par ailleurs, un paquet qui s’avéra un bel et gros enfant accompagné de la lettre suivante :
« Citoyenne, Puisque vous êtes la femme d’un homme qui devait être mon époux, prenez la charge de nourrir une créature innocente qui lui doit le jour. » Signé : Rosalie.
Sur ce, elle fit venir son mari et lui dit :
« Monsieur, quand on fait des enfants, on tâche de les placer ailleurs que chez moi ; voici un des vôtres que l’on m’adresse, vous plairait-il d’en prendre soin ? » Elle gagna (notamment) de cette répartie sa liberté à vie à son égard. 2233
Á la relecture : pas une vengeance, une saine et légitime réaction. (Cf. Culture. Cinéma. La Fiancée du pirate. La mariée était en noir, Êtres humains, Enfants, Relations entre êtres humains. Vengeance, Famille, Politique. Vengeance)
Par ordre chronologique. Femmes. Vengeances. Émile Zola :
Femmes (Vengeances) (2) : 1882. Émile Zola [1840-1902], dans Pot-Bouille, auteur de :
« C’était en elle [Berthe] un appétit grandissant de liberté et de plaisir, tout ce qu’elle se promettait dans le mariage étant jeune fille, tout ce que sa mère lui avait appris à exiger de l’homme. Elle apportait comme un arriéré de faim amassée, elle se vengeait de sa jeunesse nécessiteuse chez ses parents, des basses viandes mangées sans beurre pour acheter des bottines, des toilettes pénibles retapées vingt fois, du mensonge de leur fortune soutenue aux prix d’une misère et d’une saleté noires. […] » 2234 (Cf. Famille. Mariage. Économie. « Pauvres Les »)
Femmes (Vengeances) (3) : 1883. Émile Zola [1840-1902], dans Au bonheur des dames, auteur de :
« - Dites, je crois qu’elles se vengent ?
- Qui donc demanda Mouret, embarrassé.
- Mais les femmes… Elle se lassent être à vous et vous êtes à elles, mon cher : Juste retour ! » 2235
-------------
Femmes (Vengeances) (4) : 1886. Louise Michel [1830-1905], auteure de :
« Quand une honnête femme, calomniée ou poursuivie tue le drôle qui la pourchasse, bravo ! Elle débarrasse les autres d’un danger, elle les venge ; il n’y en a pas assez qui prennent ce parti-là. ». (Cf. Êtres humains, Relations entre êtres humains. Vengeance, Femmes. Assassinées, Hommes. Solidaires des femmes en lutte, Justice. Légitime défense, Violences. Violences à l’encontre des femmes) 2236
Rarement cité…
Femmes (Vengeances) (5) : 1928. La fiancée du pirate [Chanson de l’humiliation] chanson de Kurt Weill [1900-1950] et Berthold Brecht [1898-1956] :
- Premier couplet : « Oui c'est moi qui lave les verres et les plats / On m'appelle une Marie-couche-toi là / Quand on me donne un penny / Faut encore que j'dise merci / Me v'là en habits loqu'teux / Au fond d'cet hôtel miteux / Vous n'savez pas aujourd'hui qui je suis / Vous n'savez pas aujourd'hui qui je suis. »
- Fin : « Mais un soir, ce beau soir pour qui je vis / Voilà que les canons / S'éveilleront / et tonneront / Pour la première fois, j'éclaterai de rire / Quoi méchante, t'as le cœur à rire ?
Le navire du haut bord / Cent canons aux sabots / Bombardera le port ! /
Alors viendront à terre les matelots / Plus de cent, ils marqueront d'une croix de sang / Chaque maison, chaque porte / Et c'est devant moi qu'on apporte / Enchaînés, implorants, mutilés et saigneux / Vos pareils, tous vos pareils, beaux messieurs ! / Vos pareils, tous vos pareils, beaux messieurs !
Alors paraîtra celui que j'attends, il me dira : / Qui veux-tu de tous ces gens que je tue ? / Et moi je répondrai doucement : / Tue-les tous ! Chaque tête qui tombera / Je battrai des mains, hop là ! / Et le navire du haut bord / Loin de la ville où tout sera mort / M'emportera vers la vie ! »
Femmes (Vengeances) (6) : 2001. Jean-Claude Brialy [1933-2007], dans ses Mémoires, raconte le tournage du Bal du Comte d’Orgel [1969] qui eut lieu dans la somptueuse propriété à Montfort-L’Amaury d’un « marquis, milliardaire chilien ». Son chauffeur lui raconte la vie de « Germaine », « l’une des femmes de chambre du marquis » :
« Cela fait 45 ans qu’elle est à son service. Elle a été amoureuse de lui et lui ne l’a jamais regardée. Il l’a fait souffrir, il l’a tourmentée. Et maintenant qu’il est à moitié paralysé, elle se venge. Quand il lui demande un peu d’eau, elle lui dit : ‘On va voir’. » 2237 (Cf. Relations entre êtres humains. Vengeance)
Femmes (Vengeances) (7) : 2005-2007. Une vengeance de femme : Lisbeth Salander dans les trois livres remarquables de Stieg Larsson [1954-2004], Millenium 1, 2, 3. Un modèle ? [avec Médée ? La cousine Bette - dont le prénom est Lisbeth - ?, sans oublier la marquise de Merteuil dans Les liaisons dangereuses ? et bien d’autres encore…] (Cf. Relations entre êtres humains. Vengeance, Patriarcat)
-------------
Femmes (« Vente ») : 1995. Lu dans Jean Tulard, Guide des films. 1895-1995. L-Z. , concernant les films :
- 40 m2 en Allemagne [1986. Tevfik Baser] : « Turna a été vendue en mariage à Dursun. […] » (Cf. Femme « Réceptacle », Famille. Mariage)
- Quartier sans soleil [1954. Satsuo Yamamoto] : « Bagarres, suicides, incendie, vente de filles comme geishas pour nourrir la famille seront les conséquences de la grève. » (Cf. Enfants, Famille, Langage. Zeugma, Proxénétisme)
- Racines [1955. Benito Alazraki] : « Quatre histoires. I. La vache : un Indien vend sa femme comme nourrice. […] »
- Règne de Naples (Le). 1978. Werner Schroeder : « [parmi l’évocation du « sort des humbles et des déshérités »] « une voisine qui a vendu sa fille à un soldat américain la fin de la guerre pour manger. »
- Sans pitié [1985. Richard Pearce] : « Un flic de Chicago se fait passer pour un tueur à gages afin de piéger un homme qui veut se débarrasser du ‘propriétaire’ d’une jeune femme, Michèle Duval, vendue à 13 ans. Au cours de la transaction […]. »
- Shanghai [1941. Joseph von Sternberg] : « [La fille de Sir Guy Charteris] a été vendue comme prostituée. […] « […] Les femmes en cage que l’on vend aux marins. […] ». (Cf. Proxénétisme)
- Tonnerres lointains [1973. Satyajit Ray] : « Une amie d’Ananaga se vend pour pouvoir manger, une autre meurt de faim. » (Cf. Culture. Cinéma, Êtres humains, Femmes. Achat, Proxénétisme, Économie) 2238
Femmes. Vertu :
Femmes (Vertu) (1) : Longtemps, l’ignorance imposée fut la gardienne de la « vertu » des femmes. Efficace.
Femmes (Vertu) (2) : Aux « vertus » que l'on exige des femmes, connaît-on les « vices », qu'en échange, l'on concède [accorde ?] aux hommes ?
Par ordre chronologique. Femmes. Vertu :
Femmes (Vertu) (1) : Virgile [70 avant J.C-19 avant J.C], dans L’Énéide [V,344], auteur de :
« Gratior est pulcro veniens in corpore virtus ». Traduction : « Plus agréable est la vertu, quand elle se présente dans un beau corps. » 2239 (Cf. Êtres humains, Corps, Femmes. Vertu, Patriarcat)
Femmes (Vertu) (2) : 1687. Fénelon [1651-1715], dans son Traité de l’éducation des filles, auteur de :
« Retenez les jeunes filles dans les bornes communes, et apprenez-leur qu'il doit y avoir pour leur sexe une pudeur sur la science presque aussi délicate que celle qu'inspire l'horreur du vice. » 2240
- « Pudeur sur la science » opposé à « vice » … (Cf. Corps. Pudeur, Êtres humains. Pudeur, Femmes. Jeunes filles. Pudeur, Penser. Pensées. Binaires)
Femmes (Vertu) (3) : 1759. Adam Smith [1723-1790], dans sa Théorie des sentiments moraux, auteur de :
« […] De la même manière, une femme peut parfois ne pas sentir pour son mari la tendresse adéquate à leur union. Mais si elle a été éduquée selon la vertu, elle s’efforcera d’agir comme si elle sentait cette tendresse ; elle s’évertuera à être prévenante, serviable, fidèle, sincère, et ne manquera à aucune des attentions que le sentiment de l’affection conjugale pourrait lui avoir inspirées. »
Puis, pour l’homme, en conséquence :
« Un mari est mécontent de la femme la plus obéissante, quand il imagine que sa conduite est animée par aucun autre principe qu’un souci de ce qu’exige la relation qui les unit. » 2241 (Cf. Droit. Droits / Devoirs, Famille. Couple. Mariage, Relations entre êtres humains. Attentions, Patriarcat, Politique. Obéir, Violences. Violences à l’encontre des femmes)
Femmes (Vertu) (4) : (7 juillet) 1835. Alexis de Tocqueville [1805-1859], dans ses Voyages en Angleterre et en Irlande auteur de :
« Qu’est-ce que la vertu sinon le choix libre de ce qui est bien ? » 2242
Que de mots non pensés… (Cf. Langage. Mots, Penser)
Femmes (Vertu) (5) : 1836. Pierre-François Lacenaire [1803-guillotiné en 1836], auteur de :
« Il y a plus de vertu dans une seule femme qu’au fond de l’âme de dix philosophes. » 2243 (Cf. Êtres humains. Âmes, Justice, Politique. Morale, « Sciences » sociales. Philosophie)
* Ajout. 16 juillet 2017. Je lis dans les Dits et écrits de Michel Foucault [1926-1984] que Lacenaire était « un débauché et un proxénète qui utilis[ait] de jeunes garçons pour attirer des hommes plus âgés et ensuite les faire chanter. » 2244 (Vérifier) (Cf. Proxénétisme)
Femmes (Vertu) (6) : 1981. Maurice Regard, « éditeur scientifique », dans son Introduction pour La Pléiade à La femme auteur [1847] d’Honoré de Balzac [1799-1850], auteur de :
« Le nom d’Albertine Becker [1766-1841] rappelle curieusement celui d’Albertine Necker, Genevoise, par conséquent vertueuse, quoique nièce de Mme de Staël. [1766-1817] » 2245
N.B. Toute cette Préface, à l’avenant - scandaleuse, tant l’auteur écrit, sans ambiguïté aucune, son propre mépris des femmes écrivaines - doit être critiquée, dénoncée. (Cf. Culture. Patriarcale, Femmes. Écrivaines, Hommes)
-------------
Femmes. Veuves :
Femmes (Veuves) (1) : Longtemps, la proie favorite des notaires.
Femmes (Veuves) (2) : Les femmes dont le mari est décédé sont veuves. Les femmes dont l’enfant est décédé sont-elles mères ? Sont-elles d’ailleurs même femmes ?
Femmes (Veuves) (3) : Dicton : « Femmes de marin / Femme de chagrin / Et pour espoir / Le voile noir. »
Femmes (Veuves) (4) : Pour beaucoup de femmes, le seul espoir d’une libération.
Femmes (Veuves) (5) : Les femmes dont le fiancé étaient tué pendant la guerre de 1914-1918 étaient dénommées « les veuves blanches ».
Par ordre chronologique. Femmes. Veuves :
Femmes (Veuves) (1) : (20 juillet) 1762. Dominique Aubert [le commerçant protestant qui informa Voltaire [1694-1778] de l’exécution de Jean Calas [1698-1762]) lui écrit pour lui rapporter ce que lui avait dit Marie Calas, la veuve de Jean Calas (faussement condamné, torturé, étranglé puis brulé, le 10 mars 1762)] :
« Ce ne fut que quatre jours après l’exécution de Calas, que les prêtres l’annoncèrent à la pauvre veuve, et, depuis cet instant, ils la tourmentèrent pendant onze jours de suite pour la préparer à la mort, et la forcer à changer de religion [de protestante à catholique], dans l’espoir d’obtenir sa grâce […]. » 2246 (Cf. Droit, Famille, Justice. Voltaire)
Femmes (Veuves) (2) : 1729. Madame de Puisieux [Madeleine. 1720-1798] (attribution incertaine), dans La femme comme il y en a beaucoup, auteure de :
« Veuve depuis peu, elle venait passer son deuil avec une tante dont elle attendait une riche fortune ; elle avait perdu un mari qu’elle estimait, mais qu’elle n’aimait point, fort âgé, triste et jaloux ; ayant passé quatre ans avec lui, tâchant de le rendre heureux aux dépens même de ses plaisirs, évitant tout ce qui pouvait l’inquiéter. Elle ne vit pas avec indifférence rompre les chaines qui lui rendait sa liberté ; marquant les regrets qu’elle avait réellement, et se confortant à la décence de son état, elle résolut de passer à la campagne l’année de son deuil, et de rejeter tous les nouveaux engagements qu’on lui proposait. » 2247 (Cf. Femmes. Libres, Hommes. Époux. Heureux, Famille. Mariage, Relations entre êtres humains. Aimer)
Femmes (Veuves) (3) : (20 avril) 1794. Isabelle de Charrière [1740-1805], dans une lettre à Benjamin Constant [1767-1830], auteure de :
« Que Chaumette [Pierre. Gaspard. 1763-13 avril 1794] soit expédié [guillotiné] c’est tout simple, mais pourquoi ne pas épargner les veuves de Camille Desmoulins [1760-5 avril 1794] et de Hébert [Jacques-René. 1757-24 mars 1794] Une note précise :
« Avec Chaumette, on guillotina en effet Lucile Desmoulins [1770-13 avril 1794] et Françoise Hébert. [Marie Margueritte. Françoise. 1756-13 avril 1794] (Cf. Histoire. Révolution française. Femmes)
Femmes (Veuves) (4) : (17 septembre) 1794. Thérèse Levasseur [1721-1801] offre à La convention un manuscrit des Confessions de Jean-Jacques Rousseau [1712-1778]. 2248 (Cf. Femmes. Mères. Épouse de. Le Vasseur Thérèse)
Femmes (Veuves) (5) : 1811. Félicité de Genlis [1746-1830], dans Les souvenirs de Félicité L***, auteure de :
« Ceci me rappelle une loi établie parmi les Turcs et qui me déplaît beaucoup ; celle qui double le douaire de la veuve qui a allaité ses enfants. Cette loi qui range les mères nourrices dans la classe des mercenaires, avilit les soins maternels, et détruit la reconnaissance filiale. » 2249 (Cf. Corps. Seins, Droit. Patriarcal, Femmes. Mères. Nourrices, Famille)
Femmes (Veuves) (6) : 1816. Retrouvé dans les archives de l’hôpital de Narbonne :
« Les circonstances du temps permettent que je dépose mon enfant légitime dans cet hospice. C’est une femme plaignante qui le recommande à votre secours et à votre humanité. Mon mari, capitaine Bessole, a été tué dans l’affaire de Toulouse ; il m’a laissée dans la plus grande nécessité, il m’a laissé 4 enfants, et j’en ai placé 3 et mon dernier, le plus jeunes et le plus aimable, je le recommande à votre générosité. » 2250 (Cf. Enfants. « Placés », Femmes. Mères, Politique, Charité, Économie. « Pauvres Les »)
Femmes (Veuves) (7) : 1835. Honoré de Balzac [1799-1850], dans Le père Goriot, auteur de :
« Qu’avait été M. Vauquer ? Elle ne s’expliquait jamais sur le défunt. Comment avait-il perdu sa fortune ? ‘Dans les malheurs‘, répondait-elle. Il s’était mal conduit envers elle, ne lui avait laissé que les yeux pour pleurer, cette maison pour vivre et le droit de ne compatir à aucune infortune, parce que, disait-elle, elle avait souffert tout ce qu’il est possible de souffrir. » 2251 (Cf. Femmes. Pleurs)
Femmes (Veuves) (8) : 1853. Jules Michelet [1798-1874], dans son Histoire de la Révolution française, en conclusion du chapitre sur la prise de la Bastille [1789], écrit :
« Les veuves, chose admirable ! se montrèrent aussi magnanimes. Indigentes et chargées d’enfants, elles ne voulurent pas recevoir seules une petite somme qui leur fut distribuée ; elles mirent dans le partage la veuve d’un pauvre invalide qui avait empêché la Bastille de sauter et qui fut tué par méprise. La femme de l’assiégé fut ainsi comme adoptée par celles des assiégeants. » 2252 (Cf. Femmes, Justice, Langage, Politique. Égalité, Histoire. Révolution Française)
Femmes (Veuves) (9) : 1853. Jules Michelet [1798-1874], dans son Histoire de la Révolution française, évoque une réunion le 14 juillet 1790 des Amis de la constitution (ancêtre des Jacobins) « chez une dame veuve, personne riche et considérable de la ville [de Rouen] [...], « le centre de cette petite société ». Et Michelet décrit son engagement en ces termes :
« C’était une dame juive qui vit se convertir toute sa famille, et resta israélite ; ayant perdu son mari, puis son enfant (par un accident affreux), elle semblait, en place de tout, adopter la Révolution. Riche et seule, elle a dû être facilement conduite par ses amis […]. » 2253 (Cf. Femmes. « Seules », Histoire. Révolution Française. Femmes)
Femmes (Veuves) (10) : 1859. George Eliot [1819-1880], dans Adam Bede, auteure de :
« […] Quand un bout de pont est tombé, à quoi sert que l’autre tienne ? Je ferais aussi bien de mourir et suivre mon vieux mari. On ne sait pas s’il n’aura pas besoin de moi. » 2254 (Femmes. Comment meurent les femmes ? Famille. Couple)
Femmes (Veuves) (11) : 1865-1869. Léon Tolstoï [1828-1910], dans La guerre et la paix, évoque « les veuves infortunées des maris vivants ». 2255 (Cf. Politique. Guerre)
Femmes (Veuves) (12) : 1883. Émile Zola [1840-1902], dans Au bonheur des dames, auteur de :
« Plus tard, étant devenue veuve, elle avait épousé ce Mouret. Elle lui apportait donc la moitié du magasin. » 2256 (Cf. Famille. Couple, Patriarcat, Économie)
Femmes (Veuves) (13) : (16 janvier) 1912. Alexandra David-Neel [1868-1969], à Calcutta, écrit à son mari :
« J’ai été voir la dame américaine qui dirigé l’école des veuves hindoues. Je t’ai dit, je crois, qu’il y a ici des veuves de cinq ans, car on marie les enfants au berceau et le mariage doit devenir effectif dans la semaine qui suit la première menstruation de la fillette. L’opinion commence à s’agiter pour la suppression de cette horreur. Pour en revenir aux veuves dont beaucoup sont vierges, elles ne peuvent pas se remarier et un grand nombre tombe dans la misère ou se livre à la prostitution. L’école en question est une de celles, parmi d’autres, où l’on apprend un métier aux jeunes veuves afin qu’elles puissent gagner leur vie. » 2257 (Cf. Enfants. Filles, Femmes. Règles, Proxénétisme)
Femmes (Veuves) (14) : (30 novembre) 1912. Lou Andréas Salomé [1861-1937], dans un court texte intitulé Masculin et Féminin, après avoir nommé les « hommes insensibles », évoque les « femmes foulées aux pieds, qui parfois, à leur grand étonnement, s’épanouissent dans le veuvage, c’est à dire deviennent ce qui aurait pu être pour un homme un refuge et un enchantement. » 2258 (Hommes. Insensibles)
Femmes (Veuves) (15) : 1914. Jacqueline de Romilly [1913-2010], dans le livre Jeanne [2012] consacré à sa mère, écrit :
« Le départ de mon père [à la guerre], annoncé par un télégramme, le mena à la Somme, à Saint-Mard-les-Triots. Il y arriva le matin du 2 octobre ; le soir, il était tué d’une balle dans la tête, au moment où il sortait de la tranchée. Il n’avait rien vu de la guerre.
Jeanne ne le sut pas : on reculait alors ; rien n’était sûr ; on ne savait pas. Elle attendit donc. Elle attendit des semaines, des mois, des années. ‘Des années’, n’est pas exagéré ; l’avis de la mort de mon père lui fut envoyé, en effet le 19 janvier 1916. […]
Encore n’était-ce pas fini. L’avis ne comptait pas comme acte de décès ; il fallut un jugement. Ce jugement - je l’ai - est du 9 novembre 1917, plus de trois ans après l’évènement. Il avait fallu vingt-quatre heures pour passer du départ à la mort, mais trente-sept mois pour passer de la mort de fait à sa reconnaissance officielle. » 2259 (Cf. Politique. Guerre)
Femmes (Veuves) (16) : 1929. Éric Hobsbawm [1917-2012], dans son Autobiographie, Franc-tireur, concernant sa mère, écrit :
« La mort de mon père [en 1929] changea une situation économique déjà en crise permanente en une pure catastrophe. » 2260
Cette analyse a concerné et concerne encore tant et tant de femmes… (Cf. Famille. Mariage, Économie. Argent)
Femmes (Veuves) (17) : 1929. Ivy Compton-Burnett [1888-1929], dans Frères et sœurs, auteure de :
« Sophia donnait bien l’impression d’être une veuve. Son attitude paraissait calculée à cet effet ; toute sa vie intérieure semblait centrée là-dessus. […]
Elle exagérait le sens de son veuvage, insistait sur son bonheur conjugal et oubliait ce dont elle avait toujours compte du vivant de son mari : le sentiment qu’il lui portait avait pour objet la personnalité qu’elle s’était faite pour lui. Quant à ses enfants, elle estimait simplement qu’ils ne pouvaient pas la quitter dans son veuvage si récent. Elle considérait leur participation à son chagrin moins comme une prétention à sa sympathie que comme un soutien de leur devoir. […] » 2261 (Cf. Droit. Droit / Devoirs, Enfants. Femmes. Mères, Famille. Couple)
Femmes (Veuves) (18) : (16 décembre) 1933. Louis Guilloux [1899-1980] écrit dans ses Carnets :
« La cour spéciale de justice militaire, dans son audience du samedi 9 décembre a prononcé la réhabilitation des soldats François Laurent et A. Crémilleuse, fusillés les 8 et 9 octobre 1914.
Une indemnité de 10.000 francs a été accordée aux veuves de ces militaires injustement condamnés. » 2262 (Cf. Justice. « Militaire », Politique. Guerre)
Femmes (Veuves) (19) : 1934. Yvette Guilbert [1865-1944] chante Le fiacre de Xanrov [1888], dont les deux derniers vers sont :
« Du fiacre un' dam' sort et dit :
‘Chouett' Léon, c'est mon mari. » (Cf. Femmes. Chanteuses d’antan)
Femmes (Veuves) (20) : 1936. 2011. Anatole de Monzie [1876-1947] publie Les veuves abusives [1936. Grasset. 182p.]
Le livre fut réédité en 2011, toujours chez Grasset, dont voici la présentation :
« Les grands hommes ont quelquefois de petites femmes. Thérèse Levasseur partagea trente-trois années durant la vie de Jean-Jacques Rousseau - quoiqu'elle n'ait jamais appris à lire -, et, à la mort de l'écrivain, courut se jeter dans les bras d'un valet d'écurie ; Caroline Massin, entrée au lit du philosophe Auguste Comte en sa qualité de prostituée, se piqua de mathématiques pour y rester ; Athénaïs Michelet, Cosima Wagner, Sophie Tolstoï... elles sont huit, mesquines entre toutes, à avoir été choisies par Anatole de Monzie, huit ‘femmes de’ dont le mérite n'est jamais allé plus loin. Elles ont ‘assassiné leur mari après sa mort’. Elles sont les Veuves abusives. » (Cf. Hommes. « Grands »)
Femmes (Veuves) (21) : 1940. Charles de Gaulle [1890-1970] écrit dans ses Mémoires :
« [En 1940] Quand les journaux de Londres annoncèrent que Vichy me condamnait à mort et confisquaient mes biens, nombre de bijoux furent déposés à Carlton Gardens [Q.G des Forces Françaises Libres] par des anonymes et plusieurs douzaines de veuves inconnues envoyèrent l’alliance de leur mariage afin que cet or pût servir à l’effort du général de Gaulle. » 2263
Femmes (Veuves) (22) : (12 janvier) 1943. Thomas Mann [1875-1955], dans une lettre à Agnès E. Meyer [1887-1970], auteur de :
« J’ai appris récemment qu’ils [les nazis] ont déporté en ‘Pologne’ la veuve [?-1943] de Max Libermann [1847-1935], âgée de 86 ans, malgré l’intervention insistante de la Suède qui voulait accueillir la vieille femme.
Une note précise : « Veuve Liebermann : la malheureuse vieille femme parvint à s’empoisonner pour échapper à la déportation. » 2264 (Cf. Femmes. Âgées. Comment meurent les femmes ?)
Femmes (Veuves) (23) : (23 mai) 1948. Lu dans le Journal de ma vie de Jean Guitton [1901-1999] :
« Soirée chez Madame de Flandreysy [Jeanne de Flandreysy. 1874-1959] qui a beaucoup connu Mistral [1830-1914]. On parle de la difficulté pour la veuve d’un grand homme de lui survivre. Elle n’est plus rien quand son mari est mort. L’homme de génie ne laisse rien à sa femme ni à ses enfants. C’est comme si la nature, dit-elle, avait indiqué qu’il devait demeurer seul. Quand Mistral mourut, le cardinal de Cabrière dit à Madame de Flandreysy : ‘La femme de Mistral n’a guère su être sa femme. Espérons qu’elle saura être sa veuve‘.
Nous parlons alors de Valentine de Sayssac [Valentine Cessiat de Lamartine. 1821-1894], qui se dévoua à Lamartine [1790-1869], lequel dans les derniers temps avait une dysenterie constante. On n’a jamais su si Lamartine n’avait pas épousé Valentine. ‘Il y avait un moyen de l’apprendre, dit-elle, qui aurait été d’ôter l’anneau sur le lit de mort, et de savoir si le nom de Valentine y était gravé, mais personne n’osa le faire‘. » 2265 (Cf. Hommes. « Grands »)
Femmes (Veuves) (24) : (à partir de) 1950. Fabrizio Calvi, dans La vie quotidienne de la mafia de 1950 à nos jours, auteur de :
« Les premières personnes qui aient osé se révolter ouvertement contre le pouvoir de l’Honorable Société (la mafia) furent des veuves de mafieux ou des victimes des tueurs de la mafia. » 2266 (Cf. Femmes. Courage, Famille. Mariage. Mafia)
Femmes (Veuves) (25) : 1954. Éric Hobsbawm [1917-2012], dans son Autobiographie, Franc-Tireur, décrit son premier voyage [d’universitaires communiste anglais] en Union soviétique :
« De la Russie et de la vie des Russes, nous ne vîmes pas grand-chose, à part ces femmes entre deux âges, sans doute des veuves de guerre, qui charriaient des pierres et dégelait les rues dans cet hiver glacial. » 2267 (Cf. Femmes. Travail)
Femmes (Veuves) (26) : 1959 (à vérifier). Barbara [1930-1997] chante « Veuves de guerre », subversif, courageux, vitaliste et joyeux. (Cf. Politique. Guerre. Algérie. Femmes)
N.B. Le contexte : La guerre d’Algérie.
Femmes (Veuves) (27) : 1972. Claude Roy [1915-1997], dans Nous, auteur de :
« Un seul être vous manque et tout est différent. Différente, je m’aperçus bientôt que ma mère le devenait. Différente de l’image que m’en donnait mon père, et qu’elle avait reflété avec une application docile ; différente de la vieille dame que je me préparais laborieusement à bercer, contenir, apaiser, soutenir et tenir. […]
J’avais cru d’abord la voir se redresser du chagrin. Je la vis en réalité, lentement, se déplier de la contrainte. Elle était maintenant habitée de curiosités, fouettée d’un allant neuf. Elle souffrait encore. Elle riait déjà. Il l’avait jugée écervelée. Je commençais de l’admirer d’être ouverte à tous vents. […] Elle avait vécu casanière. Elle se retrouvait pleine de fourmis dans les jambes, envie de bouger, de voyager, de voir du pays. […] Elle croyait sincèrement ’se changer les idées’. Mais je n’en étais pas sûr : elle retrouvait les siennes. […]
J’avais reçu du Père, sans examen profond, la parole d’évangile : que ma mère n’était pas très intelligente. Je commençais à m’interroger. Elle n’était, certes, pas du tout intellectuelle. Mais elle était sagace, observatrice, et dans son bourdonnement quelques fois épuisant, elle était fine mouche, et perspicace.
Mon père s’était levé, il était sorti à jamais de la pièce. J’avais de Maman attendu qu’elle s‘abattre. Elle s’épanouissait. C’était La vieille dame indigne de Berthold Brecht. Je découvrais, là où je m’attendais le moins, ce que c’était que le poids de l’Autorité. […] » 2268 (Cf. Femmes. Intelligentes, Hommes. Autoritaires. Époux. Pères, Famille. Mariage, Patriarcat, Penser. Idées)
Femmes (Veuves) (28) : (27 décembre) 1974. Les femmes veuves des mineurs tués lors de la catastrophe minière de Liévin (42 morts. 142 orphelins) furent, du fait de l’argent qui leur fut versé, nommées « les veuves joyeuses ». 2269 (Cf. Économie. Argent)
Femmes (Veuves) (29) : 1977. Marthe Massenet [?-?], dans un livre intitulé Madame Veuve, fait état de la douleur causée par la mort de son mari, des difficultés notamment matérielles auxquelles elle est subitement confrontée, ainsi que des réactions de son entourage. Je lis :
« J’ai dû écrire une lettre particulièrement cafardeuse au Père [X], notre vieil ami. Il me rappelle à l’ordre, lui aussi : ‘La Sainte Vierge était veuve avant vous et elle n’avait pas de pension de reconversion’. Il a raison […]. » 2270 (Cf. Femmes. Vierges, Patriarcat, Politique. Religion, Économie. Argent)
Femmes (Veuves) (30) : 1980. Madeleine Renaud [1900-1994], dans La déclaration d’amour, se souvient :
« Ma mère voulait élever le mieux possible ses filles, ce qui était difficile pour une femme seule (veuve en 1904) à cette époque-là. Elle n’a jamais voulu se remarier à cause de nous. Je ne peux pas dire qu’elle entretenait à la maison le culte du père. Mais son silence était plein de son absence. [...] » 2271 (Cf. Femmes. Maison. « Seules »)
Femmes (Veuves) (31) : 1982. Marie Métrailler [1901-1979], dans La poudre de sourire, se souvient de son enfance dans le Valais (Suisse) :
« Mon grand-père est mort, très jeune d’une pneumonie vers les années 1875. [Ma grand-mère] est restée veuve avec trois enfants. […] Elle a repris le métier de coutelier. […] Elle était très vivante, très gaie, elle est morte en 1927, à l’âge de 75 ans. […]
Quand je pense à son existence ! Vois-tu jadis, on n’était pas tendre avec les veuves, pour [avec] les femmes qui se mariaient hors du village avec un étranger, pour [avec] les filles-mères. Surtout, c’était très mal vu qu’une veuve se remarie. Alors, ces femmes restaient complètement isolées chez elles. Parler avec un homme créait la suspicion… Elles sortaient le moins possible. Si elles réintégraient le sein de la famille paternelle, elles devenaient par la force des choses les domestiques de leur père, de leurs frères. » 2272 (Cf. Êtres humains. Domestiques, Femmes. Grands-mères, Famille)
Femmes (Veuves) (32) : 1990. Gilles Perrault [1931-2023], dans Notre ami le roi, après avoir évoqué le décès sous la torture au Maroc de Mohammed Diouri [1895-1953], poursuit :
« Quelques mois après son inhumation à Fès, la famille décide d’aller se recueillir sur sa tombe. Sa veuve doit obtenir une autorisation car, gérante d’un journal mal-pensant, elle n’a pas le droit de se déplacer. Prudente, elle refuse que ses deux fils montent dans la même voiture. Moumen empruntera le car. Un camion prend en écharpe l’auto familiale, tuant net la mère, le fils ainé, une sœur. Une jeep de la gendarmerie évacue prestement le chauffeur du camion. Au Maroc, la route est dangereuse. » 2273 (Cf. Femmes. Comment meurent les femmes ? Politique. État. Répression. Tortures)
Femmes (Veuves) (33) : 1992. Lu dans un Dictionnaire des femmes célèbres concernant :
- Kay Sage [« Peintre. Américaine. 1898-1963 »] : « Rentrée aux États-Unis en 1939, elle retrouva Yves Tanguy [1900-1955] qui était venu la rejoindre et l’épousa en 1940. Il la laissa veuve en 1955. »
- Claude Saint-Cyr [dite Simone Naudet. Modiste française. 1911-2002] : « En 1945, elle avait épousé le peintre Georges Martin [1906-1962] qui la laisse veuve en 1961. » Ou plutôt 1962. 2274
N.B. « Laisser » : « Maintenir quelqu’un, quelque chose, dans un état, un lieu, une situation »
Femmes (Veuves) (34) : 2003. Je lis dans le livre de Marcel Bernos, Femmes et gens d’Église dans la France classique. XVII-XVIIIème siècle :
« Dans la France d’Ancien Régime, la veuve a la réputation d’être la seule femme ‘libre‘ (un article de 1978 cité). Cette opinion est probablement à nuancer, et les remarques des médiévistes sur le ‘réemploi’ [!] des jeunes veuves par leurs familles pour de nouvelles alliances matrimoniales favorables au lignage restent sans doute en grande partie valable pour la période postérieure. La totale [!] liberté d’une femme semblait suspecte aux mentalités du temps, et à la porte de la licence. [!] Des théologiens critiquent les veuves qui ne le resteraient que ‘dans la seule pensée de vivre dans l’indépendance’ (un livre cité de 1697, réédité, corrigé et augmenté en 1719). » 2275
N.B. « Probablement à nuancer » : un euphémisme, pour le moins… (Cf. Penser. Vérité, Histoire)
Femmes (Veuves) (35) : 2004. Melania G. Mazzucco, dans Vita, auteure de :
« […] Elle n’éprouvait ni douleur ni gratitude, mais plutôt un trouble effaré à l’idée d’être encore vivante. Ses muscles, ses tendons, ses veines, ses articulations, ses os, ne poussaient qu’un cri : vivante. Je suis vivante, Vivante…
Devant elle s’ouvrait un gouffre terrifiant d’années dont elle ne savait que faire. […]. » 2276 (Cf. Corps, Famille. Couple, Penser)
Femmes (Veuves) (36) : 2005. Victorine [1911-2010], sur France Culture, « la vieille Bretonne », évoque sa vie :
« (Concernant les « siens ») : « J’ai en perdu trois le même jour : mon père, mon mari, mon frère (tous pêcheurs). […] Je me suis mariée à 21 ans. À 22 ans, j’étais veuve avec un enfant dans les bras. Vous savez combien qu’on avait de pension pour élever un gosse : 360 francs par an, alors qu’il y a 365 jours dans l’année. 5 jours sans manger [...]. Il fallait bucher… » 2277 (Cf. Femmes. Travail)
Femmes (Veuves) (37) : (6 novembre) 2018. Lu sur Franceinfo : « La ‘der des ders’ a fait 700.000 veuves, 750.000 orphelins et 1,4 million de morts côté français. » (Langage. Verbe. Faire, Patriarcat, Politique. Guerre, Histoire)
Femmes (Veuves) (38) : (3 mars) 2020. Entendu :
« Les épouses tristes font les veuves joyeuses ». (Cf. Femmes. Épouse de, Patriarcat. Proverbes)
Femmes (Veuves) (39) : (5 avril) 2020. Lu dans la chronique nécrologique de La Voix du Nord :
« Madame Suzanne Margollé, née Leprêtre, veuve de M. René Margollé » ; « Madame Annie Rousseau, née Guilbert, veuve de Monsieur Christian Rousseau » ; « Madame Françoise Watel, née Dubois. Veuve de Monsieur Jacques Watel ». (Cf. Femmes. Noms)
* Ajout. 2 août 2022. Lu dans la chronique nécrologique de La voix du Nord :
« Monsieur André Daullé. Veuf de Madame Françoise Honoré ». (Cf. Hommes. Veufs)
Femmes (Veuves) (40) : (9 octobre) 2022. Entendu sur France Culture, concernant la musicienne Alma Malher [1879-1964] :
« Elle en fera une carrière d’être la veuve de Malher. » 2278
Femmes (Veuves) (41) : (11 novembre) 2022. Je n’ai pas souvenir d’avoir entendu, vu, ni même évoqué une femme veuve de guerre Ukrainienne. Une mère, pas non plus.
Hier, j’ai entendu l’estimation de 100.000 mort-es Ukrainien-nes et 100.000 morts Russes. (Cf. Politique. Pacifisme. Médias. Bourrage de crâne. Guerre. Culture de guerre)
* Ajout. 22 avril 2023. Chiffre invérifié, invérifiable, et donc, sans aucun doute, faux.
* Ajout. 22 août 2023. Une amie me dit avoir entendu une veuve de guerre Ukrainienne.
Depuis lors, les paroles de ces femmes s’expriment. En lien, avec les échecs militaires ?
* Ajout. 1er janvier 2024. Lu, sur Franceinfo, un reportage :
« En presque deux ans de guerre en Ukraine, des dizaines de milliers de femmes sont devenues veuves. ‘J'essaie de pleurer quand je suis seule’, reconnaît l'une d'elles, mère de deux enfants. » (Cf. Femmes. Mères. Pleurs)
Femmes (Veuves) (42) : (22 février) 2023. Dans son « discours à la nation », Vladimir Poutine a présenté « ses hommages aux épouses et mères russes », puis s’est adressé « aux familles des combattants tués », pour enfin annoncer, par « la création d’un fonds d’État’ », « d’apporter une aide - personnelle - aux familles des victimes. »
Des « veuves », il n’y en a pas en Russie.
-------------
Femmes. Vies des femmes :
Femme (Vies des femmes) (1) : Une « vie - dite de - de femme », c’est vivre une vie-dite-de-couple (ou non), une vie dite-sexuelle (ou non), une vie dite-professionnelle (ou non), une vie dite-d’épouse (ou non), une vie dite-de mère (ou non), et même une vie de femme « multi-casquettes ».
Femmes (Vies des femmes) (2) : Une femme n’a de vie-de-femme que si elle vit, ou a vécu, avec un ou des hommes. Lorsque ceux-ci sont considérés comme trop nombreux - selon les normes patriarcales - elle n’a pas de vie [de femme] : elle est une ‘pute’ (et équivalents) ; lorsqu’ils sont considérés comme insuffisamment nombreux, elle est soit laissée pour compte, soit lesbienne. Évolue certes, mais si lentement…
Femme (Vies des femmes) (3) : Une femme ayant vécu « une vie - dite - de femme » peut vivre, en sus, une vie généralement considérée comme celle dévolue aux hommes. Un homme, s’il conteste, s’il récuse, s’il veut échapper à la vie telle qu’elle lui fut imposée, telle que généralement considérée comme dévolue aux hommes, n’aura jamais vécu qu’une vie d’homme.
Par ordre chronologique. Femmes. Vies des femmes :
Femmes (Vies des femmes) (1) : 1947. Louis Jouvet [1887-1951], dans Copie conforme, auteur de :
« Sa vie ne vaut pas ma liberté ». 2279
Ouvre la voie à de riches analyses politiques. (Cf. Culture. Cinéma, Patriarcat)
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. Victimes :
Femmes (Victimes) (1) : (7 février) 2019. Jean-Michel Blanquer, ministre de l’éducation nationale, auteur de :
« Le harcèlement dont les jeunes filles sont victimes »
Pour qu’elles le soient moins, dire, écrire, penser :
« Le harcèlement dont les jeunes garçons sont les auteurs ».
Et dans les deux cas, ajouter « dans la grande majorité ». (Cf. Femmes. Jeunes filles, Langage, Violences. Victimes)
Femmes (Victimes) (2) : (11 février) 2019. Entendu sur France Culture :
« Les femmes ne sont pas des victimes. » 2280 (Cf. Violences. Victimes)
Femmes (Victimes) (3) : (19 août) 2021. Michelle Perrot sur France Culture, concernant la mère - Marianne Michel - de Louise Michel [1830-1905] « une femme populaire », auteure de :
« Elle ne se plaint jamais ; c’est le contraire d’une femme victime. »
Faut-il se plaindre pour être une « victime » ? ; une « victime » est-elle définie par sa plainte ? (Cf. Relations entre êtres humains. Plainte, Violences. Victimes)
-------------
Par ordre chronologique. Femmes. « Vieilles filles » :
Femmes (« Vieilles filles ») (1) : 1850. Charles Dickens [1812-1870], dans David Copperfield, auteur de :
« Vous comprenez, Sophie est si utile dans sa famille qu’on ne pouvait pas supporter l’idée qu’elle [ne] put jamais se marier. Ils avaient même décidé, entre eux, qu’elle ne se marierait jamais et l’on l’appelait d’avance la vieille fille. » 2281 (Cf. Famille. Mariage, Économie)
Femmes (« Vieilles filles ») (2) : 1878. Émile Zola [1840-1902], dans Une page d’amour, auteur de :
« […] - Oui, c’est une grande perte, répétait la vieille fille, installée commodément dans un fauteuil. Moi, j’aurais adoré les enfants, les petites filles surtout. Eh bien quand j’y songe, je suis contente de ne pas m’être mariée. Ça évite des chagrins. » 2282
-------------
Femmes (Vieillesse) : 1732. Anne Thérèse de Lambert [1647-1733], dans son Traité de la vieillesse, auteure de :
« Un des avantages de la vieillesse, c’est la liberté. Le dernier âge nous affranchit de la tyrannie de l’opinion. Quand on est jeune, on ne songe qu’à vivre dans l’idée d’autrui : il faut établir sa réputation, et se donner une place honorable dans l’imagination des autres et être heureuse même dans leur idée : notre bonheur n’est pas réel ; ce n’est pas nous que nous consultons, ce sont les autres. Dans un autre âge, nous revenons à nous ; et ce retour à ces douceurs, nous commençons à nous consulter, et à nous croire : nous échappons à la fortune et à l’illusion ; les hommes ont perdu le droit de nous tromper ; nous avons appris à les connaître, et à nous connaître nous-mêmes ; à profiter de nos fautes qui nous instruisent autant que celles des autres : nous commençons à voir notre erreur d’avoir fait tant de cas des hommes ; ils nous apprennent souvent à nos dépens à ne compter sur rien ; les infidélités nous dégagent ; la fausseté des plaisirs nous désabuse. La vieillesse nous affranchit aussi de la tyrannie des passions, et nous fait éprouver que c’est un grand plaisir que de savoir s’en passer, et une grande volupté que de se sentir au-dessus d’elles. » 2283 (Cf. Femmes. Âgées. Heureuses. Réputation)
Et si on débutait ainsi sa jeunesse ?
Femmes (Violées. Zoo) : (11 juillet) 2013. Lu dans l’article du Figaro : Valérie Trierweiler au chevet des femmes violées du Congo Kinshasa :
« […] À l’hôpital de Panzi où l’on a soigné de nombreuses femmes violées, on s’étonne un peu : ‘Vous venez, vous pleurez, vous repartez et vous ne prenez pas les décisions qui s’imposent’, dit le docteur Désiré Alumeti, le médecin légiste de l’hôpital. ‘Nous disons merci à tous ces gens qui compatissent avec nous. On ne peut que dire merci. Mais il faut s’attaquer aux causes’.
Sur le tableau blanc de Vellada du bureau de communication de l’hôpital, le programme de la semaine est affiché : outre la délégation française, le ministre belge de la Coopération sera de passage à Panzi. Depuis le début de l’année, Ban Ki-mon, Angelina Jolie, le ministre britannique des affaires étrangères, William Hague et bien d’autres personnalités internationales ont été programmées pour des visites à l’hôpital.
‘Depuis des années que ces visites s’enchaînent sans que rien ne change, on commence à se sentir un peu comme un zoo, ici. Panzi, premier site touristique du Sud-Kivu ?’ s’interroge une aide’ soignante… [avec ce sens d’autodérision si congolais.] » conclut l’auteure de l’article du Figaro. 2284 (Cf. Violences. Violences à l’encontre des femmes. Viols)
Femmes. « Voilées » :
Femmes (« Voilées ») (1) : Lorsque quotidiennement je constate comment l’« occident » (la France donc) traite la vie quotidienne les femmes dans la publicité, les films, la presse, les émissions de radio, de télévision, justifie proxénétisme et pornographie, non seulement les femmes occidentales, mais celles aussi et surtout des pays qu’ils dominent, qu’ils exploitent, je me demande bien sur quelle légitimité les pays « occidentaux » (la France donc), se fondent pour juger, critiquer, condamner les femmes voilées, pour porter un jugement sur le principe même du voile.
Femmes (« Voilées ») (2) : Le niqab : empêche de respirer, de manger, de boire, de sentir, de voir : le monde extérieur réduit à la dimension d’une lucarne grillagée.
Femmes (« Voilées ») (3) : Des femmes, au nom de la liberté individuelle, revendiquant le port du Niqab, l’ « occident » est pris au piège de son concept majeur. Elles révèlent alors que la liberté fut et demeure un « concept » sinon erroné, du moins susceptible de trop d’interprétations, qui peuvent être antagoniques, pour être opérationnel.
Femmes (« Voilées ») (4) : Et si l’obligation, la contrainte, les pressions pour le port du voile par les femmes étaient le plus petit commun dénominateur des « branches », courants, écoles de l’Islam [que je ne connais pas] auquel pouvait adhérer les innombrables hommes inquiets de la montée du féminisme ? Un identité étatiste-religieuse patriarcale d’un « monde musulman » qui pouvait dès lors renforcer son pouvoir face à « l’occident » ?
L’imposition d’une identité, une visualisation, un marquage politique censé valable pour un État, une nation, mais dont seules les femmes sont les victimes. (Cf. Patriarcat, Politique. « Occident ». Religion)
Femmes (« Voilées ») (5) : La France colonialiste voulait dévoiler les algériennes, la France post-colonialiste interdit le voile.
La cohérence : l’évidence de la légitimité à imposer, à prescrire, à ordonner, à imposer. (Cf. Patriarcat, Politique. Colonialisme. Religion. Islam. État)
Par ordre chronologique. Femmes. « Voilés » :
Femmes (« Voilées ») (1) : 1790. Élisabeth Vigée-Lebrun [1755-1842], dans ses Souvenirs, déjà célèbre, après avoir fui la France révolutionnaire, arrive en Italie. Elle écrit :
« C’est aussi, je crois, pendant mon premier séjour à Romme que je revis l’abbé Maury [Jean Sifrein. 1746-1817], qui n’était pas encore cardinal ; il vint chez moi pour me dire que le Pape voulait que je fisse son portrait ; je le saisirais infiniment ; mais il fallait que je fusse voilée pour peindre le Saint-Père et la crainte de ne pouvoir ainsi rien faire dont je fusse contente, m’obligea à refuser cet honneur.
J’en eus bien du regret car Pie VI [1717-1799] était un des plus beaux hommes qu’on pût voir. » 2285 (Cf. Femmes. Artistes. Vigée-Lebrun Élisabeth)
Femmes (« Voilées ») (2) : (14 juin) 1910. Léon Tolstoï [1828-1910] écrit dans son Journal :
« Comme il serait naturel que les gens éclairés couvrent tout le corps, surtout les femmes, ne laissent à découvert que ce qui porte le sceau de la spiritualité - le visage. Dénuder le corps est maintenant le signe d’une chute. Cela devrait aussi chez les hommes. » 2286 (Cf. Corps. Visage)
Femmes (« Voilées ») (3) : 1969. Arthur London [1915-1986], dans L’aveu. Dans l’engrenage du procès de Prague, évoque l’Ouzbékistan soviétique (sans date) « où nombreuses les femmes continuaient à porter le voile alors qu'elles travaillaient déjà dans des grandes usines textiles ». 2287
Femmes (« Voilées ») (4) : 1994. Khalida Messaoudi, dans le Nouvel Observateur, auteure de :
« Le voile, c’est notre étoile jaune. » 2288
Femmes (« Voilées ») (5) : 1999. Je lis dans Imperium de Ryszard Kapuściński [1932-2007] le récit de l’un de ses voyages au Tadjikistan (soviétique) (sans date. autour des années 1960 ?) :
« Nous traversons le village. Les femmes Tadjikes s’arrêtent, nous tournent le dos, se protègent le visage de la main. La révolution a libéré ces visages du voile, les femmes ont ôté leur tchador, mais le réflexe est resté.
À l’Université de Douchanbé, j’ai fait la connaissance de Rokhat Nabïeva, la première femme tadjike à avoir obtenu en 1963 un titre scientifique. Le thème de sa thèse était la lutte contre le foulard islamique, lutte qui coûta la vie à des centaines de femmes ayant retiré leur voile. Les basmatchis [soulèvement des musulmans, notamment Turcs, de l’Asie centrale contre la domination coloniale exercée par l’empire russe, puis par la Russie soviétique entre 1916 et les années 1920] les exécutaient publiquement. […] » 2289 (Cf. Corps. Visage, Politique. Révolutions, Histoire)
Femmes (« Voilées ») (6) : 2010. Une belle chanson de Pierre Perret : La femme grillagée, dont le refrain est :
« Quand la femme est grillagée / Toutes les femmes sont outragées / Les hommes les ont rejetées / Dans l'obscurité »
Et dont la dernière strophe est :
« Jeunes femmes, larguez les amarres / Refusez ces coutumes barbares / Dites non au manichéisme / Au retour à l'obscurantisme / Jetez ce moucharabieh triste / Né de coutumes esclavagistes / Et au lieu de porter ce voile / Allez-vous-en, mettez les voiles. » (Cf. Patriarcat)
Femmes (« Voilées ») (7) : 2010. Catherine Clément, dans son autobiographie, Mémoire, auteure de :
« Je savais qu’en Ouzbékistan dans les années vingt [1920] la bataille du dévoilement des femmes qu’on appelait ‘Hudjum’, soutenue par Alexandra Kollontaï [1872-1952], avait fait des milliers de mortes, battues ou poignardées. » 2290 (Cf. Femmes. Remarquables. Kollontaï Alexandra, Histoire)
Femmes (« Voilées ») (8) : 2010. Michèle Le Dœuff, dans Le sexe du savoir, cite l’argument d’un « vieux jeune homme » :
« Je veux voir ce que je drague. » 2291
Femmes (« Voilées ») (9) : (janvier) 2012. Esprit publie les « Impressions du Caire », vécues pendant une semaine au Caire, par Hughes Lagrange, sociologue. « Entre réflexions politiques et description d’ambiance », dans lequel je lis :
- « Une femme en niqab me laisse entrevoir de beaux yeux, je m’attarde sur la ligne verticale du fil entre les yeux qui maintient l’ouverture étroite de l’étoffe. »
- « Les foulards larges [que l’on ne peut pas qualifier de « voile »] que portent les jeunes femmes leur donnent l’air de déesses de la période tardive, avec leur crinière symétrique. Le style des statues de pierre vieilles de trois mille ans a intégré les plis du tissu. »
- « Les foulards [idem] donnent aux femmes un air pré-Renaissance, j’admire les ovales qu’ils dessinent, soulignant leurs yeux noirs. »
- Il évoque enfin [après les « descriptions », « l’analyse » ?] : « le déclin des libertés des femmes par les contraintes vestimentaires. » 2292 (Cf. Hommes. « Intellectuels », Patriarcat, « Sciences » Sociales. Sociologie)
Femmes (« Voilées ») (10) : (20 octobre) 2014. Lu, dans Le Canard enchaîné que Christiane Taubira - PRG [Parti radical de gauche] - le 10 février 2004, avait voté contre la loi réduite à, présentée comme interdisant le port du voile à l’école [« Dans les écoles, collèges, lycées, le port des signes et tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. […]»]. Pour elle, le hijab est « un défi lancé à l’invisibilité institutionnelle des populations refoulées à la périphérie des villes. » 2293
Comprenne qui pourra…
Femmes (« Voilées ») (11) : (29 mars) 2019. Adila Bennedjaï-Zou, réalisatrice de la série d’émission Heureuse comme une arabe en France, sur France Culture, auteure de :
« Selon moi, la première fonction du débat sur le voile c’est de nous empêcher de réfléchir à autre chose. C’est comme si on passait notre temps à s’engueuler sur la couleur de la porte d’entrée alors qu’il y a toute la maison à refaire. » 2294 Analyse d’une large portée…
* Ajout. 22 octobre 2020. Jugement approprié concernant, en sus, le coronavirus et son masque.
Femmes (« Voilées ») (12) : (27 octobre) 2019. Tout discours - devenu obsédant, obsessionnel - sur le voile a pour fonction, pour résultat de détourner toutes les critiques, sur, à l’encontre des millions de musulmans et de musulmanes, vivant en France. (Cf. Hommes. Musulmans)
* Ajout. 14 janvier 2024. Il a aussi pour fonction, pour résultat, de détourner la réflexion sur l’Islam, sur ses diversités, ses contradictions, politiques, religieuses, sur les horreurs, les violences, qu’il justifie, sur l’Islam d’hier, d’aujourd’hui, de demain. (Cf. Patriarcat, Politique. Religion, Histoire)
Femmes (« Voilées ») (13) : (14 novembre) 2020. Alain Finkielkraut, sur France Culture, discutant de la pétition contre le voile à l’école du 2 novembre 1989 intitulée : Profs, ne capitulons pas, qu’il avait signé avec Régis Debray, Élisabeth de Fontenay, Élisabeth Badinter, Catherine Kintzler concernant les jeunes filles qui refusaient d’ôter leur voile auteur de :
« Ce n’étaient pas elles qui étaient exclues, c’était le voile. » 2295
Il faut oser… (Cf. Êtres humains, Femmes. Comment faire disparaître les femmes ? Jeunes filles, Patriarcat, Penser. Pensées. Abstraction)
N.B. Cette pétition évoquait « le Munich de l’école républicaine », formule revendiquée comme sienne ce jour par Régis Debray.
Femmes (« Voilées ») (14) : (17 août) 2021. Alain Finkielkraut, sur France Culture, évoque concernant l’Afghanistan, « les femmes bâchées ». Malaise (mais pas le concernant…) 2296
Femmes (« Voilées ») (15) : (7 février) 2022. Carlo Ossola, professeur au Collège de France, évoquant l’expérience de cours donnés dans des lycées par des professeurs du Collège de France, rapporte la réaction d’une « dame voilée avec ses enfants », à laquelle il fut demandé si elle avait compris ce qui avait été exprimé et qui répondit ceci :
« Je n’ai pas tout compris, mais j’ai compris l’essentiel, c’est que ces messieurs de Paris nous ont reconnu notre dignité. » 2297
Mépris de classe d’intellectuels, qui se satisfont de bien peu…
Femmes (« Voilées ») (16) : (6 mai) 2022. Alain Finkielkraut, sur France Culture, auteur de : « une femme très voilée ». (Cf. Langage. Adverbe)
Femmes (« Voilées ») (17) : (14 janvier) 2024. Entendu :
« Derrière le voile, un statut ».
Femmes (« Voilées ») (18) : (3 juillet) 2024. Lu dans Le Canard enchaîné (p.4), dans un article intitulé Soir de Fête en Lepénie, un adhérent du Rassemblement national affirmer :
« Une femme voilée, c’est une mosquée ambulante. Je le tiens d’un curé. »
Femmes (« Voilées ») (19) : (9 novembre) 2024. Delphine Mimouni, sur France Culture, présentant son livre Badgens [Éditions du seuil. 2024] cite ce slogan de femmes Iraniennes :
« Que notre sang coule, mais que nos voiles brûlent. »
Femmes (« Voilées ») (20) : (19 mars) 2025. À l’occasion du débat entre ministres - deux femmes contre deux hommes - concernant les femmes voilées dans le sport, constater que Bruneau Retailleau, ministre de l’intérieur et Gérald Darmanin, ministre de la justice, s’y opposent, me suffit.
Femmes (« Voilées ») (21) : (21 juin) 2025. Lu sur Franceinfo : « Environ vingt personnes ont agressé une femme voilée hier soir à Reims (Marne). Un individu a arraché le voile de la victime, avant de lui porter des coups au visage. La jeune femme a porté plainte, a appris l'AFP auprès du parquet. »
Autre rédaction lue sur Médiapart : « Une jeune femme a porté plainte, disant avoir été agressée jeudi soir à Reims par un groupe de personnes dont l’une lui a demandé de retirer son voile et l’a frappée. »
-------------
Femmes (Volcans) : (août) 2016. Vu, à La Bouboule, parmi de nombreuses cartes postales régionalistes, l’une d’entre elles représentant quatre femmes, de face, accroupies, côte à côte, les fesses en l’air, sous l’intitulé : Les volcans d’Auvergne.
Femmes (Volonté) : 1883. Émile Zola [1840-1902], dans Au bonheur des dames, auteur de :
- Mouret : […] « Alors, quand viendrez-vous, demanda-t-il de nouveau. Demain ? […]
- Denise : Je ne sais pas… Je ne puis pas… […]
- Mouret : De quoi donc avez-vous peur ? […]
- Denise : « Je n’ai peur de rien, monsieur… On fait seulement ce qu’on veut faire, n’est-ce pas ? Moi, je ne veux pas, voilà tout. » 2298
Femmes (Voltaire) : 1765. Voltaire [1694-1778], dans ses Nouveaux mélanges, auteur de :
« Qui est tu, toi, animal à deux pieds, sans plumes, comme moi-même, que je vois ramper comme moi sur ce petit globe ? Tu arraches comme moi quelques fruits à la boue qui est notre nourrice commune. Tu vas à la selle et tu penses ! Tu es sujet à toutes les maladies les plus dégoutantes, et tu as des idées métaphysiques ! J’aperçois que la nature t’a donné deux espèces de fesses par devant, et qu’elle me les a refusées : elle t’a percé au bas de ton abdomen un si vilain trou que tu es porté naturellement à le cacher. Tantôt ton urine, tantôt les animaux pensants sortent par ce trou ; ils nagent neuf mois dans cette liqueur abominable. Entre cet égout et un autre cloaque, dont les immondices accumulées seraient capables d’empester la terre entière ; et cependant ces sont ces deux trous qui ont produits les plus grands évènements. Troie périt pour l’un ; Alexandre et Adrien ont érigé des temples à l’autre. L’âme immortelle a donc ce berceau entre ces deux cloaques ! Vous me dites, madame, que cette description n’est ni dans le goût de Tibulle [54 ou 50-19 avant J.C], ni dans celui de Quinault [1635-1688] : d’accord, ma bonne ; mais je ne suis pas en humeur de te dire des galanteries. » 2299 (Cf. Êtres humains, Corps. Femmes. Vagin, Enfants, Femmes. Animalisation des femmes. Trous. Voltaire. Haine des femmes, Hommes. « Galants ». Grossiers. Voltaire, Patriarcat, Penser, Philosophie. Métaphysique)
Femmes (Yeux fermés) : Louis Althusser [1918-1990], auteur de :
« Je connais une jeune femme qui ferme les yeux quand elle me parle.
Et elle les ferme d’une manière extraordinairement belle.
Et quand elle ferme les yeux, ça veut dire qu’elle est vraiment avec moi. » 2300 (Cf. Êtres humains, Corps. Yeux, Hommes. « Intellectuels », Patriarcat)
XI. Femmes / Hommes (Comparaison…et inversement) :
Femmes / Hommes (Comparaison) (1) : Toute logique de comparaison, fut-elle la plus critique, interdit de s’interroger sur ce qui justement a créé les termes de la comparaison.
Femmes / Hommes (Comparaison…et inversement) (2) : Exemple d’’analyse’ : « Les hommes sont violents ». « Oui, mais les femmes aussi ». Fin du débat. Peut se varier à l’infini.
- Le vice-versa n’a jamais lieu d’être.
Par ordre alphabétique. Femmes / Hommes. Comparaison :
Femmes / Hommes (Arletty) : Refrain de la Chanson [Paroles d’Arletty [1898-1992] et chanté par elle] : La femme est faite pour l’homme :
« La femme est faite pour l'homme / Comme le pommier pour la pomme, comme l'oiseau pour le roseau et le nid pour l'oiseau / Comme l'eau pour la fleurette, la perdrix pour l’perdreau et la laine pour l'agneau / Comme le soleil pour les beaux jours, le pépin pour l’raisin et le gant pour la main / Comme le rond pour la serviette, le disque pour le phono et le doigt pour l'anneau / Comme la cage pour l'écureuil, le lorgnon l’est pour l'œil, et la mer pour le bateau / Comme le pneu pour l'auto, la baguette pour le tambour et le point pour le i / Comme le trou pour la souris, la poule pour le riz, et l'étui pour la lorgnette / Comme la bouteille pour le bouchon, la cloche pour le melon et l’cadre pour la photo / Comme le puits pour le seau, l'œuf pour la mouillette et l'chapeau pour la tête / Et le cœur pour l'amour ! » (Cf. Femmes. Artistes. Arletty)
Femmes / Hommes (Astell Mary) : 1706. Mary Astell [1666-1731], dans Some reflexions upon mariage, auteure de :
« Si tous les hommes naissent libres, comment se fait-il que toutes les femmes naissent esclaves ? » 2301 (Cf. Politique. Esclavage)
* Ajout. 21 février 2014. 1760. À comparer avec Jean-Jacques Rousseau [1712-1778], auteur, dans Du contrat Social [sa première phrase], de :
« L’homme est né libre et pourtant partout il est dans les fers. » 2302
Par ordre chronologique. Femmes / Hommes. Balzac Honoré de :
Femmes / Hommes (Balzac Honoré de) (1) : (15 février) 1834. Honoré de Balzac [1799-1850] écrit à Ewelina Hanska [1801-1882] :
« Il n’y a que les artistes qui soient dignes des femmes, parce qu’ils sont un peu femmes. » 2303
Femmes / Hommes (Balzac Honoré de) (2) : 1841. Honoré de Balzac [1799-1850], dans Mémoires de deux jeunes mariées, auteur de :
« Je ne me sens pas le moindre respect pour quelque homme que ce soit, fut-ce un roi. Je trouve que nous valons mieux que tous les hommes, même les plus justement illustres. Oh, comme j’aurais dominé Napoléon [1769-1821], ! Comme je lui aurais fait sentir, s’il m’eut aimé, qu’il était à ma discrétion ! » 2304 (Cf. Hommes. « Grands ». Napoléon, Relations entre êtres humains. Amour, Famille. Mariage. Balzac Honoré de, Patriarcat, Politique. Pouvoir)
Femmes / Hommes (Balzac Honoré de) (3) : 1846. Honoré de Balzac [1799-1850], dans La cousine Bette, auteur de :
« […] Et à voir cette jeunesse, dont la fraîcheur avait cédé sous les fatigues et les misères de l’exil, unie à cette figure sèche et dure, on aurait pensé que la nature s’était trompée en leurs donnant leurs sexes. » 2305 (Cf. Patriarcat, Sexes […])
-------------
Femmes / Hommes (Confiance) : Les hommes ont, dans leurs relations aux femmes, trop confiance en eux (ce qui, si souvent, les perd) ; les femmes, elles n’en ont pas assez (idem). Ils ont peur de paraître faibles (idem) ; les femmes de paraître fortes (Idem). N’y a-t-il pas moyen de régler le problème ?
Femmes / Hommes (Conte Paulo) : 2013. Paulo Conte, auteur (de mémoire) de :
« Les femmes n’aiment pas … le jazz. Nous, les hommes, on recherche toujours les choses les plus compliquées. » 2306
Par ordre chronologique. Femmes / Hommes. Corneille :
Femmes / Hommes (Corneille) (1) : 1639. Corneille [1606-1684], dans L’illusion comique (Acte II. Scène II), Matamore :
« Je te le dis encore, ne sois plus en alarme : Quand je veux, j'épouvante ; et quand je veux, je charme ; Et, selon qu'il me plaît, je remplis tour à tour les hommes de terreur, et les femmes d'amour. […] »
Femmes / Hommes (Corneille) (2) : 1658. Pierre Corneille [1606-1684], auteur de Stances à marquise que voici :
« Marquise si mon visage / A quelques traits un peu vieux / Souvenez-vous qu'à mon âge / Vous ne vaudrez guère mieux / Le temps aux plus belles choses / Se plaît à faire un affront / Et saura faner vos roses / Comme il a ridé mon front. / Le même cours des planètes / Règle nos jours et nos nuits / On m’a vu ce que vous êtes ; / Vous serez ce que je suis / Cependant j'ai quelques charmes / Qui sont assez éclatants / Pour n'avoir pas trop d'alarmes / De ces ravages du temps. / Vous en avez qu'on adore ; / Mais ceux que vous méprisez / Pourraient bien durer encore / Quand ceux-là seront usés. / Ils pourront sauver la gloire / Des yeux qui me semblent doux, / Et dans mille ans faire croire / Ce qu'il me plaira de vous. / Chez cette race nouvelle, / Où j'aurai quelque crédit, / Vous ne passerez pour belle / Qu'autant que je l'aurai dit. / Pensez-y belle Marquise, / Quoiqu'un grison fasse effroi, / Il vaut bien qu'on le courtise / Quand il est fait comme moi. »
- Georges Brassens [1921-1981], a vengé Marquise et toutes les femmes. Et révélé l’homme Corneille, en y ajoutant cette conclusion :
« […] Peut-être que je serai vieille / Répond Marquise, cependant / J’ai vingt-six ans mon vieux Corneille / Et je t’emmerde en attendant. » (Cf. Culture, Femmes. Beauté, Patriarcat)
-------------
Femmes / Hommes (Cossery Albert) : 2005. Albert Cossery [1913-2008], auteur de :
« Je hais les hommes. J’aime les femmes parce que, jusqu’à maintenant, elles n’ont pas commis de massacres. » 2307
Femmes / Hommes (David-Neel Alexandra) : Alexandra David-Neel [1868-1969] écrit à son mari :
« J’ai failli être médecin et ma mère seule a été la cause que je n’ai pas suivi cette carrière ». Et, en note, on découvre son argument : « Madame David disait à sa fille : ’Vous voulez être médecin ? Mais les hommes eux-mêmes n’y connaissent rien. Alors, pensez, une femme ?’ » 2308
Femmes / Hommes (Dhavernas Odile) : 1981. Odile Dhavernas, auteure dans Petite sœur née, prépare suicide de :
« […] Le mouvement (des femmes) m’offre des armes et me débarrasse enfin du rêve honteux, être un homme, ou comme un homme. » 2309
À cette simple phrase, je mesure les régressions politiques lisibles dans l’hégémonie actuelle de la soi-disant recherche d’ « égalité ». (Cf. Droit, Dhavernas Odile, Féminismes, Politique. Égalité)
Femmes / Hommes (Diderot Denis) : 1773. Denis Diderot [1713-1784], dans Ceci n’est pas un conte, auteur de :
« Écoutez, il vous respecte ; vous savez tout ce qu’il me doit. Peut-être rougira-t-il de se montrer à vous tel qu’il est. Non, je ne crois pas qu’il en ait le front ni la force. Je ne suis qu’une femme, et vous êtes un homme. Un homme tendre, honnête et juste en impose. Vous lui en imposerez. […] » 2310
Femmes / Hommes (Dostoïevski Fiodor) : 1875. Fiodor Dostoïevski [1821-1881], dans L’adolescent, auteur de :
« […] L’homme est une machine si compliquée que parfois on n’y comprend rien, surtout si cet homme est une femme. » 2311
Femmes / Hommes (Eliot George) : 1866. George Eliot [1819-1880], dans Felix Holt, le radical, auteure de :
« Je ne suis pas prête à renoncer au malheur d’être femme, quand je vois maintenant ce que peut être la bassesse d’un homme. » 2312
Femmes / Hommes (Finkielkraut Alain) : (23 avril) 2016. Alain Finkielkraut, auteur de :
« Les hommes et les femmes, ce n’est pas la même chose. » 2313 (Cf. Hommes. « Intellectuels », Féminismes. Antiféminisme, Penser)
Femmes / Hommes (Flaubert Gustave) : (10 décembre) 1869. Gustave Flaubert [1821-1880] écrit à Georges Sand [1804-1876] :
« Quelle bonne femme vous faites, et quel brave homme ! Sans compter le reste ! » 2314
Femmes / Hommes (Gentz Friedrich Von) : Friedrich von Gentz [1764-1832] à Rahel Varnhagen [1771-1833] :
« Savez-vous mon amie, pourquoi nos rapports sont si grands et si parfaits ? Vous êtes une créature infiniment productrice, et moi un être infiniment récepteur. Vous, vous êtes un grand homme ; et moi, je suis la première de toutes les femmes qui ont jamais vécu. […] » 2315
Lire la suite pour approfondir l’analyse…
Femmes / Hommes (Giacometti Alberto) : Alberto Giacometti [1901-1966], auteur de :
« Une femme, je la fais immobile et l’homme je le fais toujours marchant. » 2316
* Ajout. 15 février 2021. (4 novembre) 1945. Michel Leiris [1901-1990] écrit dans son Journal : « Dans l’après-midi, visite à l’atelier de Giacometti [1901-1966], qui travaille toujours à la figure féminine qu’il a entreprise il y a plusieurs années […] Quant à la figurine (femme debout, dans la position la plus simple : celle du garde-à-vous (sic) […] ». 2317 (Cf. Culture. Statues, Femmes. « Féminin », Patriarcat. Statuaire)
* Ajout. 25 août 2023. Je découvre la sculpture de Giacometti. La Grande Femme.I. 1960. Bronze. 272 x 35 x 54cm.
Femmes / Hommes (Goncourt Edmond et Jules de) : (18 octobre) 1867. Edmond [1822-1896] et Jules [1830-1870] de Goncourt écrivent dans leur Journal :
« Il y a des hommes. Il y a la femme. » 2318 (Cf. Patriarcat)
Femmes / Hommes (La Bruyère Jean de) : 1688. Jean de La Bruyère [1645-1696], dans Les Caractères - Les femmes - auteur d’un pertinent jugement, partiellement juste… comme tous les jugements :
« Les hommes sont cause que les femmes ne s'aiment point. » 2319 (Cf. Patriarcat. La Bruyère Jean de)
Femmes / Hommes (La Fontaine Jean de) : 1693. Jean de La Fontaine [1621-1695], dans Le corbeau, la gazelle, la tortue et le rat, auteur de :
« […] Car cet esprit qui né du firmament / A beauté d’homme avec grâces de femme […] » 2320
Femmes / Hommes (Marquez Gabriel Garcia) : 2007. Gabriel Garcia Marquez [1927-2014], dans Vivre pour la raconter, auteur de :
« […] ce sont [les femmes] qui soutiennent le monde tandis que nous en troublons l’ordre avec notre brutalité séculaire. » 2321 (Cf. Patriarcat, Violences)
Femmes / Hommes (Novalis) : Novalis [1772-1801], auteur de :
« La femme est le symbole de la bonté et de la beauté ; l’homme celui de la vérité et du droit. » 2322 (Cf. Langage. Symbole, Penser. Pensées. Binaires)
Femmes / Hommes (Obama Barak) : (19 juillet) 2018. Dans son discours à Johannesburg à l’occasion du centenaire de la naissance de Nelson Mandela [1918-2013], Barak Obama [président des États-Unis de 2009 à 2017], afin d’illustrer que « tous [traduction française] sont humains », nomme notamment :
« […] les femmes et les hommes, les homosexuels et les hétérosexuels […] »
Des sous-catégories ? 2323 (Cf. Êtres humains, Sexes […])
Femmes / Hommes (Onfray Michel) : (28 août) 2015. Michel Onfray, auteur de :
« […] Un homme et une femme, c’est exactement la même chose. […] » 2324 (Cf. Hommes. « Intellectuels ». Onfray Michel)
Femmes / Hommes (Pivot Bernard) : (9 janvier) 1981. Bernard Pivot, auteur de :
« En six ans d’Apostrophes [émission culturelle de télévision. 1975-1990], j’ai bien dû vous proposer une demi-douzaine au moins d’émissions sur les femmes en général et sur le féminisme en particulier. Mais sur les hommes, rien ! Alors, à la faveur de quelques livres qui m’ont paru intéressants, je me suis dit : Et si on parlait aussi des hommes ? Notez que parler des femmes, c’était déjà parler des hommes et que parler des hommes, c’est encore parler des femmes… » 2325
Femmes / Hommes (Prévert Jacques) : Jacques Prévert [1900-1977], auteur de :
« Moi, ça ne m’intéresse pas, l’Homme. Ce qui m’intéresse, ce que j’aime, ce sont les femmes, les enfants, les hommes. Mais l’Homme, l’Homme, l’Homme ! » 2326 (Cf. Hommes. Remarquables. Prévert Jacques)
Femmes / Hommes (Prévost Antoine-François) : 1731. Antoine François Prévost [1697-1763], dans Manon Lescaut, auteur de :
« Tu es une femme, il te faut un homme ; […]. » 2327
Femmes / Hommes (Radio courtoisie) (radio d’extrême-droite) : (29 décembre) 2017. Xavier Dor, président de SOS tous petits, qui considère l’avortement [dont, pour lui, l’usage du stérilet fait partie] comme un « crime », auteur de :
« Je tiens la femme pour supérieure à l’homme. Elle est proche de l’enfant. […] C’est le trésor de l’humanité. »
- Un homme (jeune) dans le studio ajoute alors :
« C’est pour cela que les hommes doivent en prendre soin. » 2328
Femmes / Hommes (Robert Paul) : 1976. Paul Robert [1910-1980], le père du dictionnaire Le Robert, auteur de :
« [Dans les dictionnaires] Le mot Femme… est le plus important. J’étais le rédacteur - et je m’en félicite - de l’article Femme. Et, pour essayer d’être tout à fait objectif, j’ai confié la rédaction de l’article Homme à une personne du sexe féminin [présente]. [Rire].
Et elle a fait - savez-vous ? - un article deux fois plus important que l’article Femme.
- Cela veut dire que l’homme est deux fois plus important que la femme ?
- Voilà … Mais en fait il était normal que l’article Homme soit deux fois plus long, car il y a il y a l’homme : être humain et : l’homme viril. » 2329 (Cf. Femmes. « Féminin », Hommes. « Virils », Penser, Patriarcat)
Femmes / Hommes (Sévigné Madame de) : (30 janvier) 1680. Madame de Sévigné [1626-1696], auteure de :
« M. de Luxembourg [1628-1695] est entièrement déconfit : ce n’est pas un homme, ni un petit homme, ce n’est pas même une femme, c’est une petite femmelette. » 2330 (Cf. Femmes. Femmelettes, Langage. Féminisation du langage. Voltaire)
Femmes / Hommes (Société des membres de la Légion d’honneur) : (8 mars) 2016. L’un des responsables de la Société des membres de la Légion d’honneur, après avoir évoqué le « grand universalisme » qui caractérise la Légion d’honneur, après avoir constaté qu’il « y a eu un truc très important, c’est la parité », auteur de :
« À un moment donné, on s’est aperçu que la femme, c’était un homme aussi et donc qu’il fallait aussi lui donner la Légion d’honneur… » 2331 (Cf. Politique. Parité)
Femmes / Hommes (Thackeray William Makepeace) : 1848. William Makepeace Thackeray [1811-1863], dans La foire aux vanités, auteur de :
« […] Nous avons dit que Joseph Sedley était aussi vain qu’une jeune fille. Nous savons bien que les jeunes filles retournent la médaille et disent d’une personne de leur sexe : ‘Elle est vaine comme un homme’, et elles ont bien raison. Le sexe barbu est aussi âpre à la louange, aussi précieux dans sa toilette, aussi fier dans sa puissance séductrice, aussi convaincu de ses avantages personnels que la plus grande coquette du monde. » 2332 (Cf. Femmes. « Coquettes ». Jeunes filles, Hommes. Féminisme, Relations entre êtres humains. Louanges. Vanité)
-------------
1 Les Cahiers du Grif. In : La société des femmes. Éditions complexe. 155p. 1992. p.86
2 Honoré de Balzac, Le père Goriot. Libraire Joseph Gilbert. 249p. (sans date). p.15
3 George Sand, Correspondance. Georges Lubin. Classiques Garnier. Tome XVIII. 761p. 1984 p.195 et note 1
4 Victor Hugo, L’homme qui rit. Gallimard. 616p. 1978. p.196
5 Victor Hugo, L’homme qui rit. Gallimard. 616p. 1978.p .265
6 Victor Hugo, L’homme qui rit. Gallimard. 616p. 1978. p.494
7 Jules Vallès, Oeuvres I. 1857-1870. La Pléiade. 1781p. 1975. p.1212
8 Table ronde. Homme / Femme : égalité et différences. In : L’exigence d’égalité. XXVIIIème Rencontres internationales de Genève. Éditions La Baconnière. Neuchâtel. 320 p. 1982. p.254
9 A.L Thomas, Diderot, Madame d’Épinay, Qu’est-ce qu’une femme ? Un débat préfacé par Élisabeth Badinter. POL. 194p. 1989. p.47
10 Sylviane Agacinski, Journal interrompu. 24 janvier -25 mai 2002. Seuil. 157 p. 2002. p.48
11 In : Philippe de Gaulle, De Gaulle, mon père **. Entretiens avec Michel Tauriac. Plon. 556p. 2004. p.247
12 Maurice Mességué. 16 octobre 1969. In : Jacques Chancel, Radioscopie. Vol. 1. J’ai lu. 215p. 1975. p.108
13 Christiane Rochefort, Ma vie, revue et corrigée par l’auteur. Stock. 359p. 1978. p.170
14 Léon Tolstoï, Jeunesse. In : Souvenirs et récits. La Pléiade. 1591p. 1960. p.321
15 Émile Zola, Correspondance. I. 1858-1867. Les Presses de l’Université de Montréal. Éditions du CNRS. 594p. 1978. p.259, 260
16 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. II. Une page d’amour. La Pléiade. 1748p. 1961. p.822
17 George Sand, Correspondance. Georges Lubin, Classiques Garnier. Tome XX. 942p. 1985. p.274
18 Tolstoï, Journaux et Carnets. I. (1847-1889). La Pléiade. 1451p. 1979. p.536, 1304
19 In : Paul Léautaud, Journal particulier. 1935. Le Mercure de France. 346p. 2012. note 125. p.338
20 In : Jean Tulard, Guide des films. 1895-1995. Édition du centenaire du cinéma. L.Z, 1479p. 1995. p.984
21 Françoise Dolto, Sexualité féminine. Scarabée & Co / A. M. Métailié. 346p. 1982. p.10
22 In : Georges Solovieff, Madame de Staël, ses amis, ses correspondants. Choix de lettres [1778-1817]. Éditions Klincksieck. 586p. 1970. p.107
23 Françoise d’Eaubonne, Mémoires irréductibles. Éditions Dagorno. 1135p. 2001. p.562
24 Jean-Paul Sartre, Entretiens sur moi-même. In : Situations X. Gallimard. NRF. Gallimard. 226 p. 1976. p.123
25 Ibid., p. 203, 205. Les deux interviews (différents) datent de 1975, dans le premier, Sartre répond à Simone de Beauvoir, dans le second à Michel Contat. Seule la publication ultérieure dans un même livre permet de les comparer.
26 Milena Jesenskà, Vivre. Lieu commun. 285p.1985. p.54
27 Charles Dickens, David Copperfield. Le livre de poche. Classique. 1024p. 2008. p.449
28 Alfred de Musset, Les caprices de Marianne. 1833. Acte II. Scène IV
29 Louis Aragon, Les beaux quartiers. Folio. Gallimard. 625p. 2012. p.361
30 Le journal de Caroline B. Enquête de Michelle Perrot et Georges Ribeill. Artaud. Montalba. 253p. 1885. p.21
31 Hervé Gattegno, Anne-Cécile Sarfati, Femmes au pouvoir. Récits et confidences. Stock. 402p. 2007. p.399
32 Choderlos de Laclos, Œuvres complètes. La Pléiade. 1713p. 1979. p.1068
33 Voltaire, Correspondance. V. (janvier 1758-septembre 1760). La Pléiade. 1698p. 1980. p.718, 1432, 1023
34 Jean Tulard, Guide des films. 1895-1995. Édition du centenaire du cinéma. L.Z. 1479p. 1995. p.736
35 Émile Zola, Correspondance. I. 1858-1867. Les presses de l’Université de Montréal. Éditions du CNRS. 594p. 1978. p.143
36 Marthe Massenet, Madame veuve. Elles-mêmes. Stock. 193p.1977. p.19
37 Gina Lombronso, La femme au prise avec la vie. (Traduit de l’italien) Payot. 279p. 1924. p.156,157
38 Samuel Pepys, Journal. I. 1660-1664. Bouquins. Robert Laffont. 1994. 1365p. p. 717, 718
39 George Sand, Histoire de ma vie. In : Œuvres autobiographiques. II. La Pléiade. 1638p. 2001. p.99
40 Hubert Juin, Préface de L’Art d’aimer. Folio. Classique. Gallimard. 173 p. 1994. p.16
41 France Culture, Wadii Mouawad. 30 juillet 2019
42 Fiodor Dostoïevski, Les frères Karamazov, Le club français du livre. 1060p. 1956. p.96
43 George Sand, Correspondance. Georges Lubin. Classiques Garnier. Tome XVIII. 761p. 1984 p.167
44 Sigmund Freud, Le malaise dans la culture. GF. Flammarion. 218p. 2010. p.120
45 Jean Tulard, Guide des films. 1895-1995. Édition du centenaire du cinéma. L.Z, 1479p. 1995. p.1.000
46 Léon Tolstoï, La guerre et la paix. La Pléiade. Traduction de Pierre Pascal. 1654 p. 1945. p.382 (Livre 2)
47 Les invisibles. Sébastien Lifshitz. [2012]
48 Mgr Tissier (évêque de Chalons), La femme au foyer. Pierre Téqui, Libraire-éditeur. 322 p. 1916. p.185
49 Paul Léautaud, Journal particulier. 1935. Mercure de France. 343p. 2012. p.330
50 Jean Tulard, Guide des films. 1895-1995. Édition du centenaire du cinéma. L.Z. 1479p. 1995. p.913
51 Benjamin Constant. Isabelle de Charrière. Correspondance. 1787-1805. Desjonquières. 536p. 1996. p.284
52 Doris Lessing, Le rêve le plus doux. J’ai lu. Flammarion. 636p. 1964. p.63
53 Benjamin Constant, Journal intime (1811-1816). In : Œuvres complètes. VII. Max Niemeyer Verlag. 731p. 2005. p.212
54 In : Jean Tulard, Guide des films. 1895-1995. Édition du centenaire du cinéma. L.Z. 1479p. 1995. p.1230
55 François Mauriac, Mémoires intérieurs. Le livre de poche. 384p. 1966. p.145
56 Pauline Réage, Histoire d’O. Chez Jean-Jacques Pauvert. 247p. 1961. p.83
57 Céline, Voyage au bout de la nuit. Folio Plus Classiques. 615p. 2006. p.105, 106
58 Jean Tulard, Guide des films. 1895-1995. Édition du centenaire du cinéma. L.Z. 1479p. 1995. p.1176
59 Lisible sur internet
60 Voltaire, Correspondance. VII. (janvier 1763-mars 1765). La Pléiade. 1590p. 1981. p.134
61 In : Hippolyte Taine, Les origines de la France contemporaine. Bouquins. Robert Laffont. 1707p. 2011. p.889
62 Émile Zola, Correspondance. VI. 1887-1890. Les Presses de l’Université de Montréal. Éditions du CNRS. 524p. 1987. note 2. p.368
63 In : D. H. Lawrence, L’homme et la poupée. Gallimard. 297p. 1933. p.143
64 Léon Tolstoï, Journaux et Carnets. I. (1847-1889). La Pléiade. 1451p. 1979. p.1136
65 François Mauriac, Le nœud de vipères. Bernard Grasset. 311p. 1932. p.285
66 A. Jourcin et Ph. Van Tieghem, Dictionnaires des femmes célèbres. Collection : Les dictionnaires de l’homme du XXème siècle. Larousse. 256p. 1969. p.37
67 Jules Michelet, Journal. Folio. Classique. Gallimard. 1144p. 2017. p.828
68 Lucienne Mazenod, Ghislaine Schoeller, Dictionnaires des femmes célèbres. De tous les temps et des tous les pays. Bouquins. Robert Laffont. 932p. 1992. p.626
69 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. II. Son excellence Eugène Rougon. La Pléiade. 1748p. 1961. p.67
70 France Culture, Politique. 13 mars 2021
71 Gustave Flaubert, Correspondance. III. (janvier 1859-décembre 1868). La Pléiade. 1727p. 1991. note 4. p.1070
72 Honoré de Balzac, Illusions perdues. Garnier frères, 876p. 1969. p.398
73 Lettres de Mademoiselle de Lespinasse. Précédées d’une notice de Sainte-Beuve et suivies des autres écrits de l’auteur et des principaux documents qui le concernent. Classiques Garnier. Librairie Garnier. 434p. s. d. p.85, 86
74 Jean Tulard, Guide des films. 1895-1995. Édition du centenaire du cinéma. L.Z. 1479p. 1995. p.287
75 Hippolyte Taine. Sa vie et sa correspondance. Correspondance de jeunesse.1847-1853. Hachette. 368p. 1902. p.60
76 France Culture, Billie Holiday. Une vie, une voix. Black lady. 26 juillet 2017
77 Léon Bloy, Le sang du pauvre. In : Léon Bloy. Essais et pamphlets. Bouquins. 1536p. 2017. p.446
78 Honoré de Balzac, Illusions perdues. Garnier frères. 1969. 876p.
79 Honoré de Balzac, La cousine Bette. Éditions Garnier frères. 496p. 1974. p.66
80 Victor Hugo, L’homme qui rit. Éditions Pocket. 762p. 2016. p.347
81 Michel Leiris, Journal. 1922-1989. Quarto. Gallimard. 1052p. 2020. p.486
82 Jacques Prévert, Œuvres complètes. II. La Pléiade. Gallimard. 1553p. 1996. p.12
83 Voltaire, Correspondance. VI. (octobre 1760-décembre 1762). La Pléiade. 1648p. 1980. p.264
84 Marivaux, La vie de Marianne. Folio. Classique. Gallimard. 778 p. 2014. p.651
85 Marivaux, La Colonie, In : Théâtre complet. Tome second. Classiques Garnier. 1.208p. 1999. p.685
86 In : France Culture, Cécile Sorel. Confessions d’une comédienne. 18 décembre 2017
87 Jean Tulard, Guide des films. 1895-1995. Édition du centenaire du cinéma. L.Z. 1479p. 1995. p.664
88 Honoré de Balzac, Lettres à Madame Hanska. I. 1832-1844. Bouquins. Robert Laffont. 957p. 1990. p.24, 78
89 George Eliot, Le moulin sur la Floss. Folio. Classique. Gallimard. 738p. 2003. p.441
90 Victoria Man, Marcelle Devaud. Itinéraire exceptionnel d’une femme politique française. Eulina Carvalho. 155p. 1997. p.131
91 Hippolyte Taine, Sa vie et sa correspondance. Correspondance de jeunesse.1847-1853. Hachette. 368p. 1902. p.76, 77
92 Journal de l’abbé Mugnier. 1879-1939. Le Temps retrouvé. Mercure de France. 639p. 2007. p.474
93 France Inter, Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal, Les Mémoires du duc de Saint- Simon. 27 août 2016. [1ère diffusion. 5 septembre 2015]
94 In : Les soirées de Médan. Les cahiers rouges. 239p. 1990. p.24
95 Sénèque, La constance du sage. In : Entretiens, Lettres à Lucilius. Bouquins. Robert Laffont. 1103p. 2010. p.329
96 Katherine Mansfield, Journal. Folio. Gallimard. 507p. 2000. p.448
97 Jean Racine, Esther. Acte II. Scène VII
98 Alberto Savino, Hommes, racontez-vous. Gallimard. 316p. 1978. p.70
99 Guide des Jeunes Ménages. Éditions R. Girard &Cie. 224p. s. d. (Début années 60) p.189
100 France Culture, Grands écrivains. Grandes conférences. Séverine / Vallès. 12 août 2015
101 Louis Joinet, Mes raisons d’état. Mémoires d’un épris de justice. La Découverte. 351p. 2013. p.198
102 Anaïs Nin, Journal. 1931-1934. I. Stock. Le livre de poche. 506p. 1966. p.267
103 Jean Davezies, Le temps de la justice. La Cité. Éditeur. Lausanne. 162p. 1961. p.92, 93
104 Montesquieu, Considérations sur les causes et la grandeur des romains et leur décadence. Garnier-Flammarion. 188p. 1968. p.104
105 Noam Chomsky, Glance criticizes on the USA. In : Noam Chomsky, Regard critique sur l’Amérique, Le Monde. 16 janvier 2009
106 Autre futur. net, Fabien D. À propos des États-Unis et des mouvements sociaux. Entretiens avec Noam Chomsky. 21 juin 2015
107 Nelson Mandela, Un long chemin vers la liberté. Le livre de poche. 767p. 2010. p.113, 114
108 Christine Ockrent, Françoise Giroud. Une ambition française. Fayard. 364p. 2003. p.157
109 Dictionnaire des synonymes français. Reverso
110 Eugène Delacroix, Journal. Tome I. (1822-1857). José Corti. 1214p. 2009. p.92
111 Victor Hugo, Les misérables. La Pléiade. 1805p. 1951. p.728
112 France Culture, Une vie, une oeuvre. Luigi Pirandello. 7 avril 2109 [1ère diffusion. 5 septembre 1996]
113 Le Monde, Italie. 31 décembre 1971
114 François-René de Chateaubriand, Mémoires d’Outre-tombe. I. La Pléiade. 1232p. 1983. p.138
115 Cf. Armel De Lorme, Dictionnaire des actrices du cinéma français.1929-1944. Tome I. 2018
116 Le Canard enchaîné, Cancaneries. 16 mai 2018. p.5
117 France Culture, Nuit Chantal Akerman. 10 février 2018
118 Marie-Thérèse Luiggi, Marie-Louise Girod, la dame d’en haut. Montauban, Impr. Lormand. 166p. 2013. p.43
119 France Musique. 18 septembre 2019
120 France Culture, LSD. 14/18. La guerre racontée par les archives. 7 novembre 2018
121 France Culture, Arletty, Lady Paname. 13 mai 1987. [Rediffusion. 16 juin 2017]
122 Chaine Histoire, Un film et son histoire. Les enfants du paradis. 20 décembre 2021
123 Lauren Bacall, par moi-même. Stock. 604 p. 1979. p.598
124 Honoré de Balzac, La cousine Bette. Éditions Garnier frères. 496p. 1974. p.343
125 France Culture, Une vie, une œuvre. Barbara [1930-1997], une femme-passion en automne. 18 novembre 2017
126 Barbara, Il était un piano noir. Mémoires interrompus. Le livre de poche. 189p. 1998. p.17
127 Entretien accordé à Vogue Hommes International, In : Closer, sous le titre : Brigitte Bardot : ‘J’ai plus de couilles que beaucoup d’hommes’. 13 septembre 2012
128 Le Figaro. AFP, Marine Le Pen sur CBS : ‘La France, c’est Brigitte Bardot.’ 4 mars 2017
129 Le Figaro, Brigitte Bardot : ‘J’ai été prisonnière de moi-même toute ma vie.’ 10 mars 2017
130 Le Canard enchaîné, Zigzag. 20 février 2019. p.5
131 Jean-Claude Brialy, Le ruisseau des singes. Pocket. Robert Laffont. 510p. 2001. p.227, 233
132 Érudit, Jeannie Euvrard, Entretien avec Yannick Bellon. n°82. 1996
133 France Musique, Les grands entretiens. Teresa Berganza. 20mars 2020. 8h 30
134 Jules Renard, Journal. La Pléiade. 1434p. 1965. p.428
135 Ma double vie. Mémoires de Sarah Bernhardt. Tome deuxième. (Dixième mille). Bibliothèque Charpentier. 283p. 1923. p.132
136 A. Klumpke, Rosa Bonheur, sa vie, son œuvre. 1909, Ernest Flammarion, p. 419-421 Reproduit sur la page de Marie-Josèphe Bonnet. Le testament de Rosa Bonheur (1898) 17 avril 2016
137 In : Marie-Josèphe Bonnet, Un choix sans équivoque. Denoël. Gauthier. 293p. 1981. p.201, laquelle, elle-même cite sa source : Anna Klumpe, Rosa Bonheur, Sa vie, son œuvre. Flammarion. 1909. p.358
138 France Culture, Rosa Bonheur, peinte animalière ambitieuse et femme à facettes. 20 août 2020 [1ère diffusion. 16 avril 2016]
139 In : George Steiner, Maîtres et disciples. NRF. Essais Gallimard. 204 p. 2003. p.141
140 France Musique, Les grand entretiens. Émile Naoumoff. 25-29 janvier 2021
141 Source à retrouver
142 France Culture, Louise Bourgeois. 11 septembre 2019
143 Interview par Pierre Desgraupes. 1959. In : Arte. 16h. 2 mars 2008
144 France Musique, Du caf’ conc’ à la rive gauche : Un cabaret à part : ‘Chez Agnès Capri’ . 21 août 2013
145 France Culture, Chansons boum. Hommage à Agnès Capri. 1er juillet 2012. [2ème diffusion. 10 juillet 2017]
146 France Culture, Rétro. La mort de Martine Carol. 16 juillet 2017 [1ère diffusion. 2 février 1992]
147 Les dames du Bois de Boulogne, [mauvais] film de R. Bresson. 1945
148 France Culture, Toute une vie. Maria Casarès. Une force solaire. 21 mai 2022 [1ère diffusion. 9 février 2019]
149 Michel Foucault, Œuvres. I. La Pléiade. 1640p. 2015. p.LIV ; Œuvres. II. La Pléiade. 1740p. 2015. p.XXXVIII
150 Voltaire, Correspondance. VIII. (avril 1765-juin 1767). La Pléiade. 1663p. 1983. p.140
151 In : Voltaire, Correspondance. VIII. (avril 1765-juin 1767). La Pléiade. 1663p. 1983. p.1256
152 Paul Claudel, Journal. II. La Pléiade. 1360p. 1969. p.239, 1005, 1006
153 Camille Claudel, Correspondance. Édition d’Anne Rivière et Bruno Gaudichon. Gallimard. Arts et artistes. 2003. 332p.
154 Les passions d’Henri Guillemin. À la Baconnière. 448p. 1994. p.82, 83
155 Edmond et Jules de Goncourt, Journal. Mémoires de la vie littéraire. (1887-1896). Bouquins. Robert Laffont. 1461 p.1956. p.959
156 Le Canard enchaîné, Félix Fénéon. 4 septembre 2019. p.7
157 Michel Leiris, Journal. 1922-1989. Quarto. Gallimard. 1052p. 2020. p.277
158 France Culture, Marlène Dietrich. Un ange passe. 19 octobre 2015
159 Marlène Dietrich, Marlène D. Le livre de poche. 319 p. 1984. p.76, 124, 125
160 Marlène Dietrich, Marlène D. Le livre de poche. 319 p. 1984. p.72, 73
161 George Sand, Histoire de ma vie. In : Œuvres autobiographiques. II. La Pléiade. 1638p. 2001. p.242
162 France Culture, Mémoire du siècle. Paulette Dubost. 18 mars 2017 [1ère diffusion. 8 novembre 1992]
163 Hélène Duc, Entre cour et jardin. Éditions Pascal. Biographie. 267p. 2005. p.40
164 Isadora Duncan, Ma vie. Folio. Gallimard. 447p. 2016. p.34, 43, 303, 304, 315, 374, 403, 414
165 Voltaire, Correspondance. I. (1704-1738). La Pléiade. 1735p. 1964. p.300. 1354
166 Isadora Duncan, Ma vie. Folio. Gallimard. 447p. 2016. p.359, 249, 250, 254
167 In : France Musique, Lionel Esparza. Portrait de Kathleen Ferrier. 17 décembre 2020
168 Elisabeth Schwarzkopf, Les autres soirs. Mémoires. Tallandier. 367p. 2004. p.90, 91
169 Hélène Duc, Entre cour et jardin. Éditions Pascal. Biographie. 267p. 2005. p.122
170 France Culture, Les nouvelles voix de femmes du flamenco : Esperanza Fernandez. 17 décembre 2017 [1ère diffusion. 26 avril 2002]
171 Franceinfo, Vidéo. Contre ‘l’injonction à être sexy’, Sara Forestier refuse d’être coiffée et maquillée sur France 2. 7 novembre 2017
172 Victor Hugo, Correspondance familiale et écrits intimes. Tome 1. 1802-1828. Robert Laffont. 972p. 1988. p.139, 206, 209, 211, 250, 291, 292
173 France Musique, Du caf conc’ à la rive gauche. 30 juillet 2013
174 Huffington Post, Aux Molières 2017, le sketch audacieux de Blanche Gardin. 30 mai 2017
175 Le Figaro, Chantal Goya, Encore debout. 14 janvier 2014
176 Marie-Hélène Luiggi, Marie-Louise Girod. La dame d’En Haut. Montauban, Impr. Lormand, 166p. 2003. p.35
177 Hélène Grimaud, Variations sauvages. Robert Laffont. 286p. 2003. p.186, 204
178 Wikipédia. Alice Guy
179 France Culture, Qui est Alice Guy ? 11 décembre 2019 [1ère diffusion. 2 juillet 1975]
180 France Culture, Toute une vie à inventer le cinéma : Alice Guy [1873-1968], la femme aux mille films. 12 septembre 2020
181 Dominique Desanti, La femme au temps des années folles. Le livre de poche. 447p. 1984. p.169 à 172
182 France Culture, Billie Holiday. Une vie, une voix. Black lady. 26 juillet 2017
183 Ciné Classique, Nelly Kaplan, l’œil, la plume, le destin. 7 août 2018
184 Élisabeth Vigée-Lebrun, Souvenirs. I. Une édition féministe de Claudine Herrmann. Des Femmes. 360p. 1984. p.160, 167
185 Wikipédia. Oum Khaltoum
186 France Culture, Les Regardeurs. Les deux Frida. 29 janvier 2017
187 Aline R. de Lens, Journal.1902-1924. La cause des livres, 365 p. 2007. p.413, 414
188 En scène. Le spectacle vivant en vidéo. Germaine Lubin évoque sa carrière. 14 mars 1965
189 France Culture, Mardi du cinéma. Andreï Tarkovski ou le cinéma comme icône 11 mars 2017 [1ère diffusion. 7 janvier 1986]
190 Ryszard Kapuściński, Le Négus. Flammarion. 229p. 2010. p.32
191 Mélina Mercouri, Je suis née Grecque. Le livre de poche. 318p. 1974. p.292
192 Page de couverture de Bien-être et santé. n° 343. juillet-août 2017
193 France Culture, Mauvais genre. 22 janvier 2023. [1ère diffusion. 27 juillet 2003]
194 France Culture, Mauvais genre. 22 janvier 2023. [1ère diffusion. 27 juillet 2003]
195 Paul Léautaud, Journal littéraire. Choix de pages. Folio. Gallimard. 1304p. 2013. p.210
196 Arte, Marilyn, malgré elle. 6 novembre 2005. 12h 55
197 Arte, Artistes femmes. À la force du pinceau. 8 mars 2015
198 Georges Sadoul, Dictionnaire des films. Microcosme. Le Seuil. 383p. 1990. p.241
199 France Culture, Alice Neel, portraits cachés de l’Amérique. 24 septembre 2022
200 Jean-Claude Brialy, Le ruisseau des singes. Pocket. Robert Laffont. 510p. 2001. p.219
201 France Culture, La Dispute. 22 avril 2015
202 Le Monde, Carol Rama, la mamie indigne, enfin au Musée. 14 mai 2015
203 Louis Aragon, Les beaux quartiers. Folio. Gallimard. 625p. 2012. p.290
204 France Culture, Paula Rego. Une peinture narrative. 9 août 202 [1ère diffusion. 2 décembre 2018]
205 France Culture, Les doubles cordes ou les enfants du luth. Reinette l’Oranaise et Lili Boniche. 18 février 2019 [Ière diffusion. 22 février 1991]
206 Archives INA. 20 septembre 1966
207 Madeleine Renaud, La déclaration d’amour. Éditions du rocher. 132p. 2000. p.111, 112
208 Arte, Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely. 23 août 2010
209 Niki de Saint Phalle, Mon secret. Récit autobiographique. Écrit à la main. Éditions de la différence. 2010. 40p.
210 France Culture, Une vie, une œuvre. Charlotte Salomon. 29 octobre 2016
211 France Culture, Catherine Sauvage en liberté. Sur la scène. 26 août 2017 [1ère diffusion. 18 mai 1985]
212 Alain Vircondelet, Séraphine. De la peinture à la folie. Paris. Albin Michel. 2009. 207p. p.183. Cf. aussi le film de Martin Provost, Séraphine, dont l’actrice est Yolande Moreau. 2008
213 Alexandra David-Neel, Correspondance avec son mari. Édition intégrale. 1904-1941. Plon. 943p. 2001. p.143
214 Germaine de Staël, De l’Allemagne. II. Garnier Flammarion. 318p. 1968. p.160
215 Maurice Genevoix, Trente mille jours. Seuil. 279p. 1980. p.67
216 France Culture, Jean Malaurie. 14 août 2022 [1ère diffusion. 28 novembre 1999, puis 13 février 2021]
217 The Guardian, J’ai dû me défendre. La nuit ou Harvey Weinstein s’est jeté sur moi. 10 octobre 2017
218 France Culture, Delphine Seyrig. Vie, vidéo et combat. 29 août 2020
219 Association Choisir, Avortement : une loi en procès. L’affaire de Bobigny. Idées Gallimard. 255p. 1973. p.110, 111
220 France Culture, Une vie, une œuvre. Clara Schumann (1819-1896), compositrice et amoureuse. 28 mai 2016
221 France Culture, La mémoire de Suzy. 13 mai 2017 [1ère diffusion. 15 août 1978]
222 In : Le Calvados. n°117. automne 2014 (cité par Wikipédia)
223 France Inter, L’heure bleue. Anne Sylvestre, sans concessions. 26 septembre 2017
224 Dominique Desanti, La femme au temps des années folles. Le livre de poche. 447p. 1984. p.177
225 In : Geneviève Sellier, La Nouvelle vague. Un cinéma au masculin singulier. CNRS. Éditions. 217p. 2005. p.190
226 France Culture, Plan large. Hommage à Agnès Varda. 30 mars 2019 [1ère diffusion. 2017]
227 France Inter, Agnès et toutes ses vies. 29 mars 2019
228 France Culture, Quand Cora Vaucaire racontait ses débuts à l’échelle de Jacob. 13 mai 2017 [1ère diffusion. 15 novembre 1971]
229 France Musique, Cora Vaucaire, l’intemporelle. 26 avril 2020 [1ère diffusion. 23 septembre 2018]
230 George Sand, Correspondance. Georges Lubin. Classiques Garnier. Tome XVII. 852p. 1983. p.322
231 Élisabeth Vigée-Lebrun, Souvenirs. I. Une édition féministe de Claudine Herrmann. Des Femmes. 360p. 1984. p.173
232 Élisabeth Vigée-Lebrun, Souvenirs. I. Une édition féministe de Claudine Herrmann. Des Femmes. 360p. 1984. p.241
233 Élisabeth Vigée-Lebrun, Souvenirs. I. Une édition féministe de Claudine Herrmann. Des Femmes. 360p. 1984. p.325
234 France Culture, Toute une vie. Élisabeth Louise Vigée-Lebrun. 16 août 2021 [1ère diffusion. 7 novembre 2015]
235 Colette, Prisons et paradis. Ferenczi. 219p. 1932. p.183 à 186
236 Livres Hebdo, n°1182. 24 août 2018
237 France Culture, Anna Akhmatova. 6 août 2020
238 George Sand, Histoire de ma vie. In : Œuvres autobiographiques. II. La Pléiade. 1638p. 2001. p.438
239 Florence Aubenas, Le quai de Ouistreham. Éditions de l’Olivier. 2010. 270 p.
240 Bernard-Marie Garreau, Marguerite Audoux. La couturière des lettres. Tallandier. 1991. 287p.
241 France Culture, Jane Austen, toujours vivante. 18 juillet 2017
242 André Gide, Journal. 1889-1939. La Pléiade. 1378p. 1948. p.909, 910
243 Julien Green, Les années faciles. 1926-1934. Plon. 582p. 1970. p.354
244 André Gide, Journal. 1939-1949. Souvenirs. La Pléiade. 1280p. 1954. p.272
245 Pietro Citati, Portraits de femmes. L’arpenteur. 375p. 2001. p.65
246 France Culture, Une vie, une œuvre. Jane Austen. 11 juin 2016
247 France Culture, Une vie, une œuvre. Jane Austen. 9 février 2019. [1ère diffusion. 11 juin 2016]
248 Éditions Léo Scheer. décembre 2007
249 Henri Guillemin, Une certaine espérance. Conversations avec Jean Lacouture. Arléa. 187p. 1992. p.83
250 Octavie Belot, Réflexions d’une Provinciale sur le Discours de Monsieur Rousseau, citoyen de Genève. Presses de l’Université d’Artois. 2015. 366p.
251 Voltaire, Correspondance. V. (janvier 1758-septembre 1760). La Pléiade. 1698p. 1980. p.432
252 Voltaire, Correspondance. VII. (janvier 1763-mars 1765). La Pléiade. 1590p. 1981. p.189
253 France Culture, Documentaire. Catherine Bernard [1663 (?) -1712]. La voix oubliée. 10 juin 2017
254 Maurice Nadeau, Journal en public. La Quinzaine Littéraire. Maurice Nadeau. 317p. 2006. p.224 à 227
255 Rachel Bespaloff, Lettres à Jean Wahl. 1937-1947. ‘Sur le fond le plus déchiqueté de l’histoire’. Éditions Claire Paulhan. 190p. 2003. p.7 à 45
256 Charlotte Brontë, Jane Eyre. Pocket. 761p. 2015. p.11, 12
257 Julien Green, Les années faciles. 1926-1934. Plon. 582p. 1970. p.304, 307
258 Marie Cardinal, Les mots pour le dire. Grasset. 316p. 1975
259 Virginie Talmont, Inceste. Récit. J’ai lu. 190p. 2004. p.29, 30
260 France Inter, Jacques Chancel reçoit Edmonde Charles Roux. 3 août 2016 [1ère diffusion. 28 mai 1971]
261 Le Monde Diplomatique, Christophe Wargny. Paranoïa couleur temps. Haïti au temps du Duvalierisme. novembre 2005
262 Marie Vieux-Chauvet, Amour, Colère et Folie. Éditions Zulma. 2015. 499p.
263 Micheline Bood et Serge Grand, L’Indomptable Louise Colet. Pierre Horay. 233p.1986. p.12
264 L’internaute, Thierry Poyet, Relire Louise Colet, évidemment, 20 janvier 2015
265 Julien Green, Les années faciles. 1926-1934. Plon. 582p. 1970. p.148
266 Correspondance de Gustave Flaubert. Lettres à Louise Colet. 1846-1851. Société coopérative éditions Rencontre. Lausanne. 583p. 1964. p.7 à 29
267 Émile Zola, Correspondance. IV. 1880-1883. Les Presses de l’Université de Montréal. Éditions du CNRS. 522p. 1983. note 4. p.237
268 Colette, Mes vérités. Entretien avec André Parinaud. Écriture. 232 p. 1996. p.167
269 Colette, Mes vérités. Entretien avec André Parinaud. Écriture. 232 p. 1996. p.72, 97, 101, 40
270 Willy et Colette Willy, Claudine s’en va. Les ‘Albin Michel’. 1931. 253p.
271 France Culture, Colette, avec Valérie Lemercier. 26 juillet 2015
272 501 écrivains. Un tour du monde de la littérature. Omnibus. 604p. 2011. p.255
273 Ivy Compton-Burnett, Serviteur et servante. L’Age d’homme. 227p. 1988
274 Source à retrouver
275 André Gide, Journal. 1939-1949. Souvenirs. La Pléiade. 1280p. 1954. p.55
276 Marceline Desbordes-Valmore, Poèmes et proses. Marcel Seheur Éditeur. L’âme de la femme. 172p. 1928. p.94
277 Club des poètes, La recluse d’Amherst
278 France Culture, Frederick Wiseman. 8 août 2011
279 France Culture, Flannery O’Connor. 3 août 2024 [1ère diffusion. 30 septembre 2019]
280 Louis Nucéra, Mes ports d’attache. Les cahiers rouges. Grasset. 305p. 2010. p.77
281 In : George Eliot, Middlemarch. Folio. Classique. Gallimard. 2020. Quatrième de couverture. 1152p.
282 France Culture, Répliques. À la découverte de George Eliot. 26 décembre 2020 [1ère diffusion. 10 novembre 2018]
283 France Culture, Entendez-vous l’éco ? L’économie selon George Eliott. 27 janvier 2022
284 France Culture, Zelda Fitzgerald, Une vie, Une œuvre. 9 janvier 2011
285 Lire aussi, Nancy Milford, Zelda. Stock. 1973
286 G. Bruno, Le tour de la France par deux enfants. Paris. Librairie Classique Belin. 1976. 322p.
287 France Culture, 7 femmes de Lydie Salvayre. Du 26 au 31 janvier 2015
288 Le chevalier de Propiac, Le Plutarque des jeunes demoiselles. Abrégé des femmes illustres de tous les pays. Tome premier. 360p. 1825. p.37
289 In : Albert Ollivier, Saint-Just, Gallimard. Le livre de poche, 704p. 1966. note 1. p.650
290 Lucienne Mazenod, Ghislaine Schoeller, Dictionnaires des femmes célèbres. De tous les temps et des tous les pays. Bouquins. Robert Laffont. 932p. 1992. p.364
291 Voltaire, Correspondance. II. (janvier 1739-décembre 1748). La Pléiade. 1814p. 1977. p.1472
292 Lettres de Thomas Mann (1889-1936). Gallimard. 608p. 1966. p.359, 569
293 Romain Rolland, Journal de Vézelay. 1938-1944. 1182p. 2013. p.338
294 Cité par Oct. Gréard, L’Éducation des femmes par les femmes. Études et Portraits. Hachette et Cie. 360p. 1886. p.183
295 Cité par Oct. Gréard, L’Éducation des femmes par les femmes. Études et Portraits. Hachette et Cie. 360p. 1886. p.170, 171
296 Voltaire, Correspondance. III. (janvier 1749-décembre 1753). La Pléiade. 1534p. 1975. p.641, 1319, 1322
297 France Culture, 2 décembre 2016 [1ère diffusion. 10 juillet 1983]
298 André Malraux, Antimémoires. Gallimard. 605p. 1967. p.132
299 Clara Malraux, Nos vingt ans. Le livre de poche. Grasset. 409p. 1966. p.203, 206
300 France Culture, Anne-Marie Monnet : ‘J’ai écrit dans la solitude complète, dans les montagnes, l’hiver. 8 janvier 2023
301 William Makepeace Thackeray, Barry Lyndon. Garnier Flammarion. 444p. 2019. p.268, note. p.430
302 France Culture, Les masters classe. Nathalie Nothomb. 19 mars 2020 [1ère diffusion. 20 août 2018]
303 In : Pietro Citati, Portraits de femmes. L’arpenteur. 375p. 2001. p.230
304 Cf. Sylvain Piron, Marguerite Porete et le Miroir des simples âmes. Perspectives historiques, philosophiques et littéraires. Paris. Vrin, 2014. 368p. (et notamment, l’analyse de Sylvain Piron, Marguerite entre les béguines et les maîtres. p.68 à 101)
305 Guillaume Apollinaire, Journal Intime. 1898-1918. Éditions du limon. 161p. 1991. p.148
306 Kafka, Journaux et lettres. 1897-1914. La Pléiade. 1583p. 2022. p.1390
307 Honoré de Balzac, Illusions perdues. Garnier frères, 876p. 1961. p.220
308 Christiane Rochefort, Quand tu vas chez les femmes. Roman. Grasset. 1982. 195 p.
309 Françoise Verny, Le plus beau métier du monde. Olivier Orban. 459p. 1990. p.130, 193, 210, 211
310 Jeanne-Marie Roland, Mémoires particuliers. In : La fabrique de l’intime. Mémoires et journaux de femmes au XVIIème siècle. Bouquins. Robert Laffont. 1192p. 2013. p.504
311 Jules Michelet, Histoire de la Révolution française. II. La Pléiade. 1308p.1939. p.535
312 Hippolyte Taine, Les origines de la France contemporaine. Bouquins. Robert Laffont. T.1. 839p. 1986. note 1. p.582
313 Lucienne Mazenod, Ghislaine Schoeller, Dictionnaires des femmes célèbres. De tous les temps et des tous les pays. Bouquins. Robert Laffont. 932p. 1992. p.749
314 André Gide, Journal. 1889-1939. La Pléiade. 1378p. 1948. p.1244
315 George Sand, Correspondance. Georges Lubin. Classiques Garnier. Tome XV. 964p.1981. p.180
316 George Sand, Correspondance. Georges Lubin. Classiques Garnier. Tome XV. 964p.1981. p.188
317 George Sand, Correspondance. Georges Lubin. Classiques Garnier. Tome XV. 964p.1981. p.605
318 George Sand, Correspondance. Georges Lubin. Classiques Garnier. Tome XVI. 972p. 1982. p.767
319 George Sand, Correspondance. Georges Lubin. Classiques Garnier. Tome XVII. 852p. 1983. p.292
320 George Sand, Correspondance. Georges Lubin. Classiques Garnier. Tome XXII. 868p. 1987. p.88
321 George Sand, Correspondance. Georges Lubin. Classiques Garnier. Tome XXII. 868p. 1987. p.440
322 George Sand, Correspondance. Georges Lubin. Classiques Garnier. Tome XXII. 868p. 1987. p.591
323 George Sand, Correspondance. Georges Lubin. Classiques Garnier. Tome XXIII. 781p. 1989. p.12
324 George Sand, Correspondance. Georges Lubin. Classiques Garnier. Tome XXIII. 781p. 1989. p.332 et note 3
325 George Sand, Correspondance. Georges Lubin. Classiques Garnier. Tome XXIII. 781p. 1989. p.373. note 1
326 George Sand, Correspondance. Georges Lubin. Classiques Garnier. Tome XXIV. 751p. 1990. p.19
327 George Sand, Correspondance. Georges Lubin. Classiques Garnier. Tome XXIV. 751p. 1990. p.134, 135
328 George Sand, Correspondance. Georges Lubin. Classiques Garnier. Tome XXIV. 751p. 1990. p.649
329 Goliarda Sapienza, L’art de la joie. Viviane Hamy. 637p. 2006. p.621
330 Madame de Genlis, De l’influence des femmes sur la littérature française, comme protectrices des lettres et comme auteurs. Ou Précis de l’histoire des femmes les plus célèbres. Paris. Chez Maradran. 1811. I. p.172, 173
331 Cathy Bernheim, Mary Shelley. Qui êtes-vous ? La Manufacture. 250p. 1988. p.137, 138
332 In : La fabrique de l’intime. Mémoires et journaux de femmes au XVIIème siècle. Bouquins. Robert Laffont. 1192p. 2013. p.64
333 In : Françoise Giroud, Profession Journaliste. Conversations avec Martine de Rabaudy. Hachette Littératures. 185p. 2003. p.95
334 Jean Guéhenno, Journal des années noires. 1940-1944. Gallimard. 346p. 1947. p.292
335 Georges Bernanos, Lettres retrouvées. 1904-1948. Plon. 517p. 1983. p.439
336 Adèle Toussaint-Samson, Une Parisienne au Brésil. Paris, Ollendorff. 233 p. 1883. p. 69 à 72. (Lisible sur Gallica)
337 In : Janna Ivina, Maria et Marina, Femmes et Russie. 1981. Leningrad-Paris. Des femmes. 235p. 1980. p.17
338 Le féminisme de Marina Tsvetaieva. In : Des femmes russes. Par des femmes de Leningrad et d’autres villes. Des femmes. 235p. 1980. p.160
339 In : Pietro Citati, Portraits de femmes. L’Arpenteur. 375p. 2001. p.155
340 In : France Culture, Concordance des temps. Les femmes et le pouvoir en France. 24 juillet 2021 [1ère diffusion. 11 novembre 2006]
341 Jean Chalon, Florence et Louise, les magnifiques. Florence Jay-Gould et Louise de Vilmorin. Le Rocher. 169p. 1987. p.135
342 Henry James - Edith Wharton, Lettres. 1900-1915. Seuil. 334p. 2000. p.16
343 Edith Wharton, Les chemins parcourus. Autobiographie. Flammarion. 300p. 1995. p.138, 139
344 Voltaire, Correspondance. XI. (juillet 1772-décembre 1774). La Pléiade. 1411p. 1986. p.652
345 Julien Green, Vers l’invisible. Journal 1958-1967. Le livre de poche. 477p. 1967. p.242
346 Sylviane Agacinski, Interview au Monde. 15 décembre 1998. In : Mariette Sineau, Profession, Femme politique. Sexe et pouvoir sous la Cinquième République. Presses de Sciences-po. 305p. 2001. p.179
347 Site Maison Agutte Sembat, Institut humaniste et impressionniste
348 France Culture, Avoir raison avec Raymond Aron. 21 juillet 2016
349 Raymond Aron, Mémoires. 50 ans de réflexions politiques. Julliard. (Cf. l’index à son nom, insuffisant pour évoquer la manière dont il évoque son épouse) 1983. 778 p.
350 Ibid., page 234 à 237 et, plus largement, p.741 à 743
351 Commentaire, Albert Palle, Un professeur d’énergie. n°80. hiver 1997
352 Commentaire, Nicolas Baverez, Éloge funèbre, n°80. hiver 1997
353 Pierre Vidal-Naquet, Mémoires. 2. Le trouble et la lumière. 1955-1998. Seuil / La Découverte. 382p. 1998. p.63
354 Georges Bernanos, Lettres retrouvées. 1904-1948. Plon. 517p. 1983. p.350, 351
355 Georges Bernanos, Lettres retrouvées. 1904-1948. Plon. 517p. 1983. p.419, 420
356 Jean-Loup Bernanos, Georges Bernanos, à la merci des passants. Plon, 505p. 1986. p.131, 132, 285, 132
357 Françoise Giroud, Profession Journaliste. Conversations avec Martine de Rabaudy. Hachette Littérature. 180p. 2003. p.19
358 Abel Chatelain, Le Monde est ses lecteurs. Kiosque. 280p. 1983. p.189
359 Jean-Noël Jeanneney, Jacques Julliard, Le Monde de Beuve-Méry ou le métier d’Alceste. Éditions du seuil. 377p. 1979. p.18
360 Maurice Dommanget, Auguste Blanqui, au début de la IIIème République (1871-1880) Dernière prison et ultime combat. Paris-Mouton-La Haye. 162p. 1971. p.140, 71
361 In : Jean Zay, Écrits de prison. 1940-1944. Belin. 1052p. 2014. p.513, 514
362 Préface à : Léon Bloy, Lettres à sa fiancée. Éditions Stock. 142p. 1941 (12ème édition). p.4
363 Jules Renard, Journal. La Pléiade. 1434p. 1965. p.528, 529
364 Jean Lacouture, Léon Blum. Points. Histoire. 616p. 1979. p.99
365 La Croix, L’écrivain Paulette Boudet s’est éteinte le 22 février. 2 mars 2007
366 Paulette Boudet, Ce combat n’est pas le tien… Fayard. 1988. 274p.
367 In : Daniel Stern, Histoire de la révolution de 1848. Balland. 783p. 1994. p.150
368 Edith Wharton, Les chemins parcourus. Autobiographie. Flammarion. 300p. 1995. p.84, 85
369 In : Laure Adler, Les femmes politiques. Points Actuels. Le Seuil. 278p. 1993. p.138, 142
370 Mikhaïl Gorbatchev, Mémoires. Éditions du rocher. 941p. 1997. p.596
371 In : Beaumarchais, Œuvres. La Pléiade. 1696p. 1988. note. p.1537
372 Bernadette Chirac (avec Patrick de Carolis), Conversation. Pocket. 220 p. 2001. p.35, 36, 77
373 LCI. 14 octobre 2016. 19h 25
374 Romain Rolland, Journal de Vézelay.1866-1944. Bartillat. 1182p. 2013. p.383
375 In : George Sand, Correspondance. Georges Lubin. Classiques Garnier. Tome XV. 964p.1981. p.43, 44. note 1
376 Ivy-Compton-Burnett, Frères et sœurs. L’Age d’homme. 249p. 1983. p.29
377 Ivy-Compton-Burnett, Frères et sœurs. L’Age d’homme. 249p. 1983. p.118
378 Lorenzo da Ponte, Mémoires et livrets. Le livre de poche. Pluriel. 696p. 1980. p.467
379 Émile Zola, Correspondance. IV. 1880-1883. Les Presses de l’Université de Montréal. Éditions du CNRS. 522p. 1983. p.467
380 Benoît Peeters, Trois ans avec Derrida, les carnets d’un biographe. Flammarion. 248p. 2010. p.240
381 Benoît Peeters, Derrida. Flammarion. 740p. 2010. p.352
382 Charles de Gaulle, Mémoires. La Pléiade. 1505p. 2000. p.71, 1050, 1137, 1140
383 Philippe de Gaulle, De Gaulle, mon père **. Entretiens avec Michel Tauriac. Plon. 556p. 2004. p.46, 62, 132
384 Radio courtoisie. 24 février 2018
385 Radio courtoisie, Libre journal des éditeurs. 14 juillet 2018
386 Le Canard enchaîné, La plume et le tutu. ‘Madame Céline’ de David Alliot [Tallandier] nous raconte une vie partagée entre la puanteur et la grâce. 25 juillet 2018. p.6
387 Françoise Dolto, Autoportrait d’une psychanalyste. 1834-1988. Points Actuels. 284p. 1992. p.224
388 Alfred Dreyfus, Cinq années de ma vie. Introduction de Pierre Vidal-Naquet. François Maspero. PCM. Histoire. 263p. 1982. p.72, 75, 76, 89, 96, 99, 186
389 In : Wikipédia. Élisabeth Weissmann, Lucie Dreyfus, la femme du capitaine, Paris, Textuel, 2015
390 Louise Weiss, Combats pour les femmes. Albin Michel. 270p. 1980. p.76
391 In : Le Monde, Le labeur de Penelope. 5, 6 février 2017
392 20 minutes. Penelope Fillon ‘victime d’un dispositif qu’elle ignorait’, estime Ségolène Royal. 5 février 2017
393 Le Canard enchaîné. 8 février 2017. p.1
394 Source à retrouver
395 Françoise Xenakis, Zut, on a encore oublié madame Freud, J.C. Lattès. 280p.
396 Gérard Badou, Madame Freud. Payot. 185p. 2006. p.173, 177
397 France Culture, Moi, Sigmund Freud, la mort du vieux lion. 3 août 2018
398 Jacqueline Kennedy. Conversations inédites avec Arthur. M. Schlesinger. 1964. 428p. 2011. p.295
399 Jacqueline Kennedy. Conversations inédites avec Arthur. M. Schlesinger. 1964. 428p. 2011. p.258, 259
400 André Germain, La vie amoureuse de d’Annunzio. Arthème Fayard. 284p. 1954. p.28, 44
401 In : François Mauriac, Mémoires Intérieurs. Le livre de poche. 382p. 1966. p.256. Cf. aussi : Madeleine Rondeaux, Journal.1891-1892. Publications de l’association des amis d’André Gide. 2016. 83p.
402 André Gide, Et nunc manet in te. In : André Gide, Journal. 1939-1949. Souvenirs. La Pléiade. 1280p. 1954. p.1134
403 In : André Gide, Maria Van Rysselberghe. Correspondance. 1899-1950. Gallimard. 1160p. 2016. note 2. p.495
404 André Gide, Journal. 1939-1949. Souvenirs. La Pléiade. 1280p. 1954. p.131, 170
405 André Gide, Et nunc manet in te. In : André Gide, Journal. 1939-1949. Souvenirs. La Pléiade. 1280p. 1954. p.1123 à 1160
406 Site du Sénat. Femmes et pouvoirs. XIXème-XXème siècle. 27 octobre 2016
407 Christine Ockrent, Les uns et les autres. Points Actuels. 234p. 1993. p.34, 35
408 Antonio Gramsci, Lettres de prison. Collection Témoins. Gallimard. 620p. 1971. p.508
409 Jean Grave, Mémoires d’un anarchiste. Éditions du sextant. 542p. 2009. note. p.179
410 Le Monde, Benoîte Groult, féministe et essayiste. 23 juin 2016
411 Libération, Benoîte Groult, ainsi fut-elle. 22 juin 2016
412 Daniel Guérin. Info, Anne Guérin, Les ruptures de Daniel Guérin. (s. d)
413 In : Françoise Barret-Ducrocq & Évelyne Pisier, Femmes en tête. Flammarion. 534p. 1997. p.611
414 Jean Guéhenno-Louis Guilloux, Correspondance (1927-1967). Les paradoxes d’une amitié. La part commune. 734p. 2011. p.95, 145,146
415 Friedrich Hegel, Correspondance. I. 1785-1812. NRF. Gallimard. 439p. 1962. p.332 à 334
416 Friedrich Hegel, Correspondance. II. 1813-1822. Tel Gallimard. 276p. 1990. p.190
417 Friedrich Hegel, Correspondance. I. 1785-1812. NRF. Gallimard. 439p. 1962. p.313, 314, 316
418 Le Figaro. Culture, Hitchcock et Alma, Complices à vie. 7 février 2013
419 Arte, Hitchcock / Truffaut. 22 décembre 2015
420 In : Victor Hugo. Témoin de son siècle. J’ai lu. L’essentiel. 561p. 1962. p.459
421 Jules Janin, 735 lettres à sa femme. Textes décryptés et annotés par Mergier-Bourdeix. Librairie C. Klincksieck. Tome I. 629p. 1973. p.11, 559
422 Isabelle Juppé, À bicyclette,.. Et si vous épousiez un ministre ? Grasset. 250p. 1994. p.246
423 Bruno Le Maire, Jours de pouvoir. Récit. Gallimard. 427p. 2013. p.44
424 In : Françoise Barret-Ducrocq & Évelyne Pisier, Femmes en tête. Flammarion. 534p. 1997. p.69
425 Lénine, Œuvres. Tome 37. Lettres à sa famille. (1893-1932). 758p. 1977. Imprimé en Union Soviétique. p.585
426 Léon Trotsky, Ma vie. Folio. Gallimard. 691p. 1973. p.189
427 N. Kroupskaïa, Souvenirs sur Lénine. Bureau d’éditions. 1930. (Lisible sur Gallica) 210p.
428 Wikipédia. Nadejda Kroupskaïa
429 In : Émile Zola, Correspondance. IX. 1897-1899. Les Presses de l’Université de Montréal. Éditions du CNRS. 603p. 1993. note 5. p.182
430 Roger Vailland, Laclos par lui-même. Écrivains de toujours. Aux Éditions du Seuil. 191p. 1953. p.44
431 Cf. Émile Dard, Le général Choderlos de Laclos, auteur des Liaisons dangereuses. Librairie Académique Perrin. Paris. 1936
432 Matthieu Galey, Journal Intégral. 1953-1986. Bouquins. Robert Laffont. 983p. 2017.p.669
433 France Culture, Maison Latour, L’amour et la vie d’une femme. 30 janvier 2023
434 Doris Lessing, Les enfants de la violence. La cité promise. Le livre de poche. 915p. 1981. p.488
435 In : Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions. Autres oeuvres autobiographiques. In : Œuvres complètes. I. La Pléiade. 1969p. 1986. p.1224
436 Arte, Pierre Assouline, Le siècle de Lévi-Strauss. 15 juin 2016
437 France Culture, Ce que s’engager veut dire. 28 juillet 2019 [1ère diffusion. 24 novembre 2018]
438 Wikipédia, Max Linder
439 Jean Hamburger, Monsieur Littré (notamment le chapitre IX. Le Dictionnaire) Flammarion. 307p. 1988. p.149, 150, 151
440 Le Canard enchaîné, ‘Nous’, Brigitte Macron. 13 septembre 2017. p.2
441 Françoise Barret-Ducrocq & Évelyne Pisier, Femmes en tête. Flammarion. 534p. 1997. p.39
442 J. Maitron, Dictionnaire biographique mouvement ouvrier, mouvement social (site internet)
443 Clara Malraux, Nos vingt ans. Grasset. 282p. 1966. p.167
444 Lettres de Thomas Mann (1889-1936). Gallimard. 608p. 1966. p.396, 470
445 In : Hildegard Möller, Thomas Mann. Une affaire de famille. Tallandier. 382p. 2007. p.186
446 Lettres de Thomas Mann (1889-1936). Gallimard. 608p. 1966. p.498
447 Lettres de Thomas Mann (1943-1947). Gallimard. 416p. 1970. p.342, 343
448 Katia Mann, Souvenir à bâtons rompus. Albin Michel. 187p. 1975. p.14
449 Françoise Verny, Le plus beau métier du monde. Olivier Orban. 459p. 1990. p.159
450 Benjamin Constant. Isabelle de Charrière. Correspondance. 1787-1805. Desjonquières. 536p. 1996. p.316, 317
451 Karl et Jenny Marx, Lettres d’amour et de combat. Rivages. Poche.153p. 2013. p.1
452 Friedrich Engels et Karl Marx. Correspondance. Tomes 1 et 2. 1835-1851. Les Éditions sociales. Les essentiels. 418p. 2019. p.283
453 Athénaïs Michelet, Mémoire d’une enfant. Le Temps retrouvé. Mercure de France. 2010. 250 p. (4ème de couverture)
454 Source oubliée
455 Marie-Louise Néron, La Fronde, Madame Michelet, et La mort de Madame Michelet.12 avril 1898 et 4 avril 1899
456 Jean Daniel, L’ère des ruptures. Grasset. 362p. 1979. p.260
457 In : Pierre Desgraupes, Le mal du siècle. Grasset. 346p. 1977. p.79, 80
458 Nietzsche, Humain, trop humain. Le livre de poche. 768p. 2006. p.275
459 Bernard Crick, George Orwell. Flammarion. 712p. 2008. p.571
460 René Vallery-Radot, La vie de Pasteur. Hachette. 702p.1962. p.59
461 In : Correspondances conjugales. 1914-1918. Dans l’intimité de la grande guerre. Robert Laffont. 1061 p. 2014. p.822
462 Journal de l’abbé Mugnier. 1879-1939. Le Temps retrouvé. Mercure de France. 639p. 2007. p.297
463 Romain Vaissermann (Textes édités par), Charles Péguy, L’écrivain et le politique. Éditions ENS rue d’Ulm. 332p. 2003. p.294, 297
464 RT, Gyros bleus : Les policiers en colère ont manifesté à Paris. 20 décembre 2018
465 Alexandre Soljenitsyne, Le premier cercle. Le livre de poche. 823p. 1972. p.229
466 Claude Pompidou, L’élan du cœur. Propos et souvenirs. 161p. Plon. 1997. p.109, 115
467 Anna Politkovskaïa, Douloureuse Russie. Journal d’une femme en colère. Folio. Documents. Gallimard. 561p. 2008. p.196
468 Madame Hermione Quinet, Mémoires d’exil. Paris. Troisième édition. Paris. Librairie internationale. 379p. 1869. p.18, 39, 69, 109, 128, 129, 206, 354
469 Nancy Reagan, À mon tour. Mémoires (avec William Novak). Robert Laffont. 378p. 1990. p.114
470 Maurice Nadeau, Journal en public. La Quinzaine littéraire. Maurice Nadeau. 317p. 2006. p.215, 216
471 Michèle Rocard, Au four et au moulin. Albin Michel. 257p. 1987. p.198, p.79 à 98
472 Comte Beugnot, Mémoires. 1779-1815. 349p. 1959. p.139,140
473 Victor Serge, Carnets (1936-1947). Agone. 836p. 2012. p.619 à 622
474 Romain Rolland, Journal de Vézelay.1938-1944. 1182 p. 2013. p.1147 à 1149
475 In : Claude-Catherine Kiejman, Eleanor Roosevelt, First lady et rebelle. Texto. Le goût de l’histoire. Tallandier. 254p. 2014. p.216
476 France Culture, Qui est Raoul Ruiz ? 30 mars 2016
477 Le Monde Diplomatique, Guy Scarpetta. Raoul Ruiz ou le refus des normes. mai 2016
478 Nathalie Sarraute. Qui êtes -vous ? Conversations avec Simone Benmussa. Éditions la Manufacture. 223p. 1987. p.152, 154
479 Gloria Steinem, Ma vie sur la route. Mémoires d’une icône féministe. Harper Collins. 393p. 2019. p.283
480 Nina et Jean Kéhayan, Rue du prolétaire rouge. Seuil. 222p. 1978. p.104
481 Le Monde Diplomatique, Stop au relooking ! mars 2017. p.25
482 Alexis de Tocqueville, Lettres choisies. Souvenirs. Quarto. Gallimard. 1420p. 2003. p.521, 523
483 Alexis de Tocqueville, Lettres choisies. Souvenirs. Quarto. Gallimard. 1420p. 2003. p.522 (note 92)
484 Sophie Tolstoï, Journal intime. 2 tomes. Albin Michel ; Sophie Tolstoï, Ma vie. Éditions des Syrtes, 1062 p. 1980. pp. 537, 474
485 Les passions d’Henri Guillemin. À la Baconnière. 448p. 1994. p.216
486 Des lettres, Le site des correspondances et des lettres. 2018
487 Victor Serge, Carnets (1936-1947). Agone. 836p. 2012. p.172 à 174
488 Ibid., p.192
489 François Dosse, Castoriadis, Une vie. La Découverte. 532p. 2014. p.110, 111
490 Paris Match, La parenthèse enchantée de Donald et Melania Trump. 16 décembre 2018
491 Paul Léautaud, Entretiens avec Robert Mallet. NRF. Gallimard. 397p. 1951. p.101
492 Anne Clark Amor, Madame Oscar Wilde. Perrin. 1985. 299 p.
493 Lisible sur le site Des lettres
494 Anaïs Nin, Journal. 1939-1944. Le livre de poche. 508p. 1971. p.191, 192
495 Jean Zay, Écrits de prison. 1940-1944. Belin. 1052p. 2014. p.504
496 Émile Zola, Correspondance. VIII. 1893-1897. Les Presses de l’Université de Montréal. Éditions du CNRS. 482p. 1991. p.15
497 Émile Zola, Correspondance. IX. 1897-1899. Les Presses de l’Université de Montréal. Éditions du CNRS. 603p. 1993. note 1. p.439.
498 Émile Zola, Correspondance. X. 1899-1902. Les Presses de l’Université de Montréal. Éditions du CNRS. 647p. 1995. note 2. p.187.
499 Émile Zola, Correspondance. II. 1868-1877. Les Presses de l’Université de Montréal. Éditions du CNRS. 644p. 1980. p.120
500 Évelyne Bloch-Dano, Madame Zola. Grasset. 1997. 368 p.
501 Françoise Basch, Victor Basch. De l’affaire Dreyfus au crime de la Milice. Plon. 389p. 1994. p.67
502 France Inter, L’heure bleue. Anne Sylvestre, sans concessions. 26 septembre 2017
503 France Culture, Avoir raison avec Françoise Giroud. 4 août 2019
504 France Culture. 1er février 2020. 07 h
505 Monde sociaux, Marlène Coulomb-Gully, Le sexisme bien tempéré du Canard. 1er avril 2015
506 Karl Laske et Laurent Valdiguié, Le vrai Canard. Stock. 486p. 2008. p.372 à 378
507 France Culture, La grande table. 27 juin 2018
508 Michèle Manceaux, Grand reportage. Seuil. 250p. 1980. p.123, 124
509 Christine Ockrent, La mémoire du cœur. Fayard. 320 p. 1997. p.233, 234
510 Françoise Giroud, Profession Journaliste. Conversations avec Martine de Rabaudy. Hachette Littérature. 185p. 2003. p.82
511 Michèle Manceaux, Grand reportage. Seuil. 250p. 1980. p.160
512 Christine Ockrent, Les uns et les autres. Points Actuels. 234p. 1993. p.28
513 Le Canard enchaîné, Canard plus. 11 avril 2018. p.7
514 France Culture, Avoir raison avec Françoise Giroud. 4 août 2019
515 Claude Sarraute, Des hommes en général et des femmes en particulier. 1996. 230p. Plon. p.10
516 Arte, La tragédie des brigades internationales. 25 octobre 2016
517 Louis Guilloux, Carnets. 1921-1944. Gallimard. 414p. 1978. p.144, 145
518 Le Monde, Taro dans l’ombre de Capra. 4 mai 2006
519 Irme Schaber, Une photographe révolutionnaire dans la guerre d’Espagne. Les Éditions du Rocher. 2006. 315p.
520 Arielle Caisne, L’Ortie. France Loisirs. 171p. 1992. p.52
521 Entrer dans la vie. Naissances et enfances dans la France traditionnelle. Collection Archives, Gallimard. Julliard. 246 p. 1978. p.45
522 Business News. com. Tn, Tunisie. Les ‘bonnes mœurs’ selon Souad Abderrhaim. 9 novembre 2011
523 France Musique, Les grands entretiens. Isabelle Aboulker. 21, 22 février 2022
524 France Culture, La nuit Chantal Akerman. Du jour au lendemain, Chantal Akerman pour son livre : Ma mère rit. 11 février 2018 [1ère diffusion. 7 novembre 2013]
525 Mémoires, souvenirs et journaux de la Comtesse Marie d’Agoult (Daniel Stern). II. Mercure de France. Le Temps retrouvé. 384p. 1990. p.14, 22, 36
526 Tacite, Annales. Garnier Flammarion. 499p. 1965. p.382
527 Raymond Aron, Mémoires. 50 ans de réflexions politiques. Julliard. 778 p. 1983. p.23, 24, 163
528 France Culture, Sur les docks. Enfants placés. 3 juin 2015
529 Honoré de Balzac, Le père Goriot. Librairie Joseph Gibert. 249p. (sans date). p.169
530 Honoré de Balzac, La femme de trente ans. La Pléiade. La comédie humaine. II. 1172p. 1951. p.739
531 Honoré de Balzac, La femme de trente ans. La Pléiade. La comédie humaine. II. 1172p. 1951. p.748
532 Honoré de Balzac, La cousine Bette. Flammarion. 640p. 2015. p.317
533 Samira Bellil, Dans l’enfer des tournantes. Éditions France loisirs. 234p. 2003. p.80, 81
534 Hélène Berr, Journal. Points. Tallandier. 329p. 2009. p.196
535 Victor Hugo, Choses vues. 1849-1885. Édition Hubert Juin. Folio. Classique. Gallimard. 1014p. 2010. p.388
536 Jean Lacouture, Profession Biographe. Conversations avec Claude Kiejman. Hachette Littératures. 237p. 2003. p.134
537 Brigitte, J’habite en bas de chez vous. Franceinfo. Oh ! Éditions. 268p. 2007. p.14
538 Friedrich Hegel, Correspondance. II. 1813-1822. Tel Gallimard. 376p.1990. p.354, 140
539 Calamity Jane, Lettres à sa fille. Rivages Poche. 1997. 114p.
540 Karel Capek, Une vie ordinaire. Éditions L’Age d’Homme. 165p. 2002. p.68
541 Mémoires de Catherine II. Écrits par elle-même. Librairie Hachette. 303p. 1953. p.263
542 Céline, Voyage au bout de la nuit. Folio Plus. Gallimard. 559p. 1997. p.172
543 Céline, Voyage au bout de la nuit. Folio Plus. Gallimard. 559p. 1997. p.172
544 Céline, Voyage au bout de la nuit. Folio Plus. Gallimard. 559p. 1997. p.279
545 Céline, Voyage au bout de la nuit. Folio Plus. Gallimard. 559p. 1997. p.330
546 In : Les passions d’Henri Guillemin. À la Baconnière. 448p. 1994. p.396, 397
547 Edith Wharton, Les chemins parcourus. Autobiographie. Flammarion. 300p. 1995. p.126
548 Astolphe de Custine, Lettres de Russie. Folio. Gallimard. 414 p. 1975. p.118 et Astolphe de Custine, Œuvres. La Russie en 1839. Classiques Garnier. 1168p. 2015. p.218
549 Mémoires de la baronne d’Oberkirch. Mercure de France. Le Temps retrouvé. 2004. 781p.
550 Les passions d’Henri Guillemin. À la Baconnière. 448p. 1994. p.82
551 Françoise Collin, Humour en amour, Mères /Femmes. Cahiers du Grif. n°17/18. Bruxelles. 1977. p.3 à 6
552 Ivy-Compton-Burnett, Frères et sœurs. L’Age d’homme. 249p. 1983. p.40
553 Ivy-Compton-Burnett, La chute des puissants. 1967. 241p. Gallimard. p.13
554 Ivy-Compton-Burnett, La chute des puissants. 1967. 241p. Gallimard. p.139
555 Eva Darlan, Grâce ! Mes combats jusqu’à Jacqueline Sauvage. Plon. 154p. 2016. p.62
556 France Culture, Toute une vie. Françoise d’Eaubonne [1920-2005]. 20 novembre 2021
557 Charles de Gaulle, Mémoires. La Pléiade. 1505p. 2000. p.88
558 Odile Dhavernas, Petite sœur née… prépare suicide. Seuil. 157p. 1981. p.19
559 Germaine de Staël, Correspondance générale. Tome VI. Klincksieck. 671p. 1993. p. 481 et 475, (note 13) p.477
560 Isadora Duncan, Ma vie. Folio. Gallimard. 447p. 2016. p.242
561 France Inter, 116 rue Albert Londres. Joseph Kessel, l’empereur. 25 octobre 2015
562 Sœur Emmanuelle, Confessions d’une religieuse. Flammarion. 409p. 2008. p.186
563 Elena Ferrante, Le nouveau nom. Folio. Gallimard. 623p. 2016. p.133, 134
564 Le Monde, Penelope Fillon, la discrète. 5, 6 février 2017. p.1
565 Arundhati Roy, Le Ministère du Bonheur Suprême. Folio. Gallimard. 554p. 2019. p.52
566 Christine Ockrent, Françoise Giroud. Une ambition française. Fayard. 364p. 2003. p.211
567 Carlo Goldoni, Mémoires. Le Temps retrouvé. Mercure de France. 635p. 2018. p.117
568 Journal des Goncourt. Tome IV. 1865-1868. Honoré Champion. 765p. 2019. p.406
569 France Culture, Gisèle Halimi, La révoltée de la Goulette. 12 juillet 2021
570 Victor Hugo, Correspondance familiale et écrits intimes. 1. 1802-1828. Robert Laffont. 972p. 1988. p.220, 258
571 Victor Hugo, Choses vues. 1849-1885. Édition Hubert Juin. Folio. Classique. Gallimard. 1014p. 2010. p.255
572 Léon Trotsky, Ma vie. Folio. Gallimard. 691p. 1973. p.255, 256
573 Michel Ciment, Kazan par Kazan. Ramsay. Poche cinéma. 347 p. 1985. p.12
574 France Culture, Portrait en miroir de Frida Khalo. 15 décembre 2016
575 Marc Escholier, Lacordaire ou Dieu et la liberté. Fleurus. Le livre de poche chrétien. 252p. 1961. p.42
576 Paul Léautaud, Entretiens avec Robert Mallet. NRF. Gallimard. 397p. 1951. p.35, 36, 131, 298
577 Lucienne Mazenod, Ghislaine Schoeller, Dictionnaires des femmes célèbres. De tous les temps et des tous les pays. Bouquins. Robert Laffont. 932p. 1992. p.498
578 Essais d’ego-histoire. Réunis et présentés par Pierre Nora. NRF. Éditions Gallimard. 375p. 1992. p.192
579 Le Canard enchaîné, Critique du livre de Renaud Dély : La vraie Marine Le Pen, Une bobo chez les fachos. [Plon. 2017] 8 mars 2017. p.6
580 Bernard Pascuito, Olivier Biscaye. Les politiques ont aussi une mère. Albin Michel. 224p. 2017
581 Jeune Afrique, Bonnes Feuilles. Maman ! n°2930. 5 au 11 mars 2017. p.52
582 Doris Lessing, Les enfants de la violence. Le livre de poche. 918p. 1978. p.663
583 Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions. Autres œuvres autobiographiques. In : Œuvres complètes. I. La Pléiade. 1969p. 1986. p.344, 345
584 Mémoires de Madame Campan. Le Temps retrouvé. Mercure de France. 620p. 2006. p.173, 174
585 Marivaux, La vie de Marianne. Gallimard. Folio Classique. 778 p. 2014. p.496
586 Marivaux, La vie de Marianne. Gallimard. Folio Classique. 778 p. 2014. p.518
587 Marivaux, La vie de Marianne. Gallimard. Folio Classique. 778 p. 2014. p.623
588 Bertrand Meyer-Stabley, Edwina Mountbatten. Bartillat. 302p. 2005. p.148
589 Les Cahiers du Grif. n°34. Les jeunes. La transmission. ‘D’Anne à Anne’. Paris, Tierce. 1986. p.99
590 François Mauriac, Le nœud de vipères. Bernard Grasset. 311p. 1932. p.129
591 François Mauriac, Ce que je crois. Grasset. 188p. 1962. p.71, 123
592 Le Monde, Fawzia Zouari et ses rêves de France. 21 mai 2016
593 Saint Augustin, Les Confessions. In : Œuvres. I. La Pléiade. 1520p. 1998. p.974
594 Léon Tolstoï, La guerre et la paix. La Pléiade. Traduction de Pierre Pascal. 1654 p. 1945. p.1312 (Livre 4)
595 Léon Tolstoï, Journaux et Carnets. I. (1847-1889). La Pléiade. 1451p. 1979. p.574
596 Hippolyte Taine, Les origines de la France contemporaine. Bouquins. Robert Laffont. Tome 1. 839p. 1986. p.1194
597 Zoe Oldenbourg, Visages d’un autoportrait. Folio. Gallimard. 410p. 1988. p.302
598 Robert Debré, L’honneur de vivre. Stock. Hermann. 462p. 1974. p.78
599 Charles Péguy, La république. (Source à retrouver)
600 Lou Andreas Salomé, Ma vie. PUF. Perspectives critiques. 315p. 1978. p.138, 139
601 Christophe Rocancourt, Moi, Christophe Rocancourt, orphelin, playboy, taulard. Éditions France Loisirs. 252p. 2003. p.26, 35
602 Claude-Catherine Kiejman, Eleanor Roosevelt, First lady et rebelle. Texto. Le goût de l’histoire. Tallandier. 254p. 2014. p.248, 249
603 Karl Lake et Laurent Valdiguié, Le vrai Canard. Stock. 486p. 2008. p.398
604 Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions. Autres textes autobiographiques. In : Œuvres complètes. I. La Pléiade. 1169p. 1959. p.7
605 Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions. Autres textes autobiographiques. In : Œuvres complètes. I. La Pléiade. 1969. p. 420
606 Jean-François Marmontel, Mémoires. Le Temps retrouvé. Mercure de France. 909p. 2008. p.524
607 In : Patricia Ménissier, Être mère. XVIIIe-XXIe siècle. CNRS. Éditions. 203p. 20176. p.92, 96
608 In : Vita Sackville-West, Virginia Wolf. Correspondance. 1923-1941. Cité par Bruno Lemaire, Jours de pouvoir. Récit. Gallimard. 427p. 2013. p.87
609 In : Terre entière. Le ‘tiers-monde’ vu par la presse française. 1961-1968. n°35. 218p. mai-juin 1969. p.35
610 George Sand, Correspondance. Classiques Garnier. Tome VIII. Garnier Flammarion. 868 p. 1971. p.22, 49. Et pour l’ensemble de la lettre, p.21 à 49
611 George Sand, Correspondance. Georges Lubin. Classiques Garnier. Tome XV. 964p.1981. p.129
612 George Sand, Correspondance. Georges Lubin. Classiques Garnier. Tome XVI. 972p. 1982. p.455
613 George Sand, Correspondance. Georges Lubin. Classiques Garnier. Tome XVIII. 761p. 1984 p.569
614 George Sand, Correspondance. Georges Lubin. Classiques Garnier. Tome XXI. 992p. 1986. p.415
615 George Sand, Correspondance. Georges Lubin. Classiques Garnier. Tome XXII. 868p. 1987. p.539
616 France Culture, Conversations avec Nathalie Sarraute. 27 juillet 2017. Cf., aussi Nathalie Sarraute, Enfance, Folio. Gallimard. 217p. 1995. p.121, 219
617 Christine Ockrent, Françoise Giroud. Une ambition française. Fayard. 364p. 2003. p.119
618 Madame de Sévigné, Lettres Choisies. Folio. Gallimard. 380p. 1988. p.65
619 Madame de Sévigné, Lettres choisies. Wikisource. n°274. Édition de 1846
620 In : Nouvelles du XVIIIème siècle. La Pléiade. 1552p. 2002. p.1263
621 Victor de Pange, Le plus beau de toutes les fêtes. La correspondance inédite de Madame de Staël et d’Élisabeth Hervey, duchesse de Devonshire. Klincksieck. 266p. 1980. p.112
622 France Inter, Ça peut pas faire de mal. Lettre à ma mère de Georges Simenon. 25 mars 2017
623 Svetlana Allilluyeva, Vingt lettres à un ami. Seuil. Paris Match. 257p. 1967. p.169
624 Anton Tchékhov, Les moujiks. In : Œuvres. III. La Pléiade. 1033p. 1971. p.719, 698
625 France Culture, Margaret Thatcher. La chute. 21 novembre 2022 [1ère diffusion. 31 juillet 2020]
626 Léon Tolstoï, Anna Karénine. Résurrection. La Pléiade. 1630p. 1951. p.71
627 Léon Tolstoï, Journaux et carnets. III. (1905-1910). La Pléiade. 1368p. 1985. p.423
628 In : Margaret Goldsmith, Cinq femmes contre le monde. Gallimard. 201p. 1937. p.19
629 France Culture, Entendez-vous l’éco ? Jules Verne : Le grand maître de l’innovation. 17 décembre 2020
630 Voltaire, Correspondance. IX. (juillet 1767-septembre 1769). La Pléiade. 1601p. 1985. p.487
631 Émile Zola, Correspondance. I. 1858-1867. Les Presses de l’Université de Montréal. Éditions du CNRS. 594p. 1978. p.270
632 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. II. L’assommoir. La Pléiade. 1748p. 1961. p.522
633 Cf. Marie-Victoire Louis, De qui les femmes sont-elles le nom ? http://www.marievictoirelouis.net/document.php?id=974&mode=last
634 In : Préface de François Furet. Mirabeau. Discours. Folio. Gallimard. 440p. 1973. p.10
635 Émile Zola, La curée. Le livre de poche. 412p. 2021. p.18
636 Voltaire, Correspondance. V. (janvier 1758-septembre 1760). La Pléiade. 1698p. 1980. p.759, 845
637 Sade, Les cent vingt journées de Sodome. In : Œuvres. I. La Pléiade. 1363p. 1990. p.72, 102
638 Madame de Genlis, Mémoires sur le XVIIIème siècle et la Révolution française de 1756 jusqu’à nos jours. Tome Cinquième. 1825. p.25 (Google livre)
639 Honoré de Balzac, Le médecin de campagne. La Pléiade. La comédie humaine. VIII. 1041p. 1949. p.418
640 Honoré de Balzac, Le curé de village. La Pléiade. La comédie humaine. VIII. 1041p. 1949. p.538, 539, 540, 541
641 Victor Hugo, Les misérables. La Pléiade. 1805p. 1951. p.1421, 1445
642 Mémoires, Souvenirs et journaux de la comtesse d’Agoult. (Daniel Stern) II. Le Temps retrouvé. Mercure de France. 384p. 1990. p.32
643 Alexandra David-Neel, Correspondance avec son mari. Édition intégrale. 1904-1941. Plon. 943p. 2001. p.45, 545
644 Paul Léautaud, Journal littéraire. Choix de pages. Folio. Gallimard. 1304p. 2013. p.188
645 Jules Renard, Journal. La Pléiade. 1434p. 1965. p.1028, 1204
646 Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe. Folio. 645p. 1989. p.215
647 Louis Roubaud, La prison de velours. Gallimard. Collection Succès. 254p. 1934. p.231
648 George Orwell, Une vie en lettres (Correspondance. 1903-1950). Agone. 666p. 2014. p.243
649 Anja Klabunde, Magda Goebbels (traduit de l’allemand). Tallandier. 2006. 414 p.
650 France Culture, Une vie, une œuvre. Clara Malraux [1897-1982], une intensité plus qu’humaine. 24 juin 2017 [1ère diffusion. 15 novembre 2007]
651 Édith Stein, Correspondance II. 1933-1942. Cerf- Éditions du carmel - Ad Solem. 2012. 792p.
652 Louis Aragon, Les voyageurs de l’impériale. Folio. Gallimard. 689p. 1948. p.324
653 Louis Aragon, Les voyageurs de l’impériale. Folio. Gallimard. 689p. 1948. p.404
654 André Gide, Journal. 1889-1939. La Pléiade. 1378p. 1948. p.1331
655 Édith Thomas, Les femmes en 1848. Presses Universitaires de France. 1948. 78 p.
656 Doris Lessing, Les enfants de la violence. La cité promise. Le livre de poche. 915p. 1981. p.60
657 Albertine Sarrazin, Lettres à Julien. 1958-1960. Jean-Jacques Pauvert. 543p. 1971. p.78
658 In : Honoré de Balzac, La comédie humaine. XII. La Pléiade. 1972p. 1981. p.1614
659 Linda de Suza, La valise en carton. Éditions Carrère-Michel Lafon. 210p. 1984. p.93
660 In : France Culture, La romancière Pierrette Fleutiaux, prix Femina 1990 est morte. 28 février 2019
661 Mo Yan, Beaux seins, belles fesses. Éditions du Seuil. Points. 895p. 2004. p.113
662 Marie-Claire Mendès-France, Sarah, au bout de l’enfer. Hachette. 196p. 1996. p.16
663 In : La vie est un reportage. Anthologie du reportage littéraire Polonais. Les éditons noir et blanc. 274. 2005. p.169
664 Danielle Mitterrand, Le printemps des insoumis. Le grand livre du mois. 304p. 1998. p.35, 36, 80, 81
665 Marie-Hélène Luiggi, Marie-Louise Girod. La dame d’en haut. Montauban, Impr. Lormand.166p. 2003. p.117
666 LCI, 4 mars 2016. 13h
667 Le Figaro, Le carnet du jour. 11 avril 2017
668 Le Monde, Disparition. Marceline Loridan-Ivens. 20 septembre 2018
669 France Culture, La force intacte de Saint-Augustin. 10 août 2019 [1ère diffusion. 27 avril 2019]
670 Le Monde, Gisèle Halimi. ‘J’avais en moi une force sauvage, une rage, je voulais me sauver’. 22-23 septembre 2019
671 Amartya Sen, Citoyen du monde. Odile Jacob. 487p. 2022. p.340
672 Paul Claudel, Journal. II. La Pléiade. 1360p. 1969. p.422, 1066
673 France Culture, 23 février 2017. Lise Élina, Dans les coulisses d’une grande maison de couture [1ère diffusion. Chaîne nationale. 1951]
674 In : Honoré de Balzac, La femme de tente ans. Garnier-Flammarion. 242p. 1965. p.34
675 Raymonde Courrière, Partout en France, il y avait une femme connue ou inconnue pour m’accueillir. In : Génération MLF [1968-2008]. Des Femmes. Antoinette Fouque. 615p. 2008. p.144
676 Jean Tulard, Guide des films. 1895-1995. Édition du centenaire du cinéma. L.Z. 1479p. 1995. p.879
677 Annie Stora, Femmes juives d’Algérie : émancipation et transmission. Musée d’art et d’histoire du judaïsme. Exposition Juifs d’Algérie. Table ronde. 21 octobre 2012
678 Elena Ferrante, Le nouveau nom. Folio. Gallimard. 623p. 2016. p.161
679 Chantal Mouffe, Pour un populisme de gauche. Albin Michel. 2018. 144 p.
680 Le Monde Diplomatique, Serge Halimi. Un peuple en construction. décembre 2018. p.26
681 Mémoires du cardinal de Bernis, Le Temps retrouvé. Mercure de France. 1986. 375p. p.52
682 In : Renée Dray-Bensousan, La conquête de la citoyenneté. L’impact de la Grande guerre. In : Femmes à Marseille. Histoire. Féminisme, Politique. Association Les femmes et la ville. Éditions Gaussen. 204p. 2016. p.145
683 Libération. 8 mai 2002
684 Le Monde. 21 mai 2002
685 Le Monde, Tunisie : Les propos ‘effrayants’ de Michèle Alliot Marie suscitent la polémique. 13 janvier 2011
686 Le Figaro, Des armes françaises pour la Tunisie. 27 mars 2015
687 (Source ?) 16 novembre 2008
688 Cf. Marie-Victoire Louis, De quel droit ? 8 juillet 2011 http://www.marievictoirelouis.net/document.php?id=1092&mode=last
689 20 minutes, Législatives. Martine Aubry ‘ne souhaite pas l’échec du président de la République’. 24 mai 2017
690 France Inter, Les femmes et le harcèlement au travail. La double peine. 10 juillet 2016
691 BFM-TV. 18 janvier 2019
692 Libération, Hollande met fin aux fonctions de Delphine Batho. 2 juillet 2013
693 Cécile Duflot, De l’intérieur. Voyage au pays de la désillusion. Fayard. 2014. 231p.
694 Le Parisien, Parti socialiste : Delphine Batho annonce à son tour sa candidature. 15 janvier 2018
695 Jeune Afrique, Nouria Benghebrit, l’insoumise. Du 2 au 9 octobre 2016
696 Tout sur l’Algérie. 3 avril 2019
697 France Culture, Une vie. Une œuvre. Benazir Butho. 2 décembre 2022. [1ère diffusion. 27 octobre 2012]
698 Huguette Bouchardeau, Tout le possible. Syros. 1981. 171p.
699 Colette (Colette Willy), Dans la foule. Éditions Georges Crès et Cie. Dixième édition. 1918.158p.
700 Le Figaro Madame, Catherine Coutelle : ‘Les députées sont des femmes et des mères avant tout’. 12 juin 2017
701 Élisabeth Schemla, Édith Cresson. La femme piégée. Flammarion. 1933. 343p.
702 Élisabeth Schemla, Édith Cresson. La femme piégée. Flammarion. 343p. 1993. p.42
703 Édith Cresson, Histoires françaises. Éditions du Rocher. 2006. In : Paroles de femmes, (Sous la direction de Jean-Pierre Guéno). Radio France. 157p. 2009. p.110, 111
704 Le Canard enchaîné, Minimares. 31 juillet 2019. p.2
705 Le Canard enchaîné, Rachida Dati. La dame d’affaires. 16 janvier 2024. p.7
706 Terrafemina, Cécile Duflot : ‘Je porte le flambeau féministe pour les futures générations.’
707 Cécile Duflot, De l’intérieur. Voyage au pays de la désillusion. Fayard. 231p. 214. p.226
708 Roselyne Bachelot, Geneviève Fraisse, Deux femmes au royaume des hommes. Hachette Littérature. 304p. 1999. p.30, 15, 208
709 Marie-France Garaud, La fête des fous. Qui a tué la Ve République ? Plon. 279p. 2006. p.92, 93
710 Source du livre à retrouver
711 Guillemette de Sairigné, Les françaises face au chômage. Denoël Gonthier. 1974. p.104, 135
712 Françoise Giroud, Leçons particulières. Fayard. 260p. 1990. p.94, 258, 259
713 France Culture, Sur les docks. La révolte des prostituées de Saint Nizier. 1er juin 1975
714 Élisabeth Guigou, Être femme en politique. Plon. 273p. 1997. p.222
715 Le Parisien, Législatives : dans dix jours, ma voix peut s'éteindre’ assure NKM. 6 juin 2017
716 Le Monde, Vanessa Schneider, Vade retro, macho ! 30 novembre 2016
717 AFP, Joly parle de son ‘étrangeté’. 1er avril 2012
718 AFP, Lagarde : ‘c’est un honneur et une joie’. 28 juin 2011
719 AFP, F.M.I : Lagarde sera payée 551.700 dollars. 5 juillet 2011
720 LCI, 24 janvier 2015. 12h 37
721 Le Point, Christine Lagarde : ‘Le roi Abdallah, un grand défenseur des femmes’. 24 janvier 2015
722 Le Figaro Madame, Christine Lagarde : ‘Il ne faut jamais lâcher la cause des femmes’. 2 mars 2015
723 La Tribune, Lagarde exclut un report de paiement pour la Grèce. 17 avril 2015
724 France Inter, 4 avril 2017. 17 heures
725 Marie-Noëlle Lienemann, Ma part d’inventaire. Ramsay. 156p. 2002. p.151
726 Valeurs actuelles, ‘Il faut arrêter les conneries maintenant ‘.’ Quand Brigitte flanque une ‘déculottée’ à Emmanuel Macron. 4 octobre 2018
727 Gala, Emmanuel et Brigitte Macron, très fusionnels en Arménie. Des gestes qui en disent long… 11 octobre 2018
728 Le Monde, Depuis la crise des ‘gilets jaunes’, la vie à huis clos Emmanuel Macron. 22 décembre 2018
729 Le Figaro, Gérard Collomb : ‘Aujourd’hui, Emmanuel Macron est en difficulté.’ 9 mai 2019
730 Le Canard enchaîné, Minimares. 21 août 2019. p.2
731 Maria de Lourdes Pintasilgo, L’inégalité inédite et subversive. In : L’exigence d’égalité. XXVIIème rencontres internationales de Genève. Éditions La Baconnière, Neuchâtel. 320p. 1982. p.247
732 Le Monde, De Panafieu, une ‘ex-jupette’ en rage contre le machisme de l’UMP. 2 juin 2012
733 Être français aujourd’hui et demain. I. Rapport de la commission de la nationalité (M. Marceau Long. Président) 10/18. UGE. 769p. 1988. p.501
734 Le Figaro, Valérie Pécresse : ‘Je veux sauver la droite’. 7 juin 2019
735 Le Canard enchaîné, Le mur du çon. 19 août 2020. p.1
736 Monique Pelletier, La ligne brisée. Flammarion. 190p. 1995. p.75
737 Le JDD, Une ancienne ministre agressée il y a 37 ans : ‘Honte à moi de mon silence !’ 10 mai 2016
738 Le Canard enchaîné, Muriel Pénicaud. 20 mai 2020. p.7
739 Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions. Autres œuvres autobiographiques. In : Œuvres complètes. I. La Pléiade. 1969p. 1959. p.553, 565
740 Yvette Roudy, Mais de quoi ont-ils peur ? Un vent de misogynie souffle sur la politique. Albin Michel. 218p. 1995. p.142
741 Marie-Victoire Louis, Pourquoi je ne signe pas l’Appel : ‘Des intellectuelles pour Ségolène Royal’ http://www.marievictoirelouis.net/document.php?id=772&themeid=341
742 France Culture, L’esprit public, Simone Veil : Un Panthéon pour ne jamais oublier ? 1er juillet 2018
743 Le Figaro, Démission de la ministre de l’intérieur Britannique après plusieurs scandales. 30 avril 2018
744 Françoise Giroud, La comédie du pouvoir. Fayard. 361p. 1977. p.29
745 Marlène Schiappa, Osez l’amour des rondes. La Musardine. 2010. 120p.
746 Atlantico, Marlène Schiappa, rattrapée par ses écrits. 24 mai 2017
747 ChEEk magazine, Marlène Schiappa : ‘Si Emmanuel Macron est élu, la vie des femmes va changer.’ 28 avril 2017
748 RTL. Girls, Présidentielle. Ce qu’il faut retenir du ‘Grand débat’ de la Fondation des femmes. 25 mars 2017
749 Les Nouvelles News, Marlène Schiappa : ‘Chaque action gouvernementale doit aller vers plus d’égalité entre les femmes et les hommes.’ 22 mai 2017
750 Les Nouvelles News, Marlène Schiappa : ‘Chaque action gouvernementale doit aller vers plus d’égalité entre les femmes et les hommes’. 22 mai 2017
751 Blog de Marlène Schiappa. Adjointe au Maire du Mans déléguée à l'égalité Conseillère communautaire Le Mans Métropole. Fondatrice de Maman travaille. 24 mai 2017
752 Public Sénat. 3 août 2017
753 TV. Public Sénat. 3 août 2017
754 Le Figaro, La PMA pour toutes annoncée pour 2018. 12 septembre 2017
755 Gouvernement.fr. 18 octobre 2017
756 Le Canard enchaîné, La mare aux canards. 8 août 2018. p.2
757 Le Canard enchaîné, Le melon d’or. 25 octobre 2017. p.8
758 Le Canard enchaîné, Parité mal ordonnée… 22 novembre 2017. p.2
759 Caroline de Haas, Clara Gonzales, Madeline Da Silva, Laure Salmona, Chloé Ponce-Voireau, Elliot Lepers, Décryptage du budget dédié à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. 9 p.
760 Le Canard enchaîné, La mare aux canards. 7 février 2018. p.2
761 Le JDD, Marlène Schiappa : ‘Pourquoi les accusateurs de Nicolas Hulot bafouent la parole des femmes.’ 10 février 2018
762 Le Point, Nicolas Hulot dépose plainte en diffamation contre le magazine Ebdo. 6 mars 2018
763 Touche pas à mon poste. 8 mars 2018
764 Veille de l’actualité, Spéciale ‘8 mars 2018’. 13 mars 2018
765 Le Canard enchaîné, Feuilleté de canard. 9 mai 2018. p.6
766 Site, Ministère du travail. Égalité professionnelle Hommes-Femmes. Conclusion de la concertation avec les partenaires sociaux. 9 mai 2018
767 AFP. Le Figaro-Madame, Hausse des violences et menaces contre les femmes sur leur lieu de travail. 31 mai 2018
768 Cf. le communiqué de presse collectif : Non à l’asphyxie financière de l’Association contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT) In : Courrier de la Marche mondiale des femmes contre les violences et la pauvreté. n°353. 11 mai 2018
769 Les Échos, Marlène Schiappa : ‘L’État doit reprendre la main’. 6 mai 2018
770 AVFT, De la liberté d’information des associations féministes. 27 avril 2018
771 Nouvelles News, Marlène Schiappa lance un appel à projet contre les violences. 8 mai 2018
772 Libération, Murlel Pénicaud, Marlène Schiappa : ‘Qui voudra travailler là où il n’y a pas d’égalité salariale ? 10 mai 2018
773 Huffington Post, Festival de Cannes : Marlène Schiappa soutient les actrices mais ne montera pas les marches. 12 mai 2018
774 Le Canard enchaîné, Schiappa vedette américaine. 16 mai 2018. p.2
775 Cf. notamment, Capital, Marlène Schiappa explose à l’Assemblée nationale après une allusion sur sa vie sexuelle. 17 mai 2018
776 Le Monde, Marlène Schiappa ou l’art de la mise en scène de soi. 30 mai 2018
777 Le Canard enchaîné, La mare aux canards. 17 juillet 2019. p.2
778 France 2, On n’est pas couché. 30 juin 2018
779 Le Canard enchaîné, Place des grandes odes. 4 juillet 2018. p.8
780 Paris-Match, Claire Chazal, son entretien sans tabous avec Marlène Schiappa. 15 juillet 2018
781 Le Canard enchaîné, À la une de ‘Paris-Matchisme’. 18 juillet 2018. p.8
782 Franceinfo. 25 juillet 2018
783 Le Figaro, Harcèlement de rue : ‘Premières amendes à l’automne’, annonce Schiappa. 30 juillet 2018
784 Le Canard enchaîné, Minimares. 1er août 2018. p.2
785 Le Canard enchaîné, La mare aux canards. 29 août 2018. p.2
786 Le Canard enchaîné, Schiappa…de raison. 5 septembre 2018. p.5
787 Veille de l’actualité́. Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes. 24 août 2018
788 Le Canard enchaîné, Climat, mon amour. 12 septembre 2018. p.1
789 Le Canard enchaîné, Schiappa est dure d’oseille. 12 septembre 2018. p.4
790 RMC, Interview de Marlène Schiappa. 13 septembre 2018
791 RMC, Interview de Marlène Schiappa. 13 septembre 2018
792 Le Canard enchaîné, La brosse à reluire. 17 octobre 2018. p.1
793 France 5, C Politique. 14 octobre 2018
794 Libération, 17 octobre 2018. 10h 17
795 Le Journal du Dimanche, Schiappa : ‘Je pense incarner l’ADN d’En marche’. 21 octobre 2018
796 Match, Marlène Schiappa donne des mèches de ses cheveux pour les femmes atteintes d’un cancer. 1er novembre 2018
797 Le Figaro, Polémique sur Pétain : Face à la pression, l’Élysée fait volte-face. 8 novembre 2018
798 Le Canard enchaîné, Sniper socialiste. 14 novembre 2018. p.1
799 LCI, Tweet. Marlène Schiappa. 3 décembre 2018
800 LCI. 16 décembre 2018
801 Le Canard enchaîné, Service après-vente gouvernemental. 2 janvier 2019. p.1
802 Le Figaro, Pour Macron, les ‘gilets jaunes’ traduisent ‘un ‘gigantesque échec collectif’. 22 février 2019
803 Huffington Post, Cagnotte Leetchi pour Dettinger : Schiappa veut savoir qui a participé. 8 janvier 2019
804 L’Express, Schiappa chez Hanouna : ’La France, pays qui aime se plaindre’. 26 janvier 2012
805 Le Canard enchaîné, Schiappa de course. 20 février 2019. p.2
806 20 minutes, Il existe ‘une convergence idéologique’ entre La manif pour tous et ‘les terroristes islamistes’, selon Marlène Schiappa. 20 février 2019
807 Le Figaro, La manif pour tous va porter plainte pour diffamation contre Marlène Schiappa. 22 février 2019
808 Edmund Burke, Réflexions sur la Révolution de France. Pluriel. 816p. 2011. p.15
809 C’Politique. 10 mars 2019
810 BFM-TV, Marlène Schiappa : ‘Nous avons des femmes qui paient l’incivisme de leur ex-conjoint’. 25 avril 2019
811 Huffington Post, Schiappa accusée de ‘fake news’ par un syndicat de commissaires sur les féminicides. 28 avril 2019
812 Le Journal du Dimanche, Tribune de Marlène Schiappa : ‘Qui est prêt à faire passer son pays avant son parti’ ? 9 juin 2019
813 Marche mondiale des femmes, Avortement en Europe : les femmes décident. 12 juin 2019
814 JDD, Marlène Schiappa, celle qui dérange. 6 août 2019
815 Le Canard enchaîné, Le mur du çon. 12 février 2020. p.1
816 Le Canard enchaîné, Minimares. 30 septembre 2020. p.2
817 In : Le Canard enchaîné, Schiappa de limites. 11 novembre 2020. p.1
818 Le Canard enchaîné, La mare aux canards, Les cataclysme de Schiappa. 24 février 2021. p.2
819 Le Canard enchaîné, Tripes et féminisme. 19 avril 2023. p.2
820 Charles de Gaulle, Mémoires. La Pléiade. 1505p. 2000. p.1122
821 Mouloud Feraoun, Journal. 1955-1962. Éditions du Seuil. 348p. 1962. p.292
822 Libération, La réponse de Taubira au tacle de Ciotti : ‘Je vous obsède avec une constance qui mérite l’admiration’. 23 juin 2015
823 France Culture, Grandes traversées. Margaret Thatcher. Où est passé la classe ouvrière ? 30 juillet 2020
824 France Culture, Christine Ockrent : ‘Ce qui me passionne, c’est d’apprendre des choses que j’ignore. 9 juillet 2022.
825 France Culture, L’esprit public. Simone Veil : Un Panthéon pour ne jamais oublier ? 1er juillet 2018
826 Le Monde, Elizabeth Warren, passionaria anti-Trump. 13 décembre 2016
827 Le Monde Diplomatique, Dans les revues. avril 2019. p.26
828 Cecilia Bertin, Louise Weiss. Albin Michel. 1999. 517p.
829 Louise Weiss, Combats pour les femmes. Albin Michel. 1980. 270p.
830 In : L’Évènement du jeudi. 4 mars 1994
831 Juliette Minces, De Gurs à Kaboul. Éditions de l’Aube. 315p. 2015. p.315
832 Céleste Albaret, Monsieur Proust. Robert Laffont. 455p. 1991. p.12, 437
833 France Culture, Céleste Albaret. 30, 31 juillet 2019
834 France Culture, Céleste Albaret. 2 août 2019
835 France Culture, Céleste Albaret. 2 août 2019
836 Alexandra David-Neel, Correspondance avec son mari. Édition intégrale. 1904-1941. Plon. 943p. 2001. p.254
837 Albert Camus, L’homme révolté. Idées. Gallimard. 372p. 1972. p.44, 45
838 France Culture, Une vie, une œuvre. Florence Arthaud, l’insoumise. 6 juin 2015
839 Arte, Lucie Aubrac. 15 août 2021
840 Cf. notamment, Thérèse d’Avila, Vie écrite par elle-même. Le Seuil. Points Sagesse. 1949. 1995. 476 p. ; Bernard Sesé, Petite vie de Thérèse d’Avila. Desclée de Brouwer. 1991. 153 p.
841 Pietro Citati, Portraits de femmes. L’arpenteur. 375p. 2001. p.24, 25
842 La Pléiade. Présentation du livre. Thérèse d’Avila, Jean de la Croix. La Pléiade. 2012. 1184p.
843 In : Honoré de Balzac, La cousine Bette. Flammarion. 640p. 2015. note 1. p.178
844 Mouna Ayoub, La vérité. Autobiographie. Michel Lafon. 235p. 2000. p.21, 22
845 Emma Goldman, Vivre ma vie. Une anarchiste au temps de révolutions. L’échappée. 1095p. 2018. p.841
846 Armenews.com, Syrie. Cette jeune femme kurde a eu les seins découpés par des soldats turcs. 3 février 2018
847 Jean-Claude Brialy, Le ruisseau des singes. Pocket. Robert Laffont. 510p. 2001. p.403
848 In : France Culture, Josephine Baker, l’insoumise. La mort en scène. 12 août 2022
849 Marie Bashkirtseff, Journal. Fasquelle. Tome 1er. 312 p. 1955. p.48
850 Marie Bashkirtcheff, Journal. Ed. Mazarine. 1980
851 Samira Bellil, Dans l’enfer des tournantes. Éditions France loisirs. Récit. 2003. 234p.
852 France Culture, Les pieds sur terre. Ni putes, ni soumises. Portrait de Kahina. 9 juillet 2015 [1ère diffusion. 7 mars 2003]
853 Chantal Antier, Louise de Brettignies. Espionne et héroïne de la grande guerre. Tallandier. 224 p. 2013. p.9
854 Suzanne Bidault, Par une porte entrebâillée ou : Comment les françaises entrèrent dans la carrière. La table ronde. 226p. 1972. p.48, 17, 18, 195, note 1. p.218
855 Stendhal, Lettres à Pauline. L’école des lettres. Seuil. 1994. 645p. p.123, 124
856 In : Judith Thurman, Karen Blixen. Robert Laffont. 492p. 2000. p.156
857 Pietro Citati, Portraits de femmes. L’arpenteur. 375p. 2001. p.123, 130
858 Sigmund Freud, Lettres à Wilhelm Fliess. PUF. 763p. 2006. p.705
859 Mathilde Castillon du Perron, La princesse Mathilde. Un règne féminin sous le second Empire. Amiot*Dumont. Paris. 310p. 1953. p.180
860 Tacite, Œuvres complètes. Préface et nouvelle traduction de Catherine Salles. Bouquins. Robert Laffont. 857p. 2014. Concernant Boudicca, Cf. p.46, 62, 72, 732, 734, 735
861 Le Figaro, Colette, 91 ans, vient d’obtenir se thèse en géographie. 18 mars 2016
862 In : Jean-Paul Aron, Les modernes. Gallimard. 314p. 1984. p.155
863 En sus, sur cette période, ses Mémoires, Cf. Zoé Oldenbourg, Catherine de Russie. Folio. Histoire. Gallimard. 378p. 1986. p.135
864 Victor Hugo, Les misérables. Notes et variantes. La Pléiade. 1805p. 1951. p.1661
865 Julien Green, Vers l’invisible. Journal 1958-1967. Le livre de poche. 477p. 1967. p.366
866 France Inter, Affaires sensible. Timisoara. 1989. La révolution roumaine en direct. 10 mars 2015
867 Arte, Christine de Suède. Une reine libre. 27 juin 2015
868 In : Femmes savantes. De Margueritte de Navarre à Jacqueline de Romilly. Les Belles Lettres. 388p. 2020. p.172
869 In : Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe. Folio. 645p. 1989. note. p.559
870 Danielle Michel-Chich, Thérèse Clerc, Antigone aux cheveux blancs. Des femmes. Antoinette Fouque. 132 p. 2007. p.131
871 Plutarque, Vies parallèles. Quarto. Gallimard. 2192 p. 2001. p.1669 à 1741
872 In : Éliane Richard, L’exemple marseillais en deux actes. Acte I. Les suffragettes. In : Femmes à Marseille, Histoire, féminisme, Politique. Association Les femmes et la ville. Éditions Gaussen. 204p. 2016. p.158, 159
873 In : Voltairine de Cleyre, De l’action directe. Le passager clandestin. 74 p. 2009. note 2. p.41
874 Élizabeth Craven, princesse de Berkeley, Mémoires. Le Temps retrouvé. Mercure de France. 617p. 2008. p.419
875 Renée Dray-Bensousan, La conquête de la citoyenneté. L’impact de la grande guerre. In : Femmes à Marseille. Histoire, féminisme, politique. Association Les femmes et la ville. Éditions Gaussen. 204p. 2016. p.16, 147
876 Marie d’Agoult. George Sand, Correspondance. Bartillat. 301p. 1995. p.67, 68
877 George Sand, Correspondance. Georges Lubin, Classiques Garnier. Tome XX. 942p. 1985. p.617, 618
878 Mémoires de la princesse Daschkoff, Dame d’honneur de Catherine II, Impératrice de toutes les Russies. Le Temps retrouvé. Mercure de France. 388p. 1989. p.68, 70
879 In : Simon-Pierre Perret, Harry Halbreich, Albéric Magnard. Fayard. 639p. 2001. p.322 à 326
880 Alexandra David-Neel, Correspondance avec son mari. Édition intégrale. 1904-1941. Plon. 943p. 2001. p.164
881 Jacques Prévert, Choses et autres. Folio. Gallimard. 265p. 1972. p.215, 216, 217. Cf. aussi : Jacques Prévert, Angela Davis, Œuvres complètes. II. La Pléiade. Gallimard. 1553p. 1996. p.348, 349, 350
882 Elle, n°3545. 6 décembre 2013
883 Voltairine de Cleyre, Le mariage est une mauvaise action. Introduction de Chris Crass, lequel s’inspire du livre de Paul Avrich, An American Anarchist, The life ou Voltairine de Cleyre. (qu’il faudrait traduire et publier en français). Éditions du Sextant. 60p. 2009. p.9, 10
884 Paul Avrich, An american anarchist : the life of Voltairine de Cleyre. Princeton University Press. 1978. Cité dans l’introduction de Chris Crass du livre de Voltairine de Cleyre, Anarchisme et traditions américaines. Éditions du Sextant. 2012. p.23
885 In : Journal des Goncourt. Tome IV. 1865-1868. Honoré Champion. 765p. 2019. p.417. note 3. p. 418
886 Jean-Paul Sartre, Situations VIII. Gallimard. 476p. 1980. p.309
887 Cf. concernant les actions politiques des Maoïstes en France et les réponses de la police de la justice et du système pénitentiaire, cf. Jean-Claude Vimon, Les emprisonnements des Maoïstes et la détention politique en France (1970-1971) Crimino Corpus. 6 octobre 2015
888 Friedrich Engels, Paul et Laura Lafargue, Correspondance. Tome III. (1891-1895). Les Éditions sociales. 596p. 1959, notamment p.13, 169
889 Terrel Craver, Marx’s ‘Illegitimate son’. In : Marx, Myths and Legends. Université de Bristol. mars 2005
890 Voltaire, Correspondance. IV. (janvier 1754-décembre 1757). La Pléiade. 1655p. 1978. p.33, 85
891 Voltaire, Correspondance. IX. (juillet 1767-septembre 1769). La Pléiade. 1601p. 1985. p.341
892 Voltaire, Correspondance. IX. (juillet 1767-septembre 1769). La Pléiade. 1601p. 1985. p.490
893 Ménie Grégoire, Telle que je suis. Robert Laffont. 359p. 1976. p.150, 151
894 Christiane Desroches-Noblecourt, Sous le regard des dieux. Albin Michel. 475p. 2009. p.178, 179
895 France Culture, À voix nue. Christiane Desroches-Noblecourt. 28 décembre 2017 [1ère diffusion. 20 décembre 2011]
896 Hommes et Migrations, La condition des femmes noires en France. n°1257. septembre-octobre 2005
897 Archived, Lire les Femmes écrivains et les littératures Africaines. juin 1995
898 Léon Tolstoï, La guerre et la paix. La Pléiade. Traduction de Pierre Pascal. 1654 p. 1945. p.1354 (Livre 4)
899 Svetlana Alexievitch, La guerre n’a pas un visage de femme. J’ai lu. 415p. 2016. p.52, 53
900 Lettres inédites de Juliette Drouet à Victor Hugo, Éditées par Marva A. Barnett et Gérard Pouchain. Publication des Universités du Rouen et du Havre. 271p. 2012. p.14, 147, 158, 233
901 Victor Hugo, Pendant l’exil. In : Choses vues. 1849-1885. Édition Hubert Juin. Folio. Classique. Gallimard. 1114p. 2010. p.405, 406, 431
902 Voltaire, Correspondance. II. (janvier 1739-décembre 1748). La Pléiade. 1814p. 1977. p.243, 274
903 Voltaire, Correspondance. III. (janvier 1749-décembre 1753). La Pléiade. 1534p. 1975. p.11
904 Voltaire, Correspondance. III. (janvier 1749-décembre 1753). La Pléiade. 1534p. 1975. p.1105, 109, 110, 120, 121, 122, 147, 612, 639, 830
905 Voltaire, Correspondance. I. (1704-1738). La Pléiade. 1735p. 1964. p.733
906 Voltaire, Correspondance. I. (1704-1738). La Pléiade. 1735p. 1964. p.885
907 Le chevalier de Propiac, Le Plutarque des jeunes demoiselles. Abrégé des femmes illustres de tous les pays. Tome Premier. 360p. 1825. p.241, 245, 246
908 Louise Colet, Madame du Châtelet. Lettres inédites au Maréchal de Richelieu et à Saint Lambert. In : Revue des deux mondes. T.II. 1845 (lisible sur le net)
909 Voltaire, Correspondance. V. (janvier 1758-septembre 1760). La Pléiade. 1698p. 1980. p.232
910 Voltaire, Correspondance. VIII. (avril 1765-juin 1767). La Pléiade. 1663p. 1983. p.348
911 Georges Sadoul, Dictionnaires des cinéastes. Microcosme. Le Seuil. 1990
912 Dominique Desanti, La femme au temps des années folles. Le livre de poche. 447p. 1984. p.172 à 175
913 Isadora Duncan, Ma vie. Folio. Gallimard. 447 p. 2016. p.426
914 René Descartes, Correspondance, 2. In : Œuvres complètes. Tel. Gallimard. 1178p. 2013. p.173
915 In : Femmes savantes. De Margueritte de Navarre à Jacqueline de Romilly. Les Belles Lettres. 388p. 2020. p.172, 173
916 France Culture, La Grande table. Mona Elhatawy, le combat des femmes. 11 juin 2015. Cf. aussi : Le Monde, La colère féconde de Mona Elatahawy. 24 août 2019
917 Huffington Post, Le Pape François a pris la défense d’Ève face à Adam. 17 septembre 2015
918 Oriana Fallaci, Un homme. Grasset. 1981. 497p.
919 Christine Ockrent, La mémoire du cœur. Fayard. 322p. 1997. p.103 à 118
920 Wilhelm von Humboldt, Journal Parisien.1797-1799. Honoré Champion. 417p. 2013. p.215. note 2
921 In : Beaumarchais, Œuvres. La Pléiade. 1696p. 1988. notes. p.1576, 1578
922 France Culture, Martha Gelllhorn - Raconter la guerre, toute sa vie. 12 novembre 2016
923 France Culture, Martha Gelllhorn - Raconter la guerre, toute sa vie. 19 septembre 2021. [1 ère diffusion. 12 novembre 2016]
924 Emma Goldman, Vivre ma vie. Une anarchiste au temps des révolutions. L’échappée. 1095p. 2018. p.194
925 Anna Politkovskaïa, La Russie de Poutine. Buchet/Chastel. 271p. 2005. p.83 et suivantes
926 Maurice Nadeau, Journal en public. La Quinzaine littéraire. Maurice Nadeau. 317p. 2006. p.189, 190
927 Jean Tulard, Guide des films. 1895-1995. Édition du centenaire du cinéma. L.Z, 1479p. 1995. p.290
928 Libération, Le ‘Sallygate’ de Jefferson. La liaison du Président en 1802 et de son esclave suscite les passions. 21 novembre 1998
929 John Updike, Terroriste. Points. Éditions du Seuil. 320p. 2009. p.271
930 Des femmes allemandes en résistance contre le nazisme. Blog de l’UFAC de Bagnolet. (Union locale de l’association française des anciens combattants et victimes de guerre) 6 mai 2010
931 France Culture, Les tourbillons d’Helen Hessel, La vie comme oeuvre d’art. 5 juin 2022
932 Arte, Billie Holiday, Un supplément d’âme. 12 avril 2015
933 René Floriot, Deux femmes en Cour d’Assises. Madame Steinheil et Madame Caillaux. Hachette. 178p. 1966. p.7, 8
934 Voltaire, Correspondance. X. (octobre 1769-juin 1772). La Pléiade. 1648p. 1986. p.141, 750, 825
935 In : Exploratrices et aventurières. Ou : l’art de parcourir le monde et de conquérir le ciel dans la littérature. Les thématiques. Gallimard Jeunesse. 250p. 1997. p.138 à 142
936 Cité (sans date, sans source) In : Jean Tulard, Guide des films. 1895-1995. Édition du centenaire du cinéma. L.Z, 1479p. 1995. p.230
937 Kafka, Lettres à Milena. L’Imaginaire. Gallimard. 1988. 364p.
938 Milena Jesenskà, Vivre. Lieu commun. 1985. 285p.
939 Mouloud Feraoun, Journal. 1955-1962. Éditions du Seuil. 348p. 1962. p.46
940 Kateb Yacine, La Kahina. In : Parce que c'est une femme, Textes réunis par Zebeïda Chergui, Théâtre, Éditions des Femmes. Antoinette Fouque, 2004. 174 p.
941 Friedrich Engels. Paul et Laura Lafargue, Correspondance. Tome III. (1891-1895). Les Éditions Sociales. 595p. 1959. p.76
942 Aragon, L’homme communiste. Gallimard. 246p. 1946. p.122
943 Kiki. Souvenirs retrouvés. José Corti. 319p. 2005. p.229, 230
944 France Culture, Les rencontres de Pétrarque. 20 juillet 2015
945 Arkadi Vaksberg, Alexandra Kollontaï (traduit du Russe) Fayard. 1996. 516p.
946 Friedrich Engels. Paul et Laura Lafargue, Correspondance. Tome III. (1891-1895). Les Éditions Sociales. 595p. 1959. p.29
947 Panaït Istrati, L’autre flamme. 1929. In : Œuvres. III. Édition établie et présentée par Linda Lê. Phébus. 730p. 2006. p.522
948 Pierre Pascal, En Communisme. Mon journal de Russie. 1919-1923. L’Âge d’Homme. 223 p. 1977. p.153, 154
949 Arte, Le rêve du nouveau monde. La traversée. 3 juin 2017
950 In : Honoré de Balzac, La cousine Bette. Éditions Garnier frères. 496p. 1974. note. p.422, 423
951 Zaza, Correspondance et carnets d’Élisabeth Lacoin.1914-1929. Seuil. 381p. 1991. p.295, 288
952 Simone de Beauvoir, Les mémoires d’une jeune fille rangée. (page à retrouver)
953 Friedrich Engels, Paul et Laura Lafargue, Correspondance. Tome II. (1887-1890]. Les Éditions sociales. 462p. 1957. p.376
954 Friedrich Engels. Paul et Laura Lafargue, Correspondance. Tome III. (1891-1895). Les Éditions Sociales. 595p. 1959. p.187
955 Marie A. Macciocchi, Les femmes et leurs maîtres. Christian Bourgeois. 441p. 1979. p.400. Repris (non vérifié) de Fréville, Lénine à Paris. Éditions sociales. 1950
956 Dominique Desanti, La femme au temps des années folles. Le livre de poche. 447p. 1984. p.35
957 Mémoires de la Marquise de la Rochejaquelein. Le Temps retrouvé. Mercure de France. 1988. 555p.
958 Hippolyte Taine, Une anglaise témoin de la Révolution française. Éditions Jacqueline Chambion. 197p. 2006. p.9
959 Jules Michelet, Histoire de la Révolution française. I. La Pléiade. 1530p. 1976. p.252
960 Germaine de Staël, De l’Allemagne. I. Garnier Flammarion. 380p. 1968. p.72
961 Arthur Young, Voyages en France.10/18. 311p. 1988. p.77
962 In : Femmes savantes. De Margueritte de Navarre à Jacqueline de Romilly. Les Belles Lettres. 388p. 2020. p.237
963 In : Femmes savantes. De Margueritte de Navarre à Jacqueline de Romilly. Les Belles Lettres. 388p. 2020. p.237
964 Georges Bernanos, Lettres retrouvées. 1904-1948. Plon. 517p. 1983. p.451
965 Édith Stein, Correspondance I. 1917-1933 ; II. 1933-1942. Cerf. Éditions du Carmel - Ad Solem. 2009. 2012. 767p. et 792p.
966 In : Jacques Prévert, Œuvres complètes. II. La Pléiade. Gallimard. 1553p. 1996. p.459. note. p.1246
967 Catherine Ehrel, Catherine Leguay, Prisonnières. Voix de femmes. Stock 2. 278p. 1977. p.11, 12
968 André Léo, Les spéculateurs, In : La République des Travailleurs du 29 janv. au 5 fév.1871. n°4
969 Depuis lors, plusieurs publications. Cf. aussi la présentation d’André Léo, faite par Michelle Perrot, André Léo ou la cause de l’insurrection, In : André Léo, La guerre sociale. Le passager clandestin. 2011. 75 p.
970 In : Jacques Rougerie, La Commune de Paris. In : Nouvelle encyclopédie politique et historique des femmes. Sous la direction de Christine Fauré. Les Belles lettres. 1216p. 2010. p.502, 504
971 In : Émile Zola, Correspondance. II. 1868-1877. Les Presses de l’Université de Montréal. Éditions du CNRS. 644p. 1980. note 2. p.415
972 Claudine Rey, Annie Gayat, Sylvie Pepino, Petit Dictionnaire des femmes de la Commune. Les oubliées de l’histoire. Les amies et Amie de la commune de Paris. 1871. 302p. 2018. p.49, 50
973 Julie de Lespinasse, Lettres à Condorcet. Desjonquères. 1989. 161p. Préface. p.12
974 Benjamin Constant. Isabelle de Charrière. Correspondance. 1787-1805. Desjonquières. 536p. 1996. p.127
975 Lettres et pensées du Maréchal de ligne. Texte établi par Germaine de Staël. [lisible sur Wikisource]. 1808. p.322
976 Germaine de Staël, Lettres sur les écrits et le caractère de J.-J. Rousseau, In : Œuvres complètes. Série I. Honoré Champion. 414p. 2008. p.92
977 Lou-Andreas-Salomé, Ma vie. Quadrige. PUF. 315p. 1986. p.78
978 In (notamment) : Dorian Astor, Lou Andreas-Salomé, Folio. Biographies. Gallimard. 394 p. 2009, p.121
979 Lou-Andreas-Salomé, Ma vie. Quadrige. PUF. 315p. 1986. p.149
980 Lou-Andreas-Salomé, Ma vie. Quadrige. PUF. 315p. 1986. p. XVI
981 Luxembourg (Rosa), J’étais, je suis, je serai ! Correspondance. 1914-1919. F. Maspero. 430p. 1977. p.210
982 Boris Souvarine, Staline. Éditions Ivrea. 639p. 1992. p.77
983 France Culture, Rosa, la vie, Théâtre et Cie. 11 novembre 2012 [1ère diffusion. 29 septembre 2009]
984 Les Cahiers du comte Kessler (traduit de l’Allemand). Grasset. 307p. 1972. p.86
985 James C. Scott, L’œil de l’État. La Découverte. 540p. 2021. note 1. p.261
986 In : Victor Faye, Du parti, instrument de lutte pour le pouvoir au parti préfiguration d’une société socialiste, in : Sociologie et révolution. 10/18. 438p. 1975. p.121
987 Marie A. Macchiocchi, Séminaire Paris VII. Vincennes. Les femmes et leurs maîtres. Christian Bourgeois. 441p. 1979. p.387 à 441
988 France Culture, Qui êtes-vous, Madame Simone ? 12 juillet 2024 [Date d’entrgistrement. 1er janvier 1951]
989 Le livre noir de la condition des femmes. Dirigé par Christine Ockrent. Document. XO Éditions. 954p. 2007. p.423
990 In : Victor Hugo. Témoin de son siècle. J’ai lu. L’essentiel. 561p. 1962. p.182, 184
991 Abbé Pierre & Bernard Kouchner, Dieu et les hommes. Robert Laffont. 232p. 1993. p.180, 181
992 Catherine Clément, Mémoire. Champs. Flammarion. 588p. 2010. p.356
993 Louise Michel, Mémoires. Préface de Xavière Gauthier. 582 p. Éditions Tribord. 2005. p.125
994 Paule Lejeune, Louise Michel, L’indomptable. Des femmes. 327p. 1978. p.322, 323
995 Jean Grave, Le mouvement libertaire sous la IIIème République. Souvenirs d’un révolté. Les œuvres représentatives. Gallica. 352p. 1930. p.282. Cf. aussi, Jean Grave, Mémoires d’un anarchiste. Éditions du sextant. 542p. 2009. p.495
996 France Inter, Guillaume Gallienne. Colette. 26 juillet 2015
997 Saint Augustin, Les Confessions. Chapitre IX. Vertus de Sainte Monique
998 Jacques Prévert, Œuvres complètes. II. La Pléiade. Gallimard. 1553p. 1996. p.453
999 In : Jacques Prévert, Œuvres complètes. II. La Pléiade. Gallimard. 1553p. 1996. note. p.1242, 1243
1000 Hélène Berr, Journal. Points. Tallandier. 329p. 2009. p.327
1001 France Inter, 31 décembre 2016. 8h 20
1002 Germaine de Staël, Considérations sur la Révolution française. Cf. note 42 de la première partie. Tallandier. 693p. 1983. p. 612, 613
1003 In : Georges Solovieff, Madame de Staël, ses amis, ses correspondants. Choix de lettres [1778-1817]. Éditions Klincksieck. 586p. 1970. p.27
1004 Anaïs Nin, Journal. 1939-1944. Le livre de poche. 508p. 1971. p.482, 483
1005 Voltaire, Correspondance. III. (janvier 1749-décembre 1753). La Pléiade. 1534p. 1975. p.396 à 402, 415
1006 M. Charles Collé, Journal et mémoires. Journal Historique. Année 1755. Tome. 2. Firmin Didot. 1868. p.5 (lisible sur Gallica)
1007 Charles du Bos, Journal. 1921-1923. Éditions Corrêa. Paris. 412p.1946. p.85
1008 André Gide, Journal. 1889-1939. La Pléiade. 1378p. 1948. p.784, 1067
1009 Archive INA, Marie Noël. 14 mai 1959
1010 François Mauriac, Nouveaux mémoires intérieurs. Folio. Gallimard. 374p. 1976. p.83
1011 Farah Pahlavi, Mémoires. J’ai lu. Édition Illustrée. 2004. 415p.
1012 Geneanet. Essai de généalogie par Alain Garric (sans date)
1013 Cf. Frédéric Delforge, Jacqueline Pascal (1625-1661). Une biographie. Réédition en 2017 de l’édition de 2002. Classique Garnier. 157p.
1014 Sainte-Beuve, Pascal. UGC. 10/18. 186p. 1962, p.142 à 145
1015 Jacques Prévert, Choses et autres. Folio. Gallimard. 265p. 1980. p.182
1016 George Orwell, Une vie en lettres (Correspondance. 1903-1950). Agone. 666p. 2014. p.394
1017 Magdeleine Paz, Je suis l’étranger. Reportages, Suivis de Documents sur l’Affaire. Textes réunis, présentés et annotés par Anne Mathieu. La Thébaïde. 393p. 2015. p.272
1018 Panaït Istrati, L’homme qui n’adhère à rien. Les Nouvelles littéraires. 8 avril 1933, In : Œuvres. III. Phébus Libretto. 730p. 2006. p.683
1019 Mediapart, Christophe Patillon, Magdeleine Paz, une voix oubliée. 20 mars 2016
1020 Ekaterina Olitksaïa, Le sablier. Les éditions du bout de la ville. 656p. 2024. p.480
1021 Danielle Mitterrand, Le livre de ma mémoire. Folio. Gallimard. 444p. 2007. p.55
1022 Annie de Pisan, Anne Tristan, Histoires du MLF. Préface de Simone de Beauvoir. Calmann-Lévy. 260p. 1977. p.132, 133
1023 Michelle Perrot, Essais d’ego-Histoire. Textes réunis et présentés par Pierre Nora. L’air du temps. NRF. Gallimard. 375p. 1987. p.288
1024 France Culture, Anne Pingeot, la discrète. 17 octobre 2016
1025 Le Journal du Dimanche, Catherine Nay, Les amours de Mitterrand. 16 octobre 2016
1026 Le Figaro, Dans le secret des ‘Lettres à Anne’. 4 octobre 2016
1027 Léon Tolstoï, Anna Karénine. Résurrection. La Pléiade. 1630p. 1951. p.864
1028 Erin Pizzey, Crie moins fort, les voisins vont t’entendre. Préface de Benoîte Groult. Des femmes. 1975. 228p.
1029 France Culture, Moi, Phoolan Devi. Du village aux ravines. 9 mars 2015
1030 France Culture, Moi, Phoolan Devi. De la geôle au Parlement village. 10 mars 2015
1031 France Culture, Entre histoire et légende. Métamorphoses du mythe de Phoolan Devi. 21 mars 2020 [1ère diffusion. 26 mars 1996]
1032 Thérèse Planiol, Une femme, Un destin. Éditions Rive droite. 225p. 1995. p.7, 50
1033 Journal de l’abbé Mugnier. 1879-1939. Le Temps retrouvé. Mercure de France. 639p. 2007. p.396, 397
1034 Ménie Grégoire, Telle que je suis. Robert Laffont. 359p. 1976. p.281 ; France Culture, Le printemps des crèches. 17 février 2009 ; La crèche sauvage. Entretien avec Françoise Lenoble. Prédine. La parole errante. Montreuil. 28 p.
1035 France Musique, Relax. 19 novembre 2019
1036 France Culture, Grands écrivains, grandes Conférences. Rachel par Béatrix Dussane. 19 août 2015. [1ère diffusion. 11 avril 1968]
1037 Bande annonce du film : Belles de nuit. (Vérifier)
1038 Mémoires de la comtesse de Boigne. I. Du règne de Louis XVI à 1820. Le Temps retrouvé. Mercure de France. 765p. 2008. p.235, 236
1039 Cf. Claude Dinnat, Sœur Rosalie Rendu ou la charité à l’œuvre dans le Paris du XIXème siècle. L’Harmattan. 2001. 242p.
1040 Carlo Goldoni, Mémoires. Le Temps retrouvé. Mercure de France. 635p. 2018. p.409
1041 Madeleine Riffaud, On l’appelait Rainer. (1939-1945). Julliard. 241p. 2004
1042 France Culture, Les nuits de France Culture. Marthe Robert : ‘Don quichotte, c’est le désir, et Cervantès c’est le bon sens’. 23 avril 2016. 4h.15
1043 George Sand, Histoire de ma vie. In : Œuvres autobiographiques. II. La Pléiade. 1638p. 2001. p.438
1044 France Culture, Affinité électives. Jacqueline de Romilly. 30 juillet 2016 [1ère diffusion. 10 mai 2005]
1045 In : Femmes savantes. De Margueritte de Navarre à Jacqueline de Romilly. Les Belles Lettres. 388p. 2020. p.385
1046 Madeleine Rondeaux, Journal. 1891-1892. Publications de l’association des amis d’André Gide. 83 p. 2016. p.66
1047 In : Studs Terkel, Hard times. Histoires orales de la grande dépression. Éditions Amsterdam. 2009. 596p.
1048 Claude Blanckaert (sous la direction de) Le Musée de l’homme. Histoire d’un musée Laboratoire. 288p. 2015. p.187
1049 France Culture, Le goût des civilisations perdues. 24 décembre 2019
1050 Anne-Marie Christin, Portrait de Salomé dansant. In : Érotiques. Revue d’Esthétique, 1978. 1/ 2. 10/18. 432p. 1978. note 3. p.104
1051 In : George Sand, Correspondance. Georges Lubin. Classiques Garnier. Tome XV. 964p.1981. note 1. p.576
1052 Ibid. p.622
1053 Fiodor Dostoïevski, Journal d’un écrivain. La Pléiade. 1611p. 1972. p.563, 566 à 574, 1527
1054 Journal de l’abbé Mugnier.1879-1939. Le Temps retrouvé. Mercure de France. 639p. 2007. p.169
1055 Nicolas Berdiaev, Les sources et le sens du communisme russe. Idées. NRF. 373p. 1951. p.55
1056 Didier Raymond, Schopenhauer, Écrivains de toujours. Seuil. 187p. 1995. p.83, 84
1057 Source à retrouver
1058 France Culture, Dulcie September, affaire non classée : une militante qui en savait trop ? 28 octobre 2017
1059 In : Évelyne Le Garrec, Séverine, une rebelle. 1855-1929. Le Seuil. 1982. p.190
1060 Sonia Dayan-Herzbrun, Féministe et nationaliste égyptienne : Huda Sharawi. Mille neuf cent. Revue d’histoire intellectuelle. 16. 1998. p.57 à 75
1061 David Steel, Marie Souvestre. 1835-1906. Pédagogue pionnière et féministe. Presses Universitaires de Rennes. 208p. 2014. p.94
1062 Alexander Berkman, Le mythe bolchévik. Journal 1920-1922. La digitale. 304p. 1996. p.137
1063 In : Mémoires d’une femme de qualité sur le Consulat et l’Empire. Le Temps retrouvé. Mercure de France. 578p. 2004. p.37 (vérifier)
1064 Germaine de Staël, De l’influence des passions sur le bonheur des individus et des nations. Rivages. Poche. Payot. 2000. 321p.
1065 YouTube, Henri Guillemin, Robespierre. (mastérisé le 13 octobre 2015)
1066 Germaine de Staël, Correspondance générale. Tome VI. Klincksieck. 671p. 1993. p.441
1067 Édith Stein, Correspondance. I. 1917-1933. Cerf. Éditions du Carmel - Ad Solem. p. 220, p.678, 679, 680 à 682
1068 France Culture, À voix nue. Évelyne Sullerot, Le fait féminin. Sociologue et militante féministe. 12 avril 2017
1069 Voltaire, Le siècle de Louis XIV. Le livre de poche. 1213p. 2013. p.974
1070 Catherine Le Magueresse. Facebook. 1er décembre 2020
1071 Jean Lacouture, Profession Biographe. Conversations avec Claude Kiejman. Hachette Littératures. 237p. 2003. p.58
1072 Pierre Pascal, Journal de Russie. 1928-1929. Les Éditions Noir sur blanc. 766p. 2014. p.195
1073 Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi, Djamila Boupacha. Gallimard. 280 p. 1962. p.101
1074 Le Parisien, La sœur d’Adama Traoré : ‘mon frère, c’est d’abord une victime’. 18 juillet 2017
1075 France Culture, Journal. 20 juillet 2017. 7h
1076 Madame de Sévigné, Lettres choisies. Folio. Gallimard. 380p. 1994. p.70
1077 Le Monde, Deux ans après la mort d’Adama Traoré, l’enquête est toujours enlisée. 20 juillet 2018
1078 Flora Tristan, Le tour de France. Journal Inédit. 1843-1844. Éditions Tête de feuilles. Archives et Documents. 290p. 1973. p.37, 38, 52, 102, 106
1079 Françoise Verny, Le plus beau métier du monde. Olivier Orban. 459p. 1990. p.444, 445
1080 Françoise Verny, Dieu existe, je l’ai toujours trahi. Olivier Orban. 220p. 1992. p.141, 142
1081 Pierre Pascal, Journal de Russie. 1928-1929. Les Éditions Noir sur blanc. 766p. 2014. p.710, 711
1082 L’Humanité, Dominique Barri, Andrée Viollis, le journalisme, une vocation tyrannique. 28 août 2012
1083 Jacques Prévert, Œuvres complètes. II. La Pléiade. Gallimard. 1553p. 1996. p.887
1084 Marie Fourcade, Les Britanniques en Inde [1858-1947] ou le règne du ‘cyniquement correct’. In : Marc Ferro, Le livre noir du colonialisme. Hachette Littérature. 1119p. 2004. p.450 à 458
1085 Libération, L’armée secrète de ‘L’Archipel du goulag’. 27 octobre 2008
1086 Chaîne Toute l’Histoire, Simone Weil, l’irrégulière. 14 février 2016
1087 France Culture, Simone Weil, philosophe sur tous les fronts. 1er juillet 2019 [1ère diffusion. 3 décembre 2018]
1088 Libération, Non, Hillary Clinton n’est pas ‘la première femme candidate à la Présidentielle’. 8 juin 2016
1089 Pierre Kropotkine, Mémoires d’un révolutionnaire. Autour d’une vie. Éditions de L’aube. 506p. 2008. p.422, 423
1090 Léon Trotsky, Ma vie. Folio. Gallimard. 691p. 1973. p.187
1091 Lou Andreas Salomé, Ma vie. PUF. Perspectives Critiques. 315p. 1978. p.62
1092 Albert Camus, L’homme révolté. Idées. NRF. 372p. 1970. p.200
1093 Pour reprendre le titre du livre de Sylviane Agacinski, Femmes, entre sexe et genre. Le Seuil. 2012
1094 Amnesty International. Rapport 2013. 353 p. p.196
1095 Nouvelle encyclopédie politique et historique des femmes. Sous la direction de Christine Fauré. Les Belles lettres. 2010. 1216 p.
1096 Stendhal, La chartreuse de parme. I. Garnier Frères. 334p. 1925. p.144
1097 Anton Tchékhov, Le professeur de lettres. In : Œuvres. III. La Pléiade. 1033p. 1971. p.339
1098 Cardinal de Retz, Mémoires. La Pléiade. 1003 p. 1950. p.39, 40
1099 Sade, Les cent vingt journées de Sodome. In : Œuvres. I. La Pléiade. 1363p. 1990. p.239
1100 Fiodor Dostoïevski, Les frères Karamazov, Le club français du livre. 1060p. 1956. p.401
1101 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. II. Nana. La Pléiade. 1748p. 1961. p.1180
1102 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. III. Au bonheur des dames. La Pléiade. 1958p. 1964. p.708
1103 Jules Renard, Journal. La Pléiade. 1434p. 1965. p.314
1104 Danilo Dolci. Les Temps Modernes, Enquête à Palerme. Julliard. 336p. 1957. p.131
1105 Honoré de Balzac, Splendeurs et misères des courtisanes. La Pléiade. La comédie humaine. V. 1154p. 1949. p.1028
1106 Léon Tolstoï, La guerre et la paix. La Pléiade. Traduction de Pierre Pascal. 1654 p. 1945. p.415 (Livre 2)
1107 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. III. La joie de vivre. La Pléiade. 1958p. 1964. p.1080
1108 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. III. La joie de vivre. La Pléiade. 1958p. 1964. p.1088
1109 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. III. La joie de vivre. La Pléiade. 1958p. 1964. p.1077 à 1106
1110 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. IV. La terre. La Pléiade. 1806p. 1967. p.587, 588
1111 Paul Claudel, Journal. I. La Pléiade. 1499p. 1968. p.734
1112 France Culture, Nuits magnétiques. L’espace maternel. Naissance de la mère, naissance de l’enfant. 28 août 2018 [Ière diffusion. 24 février 1981]
1113 In : Beaumarchais, Œuvres. La Pléiade. 1696p. 1988. p.670, p.620, 621, note. p.1493
1114 Stendhal, Le rouge et le noir. Le livre de poche. Classiques de poche. 577p. 2009. p.73
1115 Honoré de Balzac, La cousine Bette. Éditions Garnier frères. 496p. 1974. p.295
1116 France Culture, Madame Bovary. 28 novembre 2019
1117 In : Michel Nathan, Anthologie du roman populaire.1836-1918. 10/18. 371p. 1985. p.175, 364
1118 Paul Claudel, Journal. I. La Pléiade. 1499p. 1968. p.954, 985
1119 Ménie Grégoire, Les cris de la vie. Tchou. 271p. 1971. p.129
1120 Jean-Louis Barrault, Comme je le pense. Idées Gallimard. 252p. 1975. p.215
1121 France Culture, 29 juillet 2014. Journal de 8h.
1122 Le Monde Diplomatique, Transformations de la sexualité, permanence du sexisme. février 2018. p.14
1123 In : Diderot. Oeuvres. La Pléiade. 1445p. 1962. p.8
1124 Flora Tristan, Le tour de France. Journal. 1843-1844. I. FM. La Découverte. 233p. 1980. p.178
1125 Léon Tolstoï, La guerre et la paix. La Pléiade. Traduction de Pierre Pascal. 1654 p. 1945. p.260 (Livre 1)
1126 George Sand, Correspondance. Georges Lubin. Classiques Garnier. Tome XXII. 868p. 1987. p.118
1127 George Sand, Correspondance. Georges Lubin. Classiques Garnier. Tome XXII. 868p. 1987. p.476
1128 Louis Aragon, Les beaux quartiers. Folio. Gallimard. 625p. 2012. p.310, 324, 383, 440, 557, 558
1129 Doris Lessing, Les enfants de la violence. La cité promise. Le livre de poche. 915p. 1981. p.398
1130 Doris Lessing, Les enfants de la violence. La cité promise. Le livre de poche. 915p. 1981. p.381
1131 Simone de Beauvoir, Une mort si douce. Le livre de poche. 157p. 1971. p.14, 156
1132 Marguerite Yourcenar, Les yeux ouverts. Entretiens avec Matthieu Galey. Le livre de poche. 314p. 1980. p.25
1133 Nietzsche, Humain, trop humain. Le livre de poche. 768p. 2006. p.248
1134 Gina Lombroso, La femme aux prises avec la vie. (traduit de l’italien) Payot. Paris. 282p. 4ème tirage. 1930. p.31, 267, 268
1135 Benjamin Constant. Isabelle de Charrière. Correspondance. 1787-1805. Desjonquières. 536p. 1996. p.269
1136 Le guide de la jeune mère, par le professeur P. Lereboullet (et alii). Éditions sociales françaises. 186p. 1939. p.53, 54, 55, 164
1137 Mary Robinson, Mémoires de Mistriss Robinson, In : La fabrique de l’intime. Mémoires et journaux de femmes au XVIIème siècle. Bouquins. Robert Laffont. 1192p. 2013. p.709
1138 Marie Cardinal, Les mots pour le dire. Grasset. 317p. 1975. p.182, 183
1139 TV5. Europe. 31 octobre 2015
1140 Le Monde, Gisèle Halimi. ‘J’avais en moi une force sauvage, une rage, je voulais me sauver’. 22-23 septembre 2019
1141 Chaîne Histoire, De l’Algérie française à l’Algérie Algérienne. 15 avril 2016
1142 Khalida Messaoudi, Une Algérienne debout. Entretiens avec Élisabeth Schemla. Flammarion. 214p. 1995. p.77 à 100
1143 In : Courrier de la Marche mondiale des femmes contre les violences et la pauvreté. n°372. 31 juillet 2019
1144 Léon Tolstoï, Le bonheur conjugal. In : Souvenirs et récits. La Pléiade. 1591p. 1960. p.681
1145 In : Denis Diderot, Œuvres. La Pléiade. 1470p. 1951. p.790
1146 Honoré de Balzac, La femme de trente ans. Garnier-Flammarion. 242p. 1965. p.99
1147 Léon Tolstoï, La guerre et la paix. La Pléiade. Traduction de Pierre Pascal. 1654 p. 1945. p.409 (Livre 2)
1148 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. I. La curée. La Pléiade. 1709p.,1960. p.423
1149 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. II. Son excellence Eugène Rougon. La Pléiade. 1748p. 1961. p.145
1150 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. II. L’assommoir. La Pléiade. 1748p. 1961. p.612
1151 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. III. Au bonheur des dames. La Pléiade. 1958p. 1964. p.724
1152 János Székely, L’enfant du Danube. Folio. Gallimard. 854p. 2020. p.125, 126
1153 Doris Lessing, Les enfants de la violence. La cité promise. Le livre de poche. 915p. 1981. p.430
1154 Elena Ferrante, L’enfant perdue. Folio. Gallimard. 619p. 2018. p.331
1155 Colette, Lettres à Hélène Picard. Flammarion. 232p.1958. p.25
1156 Benjamin Constant. Isabelle de Charrière. Correspondance. 1787-1805. Desjonquières. 536p. 1996. p.288, 289, 297
1157 Cf. Anne Steiner, Les militantes anarchistes individualistes ; des femmes libres à la Belle époque. In : Aminis (Revue de civilisation contemporaine. Europe, Amériques) 8. 2008
1158 Jules Roy, Mémoires barbares. Le livre de poche. 697p. 1989. p.343
1159 Mondafrique, Liban la dolce vita de Carlos Ghosn à Beyrouth. 30 décembre. 2022
1160 France Culture, Du grain à moudre. 3 ans après Charlie : La liberté d’expression sans entraves. 5 janvier 2018
1161 Les cyniques grecs. Fragments et témoignages. Le livre de poche. Classiques de la philosophie. 352p. 2005. p.111
1162 Victor Hugo, Les misérables. La Pléiade. 1805p. 1951. note. p.1571
1163 In : La Rochefoucauld, Maximes, La Bruyère. Les caractères. Flammarion. Le monde de la philosophie. 589p. 2008. p.170
1164 Daniel Defoe, La maîtresse fortunée […] Lady Roxane. In : Moll Flanders. La Pléiade. 1728p. 1969. p.1282
1165 Voltaire, Correspondance. II. (janvier 1739-décembre 1748). La Pléiade. 1814p. 1977. p.213
1166 Voltaire, Correspondance. V. (janvier 1758-septembre 1760). La Pléiade. 1698p. 1980. p.477, 478
1167 Voltaire, Correspondance. V. (janvier 1758-septembre 1760). La Pléiade. 1698p. 1980. p.1126, 1134
1168 Denis Diderot, Réfutation d’Helvétius. In : Œuvres philosophiques. La Pléiade. 1413p. 2010. p.508, 509
1169 Honoré de Balzac, Illusions perdues. Garnier frères. 876p. 1961. p.362, 441, 661, 690
1170 Honoré de Balzac, Mémoires de deux jeunes mariées. In : La Comédie humaine. I. La Pléiade. 1065p. 1951. p.247
1171 Honoré de Balzac, La femme de trente ans. La Pléiade. La comédie humaine. II. 1172p. 1951. p.756
1172 Honoré de Balzac, La cousine Bette. Éditions Garnier frères. 496p. 1974. p.99
1173 Honoré de Balzac, La cousine Bette. Éditions Garnier frères. 496p. 1974. p.161
1174 Honoré de Balzac, La cousine Bette. Éditions Garnier frères. 496p. 1974. p.366
1175 Honoré de Balzac, La cousine Bette. Flammarion. 640p. 2015. p.335
1176 William Makepeace Thackeray, Barry Lyndon. Garnier Flammarion. 444p. 2019. p.275
1177 Charlotte Brontë, Jane Eyre. Pocket. 761p. 2015. p.428
1178 George Eliot, Le moulin sur la Floss. Folio. Classique. Gallimard. 738p. 2003. p.70, 88, 113
1179 Victor Hugo, Les misérables. La Pléiade. 1805p. 1951. P.704
1180 Victor Hugo, Les misérables. La Pléiade. 1805p. 1951. p.804, 825, 839
1181 Victor Hugo, Quatre-vingt-treize. Bibliothèque Lattès. 542p. 1988. p.307, 453
1182 George Sand, Correspondance. Georges Lubin. Classiques Garnier. Tome XVIII. 761p. 1984 p.203
1183 George Sand, Correspondance. Georges Lubin. Classiques Garnier. Tome XVIII. 761p. 1984 p.598
1184 Léon Tolstoï, La guerre et la paix. La Pléiade. Traduction de Pierre Pascal. 1654 p. 1945. p.31, 32, 33, 49, 75, 83 (Livre 1)
1185 Léon Tolstoï, La guerre et la paix. La Pléiade. Traduction de Pierre Pascal. 1654 p. 1945. p.567 (Livre 2)
1186 Léon Tolstoï, La guerre et la paix. La Pléiade. Traduction de Pierre Pascal. 1654 p. 1945. p.908 (Livre 3)
1187 Léon Tolstoï, La guerre et la paix. La Pléiade. Traduction de Pierre Pascal. 1654 p. 1945. p.916 (Livre 3)
1188 Journal des Goncourt. Tome IV. 1865-1868. Honoré Champion. 765p. 2019. p.286
1189 Fiodor Dostoïevski, L’adolescent. Folio. Classique. Gallimard. 649p. 2023. p.566
1190 Émile Zola, La curée. Le livre de poche. 412p. 2021. p.222
1191 In : Émile Zola, Mes haines. Slatkine reprints. Genève. 374p. 1979. p.69
1192 Jules Renard, Journal. La Pléiade. 1434p. 1965. p.317
1193 Léon Tolstoï, Le faux coupon. In : Souvenirs et récits. La Pléiade. 1591p. 1960. p.1383
1194 Rémy de Gourmont, Épilogues. Réflexions sur la vie, Mercure de France. 338p. 1913. p.276
1195 Lou Andrea Salomé, Correspondance avec Sigmund Freud. 1912-1936. Suivi du Journal d’une année. 1912-1913. Gallimard. Connaissances de l’inconscient. 487p. 1970. p.37
1196 Journal de l’abbé Mugnier. 1879-1939. Le Temps retrouvé. Mercure de France. 639p. 2007. p.509
1197 Antonio Gramsci, Lettres de la prison. Éditions Sociales. 310p. 1953. p.225
1198 D. H. Lawrence, L’homme et la poupée. Gallimard. 297p. 1933. p.65, 170
1199 In : France Culture, Le silence de la mer. [Lu par Michel Bouquet]. 16 février. 2024
1200 Mille Visages, un seul combat. Les femmes dans la Résistance. Témoignages recueillis par Simone Bertrand. Les Éditeurs Français Réunis. 166p. 1974. p.25
1201 Paul Claudel, Journal. II. La Pléiade. 1360p. 1969. p.813
1202 Jean-René Huguenin, Journal. Éditions du Seuil. 353p. 1993. p.72
1203 Jean Guitton, Œuvres complètes. Journal de ma vie. Desclée de Brouwer. 747p. 1976. p.302, 648, 652
1204 André Morali-Daninos, Sociologie des relations sexuelles. Que sais-je ? PUF. 126p. 1982. p.77
1205 Honoré de Balzac, Gobseck, Une double famille. GF. Flammarion. 248p. 1984. p.10
1206 Lucienne Mazenod, Ghislaine Schoeller, Dictionnaires des femmes célèbres. De tous les temps et des tous les pays. Bouquins. Robert Laffont. 932p. 1992. p.585
1207 Lucienne Mazenod, Ghislaine Schoeller, Dictionnaires des femmes célèbres. De tous les temps et des tous les pays. Bouquins. Robert Laffont. 932p. 1992. p.626
1208 Jean Tulard, Guide des films. 1895-1995. Édition du centenaire du cinéma. L.Z. 1479p. 1995. p.48, 224, 348, 903, 949
1209 Jean Tulard, Dictionnaire du cinéma. Les réalisateurs. Bouquins. Robert Laffont. 1008 p. 2003. p.465
1210 Victor Klemperer, LTI. La langue du IIIème Reich. Albin Michel. Idées. 376p. 1996. p.113, 157
1211 In : Françoise Barret-Ducrocq & Évelyne Pisier, Femmes en tête. Flammarion. 534p. 1997. p.384, 385
1212 Robert Beck (Iceberg Slim), Pimp. Mémoires d’un maquereau. Éditions de l’Olivier. 411p. 2008.
1213 Michèle Le Dœuff, Le sexe du savoir. Champs. Flammarion. 378p. 2000. p.163
1214 Charles Gellman, In : Dictionnaire de la pornographie. (Sous la direction de Philippe di Folco). PUF. 581p. 2005. p.339
1215 Pascal Bruckner, Un bon fils. Grasset. 251p. 2014. p.229, 230
1216 Juliette Minces, De Gurs à Kaboul. Éditions de l’Aube. 315p. 2015. p.52
1217 France Culture, Avoir raison avec Virginia Woolf. Du côté des bêtes, des poètes, des biographies inventées. 16 août 2017
1218 France Culture, Une éthique de la discussion avec Élisabeth de Fontenay. 3 octobre 2017
1219 Le Figaro, Jean-François Khan : ‘La droite n’est plus libérale, et les féministes sont devenues staliniennes…’. 16 mars 2018
1220 France Culture, Marie-Claude Bomsel-La lionne de la Ménagerie. 21 mars 2018 [1ère diffusion. 3 au 10 octobre 2016]
1221 Le Figaro, Trump insulte violemment son ex-conseillère à l’occasion de la sortie de son livre. 14 août 2018
1222 France Inter, ‘Vache folle, ‘ Bécassine’, À poil ! : Ségolène Royal raconte 30 ans d’attaques sexistes. 31 octobre 2018
1223 Elle, Femmes-juments et ‘prétendues’ violences obstétricales : Stupeur et polémique. 10 décembre 2018. Site du NCGOF
1224 R.T, ‘Une claque et ils reviennent au pied’ ? Darmanin dément avoir comparé les députés à des chiens. 25 février 2019
1225 France Culture, Le réveil culturel. 30 septembre 2019
1226 France Musique, Relax. 18 janvier 2021
1227 France Culture, LSD. Les femmes sont des orques comme les autres. 2 mars 2021
1228 France Culture, Panthéon Égyptien. Quand les animaux étaient de dieux. 21 juin 2021. [1ère diffusion. 21 septembre 2020]
1229 France Culture, Martine Gallard, Sabina Spielrein, avec La destruction comme cause du devenir, voulait faire une oeuvre majeure qui l’inscrirait dans le destin de la psychanalyse. 10 juillet 2024. [1ère diffusion. 21 avril 2019]
1230 Jean-Jacques Rousseau, Émile ou de l’éducation. Folio. Essais. Gallimard. Livre V. 1139p. 1995. p.535
1231 Behoteguy de Teramond, Comment recevoir sans personnel ? 350 idées de dîners que vous pourrez préparer seule. Les Éditions de la pensée moderne. Paris. Le centre de psychologie et de pédagogie. Montréal. 149p. 1965. p.29
1232 Le Monde Diplomatique, Invisible pénibilité du travail féminin. décembre 2017. p.15
1233 Dominique Desanti, La femme au temps des années folles. Le livre de poche. 447p. 1984. p.68
1234 AFP, 93 : Soupçonné d’avoir tué sa femme. 7 avril 2012
1235 Marie-Victoire Louis, Pourquoi les hommes tuent-ils les femmes ? http://www.marievictoirelouis.net/document.php?id=1180&mode=last
1236 François-René de Chateaubriand, Mémoires d’Outre-tombe. I. La Pléiade. 1232p. 1983. p.697
1237 Louise Michel, Souvenirs et aventures de ma vie. La Découverte. Maspéro. 437p. 1983. p.118
1238 Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe. Folio. 645p. 1989. p.509
1239 Mémoires du comte de Bussy-Rabutin, Le Temps retrouvé. Mercure de France. 372p. 2010. p.66
1240 Stendhal, La chartreuse de parme. I. Garnier Frères. 334p. 1925. p.164
1241 Marie Bashkirtseff, Lettres. Fasquelle. 282p. 1922. p.240
1242 Isadora Duncan, Ma vie. Folio. Gallimard. 447p. 2016. p.211
1243 Oriana Fallaci, Un homme. Grasset. 497p. 1981. p.375
1244 Nicola Berdiaev, Essai d’autobiographie spirituelle. Buchet-Chastel. 429p. 1979. p.178
1245 Journal de l’abbé Mugnier.1879-1939. Le Temps retrouvé. Mercure de France. 639p. 2007. p.262, 433
1246 Stendhal, Journal. In : Œuvres intimes. I. La Pléiade. 1637p. 1981. p.354
1247 France Culture, Quelle politique pour les personnes autistes ? 3 avril 2017
1248 János Székely, L’enfant du Danube. Folio. Gallimard. 854p. 2020. p.137
1249 Femmes et Russie. 1980. Par le collectif de rédaction de l’Almanach et quelques autres. Des femmes. 217p. 1980. p.58, 59
1250 Assemblée Nationale. Rapport d’information. n° 2702. IVG et Contraception. Première lecture. Danielle Bousquet. Présidente. 247p. 2000. p.101
1251 Henri Rochefort, Les aventures de ma vie. Le Temps retrouvé. Mercure de France. 439p. 2005. p.274 à 277
1252 Honoré de Balzac, La peau de chagrin. Le livre de poche. 366p. 1972. p.96
1253 Honoré de Balzac, La peau de chagrin. Le livre de poche. 366p. 1972. p.98
1254 Honoré de Balzac, Le colonel Chabert. La Pléiade. La comédie humaine. II. 1172p. 1951. p.1104
1255 Honoré de Balzac, La duchesse de Langeais. La Pléiade. La comédie humaine. V. 1154p. 1949. p.145, 146, 150
1256 Honoré de Balzac, La duchesse de Langeais. La Pléiade. La comédie humaine. V. 1154p. 1949. p.154,
1257 Honoré de Balzac, La duchesse de Langeais. La Pléiade. La comédie humaine. V. 1154p. 1949. p.166, 167
1258 Honoré de Balzac, Splendeurs et misères des courtisanes. La Pléiade. La comédie humaine. V. 1154p. 1949. p.1076
1259 Honoré de Balzac, Splendeurs et misères des courtisanes. La Pléiade. La comédie humaine. V. 1154p. 1949. p.1087
1260 Honoré de Balzac, Splendeurs et misères des courtisanes. La Pléiade. La comédie humaine. V. 1154p. 1949. p.1094
1261 Mary Robinson, Mémoires de Mistriss Robinson, In : La fabrique de l’intime. Mémoires et journaux de femmes au XVIIème siècle. Bouquins. Robert Laffont. 1192p. 2013. p.835
1262 Émile Gérard-Gailly, Les véhémences de Louise Colet. Mercure de France. 237p. 1934. p.138
1263 Alexandre Soljenitsyne, Le premier cercle. Le livre de poche. 823p. 1972. p.396
1264 H.F. Peters, Ma sœur, mon épouse. Tel. Gallimard. 312p. 1976. p.191
1265 Didier Raymond, Schopenhauer. Écrivains de toujours. Seuil. 187p. 1995. p.43
1266 Benjamin Constant. Isabelle de Charrière. Correspondance. 1787-1805. Desjonquières. 536p. 1996. p.182
1267 France Culture, Le cours de l’histoire. 25 mai 2020
1268 France Culture, Les jeunes face à l’Europe. 24 mai 2019
1269 Marivaux, La vie de Marianne. Folio. Classique. Gallimard. 778 p. 2014. p.101
1270 Voltaire, Correspondance. V. (janvier 1758-septembre 1760). La Pléiade. 1698p. 1980. p.41
1271 Denis Diderot, Correspondance. Bouquins. Robert Laffont.1468p. 1997. p.224
1272 Denis Diderot, Entretien d’un philosophe avec Mme la Maréchale de ***, In : Œuvres philosophiques. La Pléiade. 1413p. 2010. p.647
1273 In : Denis Diderot, Œuvres. La Pléiade. 1470p. 1951. p.423
1274 In : Nouvelles du XVIIIème siècle. La Pléiade. 1552p. 2002. p.718, 1432
1275 Mary Wollstonecraft, Défense des droits des femmes. Payot. 239 p.1976. p.59
1276 Germaine de Staël, De l’influence des passions sur le bonheur des individus et des nations, suivi de Réflexions sur le suicide. Rivages poche. 321p. 2000. p.91
1277 In : François-René de Chateaubriand, Mémoires d’Outre-tombe. II. La Pléiade. 1496p. 1988. p.213
1278 Honoré de Balzac, Gobseck. Une double famille. GF. Flammarion. 248p. 1984. p.101
1279 Balzac, Mémoires de deux jeunes mariées. In : La comédie Humaine. I. La Pléiade. 1065p. 1951. p.147
1280 In : Nicolas Gogol, Nouvelles de Pétersbourg. GF Flammarion. 282p. 2009. p.143, 144
1281 Émile Zola, Correspondance. I. 1858-1867. Les Presses de l’Université de Montréal. Éditions du CNRS. 594p. 1978. p.205
1282 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. II. Son excellence Eugène Rougon. La Pléiade. 1748p. 1961. p.145
1283 Victor Hugo, Les misérables. La Pléiade. 1805p. 1951. p.938, 939
1284 In : Margaret Goldsmith, Cinq femmes contre le monde. Gallimard. 201p. 1937. p.41
1285 In : Margaret Goldsmith, Cinq femmes contre le monde. Gallimard. 201p. 1937. p.122
1286 Margaret Goldsmith, Cinq femmes contre le monde. Gallimard. 201p. 1937. p.41
1287 In : Édith Thomas, Les femmes en 1848. Presses universitaires de France. 78 p. 1948. p.18
1288 France Culture, Hedy Lamarr (1914-2000), la dame sans passeport d’Hollywood. 25 février 2017
1289 Paul Claudel, Journal. II. La Pléiade. 1360p. 1969. p.353
1290 George Bataille, Critique, Emily Brontë. n°117. février 1957. In : Emily Brontë, Hurlevent. Folio. Classique. Gallimard. 620p. 2018. p.607
1291 A. Jourcin et Ph. Van Tieghem, Dictionnaires des femmes célèbres. Collection : Les dictionnaires de l’homme du XXème siècle. Larousse. 256p. 1969. p.172
1292 Jacques Prévert, Choses et autres. Folio. Gallimard. 265p. 1980. p.251
1293 Jean Tulard, Guide des films. 1895-1995. Édition du centenaire du cinéma. L.Z. 1479p. 1995. p.901, 910
1294 Elena Ferrante, Les jours de mon abandon. Folio. Gallimard. 275p. 2016. p.141
1295 France Culture, Le cours de l’histoire. 2 mars 2020
1296 France Culture, Répliques. À la découverte de George Eliot. 26 décembre 2020 [1ère diffusion. 10 novembre 2018]
1297 Joseph Joubert, Pensées et Correspondance, 1866. Numérisé par Google. p.70
1298 In : Diderot. Oeuvres. La Pléiade. 1445p. 1962. p.63
1299 In : Les trésors retrouvés de la Revue des deux mondes. Flammarion &revue des deux mondes. 328p. 1996. p.142, 143
1300 Antoine François Prévost, Manon Lescaut. Éditions Garnier. 340p. 1967. p.108, 180
1301 Alessandro Manzoni, Les fiancés. Folio. Classique. Gallimard. 862p. 1997. p.408
1302 Jean Cazeneuve, La vie dans la société moderne. Idées. Gallimard. 214p. 1982. p.35, 59
1303 Claude Lefort, Le pouvoir. In : Université de tous les savoirs (Sous la direction d’Yves Michaud) Qu’est-ce que la société ? Volume 3. Éditions Odile Jacob. 897p. 2000. p.705
1304 France Culture, Brésil. L’ordre au service des inégalités. 26 octobre 2018
1305 George Sand, Correspondance. Georges Lubin. Classiques Garnier. Tome XVIII. 761p. 1984 p.470
1306 AFP, Hôtel Royal Monceau : des salariés en grève. 7 octobre 2014
1307 Marivaux, La vie de Marianne. Gallimard. Folio Classique. 778 p. 2014. p.582
1308 Voltaire, Correspondance. IV. (janvier 1754-décembre 1757). La Pléiade. 1655p. 1978. p.441
1309 Charlotte Brontë, Jane Eyre. Pocket. 761p. 2015. p.301
1310 George Sand, Correspondance. Georges Lubin. Classiques Garnier. Tome XXI. 992p. 1986. p.138
1311 George Sand, Correspondance. Georges Lubin. Classiques Garnier. Tome XXI. 992p. 1986. p.166
1312 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. III. Pot-Bouille. La Pléiade. 1958p. 1964. p.226
1313 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. III. Pot-Bouille. La Pléiade. 1958p. 1964. p. 248, 246
1314 Paul Léautaud, Journal littéraire. Choix de pages. Folio. Gallimard. 1304p. 2013. p.183
1315 In : Hildegard Möller, Thomas Mann. Une affaire de famille. Tallandier. 382p. 2007. p.100
1316 Georges Bernanos, Lettres retrouvées. 1904-1948. Plon. 517p. 1983. p.144
1317 Clara Malraux, Le bruit de nos pas. V. La fin et le commencement. Grasset. 230p. 1976. p.111, 112
1318 Françoise Giroud, Journal d’un Parisienne. Le Seuil. 428p. 1974. p.62, 133, 313, 169
1319 France Culture, Docs en stocks. Sois bonne et tais-toi. 26 mars 2014
1320 George Eliot, Middlemarch. Folio. Classique. Gallimard. 1152p. 2020. p.193
1321 France Culture, Céleste Albaret chez monsieur Proust. 30 juillet 2019
1322 Jacques Tremintin, L’Internationale de la maltraitance. Revue Gavroche. n°162. avril 2010
1323 Maud Marin, Tristes plaisirs. J’ai lu. 247p. 1990. p.39 à 61
1324 George Sand, Correspondance. Georges Lubin. Classiques Garnier. Tome XXI. 992p. 1986. p.313
1325 Alexandra Kollontaï, Marxisme et révolution sexuelle. Présentation par Judith Stora-Sandor. François Maspero. Bibliothèque socialiste. 286p. 1973. p.238, 239
1326 Emma Goldman, Vivre ma vie. Une anarchiste au temps des révolutions. L’échappée. 1095p. 2018. p.816
1327 Virginia Woolf, Trois guinées. Préface de Viviane Forrester. Des Femmes. 332p. 1977. p.49, 56
1328 George Sand, Lélia. Texte établi, présenté et annoté par Pierre Reboul. Classiques Garnier. 601p. 1093. p.329, 450
1329 Sándor Márai, Mémoires de Hongrie. Albin Michel. 425p. 2004. p.131
1330 Marie Isabel Barreno, Marie Teresa Horta, Marie Velho du Costa, Nouvelles lettres portugaises. Combats. Le Seuil. 1974. p.89 (vérifier)
1331 Gavi, Sartre, Victor, On a raison de se révolter. Gallimard. La France sauvage. 378p. 1974. p.115
1332 Erin Pizzey, Crie moins fort, les voisins vont t’entendre. Des femmes. 228 p. 1975. p.78
1333 Ménie Grégoire, Telle que je suis. Robert Laffont. 359p. 1976. p.221
1334 C8, TPMP. 18 juillet 2018. 19h 20
1335 Le Monde Diplomatique, Le temps des bouffons. 1er janvier 2019
1336 Anne Clark Amor, Madame Oscar Wilde. Perrin, 299p. 1985. p.195
1337 Jean Tulard, Guide des films. 1895-1995. Édition du centenaire du cinéma. L.Z, 1479p. 1995. p.378
1338 France Inter, Message laissé sur le répondeur de Là-bas si j’y suis. 28 décembre 2012
1339 Cité par Jean Tulard, Dictionnaire du cinéma. Les réalisateurs. Bouquins. Robert Laffont. 1008p. 2003. p.321
1340 Le Canard enchaîné, Drôles de zigs. 18 avril 2018. p.5
1341 Rémy de Gourmont, Épilogues. Réflexions sur la vie, Mercure de France. 338p. 1913. p.222
1342 Journal de l’abbé Mugnier. 1879-1939. Le Temps retrouvé. Mercure de France. 639p. 2007. p.37, 52, 57, 82, 107, 115, 138, 151, 152, 168
1343 France Culture, Henri-Jean Philippe, président de Gynécologie sans frontières. La santé des femmes dans le monde : un nouveau défi. 18 septembre 2012
1344 Voltaire, Traité sur la tolérance. Le monde de la philosophie. Flammarion. 680p. 2008. p.461
1345 Marie-Armande Gacon Dufour, Mémoire pour le sexe féminin contre le sexe masculin. In : Opinions de femmes, de la veille au lendemain de la Révolution française. Éditions Côté-femmes. 176p. 1989. p.33, 43
1346 Jules Michelet, Histoire de la Révolution française I. La Pléiade. 1530p. 1976. p.414
1347 Flora Tristan, Le tour de France. Journal. 1843-1844. I. FM / La Découverte. 233p. 1980. p.84
1348 Léon Tolstoï, Anna Karénine. Résurrection. La Pléiade. 1630p. 1951. p.743
1349 Séverine, En marche… Paris, H. Simonis Empis, Éditeur. 320p. 1896. p.139, 140, 141
1350 Léon Bloy, Le sang du pauvre. In : Léon Bloy. Essais et pamphlets. Bouquins. 1536p. 2017. p.450
1351 François Mauriac, Le nœud de vipères. Bernard Grasset. 311p. 1932. p.111
1352 André Gide, Journal. 1889-1939. La Pléiade. 1378p. 1948. p.1190
1353 Michel Winock, Jeanne et les siens. Le Seuil. 265p. 2003. p.18
1354 In : Conférence internationale de service social. Paris. 23-28 juillet 1950. 412p. p.71
1355 Béatrix Beck, Léon Morin, prêtre. Gallimard. 237p. 1952. p.60
1356 Judith Thurman, Karen Blixen. Le livre de poche. 310 p. 1982. p.25
1357 France Culture, À voix nue, Évelyne Sullerot, Le fait féminin. La famille démaillée. 13 avril 2017 [Rediffusion des émissions de 2012]
1358 José-Luis de Vilallonga, À pleines dents. Éditions J’ai lu. 247p. 1976. p.11, 37, 119
1359 Doris Lessing, Les enfants de la violence. La cité promise. Le livre de poche. 915p. 1981. p.361
1360 Louis Guilloux, Carnets. 1921-1944. Gallimard. 414p. 1978. p.95, 96
1361 Voltaire, Correspondance. III. (janvier 1749-décembre 1753). La Pléiade. 1534p. 1975. p.114
1362 Balzac, Mémoires de deux jeunes mariées. In : La comédie Humaine. I. La Pléiade. 1065p. 1951. p.149
1363 Eugène Delacroix, Journal. Tome I. (1822-1857). José Corti. 1214p. 2009. p.434
1364 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. IV. La terre. La Pléiade. 1806p. 1967. p.628
1365 Roselyne Bachelot, Geneviève Fraisse, Deux femmes au royaume des hommes. Hachette Littérature. 304p. 1999. p.20
1366 France Culture, La compagnie des œuvres. Artistes et écrivaines malgré tout. 26 décembre 2019
1367 France Culture. France Musique, 7 juillet 2012. Journal. 7 h
1368 In : Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe. Folio. 645p. 1989. note. p.622
1369 France Culture, Comment saisir l’air du temps ? 16 avril 2021
1370 In : Femmes savantes. De Margueritte de Navarre à Jacqueline de Romilly. Les Belles Lettres. 388p. 2020. p.207
1371 Jean de La Bruyère, Les Caractères. Folio. Classique. Gallimard. 505p. 2001. p.263
1372 Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat social. Garnier Flammarion. 187p. 1966. p.42
1373 Honoré de Balzac, La peau de chagrin. Le livre de poche. 366p. 1972. p.20
1374 Gustave Flaubert, Correspondance. III. (janvier 1859-décembre 1868). La Pléiade. 1727p. 1991. p.163
1375 Gustave Flaubert, Correspondance. III. (janvier 1859-décembre 1868). La Pléiade. 1727p. 1991. p.166
1376 Gustave Flaubert, Correspondance. V. (janvier 1876-mai 1880). La Pléiade. 1556p. 2007. p.625, 1363
1377 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. II. Nana. La Pléiade. 1748p. 1961. p.1181
1378 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. IV. L’oeuvre. La Pléiade. 1806p. 1967. p.251
1379 In : Émile Zola, Les Rougon-Macquart. I. La curée. La Pléiade. 1709p.,1960. note. p.1597
1380 Sigmund Freud, Le malaise dans la culture. GF Flammarion. 218p. 2010. p.113, 118, 137
1381 Simone Weil, Écrits historiques et politiques. Gallimard. 413p. 1979. p.126, 127
1382 John Dos Passos, Sur toute la terre. Union soviétique, Mexique, Espagne, etc…. NRF. Gallimard. 223p. 1936. p.99, 141, 201, 205
1383 Jean-Paul Sartre, Plaidoyer pour les intellectuels. Idées. Gallimard.117p. 1972. p.50, 103
1384 Jean Lacouture, Léon Blum. Points. Histoire. 606p. 1979. p.181
1385 Raymond Aron, Mémoires. 50 ans de réflexions politiques. Julliard. 778 p. 1983. p.99, 100
1386 Jean Tulard, Guide des films. 1895-1995. Édition du centenaire du cinéma. L.Z. 1479p. 1995. p.144, 677, 716, 931, 939, 944, 953, 1071, 1145, 1246
1387 Jean Tulard, Dictionnaire du cinéma. Les réalisateurs. Bouquins. Robert Laffont. 1008p. 2003. p.833
1388 Régis Debray, Loués soient nos seigneurs. Une éducation politique. Galimard. 592p. 1996. p.332
1389 Howard Zinn, Le XXème siècle américain. Une histoire populaire du 1890 à nos jours. 474p. 2003. Agone. p.367
1390 Philippe de Gaulle, De Gaulle, mon père **. Entretiens avec Michel Tauriac. Plon. 556p. 2004. p.427
1391 Claude Habib, Galanterie française. Gallimard. 443p. 2006. p.95
1392 Catherine Clément, Mémoire. Champs. Flammarion. 588p. 2010. p.139
1393 France Culture, George Sand, Itinéraire politique. 1er août 2017
1394 France Culture, L’esprit public. 31 décembre 2017
1395 France Culture, Le parcours biographique de Berl. 23 juillet 2018
1396 TFI, 7 à 8. 23 décembre 2018
1397 France Culture, Questions d’Islam. 15 décembre 2019
1398 France Culture, La libération des corsetières. De fil en aiguille, des ouvrières. 29 novembre 2020
1399 Le Canard enchaîné, Succession de Serge Dassault : coups de Jarnac en rafales. 23 décembre 2020. p.3
1400 France Culture, Mon œuvre à moi. 20 novembre 2021
1401 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. IV. Le rêve. La Pléiade. 1806p. 1967. note p.1661
1402 George Sadoul, Histoire du cinéma mondial. Flammarion. 702p. 1963. p.272
1403 Voltaire, Lettres philosophiques. Folio. Gallimard. 280p. 1988. Annexes. p.202
1404 In : Voltaire, Correspondance. XI. (juillet 1772-décembre 1774) La Pléiade. 1986. note 3. p.1200
1405 Benjamin Constant. Isabelle de Charrière. Correspondance. 1787-1805. Desjonquières. 536p. 1996. p.152
1406 In : Denis Diderot, Œuvres. La Pléiade. 1474p. 1951. p.354
1407 Honoré de Balzac, Le médecin de campagne. La Pléiade. La comédie humaine. VIII. 1041p. 1949. p.481
1408 Honoré de Balzac, Lettres à Madame Hanska. I. 1832-1844. Bouquins. Robert Laffont. 957p. 1990. p.187
1409 Honoré de Balzac, La cousine Bette. Flammarion. 640p. 2015. p.578
1410 Jules Michelet, Histoire de la Révolution française. I. La Pléiade. 1530p. 1976. p.173
1411 Charles Dickens, Les aventures d’Olivier Twist. Gallimard. Folio Classique. 536p. 1995. p.25
1412 George Eliot, Silas Marner. Folio. Classique. Gallimard. 316p. 2019. p.207, 208
1413 Victor Hugo, Les misérables. La Pléiade. 1805p. 1951. p.331, 337, 338
1414 George Sand, Correspondance. Georges Lubin. Classiques Garnier. Tome XVIII. 761p. 1984 p.580
1415 Léon Tolstoï, Anna Karénine. Résurrection. La Pléiade. 1630p. 1951. p.809, 810, 1604
1416 Léon Tolstoï, Journaux et Carnets. I. (1847-1889). La Pléiade. 1451p. 1979. p.1036
1417 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. I. La fortune des Rougon. La Pléiade. 1709p. 1960. p.148
1418 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. I. La curée. La Pléiade. 1709p.,1960. p.378
1419 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. I. La curée. La Pléiade. 1709p.,1960. p.599
1420 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. I. Le ventre de Paris. La Pléiade. 1709p. 1960. p.610
1421 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. I. La faute de l’Abbé Mouret. La Pléiade. 1709p.,1960. p.1516
1422 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. II. L’assommoir. La Pléiade. 1748p. 1961. p.614
1423 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. II. Nana. La Pléiade. 1748p. 1961. p.1472 à 1485
1424 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. IV. La terre. La Pléiade. 1806p. 1967. p.548
1425 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. IV. La terre. La Pléiade. 1806p. 1967. p.577
1426 Claudine Rey, Annie Gayat, Sylvie Pepino, Petit Dictionnaire des femmes de la Commune. Les oubliées de l’histoire. Les amies et Amie de la commune de Paris. 1871. 302p. 2018. p.185
1427 Jean Grave, Mémoires d’un anarchiste. Éditions du sextant. 542p. 2009. p.96
1428 Jules Renard, Journal. La Pléiade. 1434p. 1965. p.138
1429 Anton Tchékhov, Récit d’un inconnu. In : Œuvres. III. La Pléiade. 1033p. 1971. p.197
1430 Anton Tchékhov, Ma vie. Récit d’un provincial. In : Œuvres. III. La Pléiade. 1033p. 1971. p.684
1431 Louise Michel, Souvenirs et aventures de ma vie. La Découverte. Maspero. 437p. 1983. p.152, 329
1432 In : Howard Zinn, Le XXème siècle américain. Une histoire populaire du 1890 à nos jours. 474p. 2003. Agone. p.46, 47
1433 Journal de l’abbé Mugnier. 1879-1939. Le Temps retrouvé. Mercure de France. 639p. 2007. p.216
1434 Panaït Istrati, Vers l’autre flamme. 10/18. 1980. p.171
1435 Louis Guilloux, Le sang noir. Folio. Gallimard. 1982. 631p. p.421
1436 Paul Claudel, Journal. II. La Pléiade. 1360p. 1969. p.208, 209
1437 Le Canard enchaîné, Illustre inconnu. 27 mars 2019. p.6
1438 János Székely, L’enfant du Danube. Folio. Gallimard. 854p. 2020. p.232
1439 In : Balzac, La femme de trente ans. Garnier-Flammarion. 242p. 1965. p.27
1440 Alfred Döblin, Berlin. Alexanderplatz. Folio. Gallimard. 627p. 2003. p.157
1441 Jacques Prévert, Œuvres complètes. II. La Pléiade. Gallimard. 1553p. 1996. p.366
1442 Elsa Morante, La storia. France loisirs. 618p. 1978. p.291
1443 Jules Roy, Mémoires barbares. Le livre de poche. 697p. 1989. p.343
1444 Jules Roy, Mémoires barbares. Le livre de poche. 697p. 1989. p.431
1445 Jean Tulard, Guide des films. 1895-1995. Édition du centenaire du cinéma. L.Z, 1479p. 1995. p.153, 162, 163, 164, 169, 216, 301, 343, 1256
1446 Jean Tulard, Dictionnaire du cinéma. Les réalisateurs. Bouquins. Robert Laffont. 1008p. 2003. p.162, 223, 223
1447 Manil Suri, Mother India. Le livre de poche. 637p. 2909. p.395, 396
1448 Source oubliée de noter
1449 France Culture, Répliques. Nouvelles naissances. 10 juillet 2021 [1ère diffusion. 26 septembre 2020]
1450 In : France Culture, La nuit Georges Brassens. Épisode 7. 24 octobre 2021
1451 Fernand Deligny, Les vagabonds efficaces & autres écrits. FM/petite Collection Maspero. 180p.1976. p.51
1452 In : Wilhelm Reich, La psychologie de masse du fascisme. Petite bibliothèque Payot. 341p. 1974. p.221
1453 L’Ouvrière, Rapport du Secrétariat féminin. n°29. 23 septembre 1922
1454 France Culture, Les inconnus de l’histoire. Lucie Colliard. 12 mars 2019 [1 ère diffusion. 24 février 1984]
1455 Honoré de Balzac, Le curé de village. La Pléiade. La comédie humaine. VIII. 1041p. 1949. p.655
1456 Benjamin Constant. Isabelle de Charrière. Correspondance. 1787-1805. Desjonquières. 536p. 1996. p.293
1457 Alexandra David-Neel, Correspondance avec son mari. Édition intégrale. 1904-1941. Plon. 943p. 2001. p.608
1458 Vassili Grossman, Vie et destin. Julliard / L’âge d’Homme. 818p. 1993. p.275
1459 Marivaux, Le paysan parvenu. In : Romans de Marivaux. La Pléiade. 1138p. 1949. p.576
1460 Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe. Folio. 645p. 1989. p.228
1461 Parents. 10 septembre 2018
1462 Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions. Autres œuvres autobiographiques. In : Œuvres complètes. I. La Pléiade. 1969p. 1986. p.346, 347, 1424
1463 Léon Tolstoï, Journaux et Carnets. I. (1847-1889). La Pléiade. 1451p. 1979. p.366
1464 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. I. Le ventre de Paris. La Pléiade. 1709p. 1960. p.804
1465 Voltaire, Correspondance. I. (1704-1738). La Pléiade. 1735p. 1964. p.138
1466 Voltaire, Correspondance. I. (1704-1738). La Pléiade. 1735p. 1964. p.1325
1467 Voltaire, Correspondance. I. (1704-1738). La Pléiade. 1735p. 1964. p.219, 1330
1468 Voltaire, Correspondance. I. (1704-1738). La Pléiade. 1735p. 1964. p.233
1469 Voltaire, Correspondance. I. (1704-1738). La Pléiade. 1735p. 1964. p.593
1470 Voltaire, Correspondance. I. (1704-1738). La Pléiade. 1735p. 1964. p.815
1471 Voltaire, Correspondance. IV. (janvier 1754-décembre 1757). La Pléiade. 1655p. 1978. p.275
1472 Voltaire, Correspondance. VI. (octobre 1760-décembre 1762). La Pléiade. 1648p. 1980. p.89
1473 Voltaire, Correspondance. VI. (octobre 1760-décembre 1762). La Pléiade. 1648p. 1980. p.147, 148
1474 Voltaire, Correspondance. VI. (octobre 1760-décembre 1762). La Pléiade. 1648p. 1980. p.184
1475 Voltaire, Correspondance. VI. (octobre 1760-décembre 1762). La Pléiade. 1648p. 1980. p.207
1476 Voltaire, Correspondance. VI. (octobre 1760-décembre 1762). La Pléiade. 1648p. 1980. p.515
1477 Voltaire, Correspondance. VII. (janvier 1763-mars 1765). La Pléiade. 1590p. 1981. p.767
1478 Voltaire, Correspondance. VII. (janvier 1763-mars 1765). La Pléiade. 1590p. 1981. p.814
1479 Voltaire, Correspondance. VII. (janvier 1763-mars 1765). La Pléiade.1590p. 1981. p.844
1480 Voltaire, Correspondance. VIII. (avril 1765-juin 1767). La Pléiade. 1663p. 1983. p.154, 141, 1244
1481 Voltaire, Correspondance. VIII. (avril 1765-juin 1767). La Pléiade. 1663p. 1983. p.1142, 1143
1482 Voltaire, Correspondance. X. (octobre 1769-juin 1772). La Pléiade. 1648p. 1986. p.367
1483 Voltaire, Correspondance. X. (octobre 1769-juin 1772). La Pléiade. 1648p. 1986. p.431
1484 Voltaire, Correspondance. X. (octobre 1769-juin 1772). La Pléiade. 1648p. 1986. p.760
1485 Voltaire, Correspondance. X. (octobre 1769-juin 1772). La Pléiade. 1648p. 1986. p.773
1486 Voltaire, Correspondance. X. (octobre 1769-juin 1772). La Pléiade. 1648p. 1986. p.863
1487 Voltaire, Correspondance. X. (octobre 1769-juin 1772). La Pléiade. 1648p. 1986. p.943
1488 Voltaire, Correspondance. XI. (juillet 1772-décembre 1774). La Pléiade. 1411p. 1986. p.626
1489 Pierre Kropotkine, Mémoires d’un révolutionnaire. Autour d’une vie. Éditions de L’aube. 506p. 2008. p.351
1490 Voltaire, Correspondance. XI. (juillet 1772-décembre 1774). La Pléiade. 1411p. 1986. p.650
1491 Voltaire, Correspondance. XI. (juillet 1772-décembre 1774). La Pléiade. 1411p. 1986. p.699
1492 Voltaire, Correspondance. XI. (juillet 1772-décembre 1774). La Pléiade. 1411p. 1986. p.748, 1303
1493 Voltaire, Correspondance. XI. (juillet 1772-décembre 1774). La Pléiade. 1411p. 1986. p.878
1494 Honoré de Balzac, Lettres à Madame Hanska. I. 1832-1844. Bouquins. Robert Laffont. 957p. 1990. p.142
1495 Honoré de Balzac, Illusions perdues. Garnier frères, 876p. 1961. p.419
1496 Honoré de Balzac, La cousine Bette. Éditions Garnier frères. 496p. 1974. p.11
1497 Correspondance de Gustave Flaubert. Lettres à Louise Colet. 1846-1851. Société coopérative éditions Rencontre. Lausanne. 583p. 1964. p.131
1498 Gustave Flaubert, Correspondance. V. (janvier 1876-mai 1880). La Pléiade. 1556p. 2007. p.92
1499 Léon Tolstoï, La guerre et la paix. La Pléiade. Traduction de Pierre Pascal. 1654 p. 1945. p.740, 741 (Livre 2)
1500 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. I. La curée. La Pléiade. 1709p.,1960. p.337
1501 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. I. La curée. La Pléiade. 1709p.,1960. p.427
1502 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. II. Nana. La Pléiade. 1748p. 1961. p.1476
1503 Émile Zola, Au bonheur des dames. Garnier-Flammarion. 442p. 1971. p.114
1504 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. III. Au bonheur des dames. La Pléiade. 1958p. 1964. p.686, 694
1505 AFP. Le Figaro, Lagarde, Le Pen en tête des femmes politiques. 8 mars 2015
1506 Les entretiens de Confucius. Folio. Gallimard.140p. 2004. p.48
1507 Comte Beugnot, Mémoires. 1779-1815. 349p. 1959. p.97, 98
1508 Journal de l’abbé Mugnier.1879-1939. Le Temps retrouvé. Mercure de France. 639p. 2007. p.401
1509 Jean-Claude Brialy, Le ruisseau des singes. Pocket. Robert Laffont. 510p. 2001. p.452
1510 France Inter, 12 décembre 2012. 8h 02
1511 Domitila Barrios de Chungara, Si on me donne la parole. La vie d’une femme de la mine bolivienne. Maspero. 1978. In : Elsa Laval, Une femme de mineur à la tribune de l’Année Internationale de la femme (1976) In : Comment le genre trouble la classe. Agone. n°43. 266p. 2010. p.69 à 84
1512 Le Monde, Élisabeth Badinter : Voyons ce qui nous unit avant ce qui nous distingue. 16 octobre 2013
1513 Libération / AFP, Les actionnaires de Publicis votent sur la rémunération des patrons. 29 mai 2013
1514 France Culture, Simone de Beauvoir. Le deuxième sexe. 21 août 2015
1515 France Culture, Le grain à moudre. De quelle égalité les ultras marins ont-ils besoin ? 4 octobre 2016
1516 Catherine Baker, Les contemplatives, des femmes entre elles. Stock 2. Voix de femmes. 1979. 460p.
1517 Jane Austen, Raison et sentiments. 10/18. 383p. 1882. p.51
1518 Marivaux, Le paysan parvenu. In : Romans de Marivaux. La Pléiade. 1138p. 1949. p.571
1519 Honoré de Balzac, Les paysans. La Pléiade. La comédie humaine. VIII. 1041p. 1949. p.180
1520 George Sand, Correspondance. Georges Lubin. Classiques Garnier. Tome XV. 964p. 1981. p.481
1521 In : Bartolomé et Lucile Bennassar, Le voyage en Espagne. Anthologie des voyageurs français et francophones du XVIème au XIXème siècle. Robert Lafont. 1276p. 1998. p.1092
1522 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. III. Pot-Bouille. La Pléiade. 1958p. 1964. p.126
1523 Assemblée Nationale, L’esclavage, en France, aujourd’hui. Auditions. Volume 2. Les documents d’information de l’Assemblée Nationale. 2001. 504 p. p.38, 59
1524 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. III. La joie de vivre. La Pléiade. 1958p. 1964. p.1064
1525 Émile Zola, La bête humaine. GF. Flammarion. 459p. 2011. p.166
1526 Sabine Dardenne, J’avais 12 ans, j’ai pris mon vélo et je suis partie à l’école… Pocket. 184p. 2006. p.64
1527 Pierre Larousse, Pages du Grand dictionnaire universel du XIXème siècle. 10/18. 309p. 1975. p.188
1528 Mémoires du cardinal de Bernis. Le Temps retrouvé. Mercure de France. 375p. 1986. p.35
1529 France Inter. 29 décembre 2017. 18h 30
1530 Stendhal, De l’amour. Michel Lévy Frères. 371p. 1857. p.190
1531 Stendhal, Journal. In : Œuvres intimes. La Pléiade. 1637p. 1981. p.311
1532 Collette Guillaumin, Sexe, Race et pratique du Pouvoir. L’idée de nature. Ed. Côté-femmes. 239 p. 1992. p.149
1533 France Culture, Dentellières de la mémoire. 23 mai 2021
1534 Margarete Buber-Neumann, Déportée en Sibérie. Éditions du Seuil, 254p. 1949. p.158
1535 Daniel Defoe, Heurs et malheurs de la célèbre Moll Flanders. In : Moll Flanders. La Pléiade. 1728p. 1969. p.632
1536 In : Honoré de Balzac, La comédie humaine. XII. La Pléiade. 1972p. 1981. p.26
1537 Balzac, Mémoires de deux jeunes mariées. In : La comédie Humaine. I. La Pléiade. 1065p. 1951. p.181
1538 George Sand, Lélia. Texte établi, présenté et annoté par Pierre Reboul. Classiques Garnier. 601p. 1093. p.184
1539 Jules Michelet, Journal. Folio. Classique. Gallimard. 1144p. 2017. p.245
1540 Charles Dickens, David Copperfield. Le livre de poche. Classique. 1024p. 2008. p.165
1541 Jules Michelet, Histoire de la Révolution française. II. La Pléiade. 1308p. 1939. p.655
1542 Victor Hugo, Les misérables. La Pléiade. 1805p. 1951. p.325
1543 Victor Hugo, Les misérables. La Pléiade. 1805p. 1951. p.741, 742
1544 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. I. La fortune des Rougon. La Pléiade. 1709p. 1960. p.166
1545 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. II. L’assommoir. La Pléiade. 1748p. 1961. p.682
1546 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. III. La joie de vivre. La Pléiade. 1958p. 1964. p.857
1547 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. III. La joie de vivre. La Pléiade. 1958p. 1964. p.856, 857
1548 Sigmund Freud. Karl Abraham, Correspondance complète.1907-1925. Connaissance de l’inconscient. Gallimard. 790p. 2006. p.147
1549 Kafka, Journaux et lettres. 1914-1924. La Pléiade. 1793p. 2022. p.39
1550 In : Annette Wieviorka, Maurice et Jeannette. Biographie du couple Thorez. Fayard. 686p. 2010. p.150
1551 János Székely, L’enfant du Danube. Folio. Gallimard. 854p. 2020. p.381
1552 Chow Ching Lie, Le palanquin des larmes. Dans la Chine de Mao, l’échappée d’une femme. J’ai lu. 382p. 2001. p.170
1553 Zoubeïda Bittari, O mes sœurs musulmanes, pleurez ! Gallimard. 215p. 1964. p.16, 7, 8
1554 Robert Beck (Iceberg Slim), Pimp. Mémoires d’un maquereau. Éditions de l’Olivier. 411p. 2008. p.26
1555 Ménie Grégoire, Telle que je suis. Robert Laffont. 359p. 1976. p.96
1556 Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées. Robert Laffont. Le livre de poche. 512p. 1976. p.346, 347
1557 In : Les Temps Modernes, Petites filles en éducation. n°358. mai 1976. p.1907
1558 Paul Thorez, Les enfants modèles. Témoignage. Lieu Commun. 198p. 1982. p.64
1559 Jean Tulard, Guide des films. 1895-1995. Édition du centenaire du cinéma. L.Z. 1479p. 1995. p.170
1560 Philippe de Gaulle, De Gaulle, mon père **. Entretiens avec Michel Tauriac. Plon. 556p. 2004. p.93, 94
1561 Nicole Malinconi, Vous vous appelez Michelle Martin. Récit. Denoël. 111p. 2008. p.67
1562 Honoré de Balzac, Le médecin de campagne. La Pléiade. La comédie humaine. VIII. 1041p. 1949. p.480
1563 Honoré de Balzac, La cousine Bette. Flammarion. 640p. 2015. p.328
1564 George Sand, Entretiens journaliers. In : Œuvres autobiographiques. II. La Pléiade. 1638p. 1972. p.987, 988
1565 Phyllis Chesler, Les femmes et la folie. Payot. 262p. 1979. p.70, 71
1566 Denis Diderot, Correspondance. Bouquins. Robert Laffont. 1468p. 1997. p.992
1567 Baronne de Suttner, Bas les armes. Fasquelle. 492p. 1899. p.55 (lisible sur Google)
1568 Anatole France et Madame de Caillavet, Lettres intimes (1888-1889). Librairie A.-G Nizet, Paris. 176p. 1984. p.156, 161
1569 Alice Sapritch, Femme-public. Ma vérité. Plon. 212p.1986. p.92
1570 Charlotte Brontë, Jane Eyre. Pocket. 761p. 2015. p.563
1571 Beaumarchais, Œuvres. La Pléiade. 1696p. 1988. p.XXVI
1572 In : La 5. L’abbé Pierre, sa halte d’Esteville. 8 août 2021
1573 Honoré de Balzac, Le lys dans la vallée. La Pléiade. La comédie humaine. VIII. 1041p. 1949. p.892
1574 Georges Bernanos, Journal d’un curé de campagne. Plon. 160ème mille. 366p. 1936. p.46, 55
1575 Voltaire, Correspondance. VII. (janvier 1763-mars 1765). La Pléiade. 1590p. 1981. p.1022, 1489
1576 Voltaire, Correspondance. X. (octobre 1769-juin 1772). La Pléiade. 1648p. 1986. p.75
1577 Voltaire, Correspondance. X. (octobre 1769-juin 1772). La Pléiade. 1648p. 1986. p.113
1578 In : Voltaire, Correspondance. XI. (juillet 1772-décembre 1774). La Pléiade. 1411p. 1986. p.1184
1579 Honoré de Balzac, Le médecin de campagne. La Pléiade. La comédie humaine. VIII. 1041p. 1949. p.513
1580 Charles Dickens, David Copperfield. Le livre de poche. Classique. 1024p. 2008. p.794, 851
1581 Léon Tolstoï, La guerre et la paix. La Pléiade. Traduction de Pierre Pascal. 1654 p. 1945. p.1188 (Livre 3)
1582 Victor Hugo, L’homme qui rit. Gallimard. 616p. 1978. p.541
1583 France Culture, La guerre racontée par les archives. 8 novembre 2018
1584 André Gide, Le retour au Tchad. In : Souvenirs et voyages. La Pléiade. Gallimard. 1467p. 2001. p.558, 559
1585 Robert Brasillach, Notre avant-guerre. Plon. 364p. 1983. p.271
1586 Colette Guillaumin, Pratique du pouvoir et idée de nature. Questions féministes. n°2 et 3. février, mai 1978. In : Sexe, Race et pratique du pouvoir. L’idée de nature. Ed. Côté femmes. 239p. 1992. p.13, 14
1587 Georges Sadoul, Dictionnaire des films, Microcosme. Le Seuil. 383p. 1990. p.316
1588 Jean Tulard, Guide des films. 1895-1995. Édition du centenaire du cinéma. L.Z. 1479p. 1995. p.503, 765
1589 Ryszard Kapuściński, Ébène. Aventures africaines. Plon. Pocket. 373p. 2002. p.318
1590 France Culture, La nuit rêvée de Sapho. 22 juin 2014
1591 Jules Roy, Mémoires barbares. Le livre de poche. 697p. 1989. p.617
1592 Radio Courtoisie. 20 décembre 2018
1593 Doris Lessing, Le carnet d’or. Le livre de poche. 945p. 2014. p.463
1594 France Culture, Au bon plaisir de Mouloudji. 25 août 2023 [Ière diffusion. 29 décembre 2014]
1595 Voltaire, Correspondance. XI. (juillet 1772-décembre 1774). La Pléiade. 1411p. 1986. p.400, 1107
1596 Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions. Autres œuvres autobiographiques. In : Œuvres complètes. I. La Pléiade. 1969p. 1959. p.342
1597 In : Honoré de Balzac, La comédie humaine. XII. La Pléiade. 1972p. 1981. p.24
1598 Honoré de Balzac, Illusions perdues. Garnier frères, 876p. 1961. p.245
1599 Léon Tolstoï, La guerre et la paix. La Pléiade. Traduction de Pierre Pascal. 1654 p. 1945. p.287 (Livre 1)
1600 Léon Tolstoï, Journaux et carnets. II. (1890-1904). La Pléiade. 1399p. 1980. p.60 à 63
1601 Fiodor Dostoïevski, Journal d’un écrivain. La Pléiade. 1611p. 1972. p.713
1602 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. III. Au bonheur des dames. La Pléiade. 1958p. 1964. p.730
1603 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. III. La joie de vivre. La Pléiade. 1958p. 1964. p.1078
1604 Léo Malet, Corrida aux Champs-Élysées. In : Léo Malet. Bouquins. Robert Laffont. 1106p. 1986. p.17
1605 Jean Tulard, Guide des films. 1895-1995. Édition du centenaire du cinéma. L.Z. 1479p. 1995. p.1223, 1134
1606 Fatéma Oufkir, Les jardins du roi. Le livre de poche. Michel Lafon. 254p. 2000. p.43
1607 France Culture, Répliques. La question trans. 11 septembre 2021
1608 Denis Diderot, Correspondance. Bouquins. Robert Laffont. 1468p. 1997. p.425
1609 Voltaire, Correspondance. XI. (juillet 1772-décembre 1774). La Pléiade. 1411p. 1986. p.689, 1253
1610 Correspondance de Gustave Flaubert. Lettres à Louise Colet. 1846-1851. Société coopérative éditions Rencontre. Lausanne. 583p. 1964. p.80
1611 In : Bartolomé et Lucile Bennassar, Le voyage en Espagne. Anthologie des voyageurs français et francophones du XVIème au XIXème siècle. Robert Lafont. 1276p. 1998. p.1095
1612 George Sand, Histoire de ma vie. In : Œuvres autobiographiques. II. La Pléiade. 1638p. 1972. p.337, 338
1613 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. I. La fortune des Rougon. La Pléiade. 1709p. 1960. p.43
1614 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. II. Nana. La Pléiade. 1748p. 1961. p.1148, 1150
1615 Khalida Messaoudi, Une Algérienne debout. Flammarion. 214p. 1995. p.40
1616 Fatéma Oufkir, Les jardins du roi. Le livre de poche. Michel Lafon. 254p. 2000. p.65, 143
1617 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. II. Une page d’amour. La Pléiade. 1748p. 1961. p.1076, 1081
1618 In : Émile Zola, Les Rougon-Macquart. I. La curée. La Pléiade. 1709p.,1960. note. p.1599, 1600
1619 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. I. La curée. La Pléiade. 1709p.,1960. p.370, 371, 396
1620 Marcel Proust, La prisonnière. Folio. Gallimard. 499p. 1959. p.167
1621 France Culture, La compagnie des œuvres. Stephan Zweig. 8 juin 2020 [1ère diffusion. 29 août 2016]
1622 L’Arc, Simone de Beauvoir interroge Jean-Paul Sartre. n°61. 1975. In : Jean-Paul Sartre, Situations, X. NRF. Gallimard, 226p. 1976. p.117
1623 France Culture, À voix nue. Simone Schwartz-Bart. 16 octobre 2017
1624 François Mauriac, Le nœud de vipères. Bernard Grasset. 311p. 1932. p.285
1625 France Culture, D’Édith Cavell à Mademoiselle Docteur ou Mata Hari : Histoire de l’espionnage au féminin. 6 août 2017. [1ère diffusion. 23 décembre 1997]
1626 Jean-François Champollion, Lettres à Zelmire. L’Asiathèque. 116p. 1978. p.78
1627 Cf. Marie-Victoire Louis, Les femmes et trois petits points http://www.marievictoirelouis.net/document.php?id=816&themeid=814
1628 Voltaire, Correspondance. XI. (juillet 1772-décembre 1774). La Pléiade. 1411p. 1986. p.182
1629 In : Robert Reid, Marie Curie, derrière la légende. Le Seuil. Points. Histoire. 345p.1983. p.157
1630 Marie-Claire Hook-Demarle, La femme au temps de Goethe. Stock. 378p. 1987. p.13
1631 Françoise Barret-Ducrocq & Évelyne Pisier, Femmes en tête. Flammarion. 534p. 1997. p.197
1632 Mireille Calle-Gruber, Mise en scène d’une lecture différentielle. Buñel : ‘Cet obscur objet du désir’. In : Lecture de la différence sexuelle. Colloque Paris VIII, CIPH. Paris, octobre 1990. Actes I. Des femmes. Antoinette Fouque. 317p. 1994. p.145
1633 Choderlos de Laclos, Les liaisons dangereuses. Lettre CVI. In : Laclos, Œuvres Complètes. La Pléiade. 1713p. 1979. p.244
1634 Crébillon fils, Les égarements du cœur et de l’esprit. GF. Flammarion. 295p. 1985. p.73
1635 Marivaux, Théâtre complet. Tome second. Classiques Garnier. 1173p. 1999. p.915. In : Journaux et Œuvres diverses. p.377
1636 Jules Michelet, Journal. Folio. Classique. Gallimard. 1144p. 2017. p.664, 802
1637 Charles Dickens, Les temps difficiles. Folio. Classique. Gallimard. 432p. 2019. p.39
1638 In : Gustave Flaubert, Correspondance. III. (janvier 1859-décembre 1868). La Pléiade. 1727p. 1991. p.312
1639 Léon Tolstoï, Hadji Mourat. In : Souvenirs et récits. La Pléiade. 1591p. 1960. p.1460
1640 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. I. La curée. La Pléiade. 1709p.,1960. p.386
1641 Antoine de Rivarol, Journal politique national (1789). In : Rivarol, Chamfort, Vauvenargues, L’art de l’insolence. Bouquins. Robert Laffont. 1517p. 2016. p.983
1642 Honoré de Balzac, Lettres à Madame Hanska. (1832-1844) Tome I. Robert Laffont. Bouquins. 957p. 1990. p.272
1643 Victor Hugo, L’homme qui rit. Gallimard. 616p. 1978. P.345
1644 Émile Zola, L’argent. Le livre de poche. 501p. 1978. p.265
1645 Léon Tolstoï, Journaux et carnets. III. (1905-1910). La Pléiade. 1368p. 1985. p.400
1646 Élisabeth Schemla, Édith Cresson. La femme piégée. Flammarion. 343p. 1993. p.28
1647 Alain Rey, Dictionnaire amoureux des dictionnaires. Plon. 998p. 2011. p.591
1648 Jean Tulard, Guide des films. 1895-1995. Édition du centenaire du cinéma. L.Z. 1479p. 1995. p.247
1649 France Inter. 31 octobre 2018
1650 Lou Andreas-Salomé, Correspondance avec Sigmund Freud. NRF. Gallimard. p.239 (Manque la date)
1651 France Culture, La nuit. René Barjavel, Les mots clés. 19 mars 2014 [1ère diffusion. 14 août 1971]
1652 Elle. 9 mai 2014
1653 Jean Tulard, Guide des films. 1895-1995. Édition du centenaire du cinéma. L.Z. 1479p. 1995. p.1250
1654 Jean Tulard, Dictionnaire du cinéma. Les réalisateurs. Bouquins. Robert Laffont. 1008 p. 2003. p.835
1655 France Culture, À voix nue. Arielle Dombasle. D’un masque à l’autre. 24 janvier 2020
1656 Gustave Flaubert, Correspondance. V. (janvier 1876-mai 1880). La Pléiade. 1556p. 2007. p.51, 61
1657 Source non relevée
1658 L’Humanité, Les parures d’Elsa au milieu du bouillonnement culturel de la fête de l’Humanité. 21 septembre 2016
1659 Arundhati Roy, Mon cœur séditieux. NRF. Gallimard. 1050p. 2020. p.913
1660 Le Canard enchaîné, Zemmour face à ‘Elle : ben voyons… 23 février 2022. p.1
1661 Lettres d’amour de Mirabeau. Librairie Garnier Frères. 356p. 1926. p.61
1662 France Culture, La grande table. Idées. 10 septembre 2019
1663 France Culture, L’humanisme d’Isaac Bashevis Singer [1902-1991]. 19 mars 2022. [1ère diffusion. 5 janvier 2013]
1664 Victor Hugo, L’homme qui rit. Gallimard. 616p. 1978. p.485
1665 Émile Zola, La curée. Le livre de poche. 412p. 2021. p.118
1666 André Dodin, St Vincent de Paul et la charité. Éditions du Seuil. Maîtres spirituels. 188p.1960. p.38
1667 Françoise d’Eaubonne, Mémoires irréductibles. Éditions Dagorno. 1135p. 2001. p.718
1668 Léon Tolstoï, La guerre et la paix. La Pléiade. Traduction de Pierre Pascal. 1654 p. 1945. p.1513, 1514 (Épilogue)
1669 Léon Tolstoï, Anna Karénine. Résurrection. La Pléiade. 1630p. 1951. p.242, 397,740
1670 Ernest Renan, Souvenirs d’enfance et de jeunesse. Folio. Gallimard. 332p. 1983. p.13 à 41
1671 Louis Guilloux, Carnets. 1921-1944. Gallimard. 414p. 1978. p.366
1672 Paul Claudel, Journal. I. La Pléiade. 1499p. 1968. p.957
1673 Françoise Giroud, Une poignée d’eau. Robert Laffont. 586p. 1973. p.227
1674 Fanny Deschamps, Journal d’une assistante sociale. Les nouveaux misérables. Éditions et publications premières. 191p. 1971. p.136
1675 Arte, Pedro Almodóvar, Tout sur ses femmes. 16 mars 2017
1676 Emily Brontë, Hurlevent. Folio. Classique. Gallimard. 620p. 2018. p.221
1677 George Sand, Correspondance. Georges Lubin. Classiques Garnier. Tome XVIII. 761p. 1984 p.588, 589
1678 George Sand, Correspondance. Georges Lubin. Classiques Garnier. Tome XXII. 868p. 1987. p.315
1679 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. III. Au bonheur des dames. La Pléiade. 1958p. 1964. p.705
1680 Le Parisien, Antoinette Fouque, [présentée comme] ‘cofondatrice du MLF en 1968 ‘. 1er octobre 2008
1681 Maria Montessori, L’enfant nouveau. 2 avril 1931 (Sur le net)
1682 Voltaire, Correspondance. III. (janvier 1749-décembre 1753). La Pléiade. 1534p. 1975. p.1030
1683 Carlo Goldoni, Mémoires. Le Temps retrouvé. Mercure de France. 635p. 2018. p.547, 548
1684 Jean-François Champollion, Lettres à Zelmire. L’Asiathèque. 116p. 1978. p.12
1685 Anton Tchékhov, Des leçons onéreuses. In : Œuvres. II. La Pléiade. 1021p. 1970. p.356
1686 In : Honoré de Balzac, La comédie humaine. XII. La Pléiade. 1717p. 1981. note. p.983
1687 Sigmund Freud, Lettres à Wilhelm Fliess, 1887-1904. PUF. 763p. 2006. p.134, 135
1688 Docteur Charles Platon et docteur Antoine Lacroix. Le sauvetage de la femme. Essai de traitement prophylactique des maladies des femmes. Librairie médicale Marcel Vigné. 671p. 1934. p.62, 63
1689 George Sand, Lélia. Texte établi, présenté et annoté par Pierre Reboul. Classiques Garnier. 601p. 1093. p.XLVI
1690 Luce Irigaray, Nietzsche, Freud et les femmes. In : Le corps-à-corps avec la mère. Les Éditions de la pleine lune. Montréal. Conférences et entretiens. 89p. 1981. p.69
1691 Journal des Goncourt. Tome IV. 1865-1868. Honoré Champion. 765p. 2019. p.194
1692 Roger Vailland, La Loi. Le livre de poche. 378 p.1965. p.158
1693 George Eliot, Le moulin sur la Floss. Folio. Classique. Gallimard. 738p. 2003. p.340
1694 Émile Zola, Thérèse Raquin. Garnier Flammarion. 253p. 1970. p.79
1695 Benoîte Groult, Ainsi soit-elle. Le Grand-Livre-du-Mois. 228p. 1976. p.50
1696 Goliarda Sapienza, L’art de la joie. Viviane Hamy. 637p. 2006. p.124
1697 Jean Tulard, Guide des films. 1895-1995. Édition du centenaire du cinéma. L.Z. 1479p. 1995. p.125
1698 Paris Match, ‘Vous n’avez pas idée ! ‘Hillary Clinton envie les répliques de Jo Biden à Donald Trump. 30 septembre 2020
1699 Le Canard enchaîné, La limite du ridicule. 29 décembre 2021. p.1
1700 Chaîne Histoire, Anne-Marie Thunissen, Femmes-machines.1996. 20 novembre 2016
1701 Planète, Les hommes en noir (concernant les Hollandais enrôlés dans la Waffen SS) 11 juin 2012. 10h 10
1702 Madeleine Riffaud, Dans les maquis ‘Vietcong’. Julliard. 267p. 1965. p.234
1703 Émile Zola, Au bonheur des dames. Retrouver la source et la page
1704 Tchékhov, L’Ile de Sakhaline. Folio. Classique. Gallimard. 568p. 2001. p.243, 244
1705 Jean Tulard, Guide des films. 1895-1995. Édition du centenaire du cinéma. L.Z. 1479p. 1995. p.519, 1069
1706 Madame du Châtelet, Discours sur le bonheur. Rivages. Poche. Petite bibliothèque. 75p. 1997. p.53
1707 Marie-Aimée Steck-Gichelin, Cahiers. In : La fabrique de l’intime. Mémoires et journaux de femmes au XVIIème siècle. Bouquins. Robert Laffont. 1192p. 2013. p.1019, 1020
1708 Ménie Grégoire, Le métier de femme. Plon. 315p. 1965. p.159
1709 Jean-Louis Bory, Guy Hocquenghem, Comment nous appelez-vous déjà ? Ces hommes que l’on dit homosexuels. Calmann-Lévy. 237p. 1977. p.13, 14
1710 Marche mondiale des femmes. 30 septembre 2019. Rassemblement soutien aux grévistes d’Ibis Batignolles. 1er octobre 2019
1711 Louis Sébastien Mercier, Tableau de Paris. Tome VII. p.133 (éditeur ?)
1712 Sade, Œuvres. I. (Notes et variantes) La Pléiade. 1363p. 1990. p.1157
1713 A. Jourcin et Ph. Van Tieghem, Dictionnaires des femmes célèbres. Collection : Les dictionnaires de l’homme du XXème siècle. Larousse. 256p. 1969. p.66, 108, 161, 183
1714 George Sand, Correspondance. Georges Lubin. Classiques Garnier. Tome XV. 964p.1981. p.392
1715 L’Express Mag. 19 janvier 2004
1716 Arte, Sandrine Bonnaire, actrice de sa vie. 8 octobre 2012. 12h 40
1717 France Culture, Du grain à moudre d’été. Les femmes peuvent-elles être des héros ? 2 août 2019
1718 Sándor Màrai, Métamorphoses d’un mariage. Albin Michel. 448p. 2006. p.34
1719 Roselyne Bachelot, La petite fille de la Ve. Souvenirs. Flammarion. 313p. 2015. p.112
1720 Mikhaïl Gorbatchev, Mémoires. Éditions du rocher. 941p. 1997. p.165, 166
1721 Victor Hugo, Les misérables. La Pléiade. 1805p. 1951. p.181
1722 L’Express, La vie sexuelle de Paul Léautaud. 26 avril 2012
1723 France Culture, Une vie, une œuvre. Rosa Bonheur. 16 avril 2016
1724 France Culture, Sonia Delaunay. 21 septembre 2019
1725 In : Robert E. Lerner, Ernst Kantorowicz, une vie d’historien. Bibliothèque des histoires. NRF. Gallimard. 638p. 2019. p.197, 198
1726 Vassili Grossman, Vie et destin. Julliard / L’âge d’Homme. 818p. 1993. p.498
1727 Être français aujourd’hui et demain. I. Rapport de la commission de la nationalité (M. Marceau Long. Président) 10/18. UGE. 769p. 1988. p.615
1728 Stendhal, Lettres à Pauline. L’école des lettres. Seuil. 1994. 645p. p.334
1729 André Breton, Anthologie de l’humour noir. Jean-Jacques Pauvert. Le livre de poche. 1966. 446p. p.273, 274
1730 George Eliot, Middlemarch. Folio. Classique. Gallimard. 1152p. 2020. p.227
1731 France Culture, A voix nue. Anne Sylvestre. 30-31 décembre 2002 [2ème diffusion. 20 janvier 2020]
1732 Philippe de Gaulle, De Gaulle, mon père **. Entretiens avec Michel Tauriac. Plon. 556p. 2004. p.172
1733 George Sand, Correspondance. Georges Lubin, Classiques Garnier. Tome XX. 942p. 1985. p.297
1734 Sigmund Freud, Lettres à Wilhelm Fliess, 1887-1904. PUF. 763p. 2006. p.59
1735 Michel Leiris, L’âge d’homme, précédée de L’Afrique fantôme. La Pléiade. 1387p. 2014. p.678
1736 Michel Foucault, Dits et écrits. 1954-1988. II. 1976-1988. Quarto. Gallimard. 1735p. 2001. p.319, 320
1737 Ibid. p. 1349
1738 Claude Dulong, Anne d‘Autriche. Folio. Histoire. Gallimard. 523p. 1985. p.17
1739 Marie-Pas-Claire, Hystériques et fières de l’être. Parole de lesbiennes. 1997. 128p.
1740 France Culture, Geneviève Fraisse. Atteindre la philosophie et le genre. 24 avril 2017
1741 Mariette Sineau, La force du nombre. Femmes et démocratie présidentielle. Éditions de l’aube. 2008. 205p.
1742 Une correspondance Saint-simonienne. Angélique Arnaud et Caroline Simon (1833-1883). Textes recueillis et présentés par Bernadette Louis. Avant-propos de Monique Rouillé. Coté-femmes. 225p. 1990. p.168
1743 Voltaire, Correspondance. V. (janvier 1758-septembre 1760). La Pléiade. 1698p. 1980. p.1103
1744 Léon Tolstoï, Les récits de Sébastopol. In : Souvenirs et récits. La Pléiade. 1591p. 1960. p.494, 495
1745 Médecin-commandant Grauwin, J’étais médecin à Dien-Bien-Phu. Éditions France-Empire. 382p. 1954 p.198
1746 Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions. Autres textes autobiographiques. In : Œuvres complètes. I. La Pléiade. 1969p. 1986. p.289
1747 Ivy-Compton-Burnett, Frères et sœurs. L’Age d’homme. 249p. 1983. p.48
1748 Roselyne Bachelot, Geneviève Fraisse, Deux femmes au royaume des hommes. Hachette Littérature. 304p. 1999. p.69
1749 Roselyne Bachelot, Geneviève Fraisse, Deux femmes au royaume des hommes. Hachette Littérature. 304p. 1999. p.239
1750 Madame de Lafayette, Œuvres complètes. La Pléiade. 1601p. 2014. p.864
1751 John Stuart Mill, De la liberté. Folio. Essais. Gallimard. 242p. 1990. p.110
1752 Émile Zola, L’argent. Le livre de poche. 501p. 1978. p.69, 499
1753 Baudelaire, Fusées. VI. 1867 (sur Wiki source)
1754 Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe. Folio. 645p. 1989. p.206
1755 Jean Monnet, Mémoires. Le livre de poche. 827p. 1976. p.134
1756 Radio courtoisie, Les mardis de la mémoire. 20 mai 2019 [Réécoute d’une émission du 12 octobre 1993]
1757 Nouvelles News, Danielle Méran : ‘Je ne suis pas la mamie du web, je suis une avocate’. 11 décembre 2015
1758 Le Monde, La parole entravée des femmes. 4 mars 2017
1759 Léon Tolstoï, Anna Karénine. In : Régine Deforges, Les cent plus beaux cris de femmes. Anthologie. Le Cherche midi. 1980. 250p. p.110
1760 In : Christine Ockrent, Françoise Giroud. Une ambition française. Fayard. 364p. 2003. p.270
1761 Jacqueline Kennedy. Conversations inédites avec Arthur. M. Schlesinger. 1964. 428p. 2011. p.59
1762 Marivaux, La vie de Marianne. Folio Classique. Gallimard. 778p. 2014. p.119, 120
1763 Benjamin Constant. Isabelle de Charrière. Correspondance. 1787-1805. Desjonquières. 536p. 1996. p.293
1764 Jane Austen, Emma. I. 10/18. 313p. 1982. p.237
1765 Honoré de Balzac, Gobseck. Une double famille. GF. Flammarion. 248p. 1984. p.74
1766 Souvenirs et mémoires de la comtesse Merlin [1789-1852]. Le temps retrouvé. Mercure de France. 474p. 2010. p.140
1767 George Eliot, Le moulin sur la Floss. Folio. Classique. Gallimard. 738p. 2003. p.725
1768 Alexis de Tocqueville, Lettres Choisies. Souvenirs. Quarto. Gallimard. 1160p. 2003. p.856
1769 Anton Tchékhov, Ma vie. Récit d’un provincial. In : Œuvres. III. La Pléiade. 1033p. 1971. p.596
1770 André Gide, Le voyage au Congo. In : Journal. 1939-1949. Souvenirs. La Pléiade. 1280p. 1954. p.851
1771 François Mauriac, Mémoires intérieurs. Le livre de poche. 384p. 1966. p.67
1772 Jacqueline de Romilly, Jeanne. Le livre de poche. 259p. 2012. p.10
1773 C8, Touche pas à mon poste. 24 mars 2017. 11h 20
1774 Radio Courtoisie, Le français en partage. 23 janvier 2018
1775 Le Canard enchaîné, Flambantes meufs. 20 janvier 2021. p.7
1776 Christine Ockrent, Françoise Giroud. Une ambition française. Fayard. 364p. 2003. p.77
1777 Lettres bougrement patriotiques de la Mère Duchêne, suivi de Journal des femmes. février-avril 1791. Les Éditions de Paris. EDHIS. 194p. 1989. p.120
1778 Doris Lessing, Préface au Carnet d’or. Le livre de poche. 945p. 2014. p.10, 11
1779 Zaza, Correspondance et carnets d’Élisabeth Lacoin.1914-1929. Seuil. 1991. 381p.
1780 In : Denis Diderot, Œuvres. La Pléiade. 1470p. 1951. p.362
1781 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. II. Nana. La Pléiade. 1748p. 1961. p.1319
1782 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. II. Nana. La Pléiade. 1748p. 1961. p.1368
1783 Émile Zola, Correspondance. V. 1884-1886. Les Presses de l’Université de Montréal. Éditions du CNRS. 515p. 1985. p.233
1784 Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe. Folio. 645p. 1989. p.196
1785 Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe. Folio. 645p. 1989. p.197
1786 Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe. Folio. 645p. 1989. p.199
1787 Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe. Folio. 645p. 1989. p.500
1788 Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe. Folio. 645p. 1989. p.505
1789 Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe. Folio. 645p. 1989. p.515
1790 In : Hildegard Möller, Thomas Mann. Une affaire de famille. Tallandier. 382p. 2007. p.207
1791 Julien Green, Vers l’invisible. Journal 1958-1967. Le livre de poche. 477p. 1967. p.146
1792 Doris Lessing, Le carnet d’or. Le livre de poche. 1984. 945p. p.653
1793 Génération MLF [1968-2008]. Des Femmes. Antoinette Fouque. 615p. 2008. p.88
1794 Femmes et Russie. 1980. Par le collectif de rédaction de l’Almanach et quelques autres. Des femmes. 217p. 1980. p.90, 91
1795 Lucienne Mazenod, Ghislaine Schoeller, Dictionnaires des femmes célèbres. De tous les temps et des tous les pays. Bouquins. Robert Laffont. 932p. 1992. p.62
1796 Marie-Pas-Claire, Hystériques et fières de l’être. Paroles de lesbiennes. 128p. 1997. p.25
1797 Françoise Gaspard, Être lesbienne : invisibilité, caricatures et violences. In : Le livre noir des femmes (Dirigé par Christine Ockrent). Document. XO Éditions. 954p. 2007. p.666
1798 Ibid.
1799 Libération, Benoîte Groult. Ainsi fut-elle. 22 juin 2016
1800 Elle, 3 janvier 2017
1801 France Culture, Une vie, une œuvre. Audre Lorde. Poète guerrière. 22 avril 2017
1802 France Culture, Juliette intime et en chansons. 26 octobre 2018
1803 France Culture, LSD. Faites du sport. 26 juin 2019
1804 Jean-Louis Bory, Guy Hocquenghem, Comment nous appelez-vous déjà ? Ces hommes que l’on dit homosexuels. Calmann-Lévy. 237p. 1977. p.20
1805 Leïla Sebbar, On tue les petites filles. Stock 2 / Voix de femmes. 357p. 1978. p.183
1806 Le Canard enchaîné, ‘Opération chasse d’eau’ au Palais-Bourbon. 29 novembre 2017. p.2
1807 H. G Wells, La Russie telle que je viens de la voir. Éditions du progrès civique. 169p. 1920. p.37
1808 Stendhal, Le rouge et le noir. Le livre de poche. Classiques de poche. 577p. 2009. p.56, 77
1809 Balzac, Mémoires de deux jeunes mariées. In : La comédie Humaine. I. La Pléiade. 1065p. 1951. p.148
1810 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. II. Son excellence Eugène Rougon. La Pléiade. 1748p. 1961. p.343
1811 Émile Zola, La bête humaine. GF Flammarion. 2011. 459p. p.183
1812 Jean-Jacques Rousseau, Les confessions. Autres oeuvres autobiographiques. In : Oeuvres complètes. I. La Pléiade, 1969p. 1986. p.308, 309
1813 Fiodor Dostoïevski, Journal d’un écrivain. La Pléiade. 1611p. 1972. p.888
1814 Jacques Prévert, Choses et autres. Œuvres complètes. II. La Pléiade. Gallimard. 1553p. 1996. p.275
1815 Voltaire, Correspondance. XI. (juillet 1772-décembre 1774). La Pléiade. 1411p. 1986. p.353
1816 Stendhal, Lettres à Pauline. L’école des lettres. Seuil. 1994. 645p. p.122
1817 Honoré de Balzac, Illusions perdues. Garnier frères, 876p. 1969. p.164
1818 Honoré de Balzac, La cousine Bette. Éditions Garnier frères. 496p. 1974. p.73
1819 George Sand, Correspondance. Georges Lubin. Classiques Garnier. Tome XXII. 868p. 1987. p.723
1820 Carlo Goldoni, Mémoires. Le Temps retrouvé. Mercure de France. 635p. 2018. p.494, 503
1821 Petit guide de sécurité familiale. Les accidents à la maison. Les Éditions sociales françaises. 96p. 1954. p.4
1822 Manil Suri, Mother India. Le livre de poche. 637p. 2009. p.201, 202
1823 Le Monde Diplomatique. avril 2023. p.26
1824 France Inter, La marche de l’histoire. Le témoin du vendredi, Denise Cacheux, socialiste rieuse. 5 juin 2015
1825 Stendhal, Correspondance. 1800-1821. I. La Pléiade. 1637p. 1962. p.192
1826 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. II. Nana. La Pléiade. 1748p. 1961. p.1189
1827 Le Figaro, Maurice Lévy : ‘Je n’ai jamais été un bon manager de femmes’. 17 octobre 2014
1828 Émile Zola, Au bonheur des dames. Garnier-Flammarion. 442p. 1971. p.44
1829 Émile Zola, Au bonheur des dames. Garnier-Flammarion. 442p. 1971. p.146
1830 TFI, Sept à huit. 22 juillet 2018
1831 Daniel Defoe, Heurs et malheurs de la célèbre Moll Flanders. In : Moll Flanders. La Pléiade. 1728p. 1969. p.845
1832 Voltaire, Correspondance. VII. (janvier 1763-mars 1765). La Pléiade. 1590p. 1981. p.286
1833 Léon Tolstoï, Anna Karénine. Résurrection. La Pléiade. 1630p. 1951. p.242
1834 Le Monde, Au Libéria, le désenchantement des femmes qui comptaient sur d’Ellen Johnson Sirleaf. 28 décembre 2017
1835 Lettres d’une religieuse portugaise. In : Régine Deforges, Les cent plus beaux cris de femmes. Anthologie. Le Cherche midi. 1980. 250p. p.19
1836 Gustave Flaubert, Madame Bovary. In : Régine Deforges, Les cent plus beaux cris de femmes. Anthologie. Le Cherche midi. 1980. 250p. p.56
1837 In : Dominique Dallayrac, Le nouveau visage de la prostitution. La révolte contre l’ordre mâle. Robert Laffont. 222p. 1976. p.169, 170
1838 TMC, Le quotidien. 24 janvier 2020
1839 Anton Tchékhov, Le duel. In : Œuvres. II. La Pléiade. 1021p. 1970. p.814
1840 Jules Roy, Mémoires barbares. Le livre de poche. 697p. 1989. p.639
1841 Arts ménagers. Revue officielle du salon des Arts ménagers. Revue bimestrielle éditée par Le Jardin des Modes. mars-avril 1950. 96 p.
1842 In : France Culture, Plein le dos du boulot. Les kinés à la rescousse. 30 mars 2022
1843 Nicola Berdiaev, Essai d’autobiographie spirituelle. Buchet / Chastel. 429p. 1979, p.99
1844 Le Monde Diplomatique, Juliette Rennes, Vieillir au féminin. décembre 2016. p.16
1845 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. II. Son excellence Eugène Rougon. La Pléiade. 1748p. 1961. p.145
1846 Françoise Basch, Victor Basch. De l’affaire Dreyfus au crime de la Milice. Plon. 389p. 1994. p.316
1847 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. I. La curée. La Pléiade. 1709p.1960. p.359
1848 George Sand, Correspondance. Garnier Flammarion. Tome 7ème. 895 p.1970. p.81
1849 Ibid. Tome 7ème. p.129
1850 Souligné par moi
1851 Ibid, Tome 8ème. Lettre à Emmanuel Arago, 12 août 1847. 868 p. 1971. p.69 et 70
1852 Ibid, Tome 8ème. p.600
1853 Ibid, Tome 25ème. 1195 p. 1991. p.623
1854 Ibid, Tome 25ème. p.689
1855 Ibid., Tome 9ème. Lettre à Charles Poncy. 26 septembre 1850. 1020 p. 1972. p.713, 714
1856 Émile Zola, La curée. Le livre de poche. 412p. 2021. p.36
1857 Mary Wollstonecraft, Défense des droits de la femme. Payot. 239 p. 2016. p.72
1858 Madame Hermione Quinet, Mémoires d’exil. Paris. Troisième édition. Paris. Librairie internationale. 379p. 1869. p.29
1859 Marie Cardinal, Autrement dit. Le livre de poche. 22p. 1977. p.144
1860 Le Canard enchaîné, Jair Bolsonaro. Samba de plafond. 17 octobre 2018. p.7
1861 Honoré de Balzac, La peau de chagrin. Le livre de poche. 366p. 1972. p.125
1862 Émile Zola, Correspondance. I. 1858-1867. Les Presses de l’Université de Montréal. Éditions du CNRS. 594p. 1978. p.249
1863 Marie d’Agoult. George Sand, Correspondance. Bartillat. 301p. 1995. p.36
1864 André Gide, Journal. 1939-1949. Souvenirs. La Pléiade. 1280p. 1954. p.118
1865 France Culture, L’esprit public. 10 mars 2019
1866 Denis Diderot, Correspondance. Bouquins. Robert Laffont. 1468p. 1997. p.398
1867 Honoré de Balzac, Splendeurs et misères des courtisanes. La Pléiade. La comédie humaine. V. 1154p. 1949. p.1013
1868 Léon Tolstoï, La guerre et la paix. La Pléiade. Traduction de Pierre Pascal. 1654p. 1945. p.976 (Livre 3)
1869 Hippolyte Taine, Les origines de la France contemporaine. Bouquins. Robert Laffont. Tome 1. 839p. 1986. p.140, 190, 193
1870 Fiodor Dostoïevski, Les frères Karamazov, Le club français du livre. 1060p. 1956. p.531
1871 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. III. Au bonheur des dames. La Pléiade. 1958p. 1964. p.678
1872 Le Figaro. AFP, Frontière de Ceuta : Décès dans une bousculade. 24 avril 2017
1873 Gustave Flaubert, Correspondance. IV. (janvier 1969-décembre 1875). La Pléiade. 1484p. 1997. p.4
1874 Jean Zay, Écrits de prison. 1940-1944. Belin. 1052p. 2014. p.604
1875 Boris Pasternak, Le docteur Jivago. Folio. Gallimard. 697p. 1972. p.340
1876 Ménie Grégoire, Telle que je suis. Robert Laffont. 359p. 1976. p.224
1877 Ryszard Kapuściński, Imperium. 10/18. 340p. 1999. p.172,173
1878 Henry David Thoreau, Journal 1er janvier 1841-21 novembre 1843. Finitude. 317p. 2013. p.137
1879 In : Wilhelm Reich, Psychologie de masse du fascisme. Petite bibliothèque Payot. 518p. 2007. p.102
1880 In : Wilhelm Reich, Psychologie de masse du fascisme. Petite bibliothèque Payot. 518p. 2007. p.71
1881 Margaret Goldsmith, Cinq femmes contre le monde. Gallimard. 201p. 1937. p.184, 185
1882 Rita Thalmann, La condition féminine sous le nazisme. In, Nouvelle encyclopédie des femmes (Sous la direction de Christine Fauré). Les Belles lettres. 1216p. 2010. p.789
1883 Restif de La Bretonne, Le pornographe ou la prostitution réformée. Mille et une nuits. n° 417. 2003. 135p (Citation de la quatrième de couverture)
1884 Friedrich Reck-Mallenczewen, La haine et la honte. Journal d’un aristocrate allemand. 1936-1944. Tempus. 359p. 2017. p.168, 169
1885 Réponse de M. Jean-Christophe Ruffin au discours de réception de Madame Dominique Bona à l’Académie française. 23 octobre 2014
1886 In : Les écrivains, témoins du peuple. J’ai lu. L’essentiel. 506p. 1964. p.197
1887 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. III. La joie de vivre. La Pléiade. 1958p. 1964. p.1109
1888 Léon Tolstoï, La sonate à Kreuzer. In : Souvenirs et récits. La Pléiade. 1591p. 1960. p.1099
1889 In : Clemenceau. L’intégrale des articles publiés de 1894 à 1906 dans La Dépêche. Éditions Privat. La Dépêche. 2014. 799p.
1890 Entrer dans la vie. Naissances et enfances dans la France traditionnelle. Collection Archives, Gallimard. Julliard. 246p. 1978. p.39
1891 Léon Tolstoï, Journaux et carnets. III. (1905-1910). La Pléiade. 1368p. 1985. p.27
1892 Simone de Beauvoir. In : Madeleine Chapsal, Les écrivains en personne. 10/18. 316p. 1973. p.55
1893 France Culture, Qui parle au nom de ‘nous’ ? 13 décembre 2019
1894 Voltaire, Correspondance. IV. (janvier 1754-décembre 1757). La Pléiade. 1655p. 1978. p.1030
1895 Eugène Delacroix, Journal. Tome I. (1822-1857). José Corti. 1214p. 2009. p.487
1896 Émile Zola, L’œuvre. Pocket. 2000. 499p. p.66
1897 Khalida Messaoudi, Une Algérienne debout. Entretiens avec Elisabeth Schemla. Flammarion. 214p. 1995. p.164, 165
1898 Gérard-Gailly, Les véhémences de Louise Colet. Mercure de France. 237p. 1934. p.107
1899 Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions. Autres œuvres autobiographiques. In : Œuvres complètes. I. La Pléiade. 1969p. 1989. p.321
1900 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. I. La curée. La Pléiade. 1709p.,1960. p.353
1901 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. III. Pot-Bouille. La Pléiade. 1958p. 1964. p.83
1902 Jean Tulard, Guide des films. 1895-1995. Édition du centenaire du cinéma. L.Z. 1479p. 1995. p.34, 42, 92, 481, 532-533, 959, 1130
1903 France Culture, Concordance des temps. Le blanc, une couleur ou pas ? 8 octobre 2022
1904 Hélène Berr, Journal. Points. Tallandier. 329p. 2009. p.106
1905 France Culture, Mauvais genres. Initial. BL. Rencontre avec Brigitte Lahaie. 11 février 2017
1906 In : Le chevalier de Propriac, Le Plutarque des jeunes demoiselles. Abrégé des femmes illustres de tous les pays. Tome premier. 360p. 1825. p.250
1907 Voltaire, Correspondance VII. (janvier 1763-mars 1765). La Pléiade. 1590p. 1981. p.567
1908 Honoré de Balzac, Lettres à Madame Hanska. I. 1832-1844. Bouquins. Robert Laffont. 957p. 1990. p.209
1909 George Sand, Lettres d’un voyageur. In : Œuvres autobiographiques. II. La Pléiade. 1638p. 1972. p.787
1910 Victor Hugo, L’homme qui rit. Gallimard. 616p. 1978. p.190
1911 Marie Bashkirtseff, Lettres. Eugène Fasquelle Éditeur. 282p. 1922. p.121, 122
1912 Boris Pasternak, Le docteur Jivago. Folio. Gallimard. 697p. 1972. p.178
1913 Samuel Pepys, Journal. I. 1660-1664. Bouquins. Robert Laffont. 1994. 1365p. p.280, 337
1914 Abbé de Choisy, Mémoires pour servie à l’histoire de Louis XIV. Le temps retrouvé, Mercure de France. 533p. 2000. p.211
1915 Mémoires du duc de Saint-Simon. Choix et présentation de Paul Galleret. 10/18. 443p. 1974. p.122, 44
1916 Françoise de Graffigny, Lettres d’une péruvienne. Adriatice Éditrice. 492p. 1987. p.293
1917 Voltaire, Correspondance. IV. (janvier 1754-décembre 1757). La Pléiade. 1655p. 1978. p.252
1918 Voltaire, Correspondance. IV. (janvier 1754-décembre 1757). La Pléiade. 1655p. 1978. p.438
1919 Voltaire, Correspondance. IV. (janvier 1754-décembre 1757). La Pléiade. 1655p. 1978. p.913
1920 Voltaire, Correspondance. XI. (juillet 1772-décembre 1774). La Pléiade. 1411p. 1986. p.899
1921 Voltaire, Dictionnaire philosophique. Garnier Flammarion. 380 p.1964. p.123
1922 Voltaire, Correspondance. XII. (janvier 1775-juin 1777). La Pléiade. 1361p. 1987. p.267, 268, 222
1923 Carlo Goldoni, Mémoires. Le Temps retrouvé. Mercure de France. 635p. 2018. p.50
1924 Joseph Fouché, Mémoires. Perrin. 668p. 2015. p.374
1925 Stendhal, Oeuvres intimes. I. La Pléiade. 1637p. 1981. p.719
1926 Stendhal, De l’amour. Michel Lévy Frères. 371p. 1857. p.296
1927 Le chevalier de Propriac, Le Plutarque des jeunes demoiselles. Abrégé des femmes illustres de tous les pays. Tome Premier. 360p. 1825. p.171, 167
1928 Chateaubriand, Lettres à Madame Récamier. Flammarion. 578p. 1998. note 32. p.367
1929 George Sand, Lélia. Texte établi, présenté et annoté par Pierre Reboul. Classiques Garnier. 601p. 1993. p.37
1930 Honoré de Balzac, La peau de chagrin. Le livre de poche. 366p. 1972. p.90
1931 Honoré de Balzac, Illusions perdues. Garnier frères, 876p. 1961. p.660
1932 Balzac, La femme de trente ans. Garnier-Flammarion. 242p. 1965. p.57
1933 Astolphe de Custine, Lettres de Russie. Folio. Gallimard. 409p. 1975. p.122
1934 Nicolas Gogol, Les âmes mortes. In : Œuvres complètes. La Pléiade. 1953p. 1966. p.1137
1935 François-René de Chateaubriand, Mémoires d’Outre-tombe. II. La Pléiade. 1496p. 1988. p.189
1936 Jules Michelet, Histoire de la Révolution française. 1. La Pléiade. 1530p. 1976. p.407
1937 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. I. La curée. La Pléiade. 1709p.,1960. p.465
1938 Émile Zola, Au bonheur des dames. Garnier Flammarion. 442p. 1971. p.90
1939 Émile Zola, L’argent. Le livre de poche. 501p. 1978. p.118
1940 George Eliot, Middlemarch. Folio. Classique. Gallimard. 1152p. 2020. p.136
1941 Hippolyte Taine, Les origines de la France contemporaine. Bouquins. Robert Laffont. Tome 1. 839p. 1986. p.209
1942 Ferdinand von Saar, Le lieutenant Burda. Bartillat. 126p. 2022. p.36
1943 Journal de l’abbé Mugnier.1879-1939. Le Temps retrouvé. Mercure de France. 639p. 2007. p.125
1944 Cité dans Philippe Artières et Dominique Kalifa, Vidal, le tueur de femmes. Une biographie sociale. Verdier. Poche. 366p. 2017. p.245, 251
1945 Marcel Proust, La prisonnière. Folio. Gallimard. 499p. 1959. p.290, 291
1946 Edith Wharton, Les chemins parcourus. Autobiographie. Flammarion. 300p. 1995. p.14
1947 François Mauriac, Le nœud de vipères. Bernard Grasset. 311p. 1932. p.239
1948 Boris Pasternak, Le docteur Jivago. Folio. Gallimard. 697p. 1972. p.38
1949 In : Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions. Autres œuvres autobiographiques. In : Œuvres complètes. I. La Pléiade. 1969p. 1986. p.1545
1950 In : Dany Cohn-Bendit, Nous l’avons tant aimée, la révolution. Le Seuil. Points Actuels. 254 p. 1988. p.191
1951 Françoise Rosay, La traversée d’une vie. Collection ‘Vécu’. Robert Laffont. 317p. 1974. p.77
1952 Louise Weiss, Combats pour les femmes. Albin Michel. 270p. 1980. p.54
1953 Georges Simenon, Mémoires intimes. Presses de la cité. 753p. 1981. p.340
1954 Raymond Aron, Mémoires. 50 ans de réflexions politiques. Julliard. 778p. 1983. p.53
1955 Lucienne Mazenod, Ghislaine Schoeller, Dictionnaires des femmes célèbres. De tous les temps et des tous les pays. Bouquins. Robert Laffont. 932p. 1992. p.624
1956 Gisèle Halimi, La nouvelle cause des femmes. Seuil. Essais. 226p. 1997. p.53
1957 Voici, Trump, avec un T comme Thénardier. 14 juin 2017
1958 France Culture, L’empire Ottoman et la Turquie face à l’Occident, les années 1820-1830. 26 mars 2020
1959 Le Canard enchaîné, L’union des forces de la joie. 11 mai 2022. p.2
1960 Mémoires du cardinal de Bernis, Le Temps retrouvé. Mercure de France. 375p. 1986. p.63
1961 Émile Zola, L’argent. Flammarion. 581p. 2009. p.124
1962 Alexandra David-Neel, Correspondance avec son mari. Édition intégrale. 1904-1941. Plon. 943p. 2001. p.87
1963 Stefan Zweig, Fouché. Le livre de poche. 279p. 2013. p.220
1964 Simone Weil, À propos de la question coloniale… In : Œuvres. Quarto. Gallimard. 1276p. 2003. p.436
1965 Robert E. Lerner, Ernst Kantorowicz, une vie d’historien. Bibliothèque des histoires. NRF. Gallimard. 638p. 2019. p.423
1966 Malwida von Meysenburg, Le Soir de ma vie, suite des Mémoires d’une idéaliste. Librairie Fischbacher. 400 p. 1908. p.24 (Lisible sur Gallica)
1967 Voltaire, Correspondance. IV. (janvier 1754-décembre 1757). La Pléiade. 1655p. 1978. p.1089, 1090
1968 Voltaire, Correspondance. XI. (juillet 1772-décembre 1774). La Pléiade. 1411p. 1986. p.71
1969 Honoré de Balzac, La cousine Bette. Éditions Garnier frères. 496p. 1974. p.188
1970 Sigmund Freud. Karl Abraham, Correspondance complète.1907-1925. Connaissance de l’inconscient. Gallimard. 790p. 2006. p.634
1971 Lucienne Mazenod, Ghislaine Schoeller, Dictionnaires des femmes célèbres. De tous les temps et des tous les pays. Bouquins. Robert Laffont. 932p. 1992. p.205
1972 Arthur Young, Voyages en France.10/18. 311p. 1988
1973 Vera Figner, Mémoires d’une révolutionnaire. Traduit du russe par Victor Serge. Gallimard. 267p. 1930. p.267
1974 Honoré de Balzac, Illusions perdues. Garnier frères, 876p. 1961. p.137
1975 France Culture, Madeleine Riffaud. La mémoire sauve. 2 août 1993
1976 Pierre Pascal, Journal de Russie. 1928-1929. Éditions Noir sur blanc. 766p. 2014. p.256
1977 In : (sans date, ni source) Fabienne Leloup, Maria Deraismes. Michel De Maule. 300p. 2015. p.179
1978 France Culture, Charlotte Delbo. 1913-1985. 21 juillet 2018
1979 Georgette Elgey, La fenêtre ouverte. Récit. Fayard. 1973. 218p.
1980 Boris Pasternak, Le docteur Jivago. Folio. Gallimard. 697p. 1972. p.37
1981 Vassili Grossman, Vie et destin. Julliard / L’âge d’Homme. 818p. 1993. p.223
1982 France Culture, Tant que le sable durera. 21 août 2016
1983 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. II. L’assommoir. La Pléiade. 1748p. 1961. p.506
1984 Laurence Klejman et Florence Rochefort, L’égalité en marche. Op. cit. p.70
1985 Victor Hugo, Choses vues. 1849-1885. Folio. Classique. Gallimard. 1014p. 2010. p.240
1986 Gloria Steinem, Ma vie sur la route. Mémoires d’une icône féministe. Harper Collins. 393p. 2019. p.99
1987 France Culture, Les femmes et les sciences. 23 juin 2018
1988 Public Sénat, 3 août 2017
1989 Fiodor Dostoïevski, Les frères Karamazov, Le club français du livre. 1060p. 1956. p.885
1990 Jacques Prévert. Oeuvres complètes. I. La Pléiade. 1452p. 1992. p.349
1991 André Gide, Le retour du Tchad, In : André Gide, Journal. 1939-1949. Souvenirs. La Pléiade. 1280p. 1954. p. 875, 883
1992 In : Albert Londres, Oeuvres complètes. Arléa. 900p. 2007. p.597
1993 Mary Robinson, Mémoires de Mistriss Robinson, In : La fabrique de l’intime. Mémoires et journaux de femmes au XVIIème siècle. Bouquins. Robert Laffont. 1192p. 2013. p.849, 850
1994 Daniel Defoe, Heurs et malheurs de la célèbre Moll Flanders. In : Moll Flanders. La Pléiade. 1728p. 1969. p.895
1995 Marivaux, La vie de Marianne. Gallimard. Folio Classique. 778 p. 2014. p.460
1996 Sade, Les cent-vingt journée de Sodome. In : Œuvres. I. La Pléiade. 1363p. 1990. p.256
1997 Carlo Goldoni, Mémoires. Le Temps retrouvé. Mercure de France. 635p. 2018. p.182
1998 In : Beaumarchais, Œuvres. La Pléiade. 1696p. 1988. p.1645, 1646
1999 Germaine de Staël, Dix ans d’exil. Fayard. 588p. 1996. p.13
2000 France Culture, Concordance des temps : La parisienne : splendeurs et misères. 1er février 2020
2001 Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Garnier Flammarion. 512p. 1967. p.384, 481, 482, 486, 505
2002 Correspondance de Gustave Flaubert. Lettres à Louise Colet. 1846-1851. Société coopérative éditions Rencontre. Lausanne. 583p. 1964. p.37
2003 Jules Michelet, Histoire de la Révolution française I. La Pléiade. 1530p. 1976. p.1146
2004 George Sand, Correspondance. Georges Lubin. Classiques Garnier. Tome XVIII. 761p. 1984 p.585
2005 Léon Tolstoï, La guerre et la paix. La Pléiade. Traduction de Pierre Pascal. 1945. 1654 p.
2006 Émile Zola, Thérèse Raquin. Garnier Flammarion. 253p. 1970. p.162
2007 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. IV. L’oeuvre. La Pléiade. 1806p. 1967. p.242
2008 Œuvres de Daniel Stern, Esquisses morales : pensées, réflexions et maximes. Calmann Lévy. 396p. 1880. p.139, 140 (Lisible sur Gallica)
2009 Anton Tchékhov, La princesse. In : Œuvres. II. La Pléiade. 1021p. 1970. p.671, 672
2010 Anton Tchékhov, Récit d’un inconnu. In : Œuvres. III. La Pléiade. 1033p. 1971. p.179
2011 Jack London, L’île des lépreux. Suivi du Journal de bord du ‘Snark’. 10/18. 346p. 1979. p.193
2012 In : Paroles de femmes (Sous la direction de Jean-Pierre Guéno) Radio France. 157p. 2007. p.42, 43
2013 Jacques Prévert, Intermède. In : Œuvres complètes. I. La Pléiade. 1452p. 1992. p.381
2014 Marie Métrailler, Marie-Magdeleine Brumagne, La poudre de sourire. L’Âge d’homme. 223 p. 1987. p.23
2015 Ivy Compton-Burnett. Serviteur et servante. L’Age d’homme. 1988. 227p. p.44
2016 Entendu sur TV5 Monde ou France 24 dans une retransmission d’un reportage le concernent du Journal télévisé canadien en français (4 ou 5 mars 2017)
2017 Jean-Jacques Rousseau, Lettres à Malesherbes. In : Œuvres complètes. I. La Pléiade. 1969p. 1986. p.1143
2018 Hillary Clinton, Mon histoire. J’ai lu. 702p. 2004. p.352
2019 Libération, 7 avril 2012
2020 20 minutes, Bois-Colombes : Un chauffeur de VTC fauche deux femmes et une poussette. 30 août 2016
2021 Honoré de Balzac, La femme de trente ans. Garnier-Flammarion. 242p. 1965. p.143
2022 Elena Ferrante, L’enfant perdue. Folio. Gallimard. 619p. 2018. p.288
2023 Honoré de Balzac, Le père Goriot. Librairie Joseph Gilbert. 249p. (sans date). p.126
2024 Roland Barthes, Œuvres complètes. Tome II. Le Seuil. 1995. p.735
2025 Source : Institut Professeur Beaulieu. Biographie
2026 Charles Dickens, David Copperfield. Le livre de poche. Classique. 1024p. 2008. p.487
2027 Charles de Gaulle, Mémoires. La Pléiade. 1505p. 2000. p.1056
2028 Soljenitsyne, L’Archipel du goulag. Tome II. 505 p. 1974. p.281
2029 Conférence de presse de M. Attali présentant son rapport sur la libéralisation de l’économie française à Sarkozy. 23 janvier 2008
2030 Public Sénat. 3 août 2017
2031 Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Garnier Flammarion. 512p. 1967. p.360
2032 Le Point, Ces biens pensants qui veulent nous rééduquer. Les nouveaux puritains. Titre du n°2226. 7 mai 2015
2033 Françoise Verny, Le plus beau métier. Olivier Orban. 459p. 1990. p.42
2034 Sud-Ouest, Jacques Chirac, Les confidences bouleversantes de son dernier compagnon de route. 4 octobre 2017
2035 Jules Roy, Mémoires barbares. Le livre de poche. 697p. 1989. p.239
2036 France Culture, Archives Colette, Changements de décors. Agnès Jaoui. 26 janvier 2014
2037 Le Monde Diplomatique, Afrique. décembre 2018. p.24
2038 France Culture, Les cours du Collège de France. 20, 21 mars 2020
2039 Voltaire, Correspondance. IV. (janvier 1754-décembre 1757). La Pléiade. 1655p. 1978. p.4
2040 Voltaire, Correspondance. VI. (octobre 1760-décembre 1762). La Pléiade. 1648p. 1980. p.803, 1454
2041 Site Tout Voltaire, Questions sur l’Encyclopédie. F-L. Voltaire Foundation University of Oxford
2042 Wilhelm von Humboldt, Journal parisien. 1797-1799. Honoré Champion. 417p. 2013. p.151
2043 In : Actes du tribunal révolutionnaire, Le Temps retrouvé. Mercure de France. 637p. 2008. p.197
2044 In : Jean Copans, Jean Jamin, Aux origines de l’anthropologie française. Les mémoires de la société des Observateurs de l’Homme en l’an VIII, Le Sycomore. 230p. 1978. p.157
2045 Honoré de Balzac, Le message. La Pléiade. La comédie humaine. II. 1172p. 1951. p.180
2046 Michelet, Jeanne d’Arc. Folio. Classique. Gallimard. 318p. 1998. p.49
2047 George Sand, Histoire de ma vie. In : Œuvres autobiographiques. I. La Pléiade. 1470p. 1970. p.784
2048 George Sand, Correspondance. Georges Lubin. Classiques Garnier. Tome XV. 964p.1981. p.163
2049 George Sand, Correspondance. Georges Lubin. Classiques Garnier. Tome XVIII. 761p. 1984 p.296
2050 George Sand, Correspondance. Georges Lubin. Classiques Garnier. Tome XXII. 868p. 1987. p.406, 558
2051 Léon Tolstoï, Journaux et Carnets. I. (1847-1889). La Pléiade. 1451p. 1979. p.380
2052 Émile Zola, Germinal. Fasquelle. Le livre de poche. 503p. 1969. p.419
2053 Mémoires, souvenirs et journaux de la Comtesse d’Agoult [Daniel Stern]. Tome I. Mercure de France. 430p. 1990. p.140
2054 Friedrich Nietzsche, Mauvaises pensées choisies. Tel. Gallimard. 612p. 2002. p.178
2055 Kafka, Journaux et lettres. 1897-1914. La Pléiade. 1583p. 2022. p.120
2056 Alexandra David-Neel, Correspondance avec son mari. Édition intégrale. 1904-1941. Plon. 943p. 2001. p.513
2057 Emma Goldman, Vivre ma vie. Une anarchiste au temps des révolutions. L’échappée. 1095p. 2018. p.45, 46, 85
2058 Michel Leiris, L’âge d’homme, précédée de L’Afrique fantôme. La Pléiade. 1387p. 2014. p.158, 180
2059 Paul Léautaud, Journal littéraire. Choix de pages. Folio. Mercure de France. 1304p. 2013. p.700
2060 Doris Lessing, Les enfants de la violence. Le livre de poche. 918p. 1978. p.438
2061 Doris Lessing, Les enfants de la violence. La cité promise. Le livre de poche. 915p. 1981. p.383
2062 Nina Berberova, C’est moi qui souligne. Actes Sud / Labor / L’aire. 609p. 1990. p.495
2063 Elsa Morante, La storia. France loisirs. 612p. 1978. p.287
2064 Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées. Robert Laffont. Le livre de poche. 512p. 1976. p.333
2065 Femmes et Russie. 1980. Par le collectif de rédaction de l’Almanach et quelques autres. Des femmes. 217p. 1980. p.86
2066 Dominique Desanti, La femme au temps des années folles. Le livre de poche. 447p. 1984. p.98
2067 In : Dany Cohn-Bendit, Nous l’avons tant aimée, la révolution. Le Seuil. Points Actuels. 254p. 1988. p.192
2068 Roselyne Bachelot, Geneviève Fraisse, Deux femmes au royaume des hommes. Hachette Littérature. 304p. 1999. p.119
2069 Françoise d’Eaubonne, Mémoires irréductibles. Éditions Dagorno. 1135p. 2001. p.649, 712
2070 Judith C., À 16 ans, aux premières réunions du MLF. In : Génération MLF [1968-2008]. Des Femmes. Antoinette Fouque. 615p. 2008. p.34
2071 In : Victor Hugo, Choses vues. 1849-1885. Folio. Classique. Gallimard. 1014p. 2010. p.1003
2072 Elena Ferrante, Le nouveau nom. Folio. Gallimard. 623p. 2016. p.404
2073 Europe 1, Une entreprise britannique autorise les congés pour règles douloureuses. 5 mars 2016. Suite à article publié par Bristol Post, Bristol company to introduce ‘period policy’ for female staff. 29 février 2016
2074 Slate.fr, Poutine n’a pas besoin de jours de congés, car il n’a pas ses règles. 7 juin 2017
2075 France Culture, La méthode scientifique. Endométriose, Une maladie méconnue.15 janvier 2018
2076 France Culture, 28 mai 2019. 07h 35
2077 Le Monde, Gisèle Halimi. ‘J’avais en moi une force sauvage, une rage, je voulais me sauver. 22-23 septembre 2019
2078 Gouv. fr. Gratuités des protections périodiques pour les étudiantes. 24 février 2021
2079 France Culture, Répliques. La question trans. 11 septembre 2021
2080 Céline, Londres. Folio. 597p. 2022 et 2023. p.58
2081 Ekaterina Olitksaïa, Le sablier. Les éditions du bout de la ville. 656p. 2024. p.327, 328
2082 Ekaterina Olitksaïa, Le sablier. Les éditions du bout de la ville. 656p. 2024. p.469, 473, 474
2083 Ekaterina Olitksaïa, Le sablier. Les éditions du bout de la ville. 656p. 2024. p.576
2084 Œuvres de Sainte Thérèse, traduites sur les manuscrits originaux par le P. Marcel Bouix, de la compagnie de Jésus. 6ème édition, Tome II. In : Le livre des fondations. Paris. Librairie Victor Lecoffre. 515p. 1884. p.49 à 502
2085 Marivaux, La vie de Marianne. Gallimard. Folio Classique. 778 p. 2014. p.535, 762
2086 Voltaire, Correspondance. IX. (juillet 1767- septembre 1769). La Pléiade. 1601p. 1985. p.548, 549
2087 Honoré de Balzac, La duchesse de Langeais. La Pléiade. La comédie humaine. V. 1154p. 1949. p.125, 132
2088 Balzac, Mémoires de deux jeunes mariées. In : La comédie Humaine. I. La Pléiade. 1065p. 1951. p.129, 130
2089 Victor Hugo, Les misérables. La Pléiade. 1805p. 1951. p.246
2090 Victor Hugo, Les misérables. La Pléiade. 1805p. 1951. p.247
2091 Journal de l’abbé Mugnier. 1879-1939. Le Temps retrouvé. Mercure de France. 639p. 2007. p.510
2092 Paul Claudel, Journal. II. La Pléiade. 1360p. 1969. p.811
2093 Ménie Grégoire, Telle que je suis. Robert Laffont. 359p. 1976. p.128, 129, 130
2094 Wikitionnaire, 10 mai 2015
2095 Stendhal, Correspondance. 1800-1821. I. La Pléiade. 1637p. 1962. p.93, 128
2096 Françoise Giroud, Une femme honorable. (Marie Curie) Fayard. 381p. 1981. p.220
2097 Suzanne Maudet, Neuf filles jeunes qui ne voulaient pas mourir. Arléa. 136p. 2004. p.73, 74
2098 Mille Visages, un seul combat. Les femmes dans la Résistance. Témoignages recueillis par Simone Bertrand. Les Éditeurs Français Réunis. 166p. 1974. p.61, 62
2099 Samira Bellil, Dans l’enfer des tournantes. Folio. Denoël. 308p. 2003. p.113
2100 Guide des Jeunes Ménages. Éditions R. Girard &Cie. 224p. s. d (début années 1960) p.166
2101 Françoise d’Eaubonne, Mémoires irréductibles. Éditions Dagorno. 1135p. 2001. p.428
2102 France Culture, Agnès Varda : ‘On est ouvert au hasard et le hasard apporte les choses’. 7 août 2017
2103 Victor Hugo, Les misérables. La Pléiade. 1805p. 1951. p.920
2104 Léon Tolstoï, La guerre et la paix. La Pléiade. Traduction de Pierre Pascal. 1654 p. 1945. p.822 (Livre 3)
2105 L’Humanité, Annie Ernaux : ‘J’ai toujours été persuadée que rien n’était jamais gagné pour les femmes’. 3 février 2014
2106 Raymond Aron, Le spectateur engagé, Julliard. 339p. 1981. p.148
2107 Elisabeth Schwarzkopf, Les autres soirs. Mémoires. Tallandier. 367p. 2004. p.67, 71
2108 France Culture, George Simenon, 11 novembre 2019
2109 Rousseau, Julie, ou la Nouvelle Héloïse. Garnier Flammarion. 1967. 610p. note. p.134
2110 John Dos Passos, Sur toute la terre. Union soviétique, Mexique, Espagne, etc…. NRF. Gallimard. 223p. 1936. p.24, 25
2111 Catherine Paysan, Nous autres, les Sanchez. Éditions Denoël. 215p. 1962. p.15
2112 Arte, Jardins d’ici et d’ailleurs. Muskau. 12 mai 2016
2113 Ferdinand Brunetière, Évolution des genres dans l’histoire de la littérature. 1890. Réédité. Pocket. 287p. 2000. p.142
2114 Voltaire, Correspondance. IV. (janvier 1754-décembre 1757). La Pléiade. 1655p. 1978. p.13
2115 Marie-Claire, Rencontres. mars 2016. p.103 à 106
2116 George Sand, Entretiens journaliers. In : Œuvres autobiographiques. II. La Pléiade. 1638p. 1972. p.999
2117 George Sand, Correspondance. Georges Lubin. Classiques Garnier. Tome XVIII. 761p. 1984 p.628, 629
2118 AFP, Arabie : des Saoudiennes revendiquent le droit de participer au scrutin des municipales. 24 avril 2011
2119 Le Canard enchaîné, C’est Saoud Rien. 22 mars 2017. p.5
2120 Jules Renard, Journal. La Pléiade. 1434p. 1965. p.14
2121 In : Alexandre Dumas, Lettres à mon fils. Le Temps retrouvé. Mercure de France. 408p. 2008. p.82
2122 Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions. Autres œuvres autobiographiques. In : Œuvres complètes. I. La Pléiade. 1969p. 1986. p.190
2123 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. III. Au bonheur des dames. La Pléiade. 1958p. 1964. p.657
2124 János Székely, L’enfant du Danube. Folio. Gallimard. 854p. 2020. p.87
2125 Marcel Bernos, Femmes et gens d’Église dans la France classique. XVII-XVIIème siècle. CERF. 404p. 2003. p.191
2126 In : France Culture, À voix nue, Roger Planchon. 16 janvier 2022. [1ère diffusion. 11 octobre 1989]
2127 George Sand, Lélia. Texte établi, présenté et annoté par Pierre Reboul. Classiques Garnier. 601p. 1093. p.17
2128 Victor Hugo, Les misérables. La Pléiade. 1805p. 1951. p.180
2129 Léon Tolstoï, La guerre et la paix. La Pléiade. Traduction de Pierre Pascal. 1654 p. 1945. p.284 (Livre 1)
2130 Émile Zola, Au bonheur des dames. Garnier Flammarion. 442p. 1971. p.164
2131 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. IV. L’œuvre. La Pléiade. 1806p. 1967. p.29
2132 Anne Delbée, Une femme. Presses de la Renaissance. 497p. 1988. p.153
2133 Nina Berberova, C’est moi qui souligne. Actes Sud / Labor / L’aire. 609p. 1990. p.369, 370
2134 Source à retrouver
2135 Shakespeare, Le conte d’hiver. Acte I. Scène II
2136 Eric Hobsbawm, Franc-tireur. Autobiographie. Ramsay. 521p. 2005. p.413, 414, 415
2137 France Culture, Grand angle : Les soignants au cœur des années sida. 7 janvier 2018 [1ère diffusion. 28 novembre 1992]
2138 Rapport de la Commission d’enquête sur l’état des connaissances scientifiques et les actions menées à l’égard de la transmission du sida. 10/18. 559p. 1993. p.344, 345, 346
2139 Michèle Barzach, Vérités et tabous. Le Seuil. 213p. 1994. p.128
2140 Catherine Kapusta-Palmer, In : Entretiens avec Cathy-France Ziouar et Hélène Cardin, Dix femmes contre le sida. Éditions Autrement. 143p. 2014. p.101
2141 Docteur Karine-Lacombe, In : Entretiens avec Cathy-France Ziouar et Hélène Cardin, Dix femmes contre le sida. Éditions Autrement. 143p. 2014. p.84, 85
2142 Daniel Defert, Une vie politique. Éditions du Seuil. 364p. 2014. p.108, 126, 128,132
2143 Franceinfo. 1Er décembre 2019
2144 Cf. notamment, Les Temps Modernes, mars-avril 1991. n° 536-537. Hugues Lagrange, Un gramme cinq de latex ? Les hétérosexuels face au risque du sida et la prévention. p.117 à 145
2145 In : Jean-Paul Aron, Les modernes. Gallimard. 314p. 1984. p.140
2146 In : Nouvelles du XVIIIème siècle. La Pléiade. 1552p. 2002. p.680
2147 George Sand, Correspondance. Tome IX. Garnier Flammarion. 1020p. 1972. p.40
2148 Albert Camus, Camus et le camp soviétique. Actuelles II. In : Essais. La Pléiade. 1975p. 1965. p.1784
2149 Svetlana Alexievitch, La guerre n’a pas un visage de femme. J’ai lu, 415p. 2016. p.177
2150 In : Femmes savantes. De Margueritte de Navarre à Jacqueline de Romilly. Les Belles Lettres. 388p. 2020. p.210
2151 In : Georges Solovieff, Madame de Staël, Ses amis, ses correspondants. Choix de lettres [1778-1817]. Éditions Klincksieck. 586p. 1970. p.330
2152 Benjamin Constant, Journal Intime (1811-1816). In : Œuvres complètes. VII. Max Niemeyer Verlag. Tübingen. 731p. 2005. p.213
2153 France Culture, La grande Table. Rentrée littéraire, Sophie Fontanel. 23 août 2017
2154 Michèle Le Dœuff, Le sexe du savoir. Champs. Flammarion. 378p. 2000. p.140
2155 George Sand, Correspondance. George Lubin. Garnier Flammarion. Tome IX. 1020 p. 1972. p.49
2156 Évelyne Bloch-Dano, Flora Tristan. Une femme libre. Grasset. Le livre de poche. 442p. 2018. p.324
2157 Le Monde, Rossy De Palma. ’Je crois en la force de la sororité’. 15-16 avril 2018
2158 Stendhal, Le rouge et le noir. Le livre de poche. Classiques de poche. 577p. 2009. p.23
2159 Stendhal, Le rouge et le noir. Le livre de poche. Classiques de poche. 577p. 2009. p.132, 133
2160 In : Nicolas Gogol, Nouvelles de Pétersbourg. GF Flammarion. 282p. 2009. p.143
2161 Lettres de Mademoiselle de Lespinasse. Précédées d’une notice de Sainte-Beuve. Classiques Garnier. 4324p. s. d. p.311
2162 Germaine de Staël, Correspondance générale. Tome VII. Champion. Slatkine. 645p. 2008. p.18
2163 Stendhal, Œuvres intimes. I. La Pléiade. p.931, 568, 627, 173
2164 In : Bianca Lamblin, Mémoires d’une jeune fille dérangée. Balland. 207p. 1993. p.128
2165 Marivaux, La vie de Marianne. Gallimard. Folio Classique. 778 p. 2014. p.484
2166 Charles de Gaulle, Mémoires. La Pléiade. 1505p. 2000. p.134, 1251
2167 Charles de Gaulle, Mémoires. La Pléiade. 1505p. 2000. p.759, 760, 761
2168 George Valence, Poincaré. Fin de l’Avant-Propos. Perrin. 2017
2169 Jeannette Laot, Stratégie pour les femmes. Stock. 250p. 1977. p.72
2170 Jean-Marie Déguignet [1834-1905], Mémoires d’un paysan Bas-breton. An Here. Pocket. 469p. 2000. p.261
2171 Honoré de Balzac, Illusions perdues. Garnier frères, 876p. 1961. p.567
2172 Léon Tolstoï, Anna Karénine. Résurrection. La Pléiade. 1630p. 1951. p.746
2173 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. I. La fortune des Rougon. La Pléiade. 1709p. 1960. p.44, 47, 1551
2174 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. III. Pot-Bouille. La Pléiade. 1958p. 1964. p.60, 61
2175 Doris Lessing, Les enfants de la violence. Le livre de poche. 918p. 1978. p.775
2176 William Makepeace Thackeray, Barry Lyndon. Garnier Flammarion. 444p. 2019. p.268, note. p.276
2177 In : Michèle Le Dœuff, L’étude et le rouet. Éditions du Seuil. 379p. 1989. p.341
2178 In : Pour Gabrielle, par Raymond Jean. In : Gabrielle Russier, Lettres de prison. Points. Actuels. Le Seuil. 140p. 1970. p.13
2179 Paul Léautaud, Journal littéraire. Choix de pages. Folio. Mercure de France. 1304p. 2013. p.1052
2180 Michel Leiris, Journal. 1922-1989. Quarto. Gallimard. 1052p. 2020. p.475
2181 In : Jean-Paul Sartre, Situations. I. février 1938-19 septembre 1944. NRF. Gallimard. 412p. 2010. p.368, 369
2182 Paroles de femmes (Sous la direction de Jean-Pierre Guéno), Radio France. 157p. 2007. p.60
2183 France Culture, À voix nue. Jean Rochefort. 9 octobre 2017 [1ère diffusion. 2 janvier 2012]
2184 Georgette Elgey, La fenêtre ouverte. Récit. Fayard. 218p. 1973. p.208
2185 France Culture, Super-résistant ou la guerre qui fait rire ensuite, diptyque de la guerre en fiction. 22 décembre 2021
2186 Honoré de Balzac, Illusions perdues. Garnier frères, 876p. 1961. p.555
2187 Louis-René Villermé, Tableau de l’état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton de laine et de soie. Études et documentation internationales. 670p. 1989. p.495
2188 In : George Sand, Correspondance. Georges Lubin. Classiques Garnier. Tome XV. 964p. 1981. note 1. p.589
2189 Victor Hugo, Les misérables. La Pléiade. 1805p. 1951. p.308
2190 Claudine Rey, Annie Gayat, Sylvie Pepino, Petit Dictionnaire des femmes de la Commune. Les oubliées de l’histoire. Les amies et amis de la commune de Paris. 1871. 2018. 302p.
2191 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. IV. L’oeuvre. La Pléiade. 1806p. 1967. p.248
2192 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. IV. La terre. La Pléiade. 1806p. 1967. p.417, 422, 427,435
2193 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. IV. La terre. La Pléiade. 1806p. 1967. p.568
2194 Anton Tchékhov, La vieille maison. In : Œuvres. II. La Pléiade. 1021p. 1970. p.328
2195 Léon Tolstoï, Journaux et Carnets. I. (1847-1889). La Pléiade. 1451p. 1979. p.936
2196 Jules Renard, Journal. La Pléiade. 1434p. 1965. p.304, 305
2197 Kafka, Journaux et lettres. 1897-1914. La Pléiade. 1583p. 2022. p.225, 226, 1385
2198 André Gide, Journal. 1889-1939. La Pléiade. 1378p. 1948. p.739, 743, 764
2199 André Gide, Voyage au Congo. In : André Gide, Journal. 1939-1949. Souvenirs. La Pléiade. 1280p. 1954. p.739, 743, 767
2200 André Gide, Journal. 1889-1939. La Pléiade. 1378p. 1948. p.838, 839
2201 Clara Malraux, Nos vingt ans. Grasset. 282p. 1966. p.197
2202 Paul Léautaud, Journal littéraire. Choix de pages. Folio. Mercure de France. 1304p. 2013. p.531
2203 Gaston Pelletier et Louis Roubaud, Images et réalités coloniales. Éditions André Tournon. 1931. 403p.
2204 Louis Roubaud, La prison de velours. Collection Succès. Gallimard, 1934. 254p. p.233 à 235
2205 Léon Tolstoï, Polikouchka. In : Souvenirs et récits. La Pléiade. 1591p. 1960. p.866
2206 Christine Ockrent, La mémoire du cœur. Fayard. 320p. 1997. p.301, 302
2207 In : Studs Terkel, Race. Histoires orales d’une obsession américaine. Éditions Amsterdam. 560p. 2010. p.84
2208 Françoise Baranne, Le couloir. Une infirmière au pays du sida. Folio. Actuel. Gallimard. 165 p. 1995. p.67, 68, 105
2209 Ekaterina Olitksaïa, Le sablier. Les éditions du bout de la ville. 656p. 2024. p.408
2210 Charlotte Brontë, Jane Eyre. Pocket. 761p. 2015. p.279
2211 Honoré de Balzac, Les paysans. La Pléiade. La comédie humaine. VIII. 1041p. 1949. p.214
2212 Jack London, Martin Eden. 10/18. 447p. 1973. p.412, 413
2213 Richard Llewellyn, Quelle était verte ma vallée. Le livre de poche. 1965. 498p. p.159
2214 Elena Ferrante, L’enfant perdue. Folio. Gallimard. 619p. 2018. p.304
2215 In : Le Canard enchaîné, Consomme et tais toi ! 5 août 2020. p.6
2216 Marlène Dietrich, Marlène D. Le livre de poche. 319p. 1984. p.16
2217 Marivaux, La vie de Marianne. Gallimard. Folio Classique. 778 p. 2014. p.455
2218 In : Lettres de femmes du XIXème siècle. Choisies et présentées par la comtesse Jean de Pange. Éditions du Rocher. Monaco. 252p. 1947. p.116
2219 Stendhal, La chartreuse de parme. I. Garnier Frères. 334p. 1925. p.144
2220 Balzac, Mémoires de deux jeunes mariées. In : La comédie Humaine. I. La Pléiade. 1065p. 1951. p.143
2221 George Sand, Correspondance. Georges Lubin. Classiques Garnier. Tome XXII. 868p. 1987. p.603
2222 Louis Guilloux, Le sang noir. Folio. Gallimard. 631p. 1982. p.222
2223 Henri Pierre, La vie quotidienne à la Maison Blanche au temps de Reagan et de George Bush. 1990. 328p. Hachette. p.82
2224 Françoise Giroud, La rumeur du monde. Le livre de poche. Arthème Fayard. 284p. 1999. p.194
2225 Elena Ferrante, L’enfant perdue. Folio. Gallimard. 619p. 2018. p.319
2226 La Pravda. 14 août 1923. In : Pierre Broué, Trotsky. Fayard. 1105 p.1988. p.435
2227 Honoré de Balzac, Splendeurs et misères des courtisanes. La Pléiade. La comédie humaine. V. 1154p. 1949. p.1087
2228 Arundhati Roy, Le Ministère du Bonheur Suprême. Folio. Gallimard. 554p. 2018. p.393, 394
2229 BBC, Les ‘femmes valises’, un trait entre l’Angola et le Brésil. 20 septembre 2017
2230 France Culture, Les agricultrices se rebellent. 2 juin 2023
2231 Voltaire, Correspondance. IX. (juillet 1767-septembre 1769). La Pléiade. 1601p. 1985. p.342
2232 Voltaire, Correspondance. XI. (juillet 1772-décembre 1774). La Pléiade. 1411p. 1986. p.509
2233 Mémoires d’une femme de qualité sous le Consulat et l’Empire. Le Temps retrouvé. Mercure de France. 578 p. 2004. p.47
2234 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. III. Pot-Bouille. La Pléiade. 1958p. 1964. p.239
2235 Émile Zola, Au bonheur des dames. (Retrouver la page)
2236 Louise Michel, Mémoires. Préface de Xavière Gauthier. 582p. Éditions Tribord. 2005. p.125
2237 Jean-Claude Brialy, Le ruisseau des singes. Pocket. Robert Laffont. 510p. 2001. p.269, 271
2238 Jean Tulard, Guide des films. 1895-1995. Édition du centenaire du cinéma. L.Z. 1479p. 1995. p.663, 667, 717, 900, 1074
2239 In : Voltaire, Correspondance. II. (janvier 1739-décembre 1748). La Pléiade. 1814p. 1977. p.37
2240 In : (sans page) présentation par Gabriel Compayré de Fénelon de l’édition électronique de l’Institut Français d’Éducation
2241 Adam Smith, Théorie des sentiments moraux. Quadrige PUF. 469p. 2010. p.230, 241
2242 Alexis de Tocqueville, Voyages en Angleterre et en Irlande. Idées, Gallimard. 372p. 1967. p.206
2243 Lacenaire, Mémoires. José Corti. 390p. 1991. p.89
2244 Michel Foucault, Dits et écrits. 1954-1988. II. 1976-1988. Quarto. Gallimard. 1735p. 2001. p.1100
2245 In : Honoré de Balzac, La comédie humaine. XII. La Pléiade. 1972p. 1981. p.598
2246 Voltaire, Correspondance. VI. (octobre 1760-décembre 1762). La Pléiade. 1648p. 1980. note 4. p.1517
2247 In : Nouvelles du XVIIIème siècle. La Pléiade. 1552p. 2002. p.717
2248 Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social. Garnier Flammarion. 187p. 1966. p.12
2249 Souvenirs de Félicie L***, In : La fabrique de l’intime. Mémoires et journaux de femmes au XVIIème siècle. Bouquins. Robert Laffont. 1192p. 2013. p.446
2250 In : Entrer dans la vie. Naissances et enfances dans la France traditionnelle. Collection Archives, Gallimard. Julliard. 246 p. 1978. p.48
2251 Honoré de Balzac, Le père Goriot. Libraire Joseph Gilbert. 249p. (sans date). p.11
2252 Jules Michelet, Histoire de la Révolution française I. La Pléiade. 1530p. 1976. p.162
2253 Jules Michelet, Histoire de la Révolution française I. La Pléiade. 1530p. 1976. p.462, 463
2254 George Eliot, Adam Bede. Archipoche. 783p. 2022. p.160
2255 Léon Tolstoï, La guerre et la paix. La Pléiade. Traduction de Pierre Pascal. 1654p. 1945. p.898 (Livre 3)
2256 Émile Zola, Au bonheur des dames. Garnier-Flammarion. 442p. 1971. p.59
2257 Alexandra David-Neel, Correspondance avec son mari. Édition intégrale. 1904-1941. Plon. 943p. 2001. p.118
2258 Lou Andrea Salomé, Correspondance avec Sigmund Freud. 1912-1936. Suivi du Journal d’une année. 1912-1913. Gallimard. Connaissances de l’inconscient. 487p. 1970. p.299
2259 Jacqueline de Romilly, Jeanne. Le livre de poche. 259p. 2012. p.49, 50
2260 Eric Hobsbawm, Franc-tireur. Autobiographie. Ramsay. 521p. 2005. p.31
2261 Ivy-Compton-Burnett, Frères et sœurs. L’Age d’homme. 249p. 1983. p.163
2262 Louis Guilloux, Carnets. 1921-1944. Gallimard. 414p. 1978. p.105
2263 Charles de Gaulle, Mémoires. La Pléiade. 1505p. 2000. p.89
2264 Lettres de Thomas Mann (1943-1947). Gallimard. 416p. 1970. p.11, 348
2265 Jean Guitton, Œuvres complètes. Journal de ma vie. Desclée de Brouwer. 747p. 1976. p.154
2266 Fabrizio Calvi, La vie quotidienne de la mafia de 1950 à nos jours. Le Livre de poche. 382p. 1986. p.27
2267 Eric Hobsbawm, Franc-tireur. Autobiographie. Ramsay. 521p. 2005. p.239
2268 Claude Roy, Nous. Folio. Gallimard. 564p. 1980. p.377 à 379
2269 France Culture, Affaires sensibles. Liévin, 27 décembre 1974. Quand la mine assassine. 25 juin 2015
2270 Marthe Massenet, Madame Veuve. Elles-mêmes. Stock. 193p. 1977. p.51
2271 Madeleine Renaud, La déclaration d’amour. Éditions du rocher. 132p. 2000. p.23
2272 Marie Métrailler, Marie-Magdeleine Brumagne, La poudre de sourire. L’Age d’homme. 223p. 1987. p.14
2273 Gilles Perrault, Notre ami, le roi. Gallimard. 367p. 1990. p.61
2274 Lucienne Mazenod, Ghislaine Schoeller, Dictionnaires des femmes célèbres. De tous les temps et des tous les pays. Bouquins. Robert Laffont. 932p. 1992. p.753
2275 Marcel Bernos, Femmes et gens d’Église dans la France classique. XVII-XVIIème siècle. CERF. 404p. 2003. p.174, 175
2276 Melania G. Marzzucco. Vita. Flammarion. 438p. 2004. p.261
2277 France Culture, Victorine, la vieille Bretonne. 6 août 2020 [1ère diffusion. 20 octobre 2005]
2278 France Culture, Oskar Kokoschka, un terrifiant prodige. 9 octobre 2022
2279 Louis Jouvet, dans Copie conforme
2280 France Culture, La musique at elle un genre ? 11 février 2019
2281 Charles Dickens, David Copperfield. Le livre de poche. Classique. 1024p. 2008. p.709
2282 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. III. La joie de vivre. La Pléiade. 1958p. 1964. p.1080
2283 Anne-Thérèse de Lambert, Traité de la vieillesse. (1732) (sans autre source) In : Régine Deforges, Les cent plus beaux cris de femmes. Anthologie. Le Cherche midi Éditeur. 251p. 1980. p.120
2284 Le Figaro, Valérie Trierweiler au chevet des femmes violées du Congo-Kinshasa. 11 juillet 2013
2285 Élisabeth Vigée-Lebrun, Souvenirs. I. Une édition féministe de Claudine Herrmann. Des Femmes. 360p. 1984. p.185, 186
2286 Léon Tolstoï, Journaux et carnets. III. (1905-1910). La Pléiade. 1368p. 1985. p.862
2287 Arthur London, L’aveu. Dans l’engrenage du procès de Prague. Gallimard. 455p. 1968. p.210
2288 In : Préface d’Élisabeth Schemla, Khalida Messaoudi, Une Algérienne debout. Flammarion. 214p. 1995. p.11
2289 Ryszard Kapuściński, Imperium. 10/18. 340p. 1999. p.82
2290 Catherine Clément, Mémoire. Champs. Flammarion. 588p. 2010. p.427
2291 Michèle Le Dœuff, Le sexe du savoir. Champs. Flammarion. 378p. 2000. p.207
2292 Esprit, Hughes Lagrange. Impressions du Caire. janvier 2012
2293 In : Le Canard enchaîné, Christiane Taubira. L’évangile selon syntaxe. 12 janvier 2022. p.7
2294 France Culture, L.S.D. Heureuse comme une arabe en France. 29 mai 2019
2295 France Culture, Répliques. 14 novembre 2020
2296 France Culture, Répliques. La question trans. 11 septembre 2021
2297 France Culture, Les cours du Collège de France. Christine Goémé interroge Carlo Ossola. 7 février 2022 [1ère diffusion. 10 mars 2016]
2298 Émile Zola, Les Rougon-Macquart. III. Au bonheur des dames. La Pléiade. 1958p. 1964. p.673
2299 Note précise à retrouver
2300 France Culture, Une vie, une œuvre. Althusser, un marxiste imaginaire. 5 décembre 2015
2301 Mary Astell, Some reflections upon mariage. 1706. Quotes from the work of Mary Astell Excerpts from Astell's work
2302 Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social. Folio. Essais. Gallimard. 535p. 1993. p.111
2303 Honoré de Balzac, Lettres à Madame Hanska. I. 1832-1844. Bouquins. Robert Laffont. 957p. 1990. p.135
2304 Honoré de Balzac, Mémoires de deux jeunes mariées. In : La Comédie humaine. I. La Pléiade. 1065p. 1951. p.170
2305 Honoré de Balzac, La cousine Bette. Éditions Garnier frères. 496p. 1974. p.56 (Erreur)
2306 Arte, 11 août 2013. 11h 57
2307 Film. GREC, Sophie Leys, Une vie dans la journée d’Albert Cossery. 2005
2308 Alexandra David-Neel, Correspondance avec son mari. Édition intégrale. 1904-1941. Plon. 943p. 2001. p.392
2309 Odile Dhavernas, Petite sœur née, prépare suicide. Seuil. 157p. 1981. p.121
2310 In : Denis Diderot, Œuvres. La Pléiade. 1470p. 1951. p.794
2311 Fiodor Dostoïevski, L’adolescent. Folio. Classique. Gallimard. 649p. 2023. p.459
2312 George Eliot, Felix Holt, le radical. Folio. Classique. Gallimard. 2021. 801p. p.606
2313 France Culture, Répliques. 23 avril 2016
2314 Gustave Flaubert, Correspondance. IV. (janvier 1869-décembre 1875). La Pléiade. 1484p. 1997. p.138
2315 Hannah Arendt, Rahel Varnhagen. La vie d’une juive allemande à l’époque du romantisme. Tierce. Littérales II. 382p. 1986. p.114
2316 France Culture, Valérie Lang lit les écrits d’Alberto Giacometti. 10 octobre 2012. 19h 58
2317 Michel Leiris, Journal. 1922-1989. Quarto. Gallimard. 1052p. 2020. p.483
2318 Journal des Goncourt. Tome IV. 1865-1868. Honoré Champion. 765p. 2019. p.342
2319 Jean de La Bruyère, Les Caractères. Folio. Classique. Gallimard. 505p. 2001. p.73
2320 Jean de La Fontaine, Fables, contes et nouvelles. In : Œuvres complètes. I. La Pléiade. 1544p. 2002. p.184
2321 Gabriel Garcia Márquez, Vivre pour la raconter. Grasset. 572 p. 2007. p.88
2322 Novalis, Œuvres complètes. II. Les Fragments. NRF. Gallimard. 458p. 1975. p.345
2323 Le Monde, Obama : ‘Une partie du monde est sur le point de basculer vers un ordre ancien, plus brutal’. 19 juillet 2018
2324 France Culture, Michel Onfray, Dernier séminaire de la Contre-histoire de la philosophie. 28 août 2015
2325 Antenne 2, Bernard Pivot. Apostrophes.. Et si on parlait des hommes …? 9 janvier 1981
2326 Jacques Prévert, Œuvres complètes. Tome II. La Pléiade. 1553p. 2004. p.870
2327 Antoine François Prévost, Manon Lescaut. Éditions Garnier. 340p. 1967. p.137
2328 Radio Courtoisie. 29 décembre 2017
2329 France Culture, Faut-il brûler les dictionnaires ? 29 octobre 2017. [1ère diffusion. 7 décembre 2016] (vérifier)
2330 Madame de Sévigné, Lettres choisies. Folio. Gallimard. 380p. 1994. p.174
2331 France Culture, Sur les docks, La société de membres de la légion d’honneur. 8 mars 2016
2332 William Makepeace Thackeray, La foire aux vanités, Folio. Classique. Gallimard. 1071p. 2005. p.65